Les années 1947, 1948 et 1949 sont les années où la lutte de classe a été la plus intense, la plus dense, de tout le 20e siècle.
Cela peut paraître étonnant et on pense alors forcément aux années 1936 et 1968, marquées par des grèves d’immense ampleur.
Cependant, ni en 1936 ni en 1968 il n’y a eu de mouvement ouvrier affrontant directement la police.
En 1936, le mouvement de grève et d’occupations d’usine s’est déroulé dans une ambiance bon enfant ; en 1968, ce sont les étudiants qui se sont confrontés aux CRS, en leur faisant face, avec les barricades.
Lors des années 1947, 1948 et 1949, il y a du sang et il y a des morts ; on tire au pistolet de part et d’autre.
Les années 1947, 1948 et 1949 se caractérisent à l’inverse par des ouvriers violents visant explicitement la police et les CRS, et la réponse fut d’ailleurs meurtrière.

Ce n’est pas pour rien que, si ces années sont connues comme turbulentes, leur contenu réel a littéralement « disparu » de l’histoire officielle et même de la gauche « contestataire » ou bien du Parti Communiste Français ayant « révisé » sa propre histoire.
Comment se retrouve-t-on dans une telle situation ?
Il faut remonter un peu en arrière. Le Front populaire a été défensif, face au fascisme. Il en sera de même avec la résistance contre l’occupation et le régime de Vichy.
Dans les deux cas, le Parti Communiste Français a adopté la ligne opportuniste de droite de Maurice Thorez : il faudrait que les communistes soient les « meilleurs élèves » (du Front populaire et de la Résistance), il serait nécessaire de s’aligner sur la « République », forme menant de manière naturelle au socialisme.
Cependant, en mai 1947, le Parti Communiste Français se fait chasser du gouvernement, au grand dam de Maurice Thorez.
Dans un contexte très prononcé de pénuries, la base commençait également à remuer contre la ligne du Parti, qui était de soutenir la reprise de la production, notamment avec la « bataille du charbon ».
Il suffit de voir qu’on passe de 374 000 jours de grève en 1946 à 22,6 millions en 1947, puis 13 millions en 1948.
Ce dernier recul n’est qu’apparent, car on a six millions et demi de grévistes en 1948, contre trois millions en 1947.
On a un mouvement de fond dans les masses et le Parti Communiste Français, qui espérait coûte que coûte rester au gouvernement, est d’ailleurs désarçonné. Cela va se refléter dans le rapport à la CGT, dans l’incapacité à calibrer correctement les grèves.
Cela provoque la défaite historique dans le cadre de cette séquence 1947, 1948, 1949.
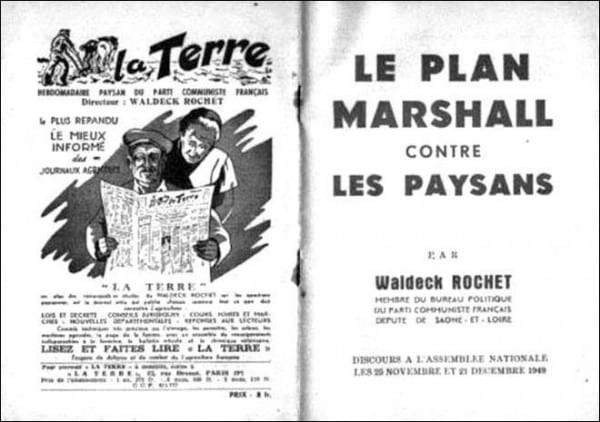
S’ajoute à cela d’une part l’irruption de la « guerre froide » lancée par la superpuissance impérialiste américaine avec le discours de Harry Truman devant le Congrès américain en mars 1947.
Et, d’autre part, il y a la réaction de l’URSS qui relance alors la bataille idéologique.
Le Parti Communiste Français, qui depuis 1945 se présente systématiquement et uniquement comme un parti de gouvernement, se voit obligé d’aller à l’affrontement.
=> retour au sommaire du dossier
sur Le Parti Communiste Français
et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949