Friedrich Engels avait noté que Balzac, un romantique, un réactionnaire, décrivait la réalité tellement méticuleusement, tellement fidèlement, qu’il bascule dans le réalisme.
On a la même chose avec Rêveuse bourgeoisie, publié en 1937, véritable expression de la contradiction au cœur de la quête d’un « socialisme fasciste » par Pierre Drieu La Rochelle.
Sorti alors à grands renforts de publicité, le roman est composé de cinq parties, les trois premières forment un véritable monument, donnant une description d’une minutie on ne peut plus réaliste de l’atroce esprit borné de la bourgeoisie, de la stupidité pragmatique du clergé, de l’arriération de la France profonde, de la corruption caractérisant Paris.
Le niveau de densité psychologique et de nuance dans l’expression sociale représentent une capacité hors-pair d’analyse, résolument marxiste.
Seulement, tout comme chez Balzac, on n’a que la bourgeoisie et pas les masses populaires. Livré à lui-même, l’auteur ne peut que basculer dans le subjectivisme.
Les quatrième et cinquième parties du roman sont par contre d’une nullité effarante. On passe subitement à une autre histoire, celle des enfants du couple décrit dans le roman, sur un ton subjectiviste, raconté d’ailleurs à la première personne du singulier : la fille du couple décrit ses rêves et ses tentatives de se redresser socialement.

Voici un extrait de Rêveuse bourgeoisie où le réalisme est puissant, car porté par l’exigence de porter une grande attention sur toutes les facultés humaines. Il est à noter que le roman a une grande dimension autobiographique, Pierre Drieu La Rochelle y dénonçant les travers de son père, et l’enfant décrit, c’est finalement lui-même.
« Yves et Geneviève, par contrecoup, avaient vivement perçu qu’elle [la mère] s’éloignait d’eux comme de toute la maison.
Était-ce en partie à cause de cela qu’Yves était si inquiet avant chacune de ces sorties dont il se faisait une fête ? Tout le reste du temps, il se considérait comme délaissé et souffrait de son isolement au point d’en pleurer souvent.
Et pourtant chacune de ces sorties était une déception et tournait à la catastrophe. L’enfant avait fini par remarquer la constance de l’événement, il faisait d’immenses efforts pour conjurer le sort fâcheux. Mais c’était en vain, et toujours la journée se déroulait de la même façon.
Ce jour-là, sa mère lui annonça de bonne heure qu’elle le promènerait après le déjeuner. Il eut un premier moment irrésistible de joie.
Mais, d’abord, son père ne rentra pas déjeuner et sa mère s’énerva considérablement à l’attendre. Elle eut des mouvements de mauvaise humeur.
Or, aussitôt que sa mère était en colère, elle devenait laide. Ce phénomène dérangeait cruellement le petit garçon dans les jouissances infinies qu’il tirait de la contemplation du joli visage de sa mère.
Il ne tarissait pas en joyeuses exclamations intérieures quand ce visage se montrait enjoué : à ses yeux enchantés, quelque chose alors rayonnait du front au menton et d’une oreille à l’autre chez la jeune femme, qui faisait valoir chaque trait, les yeux vifs et dévorants de vie, le nez mince aux narines frémissantes, les joues qui recouvraient d’une peau si douce l’arête un peu saillante des pommettes — ce qui faisait un contraste dont Yves n’avait jamais fini d’épier les deux éléments jouant l’un par-dessus l’autre.
Il y avait aussi la bouche. C’étaient des lèvres minces, souples et très rouges, même sans fard.
D’ailleurs Yves n’aimait pas le fard et il aimait ces lèvres au matin, même un peu séchées, craquelées et gercées. Elles étaient encore sinueuses. Leur ligne ourlée, palpitante, peignait si bien la gaieté, l’entrain, l’emportement. Et voilà que ces lèvres se raidissaient, pour soudain se détendre, s’affaisser.
Yves en voulait à sa mère de laisser se perpétuer ce désastre. Cela le déroutait, le bouleversait, le rendait maussade, furieux, vindicatif. Il n’en voulait pas à l’auteur de tout ce désastre, à son père ; il en voulait à la victime qui se laissait ainsi ravager.
Donc Yves fut mécontent dès le déjeuner, et, aussitôt après, il crut bien le montrer en se sauvant de table et en se retirant sans un mot dans sa chambre. Mais sa mère ne le remarqua pas et s’enferma chez elle, l’oeil fixe, murmurant de douloureuses imprécations.
Yves vit dès lors que la journée était perdue, que cette journée de sortie serait lourde de tristesse et de rancune comme les autres.
Déjà il était maussade et il ne cesserait de l’être de plus en plus jusqu’au moment où cette lourdeur deviendrait intolérable aussi bien pour sa mère que pour lui et qu’ils se querelleraient.
Il vit partir sa petite sœur pour les Tuileries et songea à l’accompagner, à renoncer à son privilège. Il en eut tellement peur, et la menace lui semblait telle-ment plus grave que d’habitude, qu’il s’élança dans le cabinet de toilette pour demander pardon à sa mère et lui crier son inquiétude.
Dans sa hâte pour empêcher l’inévitable, il ouvrit impétueusement la porte sans frapper.
Or, sa mère était plongée dans un travail étrangement minutieux. Certes, ce cabinet de toilette était en soi-même un lieu étrange, rempli de secrets qu’Yves essayait vaine-ment de percer quand la jeune femme était absente et qu’il s’y glissait seul et demeurait de longs moments pantelant d’une curiosité angoissée et sans espoir; mais ce travail lui parut d’une étrangeté particulière.
Jamais il n’avait surpris sa mère penchée sur sa glace avec autant de curiosité d’elle-même, approchant d’elle-même une main aussi caressante. Agnès surprise, percée à jour, se retourna tout d’un coup et lui cria dans un de ses accès de subite et terrible violence : — Je te défends d’entrer ici, va-t’en.
Yves qui était entré pour tout sauver vit le mal s’abattre sur lui avec une puissance de fatalité encore inconnue.
Il demeura blanc, hébété, puis il se prit de rage luis aussi contre tant de malencontre. Il se retourna tout d’une pièce pour que sa mère ne vît pas ses premières larmes et il se jeta dans la porte ouverte.
Il se précipita vers sa petite chambre, prêt aux longs sanglots dans l’abandon et la solitude les plus lamentables.
Mais Agnès avait ressenti la brutalité de son ressentiment. Et elle le suivit. L’entendant venir, il frémit de colère et de joie, et sur son lit il enfouit sa figure dans l’odeur fade et poussiéreuse d’une étoffe où le souvenir d’anciens sanglots augmentait toujours les derniers.
Elle se jeta sur lui. — Mon petit, mon petit, je te demande pardon, je suis une vilaine maman.
Yves, déconcerté, mécontent de voir lui échapper son atroce plaisir, cria sa déception. Mais déjà il était attentif à l’accent de sa mère, accent qu’il ne connaissait pas, qui le surprenait et éveillait en même temps que sa curiosité son espoir.
Il entrevit un abîme de félicité. Sa mère soudain ne le comprenait-elle pas, ne le devinait-elle pas ? Elle venait enfin près de lui comme jamais elle n’y était venue; elle était enfin au fait de ses besoins et de ses chagrins; elle était toute à lui.
Il se retourna pour la recevoir dans ses bras, et ils mêlèrent leurs deux visages enflammés par les larmes. Il y eut un long moment de bonheur pour Yves, dont il crut d’abord qu’il allait durer toujours.
Ce ne fut qu’après un long moment où il s’était étiré, fondu dans la chaleur de sa mère, qu’il se rendit compte que ce qui était pur bonheur pour lui était autre chose pour elle. Certes elle était la proie comme lui d’un ravissement, mais c’était plutôt un ravissement triste qu’un ravissement heureux comme le sien.
Il commença de nouveau à l’épier avec méfiance et crainte entre ses paupières mal séchées. Mais elle était maintenant en éveil et maintint si bien son effort pour empêcher son enfant de sentir en elle autre chose que sa tendresse que celui-ci crut à plusieurs reprises s’être trompé. Elle se remua pour détourner son attention. »
La mère est en fait piégée : son mari ne s’est précipité dans le mariage que pour la dot, en conservant sa compagne précédente comme maîtresse. Tout est alors d’une logique implacable : la femme tente de regagner sa féminité en cherchant un amant. Car elle est trop faible pour divorcer, trop faible psychologiquement et socialement, elle est restée une femme-enfant. D’où une quête identitaire dans une féminité abstraite, d’où la scène précédente d’indifférence avec son enfant quand elle se maquille.
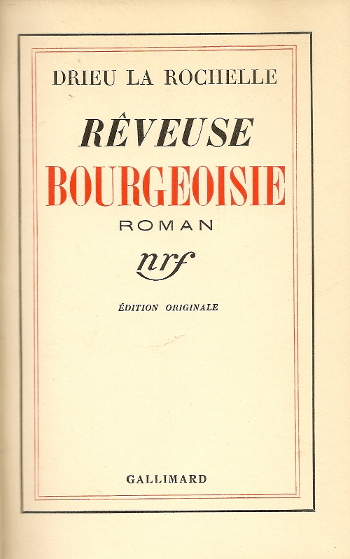
Si la relation était authentique, la femme aurait pu aller de l’avant, le couple aurait pu être un moteur, mais évidemment Pierre Drieu La Rochelle a dressé le portrait de la bourgeoisie, où tout est rêvé, vain, opportunisme le plus vil, décadence. D’où les affres de la femme face à sa situation, comme ici :
« Agnès n’avait aucune idée des hommes, elle n’avait jamais regardé les hommes, elle n’avait eu aucun besoin des hommes. Jeune fille, elle attendait, et il y avait eu Canaille.
Comment en sortir jamais ? A peine avait-elle été seule avec Canaille, dans le train, en route pour ce terrible voyage de noces en Algérie, qu’elle avait deviné tout ce que jusque-là elle n’avait pas le moins du monde pressenti.
Il la regardait si peu, il l’embrassait si peu; il regardait ailleurs, sa bouche flottait ailleurs.
Or, il y avait une fureur latente dans ce corps de jeune fille. Si peu que Camille se soit tourné vers elle, elle était devenue jeune femme tout d’un coup et cette fureur avait éclaté. Elle avait souffert de l’indifférence de Camille et sa souffrance s’était sur-le-champ transmuée en fureur.
Elle souffrait, mais elle souffrait avec colère, avec des cris. A Alger, à la découverte de la photo de Rose, elle avait pleuré, supplié, puis crié. Incapable du moindre calcul, de la moindre réflexion, sans le-conseil de personne, elle était tout abandonnée à la plus fatale sincérité.
Elle criait quand elle avait mal et c’était tout, elle attendait: que son cri conjurât le malheur. Elle ne fit rien pour lutter, pour enjôler Camille, pour surprendre ses besoins, pour substituer une image à l’image qui le fixait.
Elle était trop sincère pour nourrir la moindre imagination, le moindre artifice. Elle ne pouvait rien feindre ou inventer pour les yeux de Camille que Paris avait rendus rêveurs et maniaquement soumis à leur rêve.
Elle allait au-devant de toutes les humiliations, incapable de sortir de son orgueil candide. Il y a des êtres intelligents, rusés, façonnés, qui se plient à la vie, mais il y en a d’autres comme Agnès qui restent eux-mêmes entièrement, aveuglément — ce qui est atroce pour eux et pour les autres.
Agnès ne songea pas à imiter une Rose imaginaire pour la supplanter. Aussitôt que Camille tâchait de lui sourire ou, la nuit, la prenait dans ses bras pour un instant, aussitôt elle était entièrement occupée par l’inertie du bonheur.
Dépourvue de tout détachement et de toute ruse, elle ne songeait pas à retourner aussitôt ce bonheur sur lui pour le fasciner, le capter. Et bientôt un mot, un geste de l’indifférent la faisaient basculer de l’inertie du bonheur dans l’inertie du malheur. Ce fut ainsi pendant quelques mois.
Puis il y eut le premier enfant — l’enfant qui était Camille. En le dévorant, elle dévorait Camille; elle l’aimait anxieusement, furieuse-ment. Mais elle n’en aimait que plus furieusement encore Camille.
Elle fut ainsi pendant des années. La venue de Geneviève n’y changea rien. Elle jetait des regards aveugles autour d’elle, dans les moments où elle invoquait le ciel et la terre, où elle les prenait à témoin de son infortune.
Mais le ciel et la terre, mal peuplés par sa faible imagination et limités au cercle étroit de ses relations, ne pouvaient répondre.
Cependant, un jour, une réponse finit par se former. Il est rare qu’un être reste tout à fait sans qu’aucun autre lui réponde, bien que cette situation horrible se rencontre.
Agnès, jolie, puissante dans ses sensations, n’était pas une déshéritée, c’était seulement une paresseuse, elle avait cette paresse puissante des êtres qui font la masse principale de la vie, de ceux qui se jettent avec tout l’aveuglement de l’instinct sur le premier leurre qui s’offre, et qui s’obstinent sur lui et épuisent toute leur force sur lui. Il y eut donc Le Loreur. »
Rêveuse bourgeoisie est un portrait d’une classe sociale en perdition. C’est la dénonciation de toute une époque.