La vigueur des réseaux de résistance après-guerre avait été prise en compte par l’État au lendemain des grèves de l’automne 1947.
Ainsi, une loi du 28 décembre 1947 ramena le nombre de compagnies de CRS de 65 à 54, avec en particulier le désarmement et la dissolution des 151e et 155e compagnies.
Les trois compagnies de CRS de la Loire avaient été pareillement dissoutes, suite au vote du principe de la grève par la 133e Compagnie de Montluçon le 27 novembre 1947.
Par ailleurs, suite aux mouvements de grèves de 1947, et pour asseoir son autorité, le ministère de l’Intérieur dirigé par le socialiste Jules Moch avait créé un réseau de hauts fonctionnaires chargés de prévenir toute tentative de subversion et déployé au niveau régional, les inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire (IGAME).

De plus, l’État avait ordonné, en plus du contingent normalement prévu, le rappel de 80 000 hommes sous les drapeaux pour 1948.
Il faut noter également que, ayant constaté que les mineurs utilisaient les véhicules des charbonnages en 1947 afin de réagir aux interventions des forces de répression, cette fois ceux-ci furent confisqués par l’armée dès le départ et placés à l’intérieur d’enceintes de caserne.
On est dans un contexte de guerre civile. Au plan de l’organisation, les réseaux nés de la clandestinité des années de guerre entraient en action durant la grève.
Ainsi, le 22 octobre, autour du puits Cambefort à Firminy dans la Loire, commencèrent des affrontements très violents ; l’offensive ouvrière s’organisa sous la conduite d’un ancien commando FTP dirigé par Théo Vial-Massat.
Dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, les sabotages se multiplièrent à partir de la troisième semaine de grève et la décision des mineurs de ne plus assurer la sécurité des puits, en protestation contre l’arrivée des contingents militaires.
Le 2 novembre, à Haillicourt, dans le groupe des mines de Bruay-en-Artois, le frein de la cage d’extraction de la fosse 2 bis fut démonté, immobilisant cette machine à mi-course : les mineurs présents au fond durent de ce fait remonter par les échelles.
Le 3, des rails de chemins de fer furent enlevés entre Harnes et Billy-Montigny. Le 5, deux sabotages rendirent impossible le redémarrage de la fosse 7 de l’Escarpelle qui avait été dégagée la veille.
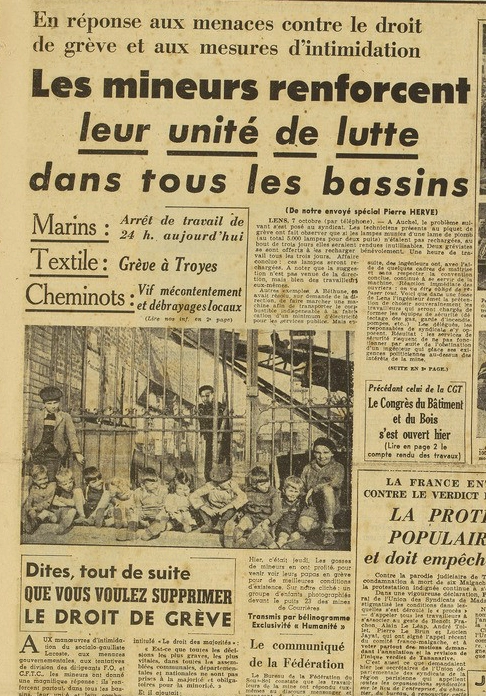
Le 9, les pneus d’un autobus des Charbonnages assurant le transport des ouvriers des campagnes vers les fosses 2 et 3 des mines de Dourges à Hénin-Liétard furent transpercés par des planches cloutées placées au travers de la route.
Dans la nuit du 11 au 12, un rail fut déboulonné à Beugin sur la ligne de chemin de fer reliant Saint-Pol-sur-Ternoise à Bruay-en-Artois puis à Lens, sans doute afin de provoquer le déraillement du train transportant les mineurs jusqu’à la fosse 7 du groupe de Bruay-en-Artois.
Le 12, à Liévin, trois individus masqués s’introduisirent dans le retour d’air d’une fosse et placèrent des explosifs sur les coussinets des moteurs servant à la ventilation.
Une seule charge explosa, n’occasionnant en fait que de faibles dégâts.
Le même jour, une grenade était lancée contre un train des mines partant de Choques, blessant l’accrocheur qui dut être hospitalisé.
Le 14, un rail était placé au travers de la ligne Rimbert-lez-Auchel-Lillers. Le 16, la ligne Auchy-Bully était touchée.
Le 22 octobre, un autobus des Charbonnages effectuant le transport des ouvriers mineurs du groupe de Nœux-les-Mines fût détourné par trois individus qui, sous la menace d’un revolver, forcèrent le chauffeur à les conduire dans le bois d’Olhain.
Arrivés à destination, ils contraignirent les passagers à s’enfuir et tentèrent de mettre le feu au véhicule.
N’y parvenant pas complètement, ils jetèrent une grenade à l’intérieur de l’autobus.
Dans le même temps, les abords des puits étaient devenus de véritables camps retranchés, les wagons sortis des rails et placés en travers, des arbres abattus le long des routes.
À la fosse 7 de Liévin à Avion, des tranchées furent creusées et des barbelés tendus tout autour du site.
La tendance révolutionnaire de la grève des mineurs de 1948 peut également se constater par le degré de participation des femmes à tous les niveaux du mouvement.
Les femmes des mines appartiennent à la classe ouvrière ; si le mariage les amenait souvent à devenir « femmes de mineurs » comme on dit « mère au foyer », toutes occupaient durant l’adolescence des postes à la production : hercheuse (qui pousse les wagonnets), trieuse (qui sépare dans des conditions éprouvantes le charbon des terres stériles), galibot (employée sur les voies au fond), lampistes (qui distribue les lampes), etc.
Dès la création des Charbonnages, la main d’œuvre masculine fut mobilisée pour les besoins du fond. Les mines durent employer plus de femmes aux lavages et aux triages.
Les conditions de travail étaient très dures et la paie inférieure à celle des hommes.
D’après une enquête du très bourgeois Nord Industriel et Commercial de décembre 1946, les ouvrières devaient travailler debout, immobiles, au contact d’un métal glacé, dans une atmosphère suffocante.
Évidemment, elles devaient supporter les grossièretés des contremaîtres et n’avaient accès ni aux douches ni aux cantines.

La participation des femmes aux actions violentes des grévistes témoigne de l’engagement total des masses dans le mouvement.
Ainsi, à Alès le 26 octobre, pour reprendre les puits évacués, les femmes armées de bâtons et de fourches allèrent au-devant des groupes lancés contre la police.
À Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, des heurts violents opposèrent six mille manifestants aux forces de l’ordre, tandis qu’à Longwy des cadres furent pris en otages.
Ces actions étaient rendues possibles par la participation décisive des femmes qui firent preuve d’un bon sens tactique et d’une grande détermination face à la violence policière.
Par ailleurs, les femmes ouvrières des mines avaient acquis une expérience importante par la participation aux activités de lutte contre les nazis.
Ainsi, dans le bassin du Pas-de-Calais, la mémoire d’Emilienne Mopty, héroïne des grèves patriotiques de 1941 était vive.
Après avoir mené un cortège de plusieurs milliers de femmes et participé à de nombreuses actions militaires contre les nazis, elle avait finalement été arrêtée alors qu’elle tentait d’attaquer un peloton d’exécution.
Menée à Cologne, elle y fut décapitée à la hache par les nazis en 1943. Le hasard voulut que son corps fût rapatrié d’Allemagne pour être enterré à Montigny-en-Gohelle, à l’automne 1948, en pleine grève des mineurs.
Ses fils, emprisonnés pour leur participation à des violences contre les forces de l’ordre, ne purent accompagner sa dépouille.
Un évènement particulièrement révélateur se produisit à Verquin, dans le Pas-de-Calais, le 19 octobre.
Dans une manifestation qui dégénérait, un ingénieur fût malmené et un inspecteur de police déculotté par des femmes.
Une rumeur au moins tendait à légitimer cette castration symbolique (dont témoigne une photographie).
Une femme avait reconnu ce policier comme l’auteur de l’arrestation de son mari sous l’Occupation.
Arrêtées, elles étaient plus largement relâchées. Par exemple, sur 32 personnes inculpées, une seule femme fut jugée par le tribunal de Béthune en mars 1949 pour l’assaut mené contre la Sous-Préfecture pendant la grève.
Les femmes jouèrent un rôle également dans la lutte psychologique – prenant parfois des formes violentes – contre les jaunes et les briseurs de grève, souvent par des actions contre des maisons ou en exerçant des pressions sur d’autres femmes.

Les femmes transformèrent donc le mouvement de 1948.
Au travers de leur action de premier plan, il n’était plus simplement question de grève.
Toutes les préoccupations du présent et du passé récent, des conditions de vie et de dignité, jaillirent au premier plan, avec urgence, violence et sans qu’il fût possible pour les pouvoirs publics de proposer des concessions.
On notera ici la résolution sur la main d’œuvre féminine qui fut adoptée lors du 27e congrès de la CGT, qui s’est tenu justement du 11 au 15 octobre 1948.
« Considérant que l’amélioration de la condition des femmes travailleuses, partie intégrante du monde du travail, et leur émancipation sont l’œuvre du mouvement syndical tout entier ; le Congrès appelle à la discussion du problème féminin à tous les échelons du mouvement syndical, depuis la section syndicale jusqu’au bureau confédéral. »
=> retour au sommaire du dossier
sur Le Parti Communiste Français
et les trois grèves historiques : 1947, 1948, 1949