1946 est l’apogée d’une trajectoire commencée en 1934, avec un Front populaire et une Résistance déformée par la ligne opportuniste de droite de Maurice Thorez.
Le Parti Communiste Français a tout perdu niveau communisme, il a tout gagné sur le plan de l’acceptation, de l’intégration.
Même s’il est contesté, évité, rejeté, le Parti Communiste Français fait partie du paysage.
On ne peut plus l’en chasser, cela lui suffit.

Sur le plan gouvernemental, rien ne changeait vraiment.
Après la démission de de Gaulle, c’est le socialiste Félix Gouin qui avait été chef du gouvernement, du 26 janvier au 24 juin 1946.
Il fut remplacé par le démocrate-chrétien Georges Bidault jusqu’au 28 novembre 1946.
C’est la logique du « tripartisme », avec le Parti Communiste Français, le Parti socialiste-SFIO, les démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire.
Les socialistes avaient relativement besoin des deux autres forces, qui quant à elles espéraient obtenir assez de poids pour se passer l’une de l’autre.
Viennent alors les élections législatives du 10 novembre 1946, les premières dans le cadre de la nouvelle constitution.
Elles permettent le plus grand succès électoral du Parti Communiste Français.

Voici les résultats :
– le Parti Communiste Français obtient 28,26 % des voix (soit 5,4 millions d’électeurs) ;
– les démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire obtiennent 25,96 % des voix (4,9 millions d’électeurs) ;
– le Parti socialiste-SFIO obtient 17,87 % des voix (soit 3,4 millions d’électeurs) ;
– la droite avec le Parti républicain de la liberté obtient 12,94 % des voix (soit 2,4 millions d’électeurs) ;
– le Rassemblement des gauches républicaines obtient 11,12 % des voix (soit 2,1 millions d’électeurs).
Naturellement, les deux principales forces revendiquent de former le centre de gravité.
Le 11 novembre 1946, le dirigeant démocrate-chrétien Maurice Schumann explique dans le quotidien catholique L’Aube que :
« Une majorité, quelle qu’elle soit, exige un pôle d’attraction. Il n’en est que deux possibles : le communisme ou nous. »
Le Parti Communiste Français réclame quant à lui la direction du gouvernement, par la voix de son Bureau Politique, le 15 novembre 1946 :
« Le Parti communiste, conscient de ses responsabilités est prêt à assumer toutes les charges qui découlent pour lui de sa position de premier Parti de France.
C’est pourquoi, respectueux des décisions du suffrage universel, il revendique l’honneur et la responsabilité de la présidence du gouvernement de la République française, dans une volonté d’étroite collaboration avec tous les républicains soucieux de poursuivre dans l’union et la concorde, dans le respect des convictions et des croyances de chacun et dans l’exaltation de l’effort de tout un peuple, une politique démocratique, laïque et sociale, gage de la renaissance de la France.
Le Bureau Politique décide de s’adresser au Conseil National du Parti Socialiste convoqué pour le 17 novembre, et de lui faire des propositions relatives à la formation d’un gouvernement d’union démocratique, laïque et sociale, à présidence communiste.
Le Parti communiste et le Parti socialiste disposent, dans la nouvelle Assemblée nationale, de forces suffisantes pour faire appliquer, en accord avec tous les républicains sincères, la volonté de suffrage universel. »
Il va de soi que Maurice Thorez ne devint pas président du Conseil.
Les socialistes répondirent simplement qu’il appartenait au Parti Communiste Français d’établir son projet, puisque lui revenait la première place électorale et donc le droit de proposer un président du Conseil.
Cela torpillait sans le dire la possibilité d’un projet commun.
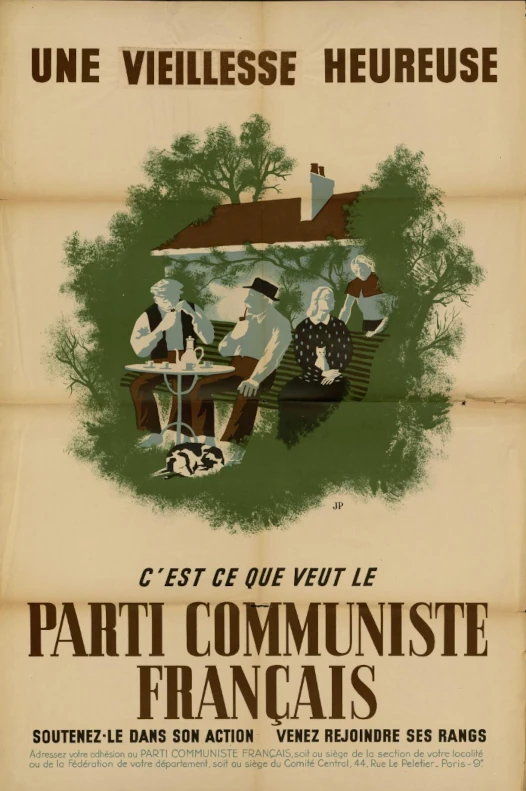
Pour autant, les socialistes ajoutèrent leurs voix aux communistes pour avoir Maurice Thorez comme président du Conseil…
Tout en sachant très bien que l’entreprise échouerait, aboutissant à 259 voix alors qu’il en aurait fallu au moins 310.
Les démocrates-chrétiens se proposent alors, se font rejeter ; il ne reste bien entendu à tout le monde qu’à proposer un candidat socialiste…
Et ce fut le retour de Léon Blum à la présidence du Conseil, avec uniquement des ministres socialistes, pour un court interlude, en raison de la prochaine élection présidentielle.
La naïveté du Parti Communiste Français est ici édifiante, mais elle a surtout comme source l’opportunisme, car son but était d’exister à tout prix dans le cadre républicain.
La quête de légitimité et l’expression du légitimisme l’emportaient sur toute autre considération.

Pour cette raison, le Parti Communiste Français soutint également le socialiste Vincent Auriol comme candidat à la présidence de la République, ce que les socialistes avaient parfaitement calculé.
Vincent Auriol fut élu (par l’Assemblée et l’équivalent de ce qu’on appellera les sénateurs) en janvier 1947.
C’est le communiste Jacques Duclos qui annonce sa victoire (« Soyons unis pour assurer par l’effort créateur de tout un peuple la prospérité de la France et la grandeur de la République »), puis Vincent Auriol embrasse Léon Blum avant de rejoindre l’Élysée.
Le socialiste Paul Ramadier prend alors le relais de Léon Blum à la présidence de la République, avec de nouveau des ministres communistes.
Malgré le poids des communistes, ce sont les socialistes qui sont au centre du jeu !
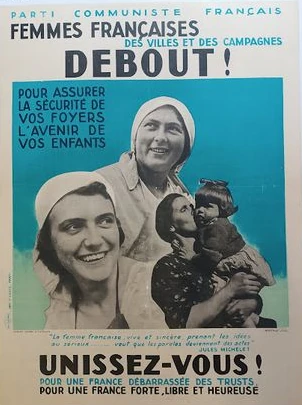
Dans le nouveau gouvernement, Maurice Thorez est vice-président du Conseil et ministre d’État (comme le démocrate-chrétien Pierre-Henri Teitgen), François Billoux est ministre de la Défense nationale (mais pas ministre de la Guerre, poste occupé par un démocrate-chrétien), Charles Tillon est ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Ambroise Croizat est ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Georges Marrane est ministre de la Santé publique et de la Population.
Seulement, le Parti Communiste Français doit faire face à un revers terrible.
Au 38e congrès du Parti socialiste-SFIO à Paris (du 29 août au 1er septembre 1946), le basculement déjà évident en 1945 s’officialise.
La direction démissionne après que le rapport moral ait été repoussé par 2 975 voix contre 1 365 (et 145 abstentions) et le document qui ressort du congrès repousse clairement le Parti Communiste Français :
« L’unité organique du prolétariat demeure pour le Parti socialiste un objectif essentiel.
Mais force est de constater qu’elle ne pourra être réalisée tant que les partis communistes nationaux ne se seront pas libérés de leur assujettissement politique et intellectuel vis-à-vis de l’État russe, et tant qu’ils ne pratiqueront pas une véritable démocratie ouvrière.
Désormais le Comité directeur du Parti sera seul habilité pour prendre contact, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, avec les organisations politiques, syndicales ou philosophiques voisines en vue d’actions communes ayant des buts précis, limités dans leur objet et dans le temps. »
C’en est fini de la fiction d’un possible « Parti Ouvrier Français ».
Après l’échec d’une assemblée toute-puissante, il ne reste plus que le gouvernement auquel s’accrocher.
La contestation interne se fait également toujours plus pressante. Maurice Thorez se retrouve notamment en minorité au Comité central du 19 mars 1947, où la majorité avait exigé que soit cessé l’appui aux crédits militaires pour la guerre en Indochine.
On est ici dans un angle mort de la stratégie républicaine, puisque le Parti Communiste Français avait, de manière persistante, par souci d’acquérir une légitimité, accompagné le maintien de l’Empire français.
Le 20 mars 1945 à l’Assemblée, André Mercier avait par exemple fait une intervention très documentée en faveur… d’un « programme colonial humain et démocratique ».
La question de l’Indochine fit sauter ce verrou, et Maurice Thorez fut alors obligé de forcer le 22 mars 1947 à une réunion d’urgence du Bureau Politique pour soutenir le vote de confiance au gouvernement, et éviter la sortie des ministres communistes.
Mais la question du soutien à outrance au gouvernement se posait désormais ouvertement.
Manœuvrer commençait à devenir difficile, d’autant plus que sur le plan économique, les masses ne pouvaient que gronder.
Et cette activité des masses commençait à se produire hors du cadre du Parti.
En mars 1947, L’Humanité tire à 613 000 exemplaires, ce qui est à la fois beaucoup et extrêmement faible.
Dans l’ordre des choses, ce quotidien devrait être lu par bien plus de gens que les membres du Parti, là il est lu par bien moins !
Et quand la CGT organise une vaste journée le 25 mars 1947, il y a finalement peu de monde. 500 000 personnes à Paris, 120 000 à Lyon, 80 000 à Bordeaux, 60 000 à Marseille, 20 000 à Rouen et autant à Lille et Nîmes, 10 000 à Strasbourg et autant à Béziers, Châteauroux, Montluçon, Toulouse.
Le 1er mai, il y a bien un million de personnes, mais cela veut dire que les mobilisations ne réussissent que de manière formalisée.
Il en va de même pour les meetings : Maurice Thorez rassemble des dizaines de milliers de personnes lors de son passage dans différentes villes du monde.
Mais il n’existe aucune dynamique idéologique, aucune dynamique politique.
On marche par rituels, traditions et revendications syndicalistes.
Le contexte va alors tout faire sauter.
=>Retour au sommaire du dossier sur
Le Parti Communiste Français
au gouvernement avec la bataille du charbon