On l’a compris : les pays d’Amérique latine obtiennent leur indépendance non pas par un soulèvement des masses populaires, mais par la lutte des criollos contre l’Espagne.
Mais les pays n’existent pas : ce sont de simples territoires, certainement pas des nations.
Il y a des haciendas et pas de bourgeoisie nationale ; il y a de vastes masses paysannes mises à l’écart et une petite minorité, les criollos, dominant de manière féodale tant dans les campagnes que dans les villes.
Il faut donc créer les pays par en haut, leur donner un contenu. Tout cela se révèle très bien par le fait que dans Ariel, José Enrique Rodó ne parle pas de Simón Bolívar.

Cela veut tout dire : si Simón Bolívar avait réellement été une figure concrète, il aurait été impossible d’aborder la question latino-américaine sans lui.
Mais Simón Bolívar est un symbole, un levier idéologique. Son seul mérite est d’avoir joué un rôle militaire et de représenter la ligne jusqu’au-boutiste, à l’opposé de Francisco de Miranda dont il s’est justement lui-même débarrassé.
Et lorsqu’il met en avant l’Amérique latine unie ou unifiée, Simón Bolívar ne fait qu’exprimer l’unité des intérêts matériels généraux des criollos, tout en façonnant un outil idéologique conforme à ces intérêts.
José Enrique Rodó fait donc l’éloge de Simón Bolívar dans Bolívar ; il est présenté comme un grand homme, comme une figure de dimension extraordinaire, avec des traits fabuleux, une « originalité irréductible », le « héros par excellence, représentatif de l’éternelle unité hispano-américaine », etc.
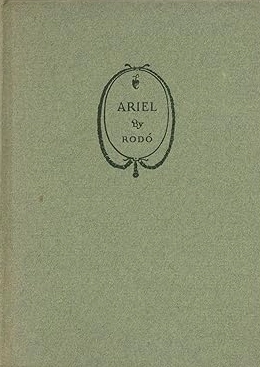
José Enrique Rodó considère, en effet, que la dimension latino-américaine doit même toucher l’Espagne, que Simón Bolívar voulait d’ailleurs instaurer une République en Espagne, etc.
Seulement, Simón Bolívar est un mythe fondateur, pas un levier fonctionnel sur le plan idéologique.
C’est pourquoi José Enrique Rodó écrit Arielsans parler de Simón Bolívar.
Désormais, il faut construire une idéologie pour justifier l’existence d’une nation dans chaque pays, avec un mode de fonctionnement institutionnel.
Et là, c’est autre chose.

De plus, le monde latino-américain est un mythe développé par les criollos ; dans la pratique, il y a différents territoires où une élite criollos a à chaque fois pris le pouvoir.
Chaque État nouveau veut son développement propre, en particulier ; il n’a pas en tête on ne sait quelle stratégie latino-américaine.
Comment concilier le mythe latino-américain fondateur avec l’affirmation de différentes nations nouvelles, en essayant en plus de ne pas céder aux divisions idéologiques au niveau de chaque État ?
C’est précisément là qu’intervient Ariel de José Enrique Rodó, c’est là qu’agit sa trouvaille « géniale » qui va amener son succès dans toute l’Amérique latine.
Si on regarde, son cheminement est le suivant.
Comme il n’y a pas réellement de peuple, seulement des masses sans une réalité nationale encore, alors il faut employer le mythe « latino-américain » pour compenser.
C’est d’autant plus important que la « libération » de l’Amérique latine implique une contradiction toujours plus antagonique entre les couches dirigeantes.

Les criollos des villes sont républicains, laïcs, ils veulent inventer « leur » république, sur le modèle français.
Les criollos des campagnes sont par contre conservateurs-catholiques, il est pour eux hors de question que la modernité vienne bousculer leur réalité.
Il faut neutraliser cette contradiction et en ce sens José Enrique Rodó devient le théoricien d’une sorte de grand compromis, consistant en l’affirmation du spiritualisme comme porteur d’un nouveau projet par génération.
Là est la force de l’ouvrage.
On a comme prétexte à la formulation de cette thèse le dernier cours de l’enseignant, « Prospero ».
C’est l’occasion pour ce dernier d’exposer l’importance de se tourner vers Ariel, et non pas vers Caliban.
Mais « Prospero » ne donne jamais de contenu à Ariel. Là est bien le « génie » de l’œuvre de José Enrique Rodó.
Celui-ci ne dit pas qu’il faut tel ou tel idéal. Ce qu’il expose, c’est la nécessité permanente d’un idéal renouvelé.

Ce qu’il explique, si on se fonde sur le matérialisme dialectique, c’est que le seul moyen de disposer réellement d’une « nation » et d’un « peuple » dans le cadre les nouveaux pays d’Amérique latine, c’est de renouveler l’idéalisme à chaque génération.
Normalement, ce qu’on peut appeler la vie spirituelle d’un peuple – mais l’expression est idéaliste – est le fruit du peuple lui-même, à travers l’Histoire.
Comme ici on n’a pas de peuple, il faut forcer la production, il faut relancer un processus à chaque génération.
On est dans la constitution artificielle, à intervalles réguliers, d’un pays, par une mobilisation idéologique idéaliste.
On lit la chose suivante dans Ariel :
« Aucun spectacle ne saurait mieux captiver simultanément l’intérêt du penseur et l’enthousiasme de l’artiste que celui offert par une génération humaine en marche vers l’avenir, vibrante d’impatience d’agir, la tête haute, le sourire empli d’un mépris hautain pour la désillusion, l’âme emplie de mirages doux et lointains qui déversent de mystérieux stimuli, telles les visions de Cipango [le Japon présenté comme une « île riche en or, perles et pierres précieuses » par Marco Polo et que Christophe Colomb espérait trouver] et d’Eldorado [contrée mythique « dorée »] dans les chroniques héroïques des conquistadors. »
Cela peut sembler abstrait. Néanmoins, si on regarde les pays latino-américains, on voit que c’est bien ce qui se passe.
Il y a tout le temps l’idée d’établir un « projet national », de produire un engouement faisant passer un cap au pays.
Ceux qui sont élus à la présidence ou au gouvernement dans les pays latino-américains ne disent pas qu’ils vont mieux gouverner, faire les choses bien, etc. ; ce qu’ils disent toujours, c’est qu’ils vont révolutionner l’état d’esprit du pays, faire des réformes de structure, faire passer enfin un cap au pays, etc.
En ce sens, Ariel est le manuel machiavélique du renouvellement idéologique permanent d’États latino-américains construits par en haut.
C’est littéralement l’expression idéologique d’une élite parasitaire qui cherche à se faire passer pour une bourgeoisie au sens historique du terme.
->retour au dossier
L’idéologie latino-américaine (Ariel, Caliban, Gonzalo)