Pendant que les forces du PCI sont harcelées et débordées sur tout le territoire, des antifascistes se regroupent spontanément, principalement des anciens combattants progressistes, des républicains du Parti Populaire Italien (catholique), des anarchistes, des socialistes…
En quelques mois, ce phénomène de cellules autonomes, les Arditi del Popolo, prend une ampleur telle que leur nombre atteint 20 000 hommes pour 144 sections.
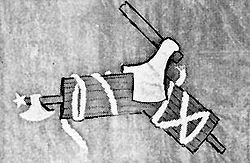
Le style des Arditi del Popolo était au moins en partie problématique, car il reprenait le principe de la brigade de choc de la première guerre mondiale, l’esthétique rebelle sans délimitations culturelles et politiques, etc. C’était une révolte populaire épidermique, née sur le terrain de la contre-violence face aux violences fascistes.

A l’été 1921, s’ouvra ainsi un débat au sein du PCI pour décider de la conduite à tenir vis à vis de ces brigades. Le PSI réformiste et son syndicat la CGL venaient alors juste de signer une trêve avec les fascistes (le Pacte de Pacification, qui tiendra jusqu’à novembre de la même année), et en ont profité dans le même temps pour dénoncer les Arditi Del Popolo, dont justement de nombreux membres étaient des socialistes.
Antonio Gramsci opta pour un rapprochement et un soutien de ce mouvement de masse :
« Les masses laborieuses qui ont continué à soutenir le PSI après la scission étaient persuadées que le mot d’ordre de non-résistance lancé par celui ci était en fait un masque tactique, qui servait à la préparation d’une grande initiative stratégique contre le fascisme. Ceci explique le grand enthousiasme avec lequel fut accueillie l’apparition des Arditi Del Popolo.
Beaucoup d’ouvriers croyaient que la prédication de non-résistance était en fait mise en avant par le Parti Socialiste et par la Confédération Générale du Travail pour minutieusement organiser le corps des Arditi Del Popolo, pour donner une forme solide et cohérente à l’insurrection populaire.
Cette illusion s’est désormais éventée. Les grandes masses populaires doivent maintenant se convaincre que derrière la position des réformistes il n’y avait rien.
Si de nombreux socialistes (aussi bien parmi les plus droitiers) ont participé à la création des premiers noyaux d’Arditis, il est désormais certain que la fulminante diffusion de l’initiative n’as pas été poussée par un plan général, préparé par le PSI, mais était dû simplement à l’état d’esprit se généralisant dans le pays, à la volonté d’insurrection qui couvait dans les larges masses. Tout ceci fut dévoilé à l’occasion du Pacte de Pacification, lequel ne pouvait que déterminer une période de reflux dans le mouvement de défense prolétarienne. »
L’Internationale Communiste défendit la même ligne et expédia alors cette lettre :
« Le PCI doit pénétrer immédiatement et énergiquement le mouvement des Arditi, s’entourer d’ouvriers et convertir en sympathisants les éléments petits bourgeois, dénoncer les aventuriers et les écarter des postes de direction, placer des éléments de confiance à la tête de mouvement.
Le Parti Communiste est le cerveau et le cœur de la classe ouvrière, il n’y a aucun mouvement auquel participe la classe ouvrière qui ne soit trop « bas » ou trop impur (…).
Votre jeune parti doit utiliser toutes les opportunités de contact direct avec les larges masses et vivre avec elles. Pour notre mouvement il est toujours préférable de commettre des erreurs avec les masses que loin d’elles, enfermé dans un cercle de dirigeants de parti, affirmant leur chasteté par principe. »
Toutefois, la majorité des cadres du Parti, dirigé par Amadeo Bordiga et sa ligne de « purisme » révolutionnaire, décidèrent de se tenir à l’écart des Arditi, de peur d’affaiblir leur propre organisation armée en se dispersant et de corrompre la direction idéologique du mouvement.
Il sera même envoyé un émissaire pour faire savoir aux Arditi que leurs dirigeants étaient des provocateurs et que le PCI appelait les communistes à quitter leurs rangs.
Il est vrai que la situation était complexe : ainsi, si à Parme les fascistes, pourtant composés de 15 000 fascistes, se brisèrent en 1922 à la résistance populaire, avec surtout les Arditi, on voit qu’il y a dans le mouvement une légion prolétarienne Filippo Corridoni, du nom d’un syndicaliste révolutionnaire partisan de la participation à la première guerre mondiale et proche de Benito Mussolini, qui le présentera par la suite comme une grande figure historique.

On a ici un mouvement d’une très grande ambiguïté, avec une nature à la fois rebelle et irrationnelle, largement ouverte culturellement au romantisme nationaliste.
Au final, les Arditi del Popolo ne purent se maintenir, leur formation étant trop spontanée, sans aucune ossature idéologique et culturelle, voire littéralement poreux au fascisme ; en octobre de la même année, on ne comptait déjà plus que 5 000 Arditi, et le mouvement s’éteignit rapidement de lui-même, mis en quarantaine par les organisations ouvrières et privé de direction stratégique conséquente.
Ce fut une perte d’énergie populaire considérable, et, de par l’ampleur du désastre face au fascisme, la gauche devait faire vite.
Pourtant, la seule chose qu’elle fut en mesure de faire, c’est de tenter une unité syndicale. Idéologiquement et culturellement, la gauche était battue : il ne restait que la substance commune à toutes les structures de gauche, le seul dénominateur commun : le syndicalisme.
Le constat sur ce point est facile à faire au niveau du PCI. C’est un parti de combat syndical, strictement équivalent au PCF de Maurice Thorez en France dans les années 1930.
En mars 1922, il y a au PCI de Turin seulement neuf intellectuels, un professeur et trois avocats, à Gênes les chiffres sont de respectivement 10, 1 et 6, ainsi que de 13, 5 et 4 à Milan, 4, 0 et 3 à Bologne, 10, 8 et 0 à Florence, 41,3 et 2 à Rome, 9, 4, et 0 à Naples, pratiquement rien pour les autres localités.
Seulement 0,5% des membres sont des intellectuels ; la démarche ne possède pas de socle idéologique et culturel développé. Reflet de ce positionnement syndicaliste éloigné du travail du Parti, il n’y a que très peu de permanents : 5 sont membres de l’Exécutif de l’Internationale Communiste, 1 est secrétaire de la Fédération de jeunesse, 4 sont des inspecteurs propagandistes, à quoi s’ajoute 12 employés et commissionnaires. A côté de cela, seulement 3 fédérations disposent de permanents.
La presse est, quant à elle, en déficit ; son tirage est faible : 45 000 pour le quotidien l’Ordine Nuovo (l’Ordre Nouveau), 16 000 pour Il lavoratore (Le travailleur) bi-hebdomadaire, pas plus de 10 000 quand il passe quotidien.
Le premier quotidien est basé à Turin et dirigé par Antonio Gramsci qui reçoit 1294 lires comme salaire, le second est basé à Trieste et dirigé par Palmiro Togliatti, avec 1500 lires comme salaire, alors que la sténo, non communiste, en touche 2000.

L’Ordine Nuovo dispose de deux rédacteurs, trois chroniqueurs, une sténo, une dactylo, trois commissionnaires, cinq employés, alors que Il lavoratore a cinq rédacteurs et deux chroniqueurs, en plus de la sténo.
Tout cela est très peu, qualitativement et quantitativement ; même Le Syndicat rouge édité par le comité syndical ne dépasse pas 15 000 exemplaires, l’organe de la jeunesse Avant-Garde fait tout juste un peu mieux avec 25 000 exemplaires.
La seule base, réelle, était le syndicalisme ouvrier, sans autre perspective. Ce qui était valable pour le PCI était valable pour le reste de la gauche ; c’est pourquoi fut fondée une organisation unitaire, une Alleanza del Lavoro – alliance du travail – regroupant en 1922 les organisations syndicales de la gauche, sur la base de l’unanimité pour décider des actions.
On y retrouve évidemment la Confederazione Generale del Lavoro lié au PSI et marquée par une présence communiste : au congrès de Livourne de 1921, les communistes obtinrent 288.000 voix contre 556.000 aux socialistes dans les Chambres du travail, 136.000 contre 798.000 dans les fédérations de métiers.
Mais on a également l’Unione Sindacale Italiana, d’orientation syndicaliste révolutionnaire, historiquement opposé à la CGL ; même durant le bienno rosso, il n’y avait pas eu d’unité. L’USI n’a d’ailleurs accepté de participer qu’avec la précision qu’elle n’accepte que l’action directe.
On a aussi l’Unione Sindacale del Lavoro et la Federazione Italiana del Mare, ainsi que parfois localement des structures catholiques.
A la direction de l’alliance, les réformistes dominent entièrement, avec les 5 représentants de la CGL, un représentant de la Fédération des travailleurs des ports (le second étant « syndicaliste »), un représentant du syndicat des chemins de fer.
Le second représentant de ce dernier syndicat est anarchiste, tout comme les deux représentants de l’Union Syndicale. On a, enfin, deux syndicalistes républicains représentant l’Union italienne du travail.
L’Alliance est donc une initiative purement défensive, visant des revendications sociales ; ce n’est pas un Front populaire capable d’initiative. C’est cependant la dernière chance, comme le constate Antonio Gramsci :
« Des ministères ont été renversés, on a cru trouver une limite aux prétentions des industriels, en nommant une commission d’enquête tout exprès, mais toutes les promesses, toutes les tentatives se sont soldées sur ce terrain au détriment des ouvriers.
C’est donc la réalité qui a entraîné l’adhésion du prolétariat à la lutte générale. Sous la poussée de cette conviction, qui a pénétré dans la conscience des ouvriers, même les plus hostiles au front unique ont dû modifier leur attitude et s’orienter bon gré mal gré, vers l’action de toutes les forces ouvrières, déployées sur un unique champ de bataille. Cette même force féconde de l’unité a donné naissance en Italie à l’organisme de l’Alliance du travail dans laquelle les ouvriers placent aujourd’hui toutes leurs espérances de lutte.
L’Alliance du travail est comme la nouvelle forteresse, dans laquelle la classe ouvrière espère enfin trouver la raison de sa sérénité.
Pour cette raison même, grande est la tâche de l’Alliance du travail en ce moment décisif pour la vie du prolétariat italien.
En demandant qu’intervienne à leurs côtés l’Alliance du travail, les métallos du Piémont et de Lombardie n’avaient certainement pas pour but de faire peser une menace, afin d’obtenir un geste de solidarité des plus vagues, mais ils l’ont fait en étant fermement persuadés que c’est seulement en combattant sous le drapeau de l’unité prolétarienne qu’il est possible de faire face aujourd’hui à l’offensive patronale.
Si cette vérité n’est pas entendue aujourd’hui de ceux qui portent la responsabilité de la totale défaite de la classe ouvrière, cette dernière a bien le droit de demander demain des comptes aux responsables, en leur faisant expier par le sang leurs lâchetés et leurs trahisons. » (L’expérience des métallurgistes en faveur d’une action généralisée, 23 mai 1922)
Les communistes, à ce titre, poussent dans la CGL : en novembre 1921, la motion communiste pour une grève générale nationale, alors qu’il y a 600 000 personnes au chômage, obtient 415 712 voix, le refus triomphant avec 1 466 000 voix, mais témoignant de la polarisation.
La première manifestation publique de l’Alliance du travail se déroule d’ailleurs à Milan, fin mars 1922, à l’occasion d’un cortège funéraire d’Emilio Corazza, un ouvrier tué par les fascistes. En mai a lieu une très grande manifestation à Rome, ville où est même proclamée par la suite la grève générale, dans un contexte d’affrontements, y compris armés.
Mais la grande catastrophe se produit lors du congrès de la CGL, à Gênes, plus tard dans l’année. Pas moins de cinq motions sont présentées. Les réformistes, partisans du refus de la lutte pour tenter d’arriver à un gouvernement dont le PSI est une composante, reçoit 537 651 voix, alors que les centristes en ont 43 533.
La gauche est plus forte, mais elle est incapable de s’unir : les communistes obtiennent 253 558 voix et du côté de la gauche du PSI les maximalistes ont 247 433 voix, les partisans de la IIIe Internationale 37 734.
La conséquence est fatale : alors que l’Alliance du travail parvient à appeler à une grève générale, dite « grève légalitaire », le 31 juillet 1922, la réaction fasciste est immense et d’une extrême violence, avec l’appui de l’État, et finalement la CGL et l’Union italienne du travail reculent. La voie est libre pour la prise du pouvoir par Benito Mussolini.