Il est significatif que la « loi fondamentale » de 1963 avait été mis en place par Ahmed Ben Bella depuis la salle de cinéma le Majestic (Atlas) dans le quartier algérien de Bab El Oued, prenant bien soin de mettre à l’écart les parlementaires.
De fait, la position tiers-mondiste d’Ahmed Ben Bella ne tenait que pour les besoins de l’affirmation du capitalisme bureaucratique algérien ; dès sa mise en place, Houari Boumédiène mena un coup d’État, le 19 juin 1965.
Il instaura une dictature ouverte, avec une constitution approuvée par exemple en 1976 à 98,5%, n’hésitant pas à faire assassiner des figures historiques du FLN, comme Mohamed Khider en 1967 en Espagne, ou encore Krim Belkacem en Allemagne en 1970, qui avait signé les accords d’Evian avec la France.

Ahmed Ben Bella restera lui-même mis à résidence jusqu’en 1980, Ferhat Abbas l’ayant été jusqu’en 1978.
L’Algérie était devenue un pays semi-colonial semi-féodal ayant totalement basculé dans le giron du social-impérialisme soviétique, avec toutefois une large influence française, justement en rapport avec l’URSS.
L’exportation des hydrocarbures était ce qui maintenait économiquement le pays, parfaitement inséré dans les rapports impérialistes internationaux ; si l’auto-suffisance alimentaire était de 70 % en 1969, elle était seulement de 30 % en 1980.
En 1975, chaque femme a en moyenne 8,1 enfants ; en 1976, le vendredi devient le jour férié, afin de se conformer à l’Islam.
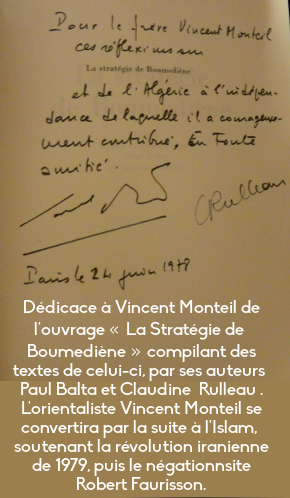
On a ici une continuité de dirigeants liés à l’armée. Après Houari Boumédiène de 1965 à 1978, Rabah Bitat dirigea l’État jusqu’en 1979, Chadli Bendjedid prenant les commandes jusqu’en 1992, en tant qu’« officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ».
L’effondrement du social-impérialisme soviétique provoqua, nécessairement, un très grave déchirement dans le capitalisme bureaucratique, alors qu’en plus, la dette extérieure était passé de 40,2 % du PIB en 1982 à 68 % en 1992.
Cela profita aux forces féodales. Celles-ci avaient commencé à développer une position antagonique dans les années 1980, renforcées par l’islamisme à l’offensive en Afghanistan, mais également en réaction à la tentative toujours plus forte du capitalisme bureaucratique de s’approprier la religion.
Ainsi, de manière dialectique, le « code du statut personnel et de la famille » du 29 mai 1984, autorisant la polygamie et accordant à la femme un rôle totalement subalterne, renforça la féodalité, donc le régime ce qui était l’objectif du capitalisme bureaucratique, mais donc en particulier le féodalisme.
Le féodalisme profite également, autre paradoxe dialectique, du fait qu’à partir de 1988 l’Algérie dépassa les 50 % de population urbanisée. Les préjugés féodaux se renforcèrent ainsi dans les villes, appuyant ainsi la féodalité.
Lorsque en octobre 1988, les manifestations de la misère de la jeunesse furent réprimées dans le sang à Alger, avec officiellement 500 morts, le capitalisme bureaucratique fut obligé d’accepter l’existence de partis politiques.

C’est alors le Front Islamique du Salut, le représentant de la féodalité, qui rafla pratiquement tous les conseils municipaux des grandes villes en 1990, puis organisa des vastes protestations contre le type de scrutin pour les législatives de 1991.

Celui-ci, qui se tint en deux tours au scrutin majoritaire, vit le FIS obtenir 48 % au premier tour, le FLN 23,4 %. Le président Chadli Bendjedid, prêt au compromis, fut alors débarqué par l’armée, qui empêcha la tenue du second tour devant se tenir en janvier.
Les « Janviéristes » de l’armée prirent alors le pouvoir : le nouveau président devint Mohamed Boudiaf, qui avait quitté l’Algérie en 1964, étant alorscondamné à mort ; symbole de la tentative d’unité des factions du capitalisme bureaucratique, il fut toutefois tué quelques mois après, dans un attentat.
Il fut remplacé par Ali Kafi jusqu’en 1994, débarqué lui-même par le Haut Comité d’État, c’est-à-dire l’armée, qui nomma à sa place le général Liamine Zéroual, figure intermédiaire entre les « réconciliateurs » et les « éradicateurs », alors que l’armée islamique du salut et le Groupe islamique armé (GIA) menaient des massacres de grande ampleur, la guerre civile quittant la vie à entre 60 et 150 000 personnes.
L’Algérie des colonels se maintint, parvenant à se tenir aux moyens des exportations de gaz et de pétrole, mais le régime était prêt à vaciller à chaque instant.
On est alors dans la fiction la plus complète : Abdelaziz Bouteflika, dernière grande figure du clan d’Oujda, fut élu président avec 73,8% des voix en 1999, avec 85% des voix en 2009, avec 81,5% des voix en 2014, date où il était tellement malade qu’il ne fut pas en mesure de prêter le serment présidentiel. Il n’était que l’homme de paille d’un régime né d’un hold-up bureaucratique et fondamentaliste se noyant dans ses propres contradictions.
L’Algérie est ainsi à la veille de soubresauts gigantesques, portant une révolution démocratique qui a été dévoyée en 1956-1962, mais dont l’exigence historique ne peut que se réaffirmer de la manière la plus nette, la plus franche.