S’il y a des rites pour l’enterrement, alors il y a une norme à ce sujet.
Ce qui fait ici la force des Livres des morts égyptien et tibétain, c’est qu’ils présentent la conception initiale de l’humanité au sujet de la mort.
Il n’y a pas la vie, puis la mort, mais la vie et la mort s’entremêlant, car au sein même de l’existence on trouve l’affrontement entre les forces bénéfiques et maléfiques.
En ce sens, le paradoxe dialectique veut que l’entre-deux où se retrouve le défunt… est également celui de l’être humain avant son propre décès.
Lorsqu’il vit, il se trouve déjà dans un entre-deux, celui où il est la victime du jeu dialectique des forces bénéfiques et maléfiques.

C’est pour ça justement qu’il a besoin de la religion. Un besoin absolu, et non relatif : l’humanité n’a pas su se passer de religion, et c’est vrai jusqu’au Communisme, jusqu’à son retour comme animal social dans le giron de la Nature.
Ici, un devient deux : les religions ont pris deux chemins différents, un rejetant le « jugement » à un moment relevant de l’entre-deux, un autre où le jugement s’établit comme exigence en permanence sur le plan mental ou légal.
Les Livres des morts égyptien et tibétain célèbrent, quant à eux, l’entre-deux comme le grand moment, le grand aboutissement.
Bien entendu, tout ce qui a été fait pendant la vie compte. Cependant, l’entre-deux a une valeur en soi, il est une quête, avec tout un parcours.
Un parcours qui reflète cependant, pour nous, la vie réelle ; quant à la quête, c’est celle du Communisme par l’humanité sortie de la nature et en quête du grand retour à celle-ci.

Ainsi, dans les Livres des morts égyptien et tibétain, le défunt qui arrive dans l’entre-deux n’est pas réellement mort.
Il porte encore la vie en Égypte antique par son corps non détruit, et dans le bouddhisme tibétain parce qu’il est encore relié à la réincarnation.
Dans les deux cas, la mort n’est pas la mort, et nous pouvons comprendre dialectiquement que la vie n’est pas la vie non plus. Et c’est un processus que d’arriver à une telle conception.
Dans l’Égypte antique, le rituel était initialement réservé au pharaon, puis le processus s’est ensuite généralisé.
Des textes dans les pyramides uniquement destinés au roi, au pharaon, on est passé au texte dans les sarcophages, à destination de l’élite.
On en arrive alors au Livre des morts égyptien, servant tout le monde, ce qui ne veut pas dire que certains textes n’étaient pas réservés aux classes dominantes, comme le Livre de l’Amdouat, appelé parfois Livre de la salle cachée,ou encore Livre des demeures secrètes (Amdouat = ce qu’il y a dans le Douat, terme désignant le « monde souterrain »).
Il y a une « démocratisation » de la mort, de la vraie mort, par « l’entre-deux ». C’est là ce qui fait l’intérêt essentiel de la question.
On n’est pas dans une approche divine où quelques-uns seulement parcourent la mort de manière mythique ou mystique.
On est dans une approche qui concerne tout le monde ; c’est une vision du monde absolue, universelle.
Dans le bouddhisme tibétain, le rapport à la mort est différencié.
Chez un vrai bouddhiste parvenu à « l’éveil », il y a un accès direct au plan supérieur : pendant une trentaine de minutes à la suite du décès, les enseignements du Bouddha apparaissent comme lumière « pure ».
Ce n’est pas le cas pour tout le monde, bien entendu. Et cette réussite immédiate des éveillés est un reste de l’époque où seule une minorité accédait réellement à l’au-delà.
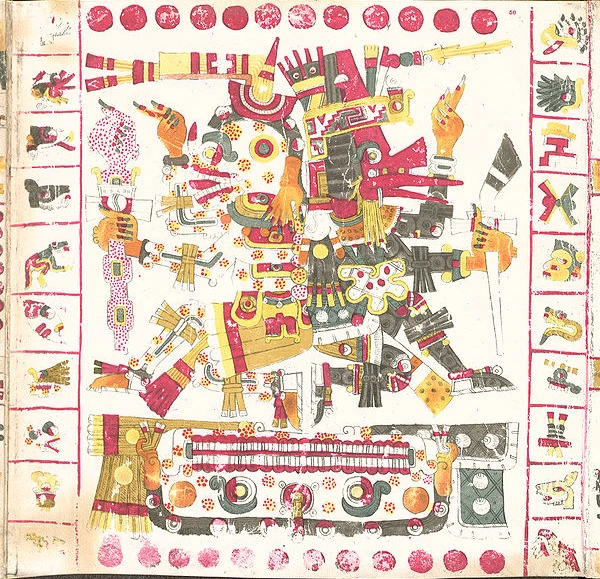
C’était donc le cas justement en Égypte antique. Non pas que le pharaon n’ait pas à subir des épreuves lorsqu’il meurt : c’est pour lui à la base, et pour lui seulement, qu’on formulait justement des incantations et des conseils pour que son périple aboutisse.
Ce que cela veut dire, c’est qu’initialement l’humanité considérait que l’âme ne parvenait sur le plan supérieur que chez certains.
Pour les autres, c’était bien plus compliqué ou bien impossible.
Autrement dit, l’accès à la vie après la mort s’est démocratisé, au cours d’un long cheminement.
Le bouddhisme originel, présent encore dans le sud de l’Asie, maintient d’ailleurs cette position que seule une poignée de gens peuvent s’arracher du cycle des réincarnations.
C’est le « petit véhicule » (qui transporte dans l’au-delà). Les autres bouddhismes relèvent du « grand véhicule » : tout le monde peut être sauvé dans cette vie même.
Néanmoins, au-delà des complications que tout cela pose, on doit bien voir que les livres des morts égyptien et tibétain relèvent d’une systématisation démocratique de l’accès à l’au-delà.
Il y a ici un aspect à creuser. Ce qui est sans doute en jeu, c’est la question « personnelle » : le pharaon gardait sa personnalité après la mort, les autres se fondaient dans l’absolu, forcément relativement flou.
Et avec la croissance des forces productives, la personnalité de chacun a pu se développer, faisant que même les esclaves pouvaient connaître un certain développement de leurs facultés.
Cela induit que, pendant toute une période, les esclaves étaient purement considérées comme des outils et se voyaient démolir psychologiquement et moralement de manière quasi totale.
L’humanité revient de très loin.
=>Retour au dossier sur Les livres des morts
égyptien et tibétain et « l’entre-deux »