Le réactionnaire Maurice Barrès, dans Un voyage à Sparte publié dans La Revue des Deux Mondes en 1905-1906, constate cet étroit rapport entre célébration de la mystique de l’antiquité et prise de position républicaine.
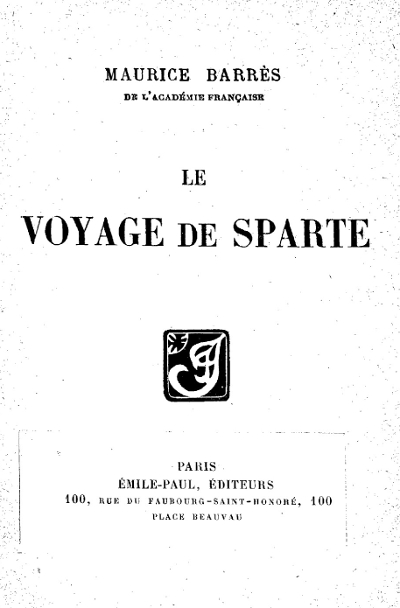
Toute la première partie est d’ailleurs consacrée à Louis Ménard. En voici les extraits les plus significatifs :
« Au lycée de Nancy, en 1880, M. Auguste Burdeau, notre professeur de philosophie, ouvrit un jour un tout petit livre :
— Je vais vous lire quelques fragmens d’un des plus rares esprits de ce temps.
C’étaient les Rêveries d’un païen mystique. Pages subtiles et fortes, qui convenaient mal pour une lecture à haute voix, car il eût fallu s’arrêter et méditer sur chaque ligne. Mais elles conquirent mon âme étonnée (…).
Il eût mieux valu qu’un maître nous proposât une discipline lorraine, une vue à notre mesure de notre destinée entre la France et l’Allemagne. Le polythéisme mystique de Ménard tombait parmi nous comme une pluie d’étoiles; il ne pouvait que nous communiquer une vaine animation poétique.
J’ai horreur des apports du hasard ; je voudrais me développer en profondeur plutôt qu’en étendue ; pourtant, je ne me plaindrai pas du coup d’alcool que nous donna, par cette lecture, Burdeau. Depuis vingt années, Ménard, sans me satisfaire, excite mon esprit.
Peu après, vers 1883, comme j’avais l’honneur de fréquenter chez Leconte de Lisle, qui montrait aux jeunes gens une extrême bienveillance, je m’indignai devant lui d’avoir vu, chez Lemerre, la première édition des Rêveries presque totalement invendue.
À cette date, je n’avais pas lu les préfaces doctrinales de Leconte de Lisle, d’où il appert que l’esthétique parnassienne repose sur l’hellénisme de Ménard, et j’ignorais que les deux poètes eussent participé aux agitations révolutionnaires et stériles que le second Empire écrasa.
Je fus surpris jusqu’à l’émotion par l’affectueuse estime que Leconte de Lisle m’exprima pour son obscur camarade de jeunesse.
Je fus surpris, car ce terrible Leconte de Lisle, homme de beaucoup d’esprit, mais plus tendre que bon, s’exerçait continuellement au pittoresque, en faisant le féroce dans la conversation ; je fus ému, parce qu’à vingt ans, un novice souffre des querelles des maîtres que son admiration réunit.
Leconte de Lisle me peignit Ménard comme un assez drôle de corps (dans des anecdotes, fausses, je pense, comme toutes les anecdotes), mais il y avait, dans son intonation une nuance de respect.
C’est ce qu’a très bien aperçu un poète, M. Philippe Dufour. « J’étais allé voir Leconte de Lisle, dit M. Dufour, au moment où la Revue des Deux Mondes publiait ses Hymnes orphiques : je suis content de ces poèmes, me déclara le maître, parce que mon vieil ami Ménard m’a dit que c’est dans ces vers que j’ai le plus profondément pénétré et rendu le génie grec. »
La jolie phrase, d’un sentiment noble et touchant ! Belle qualité de ces âmes d’artistes, si parfaitement préservées que, bien au delà de la soixantaine, elles frissonnent d’amitié pour une même conception de l’hellénisme. « Tout est illusion, » a répété indéfiniment Leconte de Lisle, mais il a cru dur comme fer à une Grèce qui n’a jamais existé que dans le cerveau de son ami (…).
D’autres fois, nous faisions des promenades le long des trottoirs. Il portait roulé autour de son cou maigre un petit boa d’enfant, un mimi blanc en poil de lapin.
Peut-être que certains passans le regardaient avec scandale, mais, dans le même moment, il prodiguait d’incomparables richesses, des éruditions, des symboles, un tas d’explications abondantes, ingénieuses, très nobles, sur les dieux, les héros, la nature, l’âme et la politique : autant de merveilles qu’il avait retrouvées sous les ruines des vieux sanctuaires.
C’était un homme un peu bizarre, en même temps que l’esprit le plus subtil et le plus gentil, ce Louis Ménard !
En voilà un qui ne conçut pas la vie d’artiste et de philosophe comme une carrière qui, d’un jeune auteur couronné par l’Académie française, fait un chevalier de la Légion d’honneur, un officier, un membre de l’Institut, un commandeur, un président de sociétés, puis un bel enterrement !
Il a été passionné d’hellénisme et de justice sociale, et toute sa doctrine, long monologue incessamment poursuivi, repris, amplifié dans la plus complète solitude, vise à nous faire sentir l’unité profonde de cette double passion (…).
Louis Ménard, transporté d’indignation par les fusillades de Juin, publia des vers politiques, Gloria victis, et toute une suite d’articles, intitulés : Prologue d’une Révolution, qui lui valurent quinze mois de prison et 10 000 francs d’amende.
Il passa dans l’exil, où il s’attacha passionnément à Blanqui et connut Karl Marx. Il vivait en aidant son frère à copier une toile de Rubens.
Leconte de Lisle, envoyé en Bretagne par le Club des Clubs, pour préparer les élections, était resté en détresse à Dinan. Il gardait sa foi républicaine, mais se détournait, pour toujours, de l’action. Il s’efforça de ramener le proscrit dans les voies de l’art : « En vérité, lui écrivait-il, n’es-tu pas souvent pris d’une immense pitié, en songeant à ce misérable fracas de pygmées, à ces ambitions malsaines d’êtres inférieurs ? Va, le jour où tu auras fait une belle œuvre d’art, tu auras plus prouvé ton amour de la justice et du droit qu’en écrivant vingt volumes d’économie politique. »
Le grand silence de l’Empire les mit tous deux au même ton. Et Ménard, à qui l’amnistie de 1852 venait de rouvrir les portes d’une France toute transformée, s’en alla vivre dans les bois de Fontainebleau.
Si l’on feuillette l’histoire ou simplement si l’on regarde autour de soi, on est frappé du grand nombre des coureurs qui lâchent la course peu après le départ, et qui, voyant le train dont va le monde, ne daignent pas concourir plus longtemps. Les hommes sont grossiers et la vie injuste.
On peut s’exalter là-dessus et dénoncer les violences des puissans et la bassesse des humbles ; on peut aussi se réfugier dans le rêve d’une société où régneraient le bonheur et la vertu.
Cette société édénique, selon Ménard, ce fut la Grèce. Il entreprit de la révéler aux cénacles des poètes et des républicains.
José-Maria de Heredia a souvent entendu Ménard lire du grec : « Ménard prenait un vieil in-folio à la reliure fatiguée, Homère, Anacréon, Théocrite ou Porphyre, et traduisait.
Aucune difficulté du texte ne pouvait l’arrêter, et sa voix exprimait une passion telle que je n’en ai connue chez aucun autre homme de notre génération. La vue seule des caractères grecs le transportait ; à la lecture, il était visible qu’il s’animait intérieurement ; au commentaire, c’était un enthousiasme. Sa face noble s’illuminait.
Il en oubliait les soins matériels de la vie. Un soir d’hiver que nous expliquions l’Antre de Porphyre, je dus lui dire tout à coup qu’il l’aisait plus froid dans sa chambre sans feu que dans l’Antre des Nymphes. »
En sa qualité d’helléniste, Ménard poursuivait le divin sur tous les plans de l’univers : comme peintre dans la nature, comme poète dans son âme, comme citoyen dans la société (…).
Au cours de ses longues rêveries dans les bois, sa prédilection pour la Grèce et sa haine de la Constitution de 1852 s’amalgamèrent. Il s’attacha au polythéisme comme à une conception républicaine de l’univers.
Pour les sociétés humaines comme pour l’univers, l’ordre doit sortir de l’autonomie des forces et de l’équilibre des lois ; la source du droit se trouve dans les relations normales des êtres et non dans une autorité supérieure : Homère et Hésiode prononcent la condamnation de Napoléon III.
Ménard exposait ces vues à M. Marcelin Berthelot, au cours de longues promenades péripatéticiennes, sous les bois paisibles de Chaville et de Viroflay. M. Berthelot et son ami Renan étaient des réguliers. Ils pressèrent Ménard de donner un corps à ses théories ingénieuses sur la poésie grecque, les symboles religieux, les mystères, les oracles, l’art, et de passer son doctorat. Ils auguraient que sa profonde connaissance du grec lui assurerait une belle carrière universitaire.
La soutenance de Ménard eut beaucoup d’éclat. Nous avons sa thèse dans le livre qu’il a intitulé : La morale avant les philosophes, et qu’il compléta, en 1866, par la publication du Polythéisme hellénique. C’est quelque chose d’analogue, si j’ose dire, au fameux livre de Chateaubriand ; c’est une sorte de Génie du polythéisme.
Le polythéisme était un sentiment effacé de l’âme humaine ; Ménard l’a retrouvé (…).
Le nouveau docteur désirait de partir pour la Grèce et il allait l’obtenir, quand un fonctionnaire s’y opposa, sous prétexte que la thèse du postulant se résumait à dire que « le polythéisme est la meilleure des religions, puisqu’elle aboutit nécessairement à la république. »
Ce fonctionnaire impérial avait bien de l’esprit (…).
Sur le tard, l’auteur des Rêveries eut une grande satisfaction. Le conseil municipal de Paris, soucieux de dédommager un vieil enthousiaste révolutionnaire, créa pour Ménard un cours d’histoire universelle à l’Hôtel de Ville (…).
Cela éclate dans ses cours, dédiés à Garibaldi, comme au champion de la démocratie en Europe. Ils sont d’un grand esprit, mais qui mêle à tout des bizarreries. « J’aime beaucoup la Sainte Vierge, m’écrivait-il ; son culte est le dernier reste du polythéisme. » À l’Hôtel de Ville, il justifiait les miracles de Lourdes et, le lendemain, faisait l’éloge de la Commune. Le scandale n’alla pas loin, parce que personne ne venait l’écouter.
En hiver, Ménard professait dans la loge du concierge de l’Hôtel de Ville. À quoi bon chauffer et éclairer une salle ? N’était-il pas là très bien pour causer avec l’ami et unique auditeur qui le rejoignait ?
C’est peut-être chez ce concierge et dans les dernières conversations de Ménard qu’on put le mieux profiter de sa science fécondée par cinquante ans de rêveries.
Ce poète philosophe n’avait jamais aimé le polythéisme avec une raison sèche et nue ; mais, à mesure qu’il vieillit, son cœur, comme il arrive souvent, commença de s’épanouir. Il laissa sortir des pensées tendres qui dormaient en lui et qu’un Leconte de Lisle n’a jamais connues.
Il me semble que nous nous augmentons en noblesse si nous rendons justice à toutes les formes du divin et surtout à celles qui proposèrent l’idéal à nos pères et à nos mères. Leconte de Lisle m’offense et se diminue par sa haine politicienne contre le moyen âge catholique. Il veut que cette haine soit l’effet de ses nostalgies helléniques ; j’y reconnais plutôt un grave inconvénient de sa recherche outrancière, féroce du pittoresque verbal.
Le blasphème est une des plus puissantes machines de la rhétorique, mais une âme qui ne se nourrit pas de mots aime accorder entre elles les diverses formules religieuses. Ménard se plaisait à traduire sous une forme abstraite les dogmes fondamentaux du christianisme, afin de montrer combien ils sont acceptables pour des libres penseurs.
Et par exemple, il disait que, si l’on voulait donner au dogme républicain de la fraternité une forme vivante et plastique, on ne pourrait trouver une image plus belle que celle du Juste mourant pour le salut des hommes (…).
J’ai bien des fois cherché à comprendre ce véritable scandale qu’est l’échec de Louis Ménard. Comment l’un des esprits les plus originaux de ce temps, à la fois peintre et poète, érudit et savant, historien et critique d’art, admiré de Renan, de Michelet, de Gautier, de Sainte-Beuve, a-t-il pu vivre et mourir ainsi complètement inconnu du public ?
L’ardeur de sa pensée démocratique a-t-elle éloigné de lui les craintifs amis des lettres ? (…).
Ménard posséda toutefois un disciple, M. Lami, esprit exalté, d’une rare distinction. Il ne le garda pas longtemps. Après avoir prié Brahma toute une nuit, M. Lami se jeta par la fenêtre en disant :
— Je m’élance dans l’éternité.
Un ami commun, M. Droz, ne voulut pas croire à cette mort extraordinaire.
— Je savais bien qu’il était fou, disait-il à Ménard, mais je croyais que c’était comme vous. »