On trouve en Égypte antique de nombreux ouvrages traitant de « la vie après la mort » : on est dans l’élaboration permanente, rendue inévitable de par la transformation de l’humanité.
Plus l’humanité quitte son passé d’animal, plus elle s’éloigne du « calme » animal (calme marqué d’une inquiétude constante), plus les excitations nerveuses deviennent nombreuses et se systématisent (en permettant en même temps, dialectiquement, de poser son esprit).
La religion s’adapte ainsi en fonction et les textes apparaissent, nuançant, modulant, modifiant, bouleversant les conceptions de « l’intervalle » entre la vie et la mort, plus exactement entre la vie-mort et le passage au paradis (ou à l’enfer).
On trouve ainsi un Livre des portes ; ce n’est pas son vrai titre, qui reste inconnu, celui-ci a été choisi par le Français Gaston Maspero (1846-1916) qui a été extrêmement actif en Égypte sur le plan de l’archéologie.
Il y a également des textes des pyramides et des textes des sarcophages, qui eux aussi abordent la question du passage dans la mort.
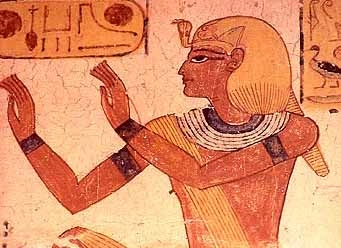
Les textes inscrits dans les pyramides sont les plus anciens ; ils datent de vers 2300 avant notre ère.
Comme naturellement c’est le fruit de tout un processus d’élaboration, cette conception de la mort est en pratique plus ancienne encore.
Les écrits se trouvent sur les murs des corridors, des antichambres et des chambres funéraires, alors que les plafonds sont recouverts d’étoiles.
Le rapport à ces dernières est évident ; on est dans l’humanité primitive qui accorde une place primordiale au déplacement des planètes et des étoiles.
Comme pour les pyramides méso-américaines et évidemment toutes les premières structures humaines, les pyramides égyptiennes sont des sortes d’observatoires où les cieux sont observés avec ferveur et inquiétude.
Les dieux sont dans les cieux ou du moins liés à eux, voire les cieux eux-mêmes. Le roi décédé doit les rejoindre, d’où des prières, des conseils, des formules magiques.
Les textes des pyramides sont donc fait pour être lus à voix haute ; on retrouve le principe dans l’ouvrage le plus fameux, destiné lui à toute la population : le Livre des morts, dont le titre réel est Livre pour sortir au jour.

La lecture à voix haute est également l’aspect central dans le Livre des morts tibétain.
Son titre réel souligne cette question de la lecture et de l’audition qui va avec, puisqu’il s’agit de La libération par l’écoute dans les états intermédiaires.
On le retrouve enseigné dans les quatre principales écoles du bouddhisme tibétain : les Nyingmapa (les Anciens), les Kagjupa (Transmission orale), les Sakyapa (Terre claire), les Gelugpa (les Vertueux).
Dans les deux œuvres égyptienne et tibétaine, l’être humain mort ne l’est pas vraiment. Il a un périple à passer avant d’atteindre la mort réelle.
Mais cette mort n’est pas la fin, elle est le commencement, car il y a un dieu-univers, qui apporte le souffle vital aux choses.
Les choses passent, mais pas le dieu-univers et c’est lui qu’on rejoint finalement, du moins doit-on tout faire pour cela, puisque c’est cela qui compte vraiment.
On doit rejoindre le « pays merveilleux » dans l’au-delà, du moins essayer car le chemin est semé d’embûches.
Quand on meurt, on ne meurt donc pas, on tombe dans un « entre-deux » entre la vie et la mort. On n’est plus vivant, mais on n’a pas encore atteint le domaine de la mort réelle, qui est celui du paradis ou de l’enfer, si l’on veut.
De manière significative, dans la « pyramide qui est la beauté des lieux », celle du pharaon Ounas (au 24e siècle avant notre ère), la première phrase qu’on peut lire est la suivante :
« Ô Ounas, tu n’es pas parti mort, tu es parti vivant… »
On lit pareillement dans le Livre des morts tibétain :
« Lorsque le Principe-Conscient sort du corps, il se demande : « Suis-Je mort ou non ? ».
Il ne peut le déterminer ; il voit ses proches, son entourage comme ils les voyaient avant. Il entend leurs plaintes.
Les illusions karmiques de terreur ne se lèvent pas encore, non plus que les apparitions ou expériences produites par les Maîtres de la Mort.
Durant cet intervalle, le Lāma [= le prêtre] ou lecteur doit suivre les directions du Thödol [= le Livre des morts]. »
Permettre à cette sorte de voyageur post-vie de dépasser cet entre-deux, qui forme une sorte de labyrinthe avec des épreuves, est le rôle des textes lus.
On s’adresse au défunt, depuis la vie, par-delà la mort, car le mort est encore relié à la vie.
La vraie vie est même après la mort, après la mort qui elle-même suit la vie. Il y a au-delà de la vie et de la mort, au-delà de l’affrontement entre les forces bénéfiques et maléfiques, au-delà du bien et du mal.
Il y a le monde éternel, celui du dieu-univers, impersonnel et infini, qui consiste en un pur souffle vital.
C’est lui que l’humanité, qui a découvert avec souffrance son esprit naissant et traumatisant, veut rejoindre. Elle veut cesser d’avoir une activité incessante et intense en elle, à travers son esprit.
Elle veut la « paix ». La quête de l’au-delà pacifié est à la fois la nostalgie de la sortie du jardin d’Éden (lorsque l’être humain était encore substantiellement animal) et une anticipation historique de la marche vers l’Éden (c’est-à-dire le Communisme, comme retour de l’humanité socialisée dans la Nature).
=>Retour au dossier sur Les livres des morts
égyptien et tibétain et « l’entre-deux »