On a vu comment José Carlos Mariátegui a compris le problème péruvien : l’indépendance a été réalisée par en haut, le féodalisme est resté, les notables se sont aussi transformés en capitalistes intermédiaires pour les pays occidentaux.
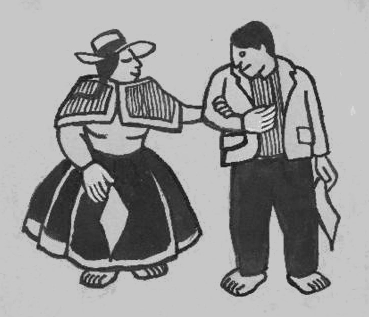
De manière dialectique, cela veut dire que la révolution libérale n’a pas eu lieu. José Carlos Mariátegui ne fait jamais que constater le caractère rétrograde des couches dominantes au Pérou.
Il les pose régulièrement en contraste avec des couches dominantes modernes, capitalistes.
Lui-même n’est pas favorable à une modernisation.
Mais il a conscience que, dialectiquement, une définition par la négative est nécessaire. De là vient sa critique de la République qui, finalement, n’en est pas réellement une.
Elle brise la grande propriété terrienne, mais pas celle des grands propriétaires terriens, seulement celle des communautés indiennes.
« Examinons maintenant comment le problème foncier s’est posé sous la République.
Pour clarifier ma vision de cette période, en lien avec la question agraire, je dois souligner une idée que j’ai déjà exprimée concernant la nature de la révolution donnant l’indépendance au Pérou.
La révolution a trouvé le Pérou en retard dans la formation de sa bourgeoisie.
Les éléments d’une économie capitaliste étaient plus embryonnaires dans notre pays que dans d’autres pays d’Amérique latine, où la révolution s’appuyait sur une bourgeoisie moins latente et moins naissante.
Si la révolution avait été un mouvement des masses indigènes ou avait représenté leurs revendications, elle aurait nécessairement eu un caractère agraire.
On a déjà bien étudié comment la Révolution française a particulièrement bénéficié à la classe rurale, sur laquelle elle a dû s’appuyer pour empêcher le retour de l’Ancien Régime.
Ce phénomène, d’ailleurs, semble propre aux révolutions bourgeoise et socialiste, à en juger par les conséquences plus définies et plus stables du renversement du féodalisme en Europe centrale et du tsarisme en Russie.
Dirigées et menées principalement par la bourgeoisie et le prolétariat urbains, l’une et l’autre de ces révolutions ont eu pour bénéficiaires immédiats les paysans.
En Russie notamment, cela a été cette classe qui a récolté les premiers fruits de la révolution bolchevique, car aucune révolution bourgeoise n’avait encore eu lieu dans ce pays, laquelle aurait liquidé le féodalisme et l’absolutisme et instauré un régime libéral-démocratique à leur place.
Mais pour que la révolution démocratique-libérale ait eu ces effets, deux prémisses étaient nécessaires : l’existence d’une bourgeoisie consciente des buts et des intérêts de son action, et l’existence d’un état d’esprit révolutionnaire au sein de la classe paysanne, et surtout, sa revendication du droit à la terre dans des conditions incompatibles avec le pouvoir de l’aristocratie foncière.
Au Pérou, encore moins que dans d’autres pays d’Amérique, la révolution pour l’indépendance n’a pas répondu à ces prémisses.
La révolution a triomphé grâce à la solidarité continentale obligatoire des peuples qui se sont rebellés contre la domination espagnole et parce que la situation politique et économique mondiale a joué en sa faveur.
Le nationalisme continental des révolutionnaires hispano-américains, combiné à cette communauté forcée des destins, a mis à égalité les peuples les plus avancés dans leur marche vers le capitalisme et les plus arriérés sur la même voie.
Étudiant la Révolution argentine, et donc la Révolution américaine, [Esteban] Echeverría [1805-1851, principale figure du romantisme libéral en Argentine] classifie les classes comme suit :
« La société américaine, dit-il, était divisée en trois classes, chacune ayant des intérêts opposés, sans aucun lien de sociabilité morale et politique.
La première était composée des hommes en robe, du clergé et des patrons ; la seconde était composée de ceux qui s’enrichissaient grâce au monopole et aux caprices de la fortune ; la troisième était composée des paysans, appelés « gauchos » et « compadritos » dans le Río de la Plata, « cholos » au Pérou, « rotos » au Chili et « léperos » au Mexique.
Les castes indigènes et africaines étaient des esclaves et avaient une existence extrasociale.
La première vivait sans produire et disposait du pouvoir et des privilèges de l’hidalgo ; c’était l’aristocratie, composée principalement d’Espagnols et de très peu d’Américains.
La seconde profitait, exerçant tranquillement son industrie et son commerce ; c’était la classe moyenne qui siégeait dans les cabildos [= les corps administratifs coloniaux gérant les municipalités] ; la troisième, unique productrice par le travail manuel, était composée d’artisans et de prolétaires de toutes sortes.
Les descendants américains des deux premières classes, ayant reçu une éducation en Amérique ou dans la péninsule, furent ceux qui portèrent haut la bannière de la révolution. »
La Révolution [latino-]américaine, plutôt qu’un conflit entre la noblesse terrienne et la bourgeoisie marchande, produisit en bien des cas leur collaboration, soit par l’imprégnation des idées libérales qui marquait l’aristocratie, soit parce que cette dernière, dans bien des cas, ne voyait dans la révolution qu’un mouvement d’émancipation vis-à-vis de la couronne espagnole.
La population paysanne, qui au Pérou était indigène, n’eut pas en la révolution une présence directe, active.
Le programme révolutionnaire ne représentait pas ses revendications.
Mais ce programme s’inspirait de l’idéologie libérale.
La révolution ne pouvait ignorer les principes qui tenaient compte des revendications agraires existantes, fondées sur la nécessité pratique et la justice théorique de libérer la propriété foncière du joug féodal.
La République intégra ces principes dans ses statuts.
Le Pérou ne disposait [cependant] pas d’une classe bourgeoise pour les appliquer en harmonie avec ses intérêts économiques et sa doctrine politique et juridique.
Or, la République – car tel était le cours et le mandat de l’histoire – devait se fonder sur des principes libéraux et bourgeois.
Cependant, les conséquences pratiques de la révolution, concernant la propriété agraire, ne pouvaient manquer de se limiter aux limites fixées par les intérêts des grands propriétaires.
C’est pourquoi la politique de désengagement de la propriété agraire, imposée par les fondements politiques de la République, ne s’attaqua pas aux latifundia.
Et – bien que les nouvelles lois ordonnèrent la distribution des terres aux indigènes – elle s’attaqua, en échange, au nom des postulats libéraux, à la « communauté ».
S’inaugure ainsi un régime qui, quels qu’étaient ses principes, aggravait d’un certain degré la condition des indigènes au lieu de l’améliorer.
Et ce n’était pas la faute de l’idéologie qui inspirait la nouvelle politique et, correctement appliquée, aurait dû mettre fin à la domination féodale sur la terre, transformant les indigènes en petits propriétaires terriens.
La nouvelle politique abolit formellement les « mitas », les encomiendas, etc.
Elle comprenait un ensemble de mesures qui signifiaient l’émancipation des peuples indigènes en tant que serfs.
Mais, comme, d’un autre côté, elle laissait intacts le pouvoir et la force de la propriété féodale, elle invalidait ses propres mesures de protection des petits propriétaires et des travailleurs agricoles.
L’aristocratie foncière, sinon ses privilèges initiaux, conserva ses positions de fait.
Elle demeura la classe dominante au Pérou. La révolution n’avait pas véritablement porté une nouvelle classe au pouvoir.
La bourgeoisie professionnelle et marchande était trop faible pour gouverner.
L’abolition du servage n’était donc qu’une déclaration théorique. Parce que la révolution n’avait pas touché les latifundia.
Et le servage n’est qu’une des facettes du féodalisme, mais pas le féodalisme lui-même. »
José Carlos Mariátegui met systématiquement en tension les choses lorsqu’ils les présente. C’est un révolutionnaire et il parvient à voir comment les choses s’agencent vraiment, au-delà des apparences.
=>retour au dossier sur
José Carlos Mariátegui et le matériau humain