Pierre Drieu La Rochelle marque l’échec d’une forme de romantisme : celui qui se veut, d’une manière ou d’une autre, encore liée au symbolisme, à la quête d’un idéal dématérialisé.
La quête d’une forme parfaite d’union est en même temps quête accompagnée d’un goût pour la décadence, la fréquentation des prostituées; on a la même ambivalence que chez Baudelaire, avec la femme à la fois ange et démon, entièrement valorisé et totalement dévalorisée.
Voici un passage relativement exemplaire du sens de cette quête dans L’homme couvert de femmes, de 1925 :
« Gille sentait confusément que Luc personnifiait tout le délire qui était en lui et autour de lui. Double délire qui, à la fin, n’en fait qu’un, mais il avait mis du temps avant de pouvoir tout discerner (…).
– Luc, je se ne saurais vous dire comment votre vie m’effraie. Où allez-vous ? Ne voulez-vous vraiment aller nulle part ? Vous courez d’un être à un autre être ?
– Mais, on vieux, vous êtes comme moi, et bien pire que moi. Enfin depuis que vous êtes ici…
– Mais, moi, je ne me remue que pour m’arrêter. Je cherche pour trouver.
– La belle affaire, nous sommes tous comme vous.
– Mais non, vous cherchez pour chercher, vous seriez dégoûté de trouver.
– Et vous, donc ? je voudrais voir ça. D’ailleurs, je suis bien tranquille, nous ne trouverons ni vous ni moi.
– Mais vous savez, reprit Gille, je n’ai jamais été comme vous. Jamais je ne jouis de la multiplicité de mes expériences. Certes, j’admire le déploiement de la chair, c’est un grand arbre dont le bruissement de multitude remplit le ciel. Mais c’est là concupiscence esthétique et non pas sensuelle.
J’aurais voulu être peintre. Je ne suis jamais repu de la variation infinie et imperceptible des formes, de l’enchaînement inlassable des figures.
Mais cette jouissance interminable, c’est autant de dérobé au plus mordant de mon âme qui, à la fin est accablé sous la masse monotone où retombent bientôt tant d’accidents charmants.
Je n’ai jamais cru que j’augmentais ma connaissance et ma possession par le nombre, par la multiplication. Je ne crois pas qu’on puisse additionner les âmes les unes aux autres. Je ne cherche pas l’âme du monde. Je ne suis pas de ces quêteurs vagues qui glanent brin à brin, dans une succession indéfinie, les criants traits dispersés de la figure universelle. »
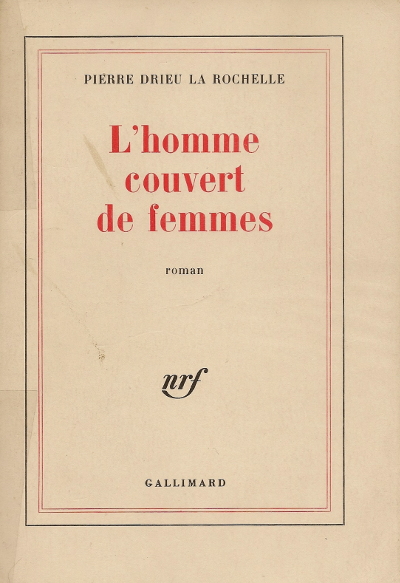
Dans Le jeune européen, de 1927, on peut lire:
« Me voilà seul. J’ai perdu les hommes (…). Je ne sais pas aimer. L’amour de la beauté est un prétexte pour honnir les hommes.
Il est impossible que tout un fragment de l’Univers soit si faible, si laid ; ou bien se prépare, au cœur de sa dissolution, quelque chose de fort et d’inconnu que je dois découvrir et aimer.
Pourquoi aucun ustensile, aucune femme, aucun plaisir, aucun travail ne me paraît un achèvement, autour de moi ? (…)
Je sens l’éternel, tissu dans le moindre texte de la vie humaine. Mais pourtant, – est-ce ma faute ou celle de mon époque ? – à tout moment rien ne me paraissant achevé, tout me paraît manqué. »
Dans le nouvelle Rien n’y fait, on lit :
« Mais je dus rentrer à Paris. Rosita me déclara qu’elle voulait y rentrer aussi et y vivre avec moi (…). Je fus transporté et j’emmenai Rosita. Mais, à Paris, tout changea quand j’entrai dans son appartement.
Jusque-là, Rosita avait été pour moi exactement la femme que ses gestes me décrivaient, une femme simple – silencieuse ou rieuse – directe, s’offrant avec pudeur, c’est-à-dire sans réserve mais aussi sans hâte, à une volupté dont elle s’imprégnait peu à peu.
Mais maintenant tous ces objets laids et futiles qui encombraient sa chambre et son boudoir s’imposaient à mes yeux comme des tenants et des aboutissants. Qui avait donné ces objets ? Qu’avaient-ils vu ?
Il n’y a rien qui touche à un être qui ne lui donne un sens. Quels replis de sa nature avaient secrété des symboles si affreux. Je commençais à la questionner.
A la première question, elle me regarda d’un air surpris. Ensuite, une assez longue réflexion lui donna de la détresse. Enfin, elle me répondit avec de la résignation et de l’ennui. Comme tous les jaloux, je croyais être invisible. »
Une preuve de cette tendance à la dématérialisation, au non-respect de la dignité du réel, se retrouve parfaitement dans un passage terrible qu’on trouve dans Etat-civil, de 1921.
« Un été, j’étais tout le temps fourré dans une petite ferme qui attenait à notre jardin. Je m’enfermais dans le poulailler où je jouissais avec une âpreté avaricieuse de la solitude, du secret.
Ou de la quiétude, de l’absence du dérangement : dès ces premières ardeurs de petit bourgeois idéaliste, illusionniste, il s’y mêlait cette bassesse.
J’avais une poule préférée, Bigarette, dont je vois la tête fine et preste. Je l’entourais de mille soins qui ne l’effarouchaient plus. Mais ces soins devenaient brusques et tyranniques.
A les répéter je m’exaspérais, mais je ne pouvais les cesser. Ma sollicitude se transformait en ténacité rageuse. Une obscure hostilité pointait contre l’objet de mon attachement, il m’échappait des gestes bizarres.
Par exemple, je prétendais que l’écorce qui recouvrait les pattes frêles de mon amie était de la crasse et que je devais l’ôter. Avec mes ongles je m’enhardissais petit à petit à l’écorcher vive. Puis j’avais assez de ce nettoyage minutieux, très lent, qui me faisait un peu haleter.
J’étais las d’être accroupi et de la serrer entre mes jambes pour comprimer ses soubresauts et ses battements d’ailes. Je la lâchais, mais cela me décevait et m’impatientait de la voir s’écarter en boitillant et l’aile lâche.
Alors je la ressaisissais et la jetais en l’air pour la rattraper avec des mains crochues. Elle s’alourdissait et ne voletait plus. D’une minute à l’autre je devenais inquiet et j’allais la cacher dans la paille où l’on ne trouvait plus ses œufs délicats.
Ce manège dura quelques jours, je préférais sans me l’avouer n’être pas vu. Mais ma grand’mère flaira quelque chose et m’épia. Ce fut ce jour-là que Bigarette mourut.
Toute la famille fut avertie et se trouva fort soucieuse. Pour terroriser cette canaille qui s’était levée en moi il fallait un grand appareil de justice.
En entrant dans le salon avant le déjeuner, je fus soudain épouvanté en trouvant tout le monde rassemblé et tant de regards sévères tournés vers moi. Mon père avait les mains derrière le dos. Il jeta sur une table le cadavre de Bigarette.
Je ne savais pas qu’elle était morte, mais tout d’un coup je compris que je l’avais tuée. Je ne soupçonnais pas encore toute la noirceur de ma conduite.
Mon père me promena dans les détours de mon crime. Ce fut une grande nouveauté. Tout l’univers était contre moi et m’accablait, je connus l’isolement effaré et superbe de l’assassin.
Je me pliais naturellement à l’opinion du monde, et pourtant il y avait au fond de moi une retraite sombre où quelque chose ne se rendait pas.
Mais la source de ma vie était troublée et bien longtemps j’eus une sorte de peine à achever mes gestes, mes paroles, à occuper l’espace et à prélever ma part de l’attention des hommes.
Je doutai passionnément et je m’éloignai de ce mauvais jour avec une plaie imperceptible qui pouvait s’agrandir.
Il y eut aussi un remord qui s’attaquait à ma chair. Souvent la nuit, un cauchemar me réveillait, le fond de mon lit était plein de sang et de plumes, je ne pouvais me rendormir, les pieds recroquevillés sous moi.
Depuis cet événement je n’ai jamais pu toucher un oiseau sans pâlir. »
Pierre Drieu La Rochelle marque l’échec du romantisme idéaliste.