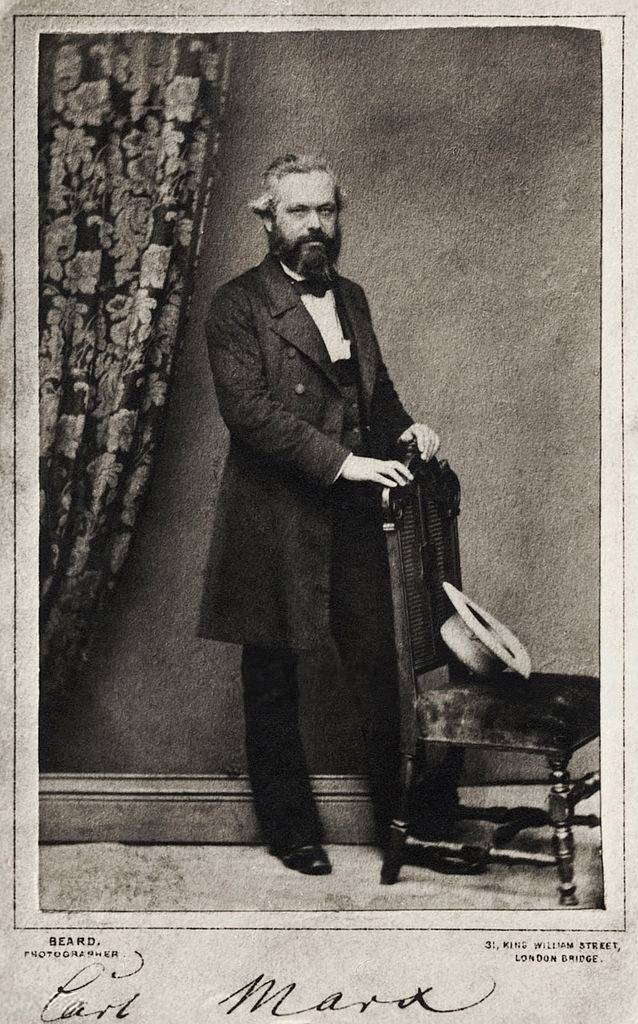Le puissant développement de la social-démocratie en Allemagne et en Autriche-Hongrie ne pouvait pas ne pas toucher la classe ouvrière française, malgré l’orientation entachée d’anarchisme et de syndicalisme de celle-ci. Pour cette raison, l’existence d’un seul parti, au lieu de plusieurs mouvements eux-mêmes issus de plusieurs tendances, apparaissait comme une obligation incontournable par rapport à la pression ouvrière internationale en ce sens.
Ainsi, au congrès d’Amsterdam de la seconde Internationale en 1904, avec notamment 101 délégués anglais, 66 délégués allemands, 38 délégués belges, 29 délégués polonais, 45 délégués russes, et 89 délégués français, la tendance de Jean Jaurès s’était faite plus que taper sur les doigts pour sa logique de participation gouvernementale : il lui fallut céder relativement pour rester dans le cadre ouvrier international. Et céder signifier aussi accepter l’exigence du Congrès voulant qu’il n’y ait qu’un seul Parti par pays.

Le Parti socialiste français de Jean Jaurès et le Parti socialiste de France de Jules Guesde, mais aussi les Fédérations autonomes (des Bouches-du-Rhône, de Bretagne, de l’Hérault, de la Somme, de l’Yonne) où était actif Gustave Hervé et le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, se virent donc historiquement forcés de s’unir, ce qui fut fait dans le cadre d’un congrès du 23 au 25 avril 1905, avec 286 délégués se réunissant dans la Salle du Globe, boulevard de Strasbourg à Paris.
Sont présents, comme représentants de l’Internationale, Camille Huysmans, secrétaire du Bureau socialiste international, ainsi qu’Emile Vandervelde. L’Humanité du 30 octobre 1905 parle d’un
« vaste local orné de drapeaux rouges avec la grande inscription en lettres dorés sur fond rouge : Parti socialiste section française de l’Internationale ouvrière. Face au bureau s’étale la belle devise : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Le Congrès est fort bien organisé. Autour de quatre rangées de tables perpendiculaires au bureau, se groupent les congressistes. La fanfare ouvrière joue l’Internationale. »

La manière dont cela fut fait souligne l’importance de cet arrière-plan : la naissance du Parti socialiste Section Française de l’Internationale Ouvrière est surtout l’expression d’une logique internationale ouvrière.
Le courant de Jean Jaurès ne représentait en effet que 8 500 membres, celui de Jules Guesde que 16 000 membres. Ces chiffres, outre qu’ils montrent l’absence d’ancrage organisé dans la classe ouvrière, allaient par contre de paire avec un ancrage électoral puissant : 406 000 et 487 000 voix respectivement. Et justement le Parti socialiste Section Française de l’Internationale Ouvrière ne sortira jamais de cette opposition entre un écho organisationnel très faible et un électorat solide ; il en ira par ailleurs de même avec la SFIO d’après 1920 et le Parti Socialiste ensuite.
Les mouvement socialistes sont en France surtout des machines électorales, sans base militante et pour cette raison d’ailleurs, le congrès d’unification ne fut pas déterminé par les membres, mais par une interprétation semi-électoraliste. La convocation au « congrès d’unification » précise en effet dans son troisième article :
« Le Congrès est convoqué sur la base d’une représentation proportionnelle des forces socialistes constatées lors du Congrès d’Amsterdam et calculées, d’une part, sur le nombre des membres cotisants et, d’autre part, sur le chiffre des voix obtenues au premier tour des élections législatives générales de 1902. »
C’est là une entorse fondamentale à la démarche social-démocrate qui raisonne en termes de programme et de valeurs. Les Fédérations devaient même initialement recevoir, pour les congrès, des mandats selon les résultats électoraux, mais ce point fut supprimé lors des débats de l’unification.
Néanmoins, cette tendance de fond va avoir une conséquence significative : celle de renforcer le poids des zones d’implantations déjà existantes. Il y a ainsi 3 mandats dans l’Ain, 2 en Dordogne, 3 en Isère, 4 dans la Somme mais 8 dans l’Aube, 12 en Gironde, et surtout 47 du Nord et 47 de la Seine (soit la région parisienne grosso modo). Cette tendance à avoir de gros pôles et une présence quasi inexistante dans de nombreuses régions ne cessera pas par la suite.
En ce sens, il faut avoir un regard particulièrement critique sur le grand accent mis, de la part de la commission d’unification, sur la nécessaire centralisation et le caractère unanime devant assurer la vie interne de la nouvelle organisation. Il ne s’agit pas d’un processus démocratique amenant un saut qualitatif à un Parti conscient de lui-même, mais d’un rassemblement chapeauté de manière administrative et asséchant immédiatement la vie interne.
En quoi consiste d’ailleurs la direction ? Voici comment le règlement du nouveau Parti présente la chose dans les articles 20 et 21 :
« Dans l’intervalle des Congrès nationaux, l’administration du Parti est confiée au Conseil national. Le Conseil national est constitué par les délégués des Fédérations, la délégation collective du Groupe socialiste au Parlement, la Commission administrative permanente élue par le Congrès national. »
On voit bien qu’aux délégués de la base s’opposent non seulement les parlementaires formant une entité à part, mais en plus une « commission administrative » formant un véritable appareil séparé, d’autant plus que ses 22 membres sont élus au congrès par les délégués présents. Il ne s’agit pas d’un Comité Central élu et devenant lui-même la direction, mais d’une direction parallèle aux autres.
Il était inévitable qu’il y ait des conflits entre ces trois appareils, reflétant une base non unifiée idéologiquement. Cela est d’ailleurs assumé, puis qu’au sujet de la contrôle de la presse du Parti, le règlement affirme la chose suivante :
« La liberté de discussion est entière dans la presse pour toutes les questions de doctrine ou de méthode ; mais pour l’action, tous les journaux, toutes les revues socialistes doivent se conformer aux décisions des Congrès nationaux et internationaux interprétées par le Conseil national du Parti. »
Cette absence d’unité idéologique, sans parler de la culture, en dit long sur la nature pratiquement syndicaliste du projet de Parti socialiste. La soumission à la CGT pour ce qui concerne les questions économiques sera de fait par la suite entièrement assumée, tel quel.
Par là-même, il faut être circonspect sur les affirmations effectuées à l’occasion du document signé par les protagonistes pour entamer le processus d’unification. On y lit notamment :
« Le Parti socialiste est un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d’échange, c’est-à-dire de transformer la société capitaliste en une société collectiviste et communiste, et pour moyen l’organisation économique et politique du prolétariat.
Par son but, par son idéal, par les moyens qu’il emploie, le Parti socialiste, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, n’est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classe et de révolution.
Les élus du Parti au Parlement forment un groupe unique, en face de toutes les fractions politiques bourgeoises. Le groupe socialiste au Parlement doit refuser au Gouvernement tous les moyens qui assurent la domination de la bourgeoisie et son maintien au pouvoir ; refuser, en conséquence, les crédits militaires, les crédits de conquête coloniale, les fonds secrets et l’ensemble du budget. »
Ces points ont été écrits sous l’influence de l’Internationale ; ils ne reflètent cependant nullement le sens de la démarche de nombre de dirigeants et responsables socialistes, qui n’ont en pratique aucune force vive à part le réservoir électoral.