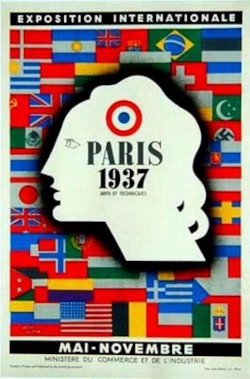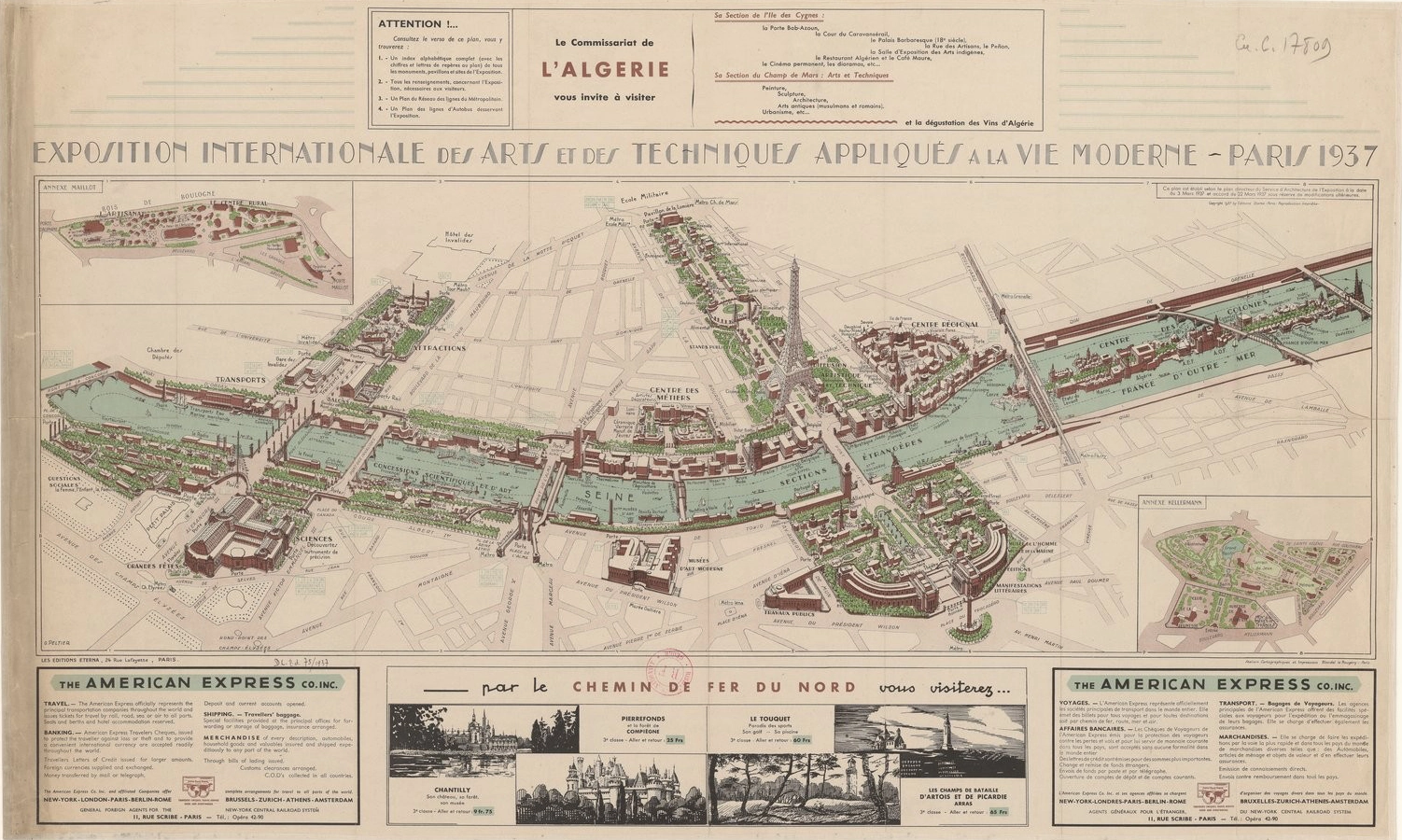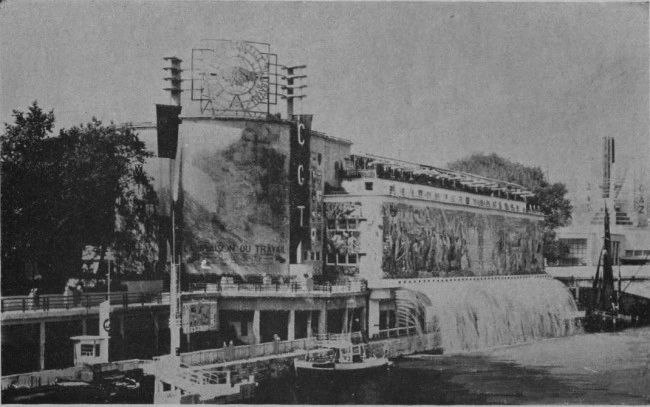Les cortèges parisiens du 14 juillet 1937, où défilent plusieurs centaines de milliers de personnes (100 000 à Lyon, 100 000 à Marseille), débouchent sur une scène place de la Nation à Paris où les participants au Front populaire tiennent des discours d’unité.
Camille Chautemps n’est pas présent, par souci de s’éloigner, mais le message qu’il fait lire salue « l’œuvre immense et généreuse du gouvernement Blum ». C’est la continuité, mais sous l’égide des radicaux cette fois, et ceux-ci exigent la fin de l’agitation dans le pays.
Notons également que le matin du 14 juillet avait vu un défilé militaire d’une ampleur toute nouvelle, avec des chars d’assaut et des avions, dont un termina dans la Seine en plein Paris, plusieurs autres connaissant des déboires similaires au moment de rentrer.
C’est une continuité, mais en même temps un basculement. Officiellement, le Front populaire continue. Mais quel est le bilan ? Que faut-il faire ?
Dans la pratique, le constat est facile à comprendre : Léon Blum n’a rien osé. Jean-Pierre Maxence, un intellectuel d’extrême-droite, critique de manière très réaliste les prétentions du gouvernement de Léon Blum qui a lamentablement échoué. Léon Blum a reculé sur tous les plans et les acquis réalisés ont pour beaucoup perdu leur valeur matérielle.
Mais personne n’ose affirmer réellement cela à gauche, pour de multiples raisons. Déjà, parce que les seuls à le faire, ce sont les quelques agitateurs trotskistes marginalisés et épaulés par Marceau Pivert à l’intérieur du Parti socialiste-SFIO. Leur discours est maximaliste et hors sol, typique de l’ultra-gauche. Ils ont été opposés au Front populaire comme unité socialiste-communiste, ils veulent la « révolution permanente ». Personne à gauche n’a envie de leur ressembler.
Le Parti Communiste Français pourrait mener la critique, de manière constructive, mais il est amorphe en raison de la ligne « nationale » imposée par Maurice Thorez, qui paralyse toute critique du Front populaire et toute dénonciation des radicaux. Il va d’ailleurs le payer extrêmement cher par la suite.
Léon Blum peut donc se targuer de toutes les qualités, comme au congrès du Parti socialiste-SFIO à Marseille, début juillet 1937, encore et toujours avec une auto-satisfaction dégoulinante.
« Somme toute, le Parti est encore sous le coup d’une suite d’événements qui se sont précipités pendant une dizaine de jours, événements que certainement il comprend, mais qu’un très grand nombre de nos militants n’acceptent pas, se refusent, si je peux dire, à admettre au fond d’eux-mêmes.
Et vis-à-vis de ceux d’entre nous qui en portent la responsabilité principale, je sens très bien que l’amitié du Parti n’est pas diminuée, bien au contraire.
Jamais nous n’en avons reçu, mes camarades et moi, de témoignages plus touchants, mais il semble parfois que ce qu’on nous témoigne, ce soit plutôt de la solidarité personnelle, de l’affection et une confiance née en partie de l’habitude plutôt qu’une conviction tirée de l’examen critique des événements actuels (…).
Le gouvernement de Front populaire à direction socialiste a fait en France la première épreuve de la direction socialiste au pouvoir. Cette expérience vient de s’achever, cette première expérience vient de s’achever après treize mois d’existence, et quels mois !
Des mois où chaque semaine nous a semblé longue, je vous prie de le croire !
Où sont venus l’un après l’autre, des mois durant, les jours sans répit et les nuits sans sommeil ; où il semble que par on ne sait quelle malice, par quelle conjuration maligne du sort, toutes les épreuves, toutes les difficultés, quelles qu’elles soient, celles qu’on pouvait prévoir et celles qu’on ne pouvait même pas prévoir, se sont accumulées, et accumulées dans le même instant.
Des mois où, chaque fois qu’on entendait la sonnerie du téléphone, on le décrochait en se demandant : « Qu’est-ce qu’il y a encore ? ».
Eh bien, cette épreuve est terminée ! Et je demande si dans ce Congrès il y aura une voix – je dis une voix ! – pour porter contre elle une condamnation ? (Applaudissements) (…).
Est-ce qu’il faut le répéter une fois de plus, après que tous – personne ne l’a fait avec plus de netteté et plus de force que Paul Faure – est-ce qu’il faut répéter une fois de plus que nous n’étions pas un gouvernement socialiste, gouvernant sur le programme socialiste ? (…) Je ne crois pas pécher par un excès de présomption vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de l’oeuvre que nous avons accomplie, ensemble, mes amis du gouvernement et moi. L’autocritique, je peux dire que personne ne l’a exercée sur lui-même plus sévèrement que moi.
Et cependant, je n’avoue pas l’échec, non ! Nous n’avons pas échoué ! (Acclamations. La salle, debout, applaudit.) Non, nous ne sommes pas un parti vaincu, un parti mené à la défaite par les fautes de ses chefs !
Est-ce que vous avez, les uns et les autres, le sentiment d’être ici les représentants d’un parti vaincu ? Non ! (Très vifs applaudissements) (…)
[Le dirigeant de l’aile gauche des socialistes] Zyromski arrivait chez moi [le 20 juin 1937 pour empêcher la démission de Léon Blum] porteur d’une motion votée à l’unanimité par le Congrès fédéral de la Seine [le bastion de l’aile gauche et promoteur de l’unité avec les communistes dès février 1934], qui s’était réuni ce même dimanche et il me disait : « La résistance ! La résistance en faisant appel aux masses, la résistance en appelant le pays à l’action ! La résistance dont le gouvernement prendra la tête. La résistance par un acte semblable à celui qu’ensemble, au nom du Parti, avec quelques amis, nous avons accompli le 12 février 1934 et qui a sauvé dans ce pays la République. »
La différence, entre le 12 février et le 20 juin, c’est que le 12 février – et cela était une grande part de notre force – nous représentions la légalité républicaine, contre les entreprises factieuses. (Applaudissements.)
Et le 20 juin, que la loi soit bien ou mal faite, nous n’aurions pas représenté la légalité constitutionnelle. Nous pouvions à coup sûr persévérer dans une lutte légale contre le Sénat (…).
Et pendant ce temps-là, nous avions la certitude, comme les événements l’ont prouvé, qu’on se servirait – et avec quelque facilité, avec quelle facilité ! – de l’arme atroce, de l’arme envenimée de cette panique financière et monétaire, dont nos adversaires se servent contre nous, dussent-ils pour nous atteindre, passer au travers du corps. (Quelques applaudissements.).
Si nous engagions une telle lutte, il fallait, vous le sentiez bien, la conduire jusqu’à son terme et la conduire victorieusement. Et alors il fallait y aller, il fallait commencer la bataille, il fallait lutter jusqu’à la victoire.
Dans cette lutte, est-ce que tout le Front populaire nous aurait suivis ? Est-ce que, cette lutte, nous pouvions la mener sans demander et sans obtenir le concours actif des organisations ouvrières ? Dans quel état jetions-nous le pays ? (…)
Considérant l’état intérieur du pays, son état psychologique, considérant le danger extérieur, nous avons dit : non, nous n’avons pas le droit de faire cela, nous n’en avons pas le droit, vis-à-vis de notre Parti, nous n’en avons pas le droit vis-à-vis de notre pays. (Applaudissements vifs.) »
L’autosatisfaction de Léon Blum et des socialistes est hallucinée et témoigne d’une croyance absolue en la spécificité française, en sa stabilité, en sa nature fondamentalement « bonne ». Néanmoins, cela n’ira pas sans heurts.
La ligne de Léon Blum ne l’emportera que par 2949 voix contre 2439 ; le Congrès socialiste a été tendu, on en est venu aux mains.
Voici justement la position critique de Jean Zyromski, le dirigeant de la Bataille socialiste, l’aile gauche du Parti socialiste-SFIO, qui a joué un rôle clef dans la mise en place du Front populaire en se tournant vers le Parti Communiste Français depuis son propre bastion, la Fédération socialiste de la Seine (c’est-à-dire de la région parisienne).
Pour Jean Zyromski, il faut reconnaître que la chute du gouvernement de Léon Blum est une défaite, et que des ministres socialistes soient présents dans le gouvernement qui suit, avec à sa tête le radical Camille Chautemps, n’y change rien.
Seulement voilà, si Jean Zyromski sait ce qu’il n’aurait pas fallu faire, il ne sait pas pour autant quoi faire. Il faut attendre le bon moment, et considérer le gouvernement de Camille Chautemps comme une simple transition, une période passagère avant la véritable lancée. C’est volontariste, mais les masses sont pour beaucoup déboussolées : l’ambiance est devenue morose, tendue, agressive.
« Camarades, je viens à cette tribune avec le sentiment très net de la gravité de la situation pour notre parti.
Je viens ici au nom de tous mes amis de la Bataille socialiste, mandaté par eux, pour expliquer devant le congrès le sens de notre motion et la manière dont nous entendons résoudre la crise qui s’est ouverte dans le Parti, depuis le 20 juin, crise qui a secoué tout le Parti, qui le secoue encore, et qui doit être dénouée comme nous le pensons, si on ne veut pas qu’il aille à la pire des aventures et à la pire des catastrophes (…).
D’abord fait que je crois incontestable, et incontesté : le gouvernement de M. Chautemps [qui suit celui de Léon Blum] n’est pas et ne peut pas être un vrai gouvernement de Front populaire. (Applaudissements.) Il ne l’est pas en raison de sa constitution même, en raison de sa composition même. Regardons la réalité en face, si dure soit-elle : il est le résultat d’une défaite que le Parti a subie en présence de l’offensive conjuguée du Sénat et de l’oligarchie financière (Applaudissements.)
Le 20 juin, pour nous, n’est pas une journée de victoire, c’est une journée de défaite, c’est un recul incontestable du Front populaire et le fait que le gouvernement Chautemps a succédé à un gouvernement de Front populaire à direction socialiste, le fait que le gouvernement Chautemps n’est pas à l’image du Front populaire, le fait que le gouvernement de M. Chautemps est, passez-moi l’expression, un « ersatz » et un mauvais « ersatz » du Front populaire, doit nous penser à prendre un certain nombre de déterminations pour faire cesser une situation qui est insupportable et qui ne correspond pas à ce qu’est, en réalité, le Front populaire. (Applaudissements.)
Je vais maintenant rappeler un peu le passé, non pas pour me complaire dans des critiques du passé mais pour en tirer des leçons pour l’avenir.
Camarades, nous ne voulions pas de cela, nous ne l’avons pas voulu, nous avons voulu autre chose et nous avons dit ce que nous voulions. Le 20 juin, au lieu de s’en aller devant le vote du Sénat, c’était le moment de contrebalancer l’action du Sénat et des oligarchies financières, par le recours à ce qui est votre véritable force, l’action de la classe ouvrière (Applaudissements.)
Nous l’avons dit, nous ne sommes pas contentés de le dire. Nous sommes allés trouver notre camarade Blum avec un appel unanime de la Fédération de la Seine, réunie dans son Congrès. Nous avons dit : « Nous comptons sur vous, nous comptons sur le gouvernement, à l’heure actuelle ; ce n’est pas simplement un parti d’opposition qui, à certains moments, doit entraîner des masses populaires, c’est à vous, comme le 12 février 1934, avec notre appui, qu’il convient d’entraîner les masses ouvrières et paysannes, de ce pays, à l’action contre le Sénat et contre les oligarchies financières. » (Applaudissements.)
C’était, je crois, cela la vérité. C’était, je crois, cela le devoir. C’était, je crois, cela la véritable direction. Je considère qu’une erreur d’optique extrêmement grave a été commise et maintenant que l’on ne vienne pas dire : « Mais la Confédération Générale du Travail ne marchait pas, mais le Parti communiste ne marchait pas. »
Non, vous n’avez pas le droit de dire cela ! Vous n’avez pas le droit d’employer cet argument, car – et vous l’avez d’ailleurs très loyalement dit et répété dans votre discours de Bordeaux – vous avez dit qu’il vous apparaissait – et j’emploie l’expression la plus modérée – comme contre-indiqué en raison de la situation intérieure et de la situation extérieure, d’une mise en mouvement des masses ouvrières et paysannes.
C’était votre droit de penser ainsi, vous estimiez contre-indiqué, à ce moment-là, surtout pour la politique internationale, la mise en mouvement de ces masses ouvrières et paysannes, comme le Parti l‘avait fait sous voter égide, le 12 février 1934. Vous ne l’avez pas fait et l’erreur d’optique a entraîné l’erreur d’aiguillage (Applaudissements.)
Déjà, mauvaise bifurcation. Ce n’est plus la pause que nous avons acceptée dans certaines circonstances et sous certaines conditions. C’était déjà la bifurcation.
Et quarante-huit heures plus tard, le Conseil national du Parti malgré notre opposition tenace et passionnée, acceptait alors la participation socialiste au gouvernement de M. Chautemps.
La décision du Conseil national entourait cette participation d‘un grand nombre de conditions et de garanties. Mais comme il arrive toujours dans ces sortes d’opérations, le soir même de la décision du Conseil national, elle était déjà violée, la décision de la majorité du Conseil national ! (Applaudissements).
Elle n’était pas simplement violée par la présence de M. Queuille au ministère des Travaux publics. Cela c’est après tout, très peu de choses.
Mais elle a été violée par, ce qui est beaucoup plus grave, la présence et l’arrivée providentielle et miraculeuse de M. Georges Bonnet qui revenait de Washington et des Etats-Unis pour nous apporter les trésors de sa politique financière ! (Applaudissements.)
Nous n’avons pas marché, nous ne marchons pas et nous ne marcherons pas pour cela ! (Applaudissements.)
Le gouvernement de M. Chautemps n’est pas seulement un véritable gouvernement de Front populaire, en raison de sa constitution même. Ce n’est pas non plus ce que nous appelons un gouvernement de Front populaire en raison de son programme.
On nous a dit, on nous a proposé, au Conseil national : « Il ne s’agit pas de savoir combien il y a de ministres socialistes, où ils sont, s’ils sont à la présidence ou non. Il s’agit de savoir quel est le programme du Front populaire ».
Oh ! mais, camarades, la réponse est venue ! Elle est venue très clairement, très brutalement. Les premières réponses, car il y en aura d’autres, qui seront encore beaucoup plus claires et beaucoup plus brutales. (Quelques applaudissements.)
Nous avons les décrets-lois de M. Bonnet, et alors véritablement si mon ami Auriol est dans la salle, je veux lui dire qu’hier j’ai reçu un véritable coup de massue ! J’ai été stupéfait et j’ai été épouvanté ! (Très bien ! Applaudissements)… lorsque Vincent Auriol avec… (Manifestations dans les tribunes.)
Le Président. Allons ! Vous n’êtes pas chargés de faire la police, camarades, taisez-vous ! Continue Zyromski. (Bruit dans la salle) Si tous les commissaires se mettent à parler, on est foutu !
Zyromski. Lorsque, avec une loyauté vraiment excessive, en se piquant d’honneur, notre camarade Vincent Auriol se considérait comme mandaté ici pour défendre et justifier les projets de M. Georges Bonnet, je pensais véritablement que ce n’était ni notre rôle, ni peut-être sa place car enfin dire que les projets de M.Georges Bonnet sont des projets qui ne heurtent pas la démocratie, alors cela voudrait dire que tout ce que Vincent Auriol et Léon Blum ont enseigné au Parti, depuis des dizaines d’années, tout cela était complètement faux et complètement démenti par les évènements ? (Applaudissements.)
Voyons, camarades ! Mais enfin je me rappelle toute la bataille que nous avons mené contre la superfiscalité Poincaré ; dieu sait si nous avons mené la bataille sous la conduite de Léon Blum contre la superfiscalité Poincaré !
Mais vous savez la superfiscalité Georges Bonnet c’est encore bien autre chose !
Et je veux me rappeler que ce qui constitue des originalités du Front populaire, ce qui fait sa force dans notre pays, c’est que justement ce n’est pas simplement une combinaison électorale et parlementaire mais c’est une sorte de jonction, de conjonction du prolétariat et des classes ouvrières, et dans notre pays de petite paysannerie, d’artisanerie, ces catégories sociales intermédiaires continuent à jouer un rôle au point de vue social important.
Eh bien, vous savez, en ce qui concerne les classes moyennes, elles sont servies avec M. Georges Bonnet (Applaudissements.)
Que ce soient les dispositions relatives à l’impôt direct sur le revenu.
Que ce soient les dispositions sur l’augmentation des taxes ferroviaires et des tarifs postaux et des droits de douanes ; que ce soit tout cet ensemble de dispositions, elles sont très bien servies !
Et lorsqu’on vient nous dire que les majorations ne portent pas sur les denrées de première nécessité, sur les denrées de consommation, alors véritablement, moi, je ne comprends plus rien du tout ! Les denrées de consommation, elles sont transportées soit par chemin de fer, soit par camions !
Et lorsque vous frappez les tarifs marchandises, d’une augmentation de tarif de 18 %, eh bien, je pense qu’elles auront une répercussion sur le prix de toutes les denrées de première nécessité !
Je ne veux pas me livrer à ce jeu trop facile de dépiautage, de critique par détail de tous les impôts nouveaux et de toutes les taxes de M. Georges Bonnet, mais je veux dire que cela va à l’encontre de tout le programme, de tout l’esprit non seulement du Front populaire, mais de tout ce que le Parti a dit en matière économique, en matière fiscale, en matière sociale (Applaudissements.)
Je sais très bien que Vincent Auriol dans ses projets avait prévu quelques aggravations et quelques ajustements de taxes. Nous n’en étions pas extrêmement satisfaits, d’ailleurs, mais au moins il y avait des contre-parties.
Ces contre-parties, je n’en retrouve aucune, notamment, il y avait un point qui m’avait personnellement beaucoup séduit : il y avait cette obligation pour les compagnies d’assurance de réinvestir 25 % des réserves mathématiques dans les fonds d’Etat (Applaudissements.)
Ça n’y est plus. Mais ce n’est pas étonnant, la politique financière du Front populaire ou du front populaire « ersatz » de M.Chautemps, elle est confiée aux représentants de la Banque Lazare et de l’oligarchie bancaire ! (Vifs applaudissements.)
Non ! Nous sommes des militants, mais nous ne sommes pas encore tout à fait des imbéciles (Applaudissements.)
Alors, camarades, après vous avoir démontré – et je crois que c’est un certain nombre d’idées incontestables – que le gouvernement de M. Chautemps n’est pas un vrai gouvernement de Front populaire, que c’est un ersatz, que le gouvernement de M. Chautemps ne peut pas appliquer le programme de Front populaire, que dès son début et dès ses origines, il va à l’encontre de toutes les directions de ce programme, vous ayant dit que nous ne voulons pas de cela, que nous ne l’avons pas voulu, que nous aurions voulu, pour éviter cela, que l’on fasse appel à l’action socialiste, à l’action ouvrière, c’est-à-dire à l’action de masse, faisant pression sur les pouvoirs publics et le pouvoir parlementaire, je viens vous demander de ne pas vous installer dans le fait accompli. Oh ! je sais, la valeur et la force du fait accompli ! Mais enfin le rôle du Parti n’est pas d’accepter les faits accomplis. Le capitalisme aussi est un fait, et je suppose que le Parti ne s’est jamais installé dans le régime capitaliste (Applaudissements.)
Je vous demande, étant donné les dangers de cet engrenage, que vous sentez tous, qu’au moins aujourd’hui le Parti, dans sa souveraineté, le Parti, émanation de ses congrès fédéraux, le Parti, émanation de toutes se fédérations, dise : Nous n’acceptons pas cela !
Mais non seulement nous n’acceptons pas, mais nous allons travailler à ce que dans le plus bref délai possible, la République française ait de nouveau un véritable gouvernement de Front populaire ! (Applaudissements.)
Voilà l’objectif, voilà la ligne directrice, voilà le but à atteindre dans le plus bref délai. Le gouvernement Chautemps ne peut être qu’une combinaison absolument transitoire et le devoir du Parti est d‘entraîner et d’animer le Front populaire pour déterminer dans ce pays le climat social favorable au retrait de ce ministère qui n’est pas l’émanation des forces populaires de France (Applaudissements.)
Et ici – et je ne veux éviter aucune difficulté, pas plus avec les camarades de l’ex-gauche révolutionnaire qu’avec les camarades de la majorité de la CAP – nous sommes tous d’accord pour dire que si nous ne voulons pas fixer un jour J et une heure H pour la disparition du ministère Chautemps, nous sommes tous d’accord pour dire que le devoir du Parti est dès maintenant de travailler de toutes ses forces, par la mobilisation des masses populaires, à créer une situation telle qu’il ne puisse pas rester au pouvoir ! (Applaudissements.)
Gueret. Est-ce que les ministres doivent se retirer, Zyromski ? Voilà la question !
Zyromski. Je viens de te répondre ! Nous n’avons pas ici à fixer le jour J et l’heure H pour le retrait du ministère !
Lebas. Ah ! Si, si !
Zyromski. Nous avons ici à fixer…
Lebas. Nous poserons la question !
Zyromski. Je n’en doute pas que vous la poserez ! Mais moi, je vous donne la réponse et laissez-moi vous donner ma réponse : Je dis que nous n’avons – te je répète, et nous ne démordons pas de cette position – nous n’avons pas à fixer le jour J et l’heure H pour le retrait des ministres socialistes.
Nous avons à fixer et à déterminer la ligne politique du Parti, l’objectif du Parti qui doit être de réunir dans le plus bref délai possible, dans la mise en mouvement des masses populaires, les conditions sociales pour que le ministère Chautemps soit forcé de se retirer devant ce mouvement… (Applaudissements) comme les capitalistes savent très bien créer un climat favorable quand il s’est agi d’un gouvernement à direction socialiste.
Voilà notre proposition. Vous pouvez la critiquer vous pouvez ne pas la partager, elle est claire, et je dirai maintenant sans aucune gêne, à mes amis de la Gauche révolutionnaire, que je suis convaincu en prenant cette position, d’être pleinement fidèle à l’esprit de toutes nos motions qui basent toute l’action du socialisme sur le mouvement constant et permanent des masses ouvrières et paysannes et nous préférerions, pour notre part, de beaucoup que le gouvernement Chautemps se retire globalement devant la pression du mouvement des masses populaires, qu’à la suite des incidents de la vie parlementaire.
Voilà notre position et voilà notre conception.
Je voudrais maintenant terminer cette intervention en déclarant que le futur gouvernement de Front populaire devra être à l’image u Front populaire, c’est-à-dire à direction socialiste, avec la participation du Parti communiste qui maintenant a réparé sa lourde faute de refus de participation(Applaudissements.)
Ce gouvernement devra également comporter la collaboration permanente et active de la grande force syndicale unifiée, de la classe ouvrière française, la Confédération Générale du Travail. (Applaudissements.)
Voilà comment je vois le futur gouvernement de Front populaire et je n’exclus aucun des éléments bourgeois, aucune des éléments démocrates qui veulent accepter loyalement cette formation et cette constitution.
Ce nouveau gouvernement ainsi constitué, ce nouveau gouvernement reprenant intégralement le programme du Front populaire, ne devra pas oublier ce que le premier gouvernement de Front populaire a, malgré tout, un peu trop oublié : qu’il ne suffit pas d’avoir une majorité parlementaire cohérente et fidèle pour mener une politique de Front populaire.
Il faut se souvenir que le Front populaire, ce n’est ni le cartel électoral des gauches, ni la participation ministérielle ; ce n’est aucune de ces formes d’action périmées d’autrefois, que nous avons combattues, que nous avons eu raison de combattre.
Le Front populaire est avant tout un mouvement de masse, surgi de la profondeur du pays républicain, démocrate et prolétarien, et plus les résistances augmentent, plus les obstacles sont accumulés, plus il est indispensable de les conjuguer et de coordonner la force de l’action parlementaire, la force de l’action gouvernementale, avec la force d’un mouvement des masses populaires dans le pays ! (Applaudissements.)
J’ai le sentiment, j’ai la conviction que depuis déjà plusieurs semaines, cette conception était absente du premier gouvernement de Front populaire à direction socialiste : avant le conseil national du 16 avril que nous avons tenu dans la mairie de Puteaux – permettez-moi de la vous le rappeler- je me rappelle avoir écrit dans la « Vie du Parti » que le soutien actif des masses populaires était à la fois la raison d’être et la condition d’un succès d’un gouvernement de Front populaire.
Quelques semaines après, parce que l’on a oublié cette notion et que vous êtes enfermés dans le cadre parlementaire, dans le cadre strictement constitutionnel, vous n’avez pas cru devoir faire appel à ces forces profondes et à ces réserves actives du pays, qui sont la raison d’être et la garantie du succès du mouvement prolétarien et démocratique ; vous avez déterminé un échec redoutable du Front populaire.
Et maintenant, il faut réparer cet échec, mais il faut le réparer dans des conditions beaucoup plus difficiles et dans des conditions beaucoup plus délicates. Non, je ne veux pas attendre !
Non je ne veux pas m’installer dans le gouvernement Chautemps !
Il y a des hommes qui y sont délégués, soit ! Ils sont dans un tunnel, il faut sortir du tunnel le plus vite possible. (Applaudissements.)
Le devoir du Parti est dire clairement la route à suivre, la voie à tracer, la ligne qu’il faut développer. Réunir en utilisant toutes les occasions – et M. Georges Bonnet nous fournit toutes les occasions avec un générosité toute américaine – (applaudissements.) Il faut utiliser toutes les occasions pour déterminer un mouvement qui portera le vrai gouvernement de Front populaire.
Quelques voix. Ce soir ?
Zyromski. Vous allez me dire : « Mais vous brisez le Front populaire ». Non, camarades, je sauve encore le véritable Front populaire dans le pays ! (Applaudissements.)
Je suis convaincu que je sauve véritablement le Front populaire dans le pays, mouvement de masses que vous désillusionnez, que vous acculez aux déceptions ! (Quelques applaudissements.)
Voilà ce que j’ai la sensation de faire aujourd’hui ; le seul moyen de conserver et de garantir le Front populaire est de prendre cette attitude.
Attitude courageuse, attitude difficile ; c’est le cas de rappeler le mot de Léon Blum : « tout est difficile. » Il faut, voyez-vous, au plus vite réparer les erreurs. Il faut au plus vite réparer les dégâts.
Je suis convaincu que si sous une forme quelconque, même en pimentant de quelques conditions et de quelques garanties supplémentaires, votre motion, vous disiez que vous acceptiez le fait accompli, quitte à demain, dans une échéance lointaine, faire autre chose…cela ne suffit pas !
Nous ne voulons pas d’échéances lointaines et vagues !
Nous voulons les échéances rapprochées par la claire compréhension du Parti, de son devoir et de tout son devoir ; c’est ce que nous demanderons au Parti de proclamer avec la conviction que nous servons véritablement notre Parti, que nous devons lui épargner les erreurs, les défaillances, les abandons d’autres partis, avec la volonté de préparer, de conquérir, l’avenir socialiste ! (Très vifs applaudissements.) »