La carrière politique de Pierre Drieu La Rochelle après 1934 s’avéra un fiasco complet. De 1936 à 1939, il participa au Parti Populaire Français de Jacques Doriot, tentant de s’en faire l’intellectuel et écrivant des documents cherchant à présenter celui-ci comme le Führer français, comme dans Avec Jacques Doriot :
« Nous avons vu vivre, travailler, Jacques Doriot.
Nous avons vu le fils du forgeron, nous avons vu l’ancien métallurgiste dans la houle de ses épaules et de ses reins, dans le hérissement de sa toison, dans la vaste sueur de son front, continuer et épanouir devant nous le travail de quinze ans.
Devant nous, il a pris à bras-le-corps toute la destinée de la France, il l’a soulevée à bout de bras comme un grand frère herculéen (…).
Jacques Doriot et les faits, ça ne fait qu’un.
Jacques Doriot a été ouvrier métallurgiste, il en a gardé quelque chose, en cela comme dans le reste. Il sent la vie comme une réalité massive, comme un bloc de métal qu’il s’agit de laminer, de découper, de forger. »
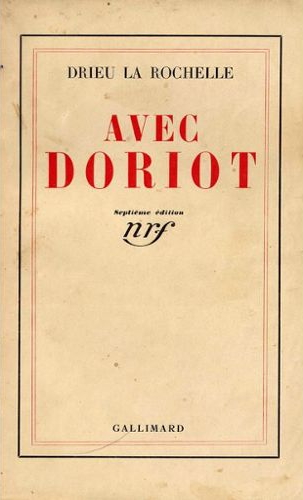
On est ici dans une mythologie viriliste, comme dans Jacques Doriot ou la vie d’un ouvrier français, où on lit :
« Ceux qui ont vu alors Jacques Doriot [en 1925 lors d’une grève générale, la police réprimant les manifestants, Drieu La Rochelle n’assistant pas à la scène], seul, tenir tête à 200 policiers, foncer dans le tas, faire tourner un guéridon de café au-dessus de sa tête, soulever des grappes sur ses puissantes épaules, ne s’effondrer qu’à l’épuisement complet, savent qu’il y a en France au moins un homme politique qui est un homme. »

Pierre Drieu La Rochelle, qui fut même l’éditoritaliste de l’organe du Parti Populaire Français, L’Émancipation nationale, rompra avec Jacques Doriot lorsqu’il découvrira qu’il avait accepté des subsides de l’Italie fasciste, s’apercevant surtout du mode de vie opportuniste et parasitaire du prétendu Führer tant attendu.
Mais il reviendra dans ce parti en novembre 1942, pour montrer sa « préférence » fasciste à l’occupant nazi qui mène une « politique vaseuse », dans un acte de fuite en avant complet, pour simplement assumer son erreur.
Le 10 juin 1944, dans son Journal intime, Pierre Drieu La Rochelle écrit en effet :
« Le regard tourné vers Moscou. Dans l’écroulement du fascisme, je rattache mes dernières pensées au communisme.
Je souhaite son triomphe, qui me paraît non pas certain immédiatement, mais probable à une plus ou moins longue échéance. Je souhaite le triomphe de l’homme totalitaire sur le monde.
Le temps de l’homme divisé est passé, le temps de l’homme réuni revient. Assez de cette poussière dans l’individu, de cette poussière d’individus dans la foule.
Et puis le moment est revenu pour l’homme de se courber, d’obéir… à une voix plus forte en lui que toutes les voix. Staline, c’est donc mieux qu’Hitler le triomphe de l’homme sur l’homme, du plus fort de l’homme contre le plus faible.
Et que cette Église soit brûlée jusqu’au fondement, cette Eglise morte, qui a fini son temps depuis longtemps. »
Et le 28 juin :
« Je ne quitterai pas Paris, je mourrai quand les Américains arriveront à Paris. Je ne crois pas que je puisse me rallier décemment au communisme. J’ai été trop anticommuniste de fait, sinon de fond.Bien que croyant depuis longtemps au socialisme, je me suis carrément détourné de la forme communiste du socialisme à partir de 34, après avoir beaucoup hésité entre 1926 et 1934.
Encore au moment du 6 février, j’ai cru à la possibilité d’une entente entre les préfascistes et les communistes. En venant chez Doriot, j’ai été heureux de me rapprocher de communistes.
Mais ensuite, j’ai adhéré à la lutte anticommuniste, à la lutte surtout contre les communistes. Je ne croyais pas à la capacité des communistes russes de réussir des révolutions en-dehors de chez eux.
Les exemples de Chine, d’Espagne me confirmaient dans cette vue. Je croyais que la logique socialiste s’imposait au fascisme comme malgré lui, et que surtout la guerre activerait l’involution socialiste du fascisme.
J’étais intellectuellement très hostile au dogmatisme marxiste, au matérialisme même très assoupli.
J’étais surtout plein de répugnance pour les communistes français à cause de tout ce qui subsistait en eux d’anarchiste, de pacifiste, de libertaire, de petit-bourgeois.
Pourtant, j’avais de la sympathie pour leur sincérité, leur dévouement. Je craignais aussi la mainmise des Juifs sur eux.
Entre 1939 et 1942, j’ai cru à une décadence, à une dégénérescence du communisme à cause de son caractère ouvriériste, de sa tendance à détruire les élites (!). Mon voyage si bref à Moscou ne m’avait rien appris bien au contraire.
La liaison que j’ai eue pendant des années avec la plus riche des bourgeoises a aussi émoussé ma réflexion, bien que ma décision fasciste était prise le 6 février, un an avant de la connaître.
C’est tout bonnement la victoire russe qui m’a rouvert les yeux, comme à tous : cela est infiniment vexant (…).
Rien ne me sépare plus du communisme, rien ne m’en a jamais séparé que ma crispation atavique de petit-bourgeois. Mais cela est énorme et a engendré des paroles et des attitudes auxquelles il vaut mieux rester fidèle, auxquelles je ne puis que rester fidèle. »