Il ne faut pas se tourner vers les Lumières, vers Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), ou Voltaire (1694-1778) par exemple.
Ceux-ci comptent naturellement mais à l’arrière-plan, car la France est façonné historiquement autour de la question de l’État, des évolutions techniques et du rapport à la loi.
C’est ce que le poète Joachim Du Bellay (1522-1560) résumait déjà parfaitement à son époque avec son fameux « France, mère des arts, des armes et des lois ».
Pour reprendre la formule, l’évolution des « arts » (au sens d’artisanat, technique) était apportée par la bourgeoisie, les armes relevaient de l’État, restait alors la question des lois.
Il faut ici se tourner vers l’ouvrage historiquement majeur du XVIIIe siècle sur le plan révolutionnaire : De l’esprit des lois, de Montesquieu, paru en 1745 à Genève en Suisse.
Ce très long ouvrage en plusieurs volumes (grosso modo un peu moins de six cent pages au total) pose une thèse essentielle dans les livres XXX et XXXI.
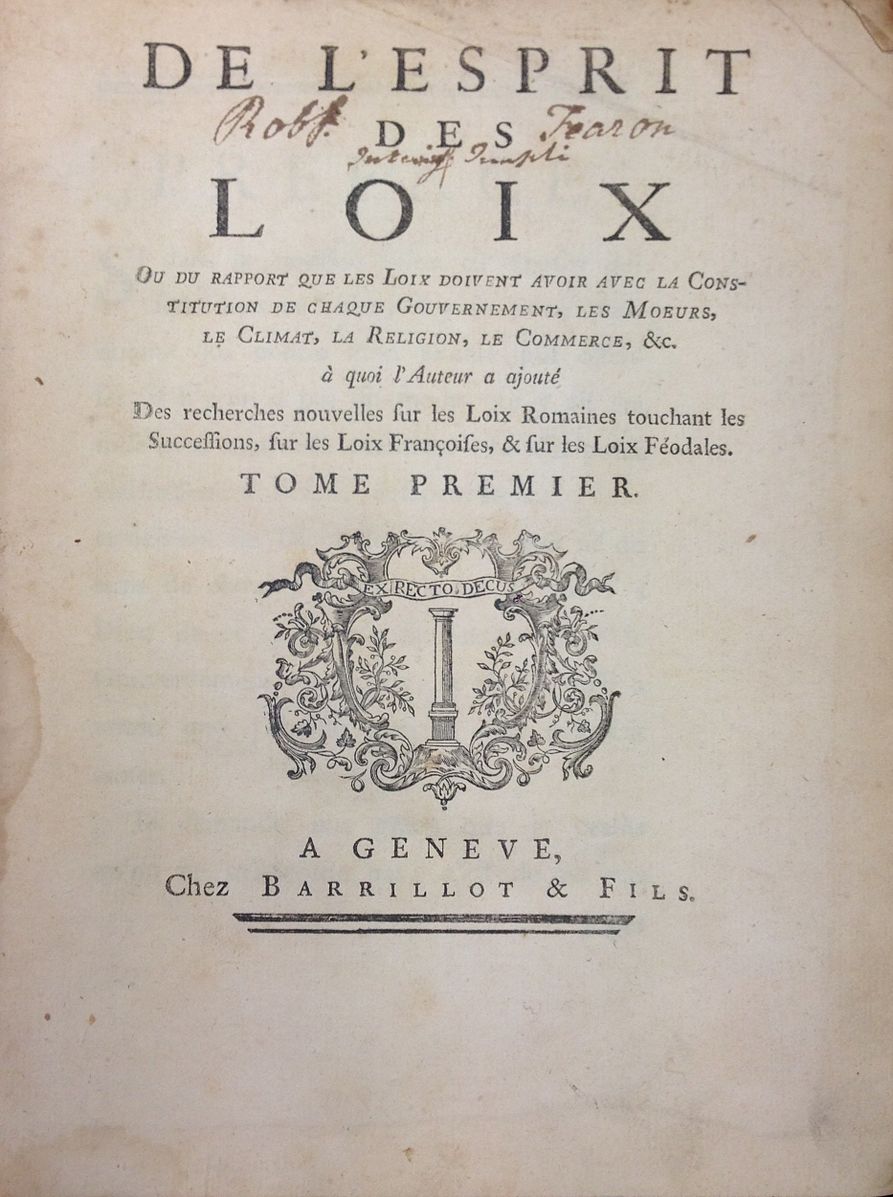
Le livre XXX s’intitule « Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la Monarchie » et le livre XXXI « Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur Monarchie ».
Cela n’a pas été souligné (voire même remarqué) par les commentateurs bourgeois, mais cette question « franque » était déjà au cœur de la grande polémique entre les protestants et la monarchie au XVIe siècle.
Les protestants remettaient alors en cause le roi comme étant devenu un tyran ayant modifié dans un mauvais sens les normes juridiques historiques instaurés à l’époque des Francs envahissant la Gaule romaine.
Montesquieu procède avec la même approche justificatrice par l’Histoire et d’ailleurs les livres XXX et XXXI concluent l’ouvrage en composant le tome quatre.
L’idée est la suivante : les fiefs étaient initialement remis à des figures utiles à l’État, en devenant acquis perpétuellement à quelqu’un et à ses descendants cela aboutit à une dégénération des propriétaires et à un affaiblissement de l’État.
Et, selon Montesquieu, on est dans le même cas de figure au XVIIIe siècle qu’à l’époque de Hugues Capet : l’État s’est trop dilué. Il dit ainsi :
« L’hérédité des fiefs, & l’établissement général des arrière-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, & formèrent le gouvernement féodal.
Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n’en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent.
Les rois n’eurent presque plus d’autorité directe : un pouvoir qui devoit passer par tant d’autres pouvoirs, & par de si grands pouvoirs, s’arrêta ou se perdit avant d’arriver à son terme.
De si grands vassaux n’obéirent plus ; & ils se servirent même de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir.
Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Rheims & de Laon, restèrent à leur merci. L’arbre étendit trop loin ses branches, & la tête se sécha.
Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd’hui l’empire.
On donna la couronne à un des plus puissants vassaux. »
D’où la thèse mise en avant en découlant forcément et mise en avant, en 1776, par Pierre-François Boncerf dans « Les inconvéniens des droits feodaux ou Réponse d’un Avocat au Parlement de Paris, à plusieurs Vassaux des Seigneuries de… de… etc. ».
C’est un ouvrage capital, dont l’argumentation est la suivante : les aristocrates sont issus d’une systématisation de fiefs relevant initialement du mérite chez les Francs.
C’est la même idée que chez Montesquieu.
Boncerf résumé cela ainsi :
« Les Rois de la seconde Race songèrent à faire revivre l’ancienne institution des Francs, qui, divisés par centaine, avaient un chef choisi par les soldats ; cette institution militaire avait fini avec les conquêtes : il fut ordonné que tout homme libre s’attacherait un chef, à un soldat plus âgé que lui, senior, qu’il se lierait par le nœud de la recommandation et qu’il le suivrait à la guerre.
Ce nouveau lien fut d’abord purement personnel, mais il dégénéra insensiblement, et la subordination, devint dépendance et servitude.
L’héritier du chef crut avoir un droit à son titre comme à ses biens, il compta le vassal parmi les biens de la succession, et bientôt le vasselage fut regardé comme un rapport entre les possessions et non plus entre les personnes.
Les Comtes et les Ducs s’emparèrent des terres domaniales y attachèrent les droits qui n’étaient attachés qu’à leurs Offices, la puissance publique s’affaiblit, et son action fut interceptée.
Le faible chercha l’appui du plus fort, et acheta, par la perte de sa propriété, le droit d’usurper celle des autres : ainsi se forma cette chaîne de protecteurs et de protégés, d’oppresseurs et d’opprimés de tyrans et d’esclaves qui inondèrent la France. »
Boncerf dit alors que la situation est désormais intenable, alors que, qui plus est, les aristocrates eux-mêmes sont confrontés à une situation nouvelle.
Ils développent en effet leurs richesses, mais c’est un tel chaos juridique que, même pour eux, les questions de l’héritage et de la gestion de leurs possessions sont compliquées en raison de l’inextricable division administrative-judiciaire du pays et de l’importance de l’Église catholique romaine cherchant à renforcer ses propres positions.
Il leur faut, pour récolter ce qui leur revient de droit, un très nombreux personnel (collecteur, sergent, comptable, etc.), alors qu’en plus il y a des tergiversations perpétuelles sur « le droit, la quantité ou la manière de payer », avec des procès, d’autres seigneurs ayant des exigences, etc.
Partant de là, il vaut mieux pour les aristocrates que, tout en gardant leur statut, ils reconnaissent le droit de propriété :
« Ce n’est qu’une affaire de calcul, ils [les Seigneurs] sont las d’aliéner les droits de leurs Fiefs et la plupart le feront volontairement, s’ils y trouvent comme je vais le démontrer, le moyen de tripler, et même de quadrupler leurs revenus, sans rien perdre des droits honorifiques. »
Il faut donc abolir les fiefs en dédommageant les aristocrates, ce qui est dans leur intérêt personnel par ailleurs, et en maintenant leur statut.
On devine naturellement que Boncerf et Montesquieu reflètent l’idéologie monarchiste constitutionnelle à l’anglaise.
Boncerf souligne d’ailleurs que c’est l’intérêt de la monarchie absolue elle-même, puisqu’elle se veut un État toujours plus en mesure de se renforcer.
« La prospérité des États est en raison de la liberté des personnes, des choses et des actions.
Ces trois genres de liberté rejettent l’esclavage des personnes, les différentes servitudes établies sur les fonds par le Droit féodal et les obstacles qu’apportent au commerce les privilèges de vente et de fabrications, et ensuite les péages douanes et prohibitions.
Nous ne dirons rien de fa liberté du commerce, qui est celle des actions. Le Ministre éclairé qui le protège lui assurera tous les avantages qui pourront le faire prospérer.
L’esclavage des personnes fit régner avec lui l’ignorance ; il bannit les arts, rendit la nature sauvage, et plongea la France dans le chaos d’où elle n’a commencé à sortir qu’à l’époque des affranchissements.
Les affranchissements ont créé les villes, les citoyens, les arts les lettres et Ies bonnes lois.
Les succès des premiers en déterminèrent d’autres imités par les seigneurs et bientôt libre et François [Français] furent synonymes (…).
Les droits féodaux, pour de médiocres produits, présentent mille embarras et difficultés, tant au Seigneur qu’au vassal (…).
L’opération serait très-simple ; le Roi permettrait à tous ses vassaux de racheter toutes rentes, devoirs et servitudes féodales (…).
Au moyen de ce rachat, tous les héritages relevant du Domaine, seraient et demeureraient à jamais francs et libres comme les personnes même des François et seraient possédés optimo jure [avec tous les droits] (…).
Ainsi tomberait la myriade des Lois féodales, labyrinthe multiplié comme les Coutumes et leurs droits (…).
La conservation des institutions Féodales n’est utile, ni à l’ordre public, ni au Roi, ni à l’État ni aux particuliers (…).
La Féodalité contrarie la production des richesses naturelles, elle n’est point analogue aux mœurs et aux intérêts actuels de la Nation ; ni la vieille opinion qui protège la Féodalité, ni son antiquité ne peuvent empêcher les bons effets des affranchissements volontaires. »
Boncerf pensait que ce point de vue reflétait, somme toute, celui de la monarchie absolue cherchant à se renforcer, quitte à céder davantage à la bourgeoisie.
C’était une erreur fatale, dans la mesure où la monarchie absolue était une superstructure de la féodalité.
En conséquence, le Parlement de Paris entièrement aux mains de la monarchie absolue depuis son écrasement condamna l’ouvrage de Boncerf à « être lacérée et brûlée au pied du grand Escalier du Palais, par l’Exécuteur de la Haute-Justice ».
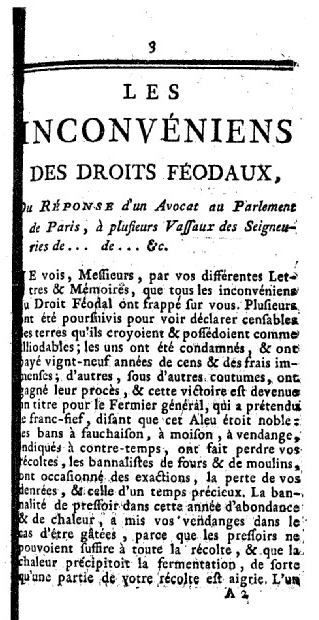
Le régime refusait de faire disparaître la noblesse juridiquement : toute réforme dans le sens d’une monarchie constitutionnelle, avec une monarchie d’un côté, une noblesse extirpée du féodalisme et une bourgeoisie conquérante de l’autre, s’avérait impossible.
Le régime s’arc-boute une dernière fois.
Le 30 mars 1776, le régime annonce par une décision du parlement qu’il a compris que son refus de réforme annoncé par l’écrasement de l’ouvrage de Boncerf exigeait de s’arc-bouter sur lui-même.
Cela montre qu’à la veille de 1789, seule la voie révolutionnaire est possible pour que la bourgeoisie puisse devenir plus ample.
Sur le plan juridique comme idéologique, le régime signe là son arrêt de mort.
« Ce jour, toutes les chambres assemblées, la Cour considérant qu’il importe à la tranquillité publique de maintenir de plus en plus les principes anciens et immuables qui doivent servir de règle à la conduite des Peuples, et quelques esprits inquiets ont paru vouloir altérer en essayant de répandre des opinions systématiques et des spéculations dangereuses :
Considérant en outre que de la licence à laquelle se sont livrés ces esprits inquiets il est déjà résulté en divers lieux des commencements de trouble également contraires à l’autorité du Roi, au bien de l’État aux droits de propriété des Seigneurs, et aux véritables intérêts du Peuple ;
Considérant enfin qu’il est de son devoir et conforme aux intentions du Roi, de maintenir l’ordre public, fondé sur la Justice et, sur les Loix et auquel la Monarchie doit, depuis tant de siècles, sa prospérité, sa gloire et sa tranquillité : Ouïs les Gens du Roi.
La dite Cour a ordonné et ordonne à tous les Sujets du Roi, Censitaires, Vassaux et Justiciables des Seigneurs particuliers de continuer, comme par le passé, à s’acquitter, soit envers ledit Seigneur Roi, soit envers leurs Seigneurs particuliers, des droits et devoirs dont ils sont tenus à leur égard, selon les Ordonnances du Royaume,Déclarations et Lettres-Patentes du Roi, duement vérifiées, registrées et publiées en la Cour, Coutumes générales et locales, reçues et autorisées, titres particuliers et possessions valables des Seigueurs.
Fait très expresses inhibitions et défenses d’exciter, soit par des propos, soit par des écrits indiscrets, à aucune innovation contraire auxdits droits et usages légitimes et approuvés, sous peine, contre les contrevenans, d’être poursuivis extraordinairement comme réfractaires aux Loix, perturbateurs du repos public, et de punition exemplaire :
Enjoint à tous les Juges du ressort d’y tenir la main chacun en droit soi ; ordonne qu’à cet effet le présent Arrêt sera, à la poursuite et diligence du Procureur Général du Roi, incessamment envoyé à tous les Bailliages et Sénéchaussées du ressort, même aux Justices seigneuriales ressortissantes immédiatement en la Cour, à l’effet d’y être lu, publié, registré et exécuté selon sa forme et teneur ; enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi, et aux Procureurs-Fiscaux d’y faire procéder sans délai, et d’en certifier la Cour ce mois :
que le présent Arrêté sera imprimé, publié et affiché en cette Ville de Paris, et par-tout où besoin sera.
Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le trente Mars mil sept cent soixante-seize. »
->Retour au sommaire du dossier sur
La France à la veille de 1789