La CGT-Force Ouvrière est ainsi née comme plate-forme syndicale anticommuniste, mais dans un sens également violemment anti-politique.
Par conséquent, elle sait qu’elle est anticommuniste mais elle ne raisonne pas du tout par rapport à cela.

Le syndicalisme de la CGT-FO s’imagine au-delà de la politique et la base de sa conception, c’est un rejet viscéral de l’État et une volonté de négociation professionnelle directe avec le patronat.
Comme l’a formulé Marc Blondel, secrétaire général de 1989 à 2004, en 1995 :
« Plus nous serons capables de discuter avec le patronat, et plus nous remettrons l’État à sa place. »
La CGT-FO représente ici toute une tradition syndicaliste dont le point culminant est la charte d’Amiens.
Il ne fait pas de politique, il représente les intérêts directs des travailleurs dans leur contrat avec le patronat.
La CGT a la même démarche, mais considère qu’elle doit être une force allant dans le sens de la cogestion des affaires étatiques et des entreprises.
La CGT-FO réfute catégoriquement cela, ce qui unit dans les faits, en son sein, les réformistes opposés par principe à une telle démarche et l’ultra-gauche qui prétend vouloir tout chambouler.
Ce chamboulement est censé, naturellement, avoir une dimension syndicaliste, dans la tradition de la CGT des origines et du socialisme français à la Proudhon.
Pour les réformistes de la CGT-FO comme pour sa minorité « ultra », le syndicalisme est porté par des individus libres, rétifs à tout « totalitarisme », car opposé à toute décision de portée étatique.

Dans un article sur La force de l’indépendance syndicale, en 1996, Marc Blondel présente de la manière suivante cette perspective commune :
« Ce que la Charte d’Amiens a apporté, c’est la notion d’indépendance syndicale et celle de majorité du syndicalisme.
On ne sera donc pas surpris que, depuis 1906, des arguments dilatoires, des interprétations, soient périodiquement développés contre cette Charte d’Amiens, notamment « pour justifier la nécessité d’adapter le syndicalisme ».
Il est indéniable que le syndicalisme a toujours été à la fois courtisé et attaqué.
Courtisé, car à l’encontre des mauvais coups que l’on veut lui faire subir, c’est le syndicalisme qui, historiquement, détient la clé du comportement des forces sociales ouvrières.
Attaqué de toutes parts, et plus particulièrement quand la situation le conduit à être force de résistance, le syndicalisme devient alors gênant.
La tentation alors pour les gouvernants, quels qu’ils soient, d’essayer d’intégrer le syndicalisme, d’abord dans l’entreprise puis dans les rouages de l’État, est elle aussi cyclique.
Ce qui est toujours en cause, c’est l’indépendance et le droit permanent à la liberté de comportement, qui ne peuvent qu’être le privilège d’un syndicalisme authentiquement libre. »
La CGT-Force Ouvrière n’est ainsi pas un syndicat de cogestion, pas plus qu’il n’est favorable au corporatisme.
Ses activistes sont pour des revendications allant dans le sens de conquêtes sociales, avec une minorité espérant que cela aille « jusqu’au bout ».

Il y a donc des différences de sensibilité entre ceux qui acceptent le capitalisme et ceux qui pensent, dans un sens anarchiste ou trotskiste, qu’il y aura son dépassement.
Les premiers forment une écrasante majorité, pétrie de ses certitudes, qui ne voit aucun souci à l’existence d’une minorité, du moment qu’elle reste antipolitique dans sa démarche syndicale.
André Bergeron (1922-2014), qui fut le dirigeant de 1963 à 1989, reflète tout à fait cette conception majoritaire lorsqu’il dit au congrès de 1966 :
« La lutte de classes, elle existera longtemps encore, et, c’est là mon opinion personnelle, elle existera sans doute toujours. »
La clef, c’est le syndicat indépendant et porté par une base unie au point d’assécher toute question politique.
André Bergeron, dans l’article Le sens d’une victoire en 1983 dans Force Ouvrière Hebdo du 26 octobre 1983, résume cela ainsi :
« Force Ouvrière n’est, par principe, ni pour ni contre les gouvernements, ni celui de maintenant, ni ceux d’avant Mai 1981.
La Confédération n’est pas au même endroit.
Elle n’assume pas les mêmes responsabilités.Les gouvernements dirigent l’État.
Le mouvement syndical défend les intérêts de ceux qu’il représente. »
Le syndicat se limite aux questions professionnelles et considère que cela a un sens échappant à la politique.
Ce n’est évidemment pas le cas et en fait, la contradiction fondamentale de la CGT-FO repose en fait sur son incapacité à se décider si elle est davantage en conflit avec le patronat ou avec l’État.
En pratique, elle ne l’est ni avec l’un ni avec l’autre, car elle est historiquement un simple produit du dispositif anticommuniste, et sa démarche dégénère systématiquement dans le sens de la corruption sociale, c’est-à-dire dans la mise en place d’une aristocratie ouvrière.
Cela se veut justifié par l’idée qu’il s’agit d’arracher des droits coûte que coûte, dans un rapport conflictuel allant… jusqu’à l’entente cordiale, en sous-main, et même l’institutionnalisation.
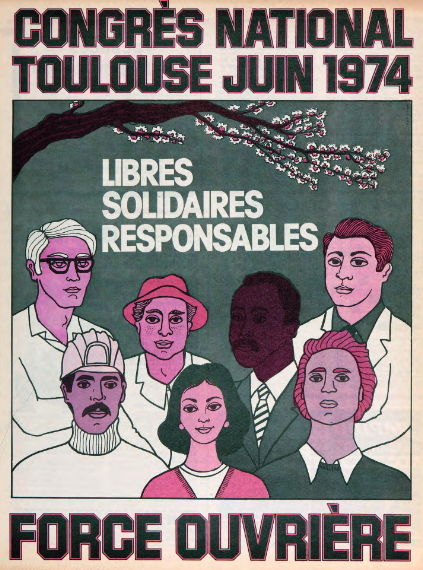
Ainsi, la ville de Marseille est pratiquement cogérée depuis le début des années 1950 par la mairie et la CGT-FO, depuis une alliance avec le maire SFIO Gaston Defferre.
C’est vrai au point que Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille au milieu des années 1990 jusqu’au moins en 2019, s’est vu remettre une carte de membre d’honneur du syndicat en 2014.
Le secrétaire général Force ouvrière des territoriaux de la ville a comme surnom le « vice-roi de Marseille ».
Une affaire connue est aussi celle de la « caisse d’entraide » de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, un syndicat patronal de la plus haute importance (la seule structure syndicale non dissoute par le régime de Vichy).
600 millions d’euros furent amassés depuis 1972 et distribués aux syndicats anticommunistes.
De plus, la CGT-FO reçoit des fonds publics, à hauteur de pratiquement le tiers de ses ressources ; le syndicat est une composante essentielle, à hauteur de 10-15 % des voix aux élections, de toutes les instances où les syndicats relèvent directement des institutions.
La CGT-Force Ouvrière relève ainsi du mythe bien français que présente la charte d’Amiens ; elle est l’expression culturelle la plus pure du rejet du marxisme et de la tradition social-démocrate qui en est issue en Allemagne et en Autriche à la fin du 19e siècle.