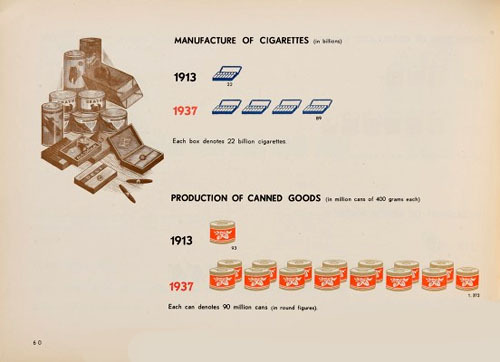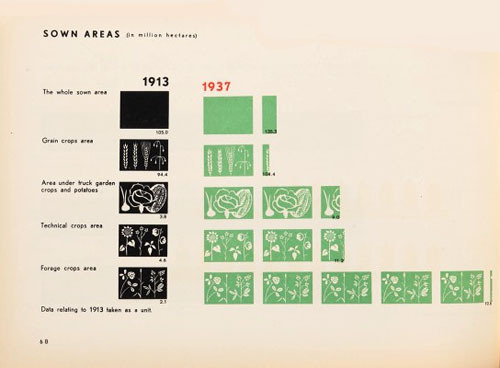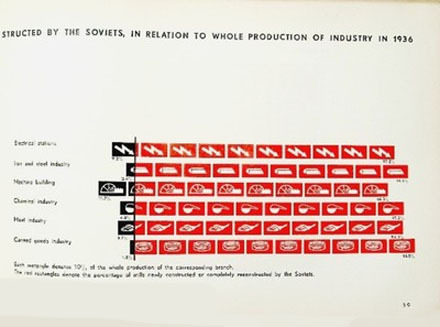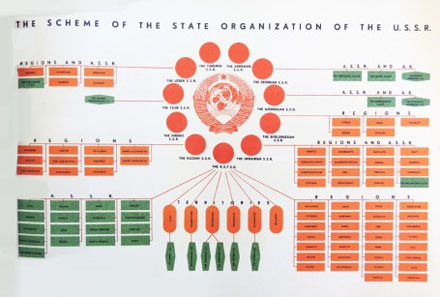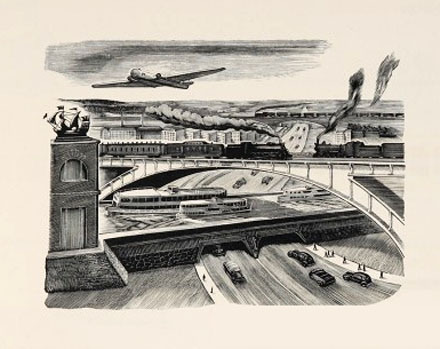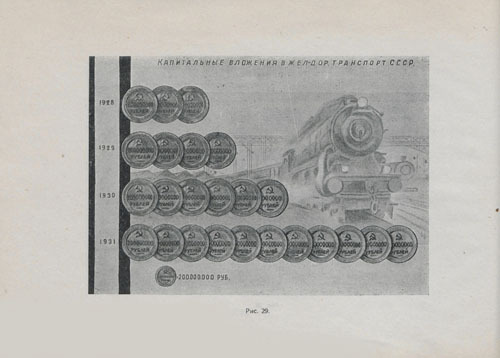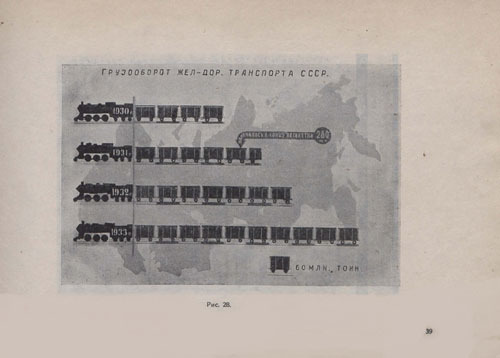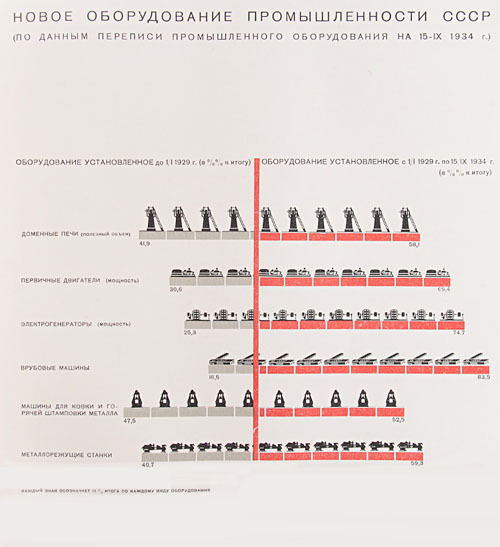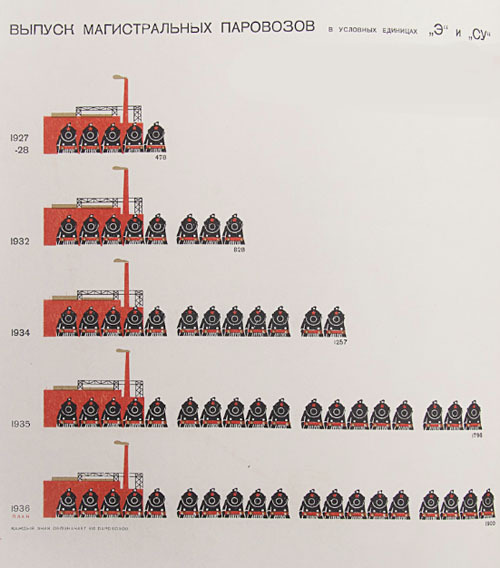En commémoration du 100e anniversaire de la naissance du grand Lénine
Renin Ribao, Hongqi, Jiefangjun Bao, 22 avril 1970
« Le léninisme est le marxisme de l’époque
de l’impérialisme et de la révolution prolétarienne. »
Staline, Des principes du léninisme
I. LE DRAPEAU DU LÉNINISME EST INVINCIBLE
Le 22 avril marque, cette année, le centième
anniversaire de la naissance du grand Lénine.
C’est avec le plus profond respect pour le grand
Lénine que les marxistes-léninistes, le prolétariat et les peuples
révolutionnaires du monde entier commémorent cette journée
historique.
Lénine fut, après la mort de Marx et d’Engels,
le grand dirigeant du mouvement communiste international, le grand
éducateur du prolétariat et des peuples opprimés du monde entier.
En 1871. dans l’année qui suivit la naissance de
Lénine, éclata l’insurrection de la Commune de Paris, qui fut la
première tentative du prolétariat pour renverser la bourgeoisie.
Lorsque Lénine commença ses activités
révolutionnaires — fin du XIXe, début du XXe siècle —, le
monde entrait dans l’époque de l’impérialisme et de la révolution
prolétarienne. Dans sa lutte contre l’impérialisme et les
opportunismes de toute espèce et, en particulier, contre le
révisionnisme de la IIe Internationale, Lénine continua, sauvegarda
et développa le marxisme, le faisant accéder à une étape
nouvelle, celle du léninisme.
Tout comme Staline l’a dit, « le léninisme
est le marxisme de l’époque de l’impérialisme et de la révolution
prolétarienne » (J. V. Staline : « Des principes du
léninisme »).
Lénine analysa les contradictions de
l’impérialisme, mit en évidence ses lois et résolut toute une
série de questions d’importance majeure concernant la révolution
prolétarienne à l’époque de l’impérialisme, et notamment la
suivante : le socialisme « triomphera d’abord dans un seul
ou dans plusieurs pays » (V. I. Lénine : « Le
programme militaire de la révolution prolétarienne »).
Il exposa en termes explicites l’idée que le
prolétariat doit s’assurer la direction dans la révolution
démocratique bourgeoise, et dirigea le prolétariat russe dans cette
répétition générale que fut la révolution de 1905.
La Grande Révolution socialiste d’Octobre dirigée
par Lénine permit la transformation fondamentale du monde ancien,
capitaliste, en un monde nouveau, socialiste, inaugurant ainsi une
ère nouvelle dans l’histoire de l’humanité.
Dans les domaines de la théorie comme de la
pratique, la contribution de Lénine à la cause de la révolution
prolétarienne est immense.
A la mort de Lénine, Staline continua et
sauvegarda la cause du léninisme dans la lutte contre les ennemis de
classe de l’intérieur et de l’extérieur du pays, et contre les
opportunistes de droite et « de gauche » au sein du
Parti.
Sous la direction de Staline, le peuple soviétique
poursuivit son avance dans la voie du socialisme et remporta de
grandes victoires. C’est toujours sous la conduite de Staline qu’il
devint, au cours de la Seconde guerre mondiale, le principal artisan
de la victoire sur l’agression fasciste, et qu’il accomplit de
magnifiques exploits qui demeureront à jamais immortels dans
l’histoire de l’humanité.
Les communistes et le peuple chinois n’oublieront
jamais que c’est dans le léninisme qu’ils ont trouvé la voie de
leur émancipation.
Le camarade Mao Tsé-toung a dit : « Les
salves de la Révolution d’Octobre nous apportèrent le
marxisme-léninisme. » « Ils [les Chinois] découvrirent
cette vérité universellement valable qu’est le marxisme-léninisme,
et la physionomie de la Chine se mit à changer. » ( »De
la dictature démocratique populaire »)
Et d’indiquer : « Le peuple chinois a
toujours considéré que la révolution chinoise est la continuation
de la Grande Révolution socialiste d’Octobre. » (Allocution du
président Mao, 17 avril 1957) .
Appliquant la théorie marxiste-léniniste, le
camarade Mao Tsé-toung a résolu de façon créatrice les problèmes
fondamentaux de la révolution chinoise, dirigé le peuple chinois
dans les luttes et les guerres révolutionnaires, les plus longues,
les plus acharnées, les plus dures et les plus complexes de
l’histoire de la révolution prolétarienne mondiale, et conduit la
révolution populaire à la victoire dans un grand pays d’Orient tel
que la Chine.
C’est là la plus grande victoire de la révolution
prolétarienne mondiale depuis la Révolution d’Octobre.
Nous vivons, à l’heure actuelle, une nouvelle et
grandiose époque de la révolution mondiale.
Depuis l’époque où vivait Lénine, la situation
internationale a connu des changements prodigieux.
L’évolution de toute l’histoire mondiale a
corroboré la justesse de la doctrine révolutionnaire de Lénine et
prouvé que le drapeau du léninisme est invincible.
Mais l’histoire connaît des vicissitudes. De même
qu’après la mort d’Engels apparut le révisionnisme de
Bernstein-Kautsky, après la mort de Staline apparut le révisionnisme
de Khrouchtchev-Brejnev.
Au terme de onze ans de pouvoir khrouchtchévien,
une scission s’est produite au sein de la clique révisionniste, et
Brejnev a pris la place de Khrouchtchev ; plus de cinq ans se
sont encore écoulés, et c’est ce personnage qui, aujourd’hui,
préside en Union soviétique la « commémoration » du
centième anniversaire de la naissance de Lénine.
Lénine a fait remarquer : « On a
toujours vu, au cours de l’histoire, qu’après la mort de chefs
révolutionnaires populaires parmi les classes opprimées, les
ennemis de ces chefs tentaient d’exploiter leur nom pour duper ces
classes. » (V. I. Lénine : « L’impérialisme et la
scission du socialisme »)
Le renégat Brejnev et ses semblables n’ont pas
agi autrement avec le grand Lénine.
Dans leurs prétendues Thèses pour le 100e
anniversaire de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine, ils vont
jusqu’à déformer impudemment la grandiose image de l’éducateur
révolutionnaire du prolétariat que fut Lénine, faisant passer leur
pacotille révisionniste pour du léninisme.
Ils feignent de « commémorer » la
naissance de Lénine, alors qu’en réalité ils ne font qu’usurper
son nom pour intensifier la mise en pratique de leur
social-impérialisme, de leur social-fascisme et de leur
social-militarisme.
C’est là une grossière insulte à Lénine !
Dénoncer à fond la trahison des renégats
révisionnistes soviétiques envers le léninisme, mettre à nu le
caractère de classe du social-impérialisme révisionniste
soviétique, faire ressortir la loi historique de la fin inéluctable
à laquelle est voué le social-impérialisme, tout comme
l’impérialisme capitaliste, et donner une nouvelle impulsion à la
grande lutte que mènent les peuples du monde contre l’impérialisme
américain, le révisionnisme soviétique et toute la réaction,
telle est, à l’heure actuelle, notre tâche de combat.
C’est aussi ce qui donne, toute sa signification à
notre commémoration du centième anniversaire de la naissance du
grand Lénine.
II. LA QUESTION FONDAMENTALE DU LÉNINISME, C’EST
LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT
Dans sa lutte contre l’opportunisme, contre le
révisionnisme, Lénine a indiqué à maintes reprises : La
question fondamentale dans la révolution prolétarienne, c’est de
prendre le pouvoir par la violence, de briser la machine d’Etat de la
bourgeoisie et d’instaurer la dictature du prolétariat.
Lénine dit : « Celui-ci [l’Etat
bourgeois] ne peut céder la place à l’Etat prolétarien (à la
dictature du prolétariat) par voie d’« extinction »,
mais seulement, en règle générale, par une révolution violente. »
(V. I. Lénine : « L’Etat et la Révolution »)
Lénine dit encore : La théorie de Marx sur
la dictature du prolétariat « est indissolublement liée à
toute sa doctrine sur le rôle révolutionnaire du prolétariat dans
l’histoire.L’aboutissement de ce rôle, c’est la dictature
prolétarienne » (Ibidem).
La victoire de la Révolution d’Octobre dirigée
par Lénine fut une victoire de la théorie marxiste de la révolution
prolétarienne et de la dictature du prolétariat. La voie de la
Révolution d’Octobre, c’est la voie par laquelle le prolétariat
instaure sa dictature par la révolution violente.
A l’époque de la Révolution d’Octobre, Lénine
fit le bilan de la pratique révolutionnaire nouvelle et développa
encore la théorie marxiste de la dictature du prolétariat.
Il dit notamment : La révolution socialiste,
« c’est toute une époque de conflits de classes aigus »
(V. I. Lénine : « La révolution socialiste et le droit
des nations à disposer d’elles mêmes »), « tant
qu’elle [cette époque] n’est pas terminée, les exploiteurs gardent
inéluctablement l’espoir d’une restauration, espoir qui se
transforme en tentatives de restauration » (V. I. Lénine :
« La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky »).
Par conséquent, il estime que la dictature du
prolétariat « est nécessaire . . . non seulement pour le
prolétariat qui aura renversé la bourgeoisie, mais encore pour
toute la période historique qui sépare le capitalisme de la
‘société sans classes’, du communisme » (V. I. Lénine :
« L’Etat et la Révolution »). Aujourd’hui, tandis que
nous commémorons le centième anniversaire de la naissance de
Lénine, réétudier ces thèses brillantes est d’une très
importante signification pratique.
On sait que c’est précisément sur cette question
fondamentale que constituent la révolution prolétarienne et la
dictature du prolétariat que la clique des renégats révisionnistes
soviétiques a trahi le léninisme et la Révolution d’Octobre.
Dès que le visage révisionniste de Khrouchtchev
commença à se dessiner, le camarade Mao Tsétoung indiqua de façon
pénétrante : « A mon avis, il y a deux ‘épées’ :
l’une est Lénine et l’autre, Staline. Cette épée qu’est Staline,
les Russes l’ont maintenant rejetée. »
« Cette épée qu’est Lénine, n’a-t-elle
pas aussi été rejetée quelque peu par certains dirigeants
soviétiques ? Je pense qu’elle l’a été dans une large mesure.
La Révolution d’Octobre est-elle toujours
valable ? Peut-elle encore servir d’exemple aux différents
pays ?
Le rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès du
P.C.U.S. Dit qu’il est possible de parvenir au pouvoir par la voie
parlementaire ; en d’autres termes, les différents pays
n’auraient plus besoin de suivre l’exemple de la Révolution
d’Octobre. Cette porte une fois ouverte, le léninisme a
étépratiquement rejeté. » (Allocution du président Mao à
la deuxième session plénière du Comité central issu du Ville
Congrès du Parti communiste chinois, 15 novembre 1956)
III. LE COUP D’ETAT CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE DE LA
CLIQUE RENÉGATE DE KHROUCHTCHEV-BREJNEV
Comment le capitalisme a-t-il pu être restauré
en Union soviétique, premier Etat socialiste apparu dans le monde,
et comment ce pays a-t-il pu devenir social-impérialiste ?
Si nous examinons les choses du point de vue
marxiste-léniniste, et surtout à la lumière de la théorie du
camarade Mao Tsétoung sur la continuation de la révolution sous la
dictature du prolétariat, nous pouvons comprendre que cela résulte
essentiellement de la lutte de classes en Union soviétique, de
l’usurpation de la direction du Parti et de l’Etat par une poignée
de responsables du Parti soviétique engagés dans la voie
capitaliste, autrement dit, de l’usurpation du pouvoir prolétarien
par la bourgeoisie de ce pays.
C’est également l’aboutissement de la politique
d’ « évolution pacifique » que, pour échapper à
sa perte, l’impérialisme mondial a poursuivie en Union soviétique
par l’intermédiaire de la clique des renégats révisionnistes
soviétiques.
Le camarade Mao Tsétoung dit : « La
société socialiste s’étend sur une assez ongue période
historique, au cours de laquelle continuent d’exister les classes,
les contradictions de classes et la lutte de classes, de même que la
lutte entre la voie socialiste et la voie capitaliste, ainsi que le
danger d’une restauration du capitalisme. »(Interventions du
président Mao à la réunion de travail du Comité central du Parti
en août 1962 à Peitaiho, et à la Xe session plénière du Comité
central issu du VIIIe Congrès du Parti communiste chinois, en
septembre 1962)
La lutte de classes en société socialiste reste
centrée sur le problème du pouvoir.
Le camarade Mao Tsétoung dit encore : « Les
représentants de la bourgeoisie qui se sont infiltrés dans le
Parti, dans le gouvernement, dans l’armée et dans les différents
secteurs du domaine culturel constituent un ramassis de
révisionnistes contre-révolutionnaires. Si l’occasion s’en
présentait, ils arracheraient le pouvoir et transformeraient la
dictature du prolétariat en dictature de la bourgeoisie. »
(«Circulaire » du Comité central du Parti communiste chinois
en date du 16 mai 1966)
Après la Révolution d’Octobre, bien que la
bourgeoisie eût été renversée en Union soviétique, les classes
et la lutte de classes n’ont jamais cessé d’y exister. Staline
élimina un très grand nombre de représentants de la bourgeoisie,
contre-révolutionnaires, qui s’étaient infiltrés dans le Parti,
notammentles Trotski, Zinoviev, Kaménev, Radek, Boukharine et
Rykov ; ce qui suffit à montrer que la lutte de classes ne
cessa jamais de se poursuivre avec acharnement et que le danger d’une
restauration du capitalisme ne cessa jamais d’être une réalité.
L’Union soviétique était le premier Etat de
dictature du prolétariat ; elle n’avait pas suffisamment
d’expérience pour consolider la dictature du prolétariat et
prévenir la restauration du capitalisme.
Ce fut dans ces circonstances qu’après la mort de
Staline, Khrouchtchev, un responsable engagé dans la voie
capitaliste, dissimulé au sein du Parti communiste de l’Union
soviétique, lança une attaque surprise en faisant un « rapport
secret » qui diffamait Staline avec perfidie et, par toutes
sortes de moyens sournois et de ruses, usurpa la direction du Parti
et de l’Etat soviétiques.
Ce fut un coup d’Etat contre-révolutionnaire qui
transforma la dictature du prolétariat en dictature de la
bourgeoisie et qui, renversant le socialisme, restaura le
capitalisme.
Brejnev a été complice de Khrouchtchev dans ce
coup d’Etat et plus tard a pris sa place. Au fond, son accession au
pouvoir est la suite du coup d’Etat contre-révolutionnaire de
Khrouchtchev. Brejnev, c’est Khrouchtchev II.
Le camarade Mao Tsétoung dit : « Le
révisionnisme au pouvoir,c’est la bourgeoisie au pouvoir. »
(Déclaration du président Mao lors d’un entretien, août 1964)
« En Union soviétique, à l’heure actuelle,
c’est la dictature de la bourgeoisie, celle de la grande bourgeoisie,
une dictature du type fasciste allemand, une dictature du type
hitlérien. » (Déclaration du président Mao lors d’un
entretien, 11 mai 1964)
Ces brillantes thèses du camarade Mao Tsétoung
ont révélé, de façon on ne peut plus pénétrante, le caractère
de classe et l’origine sociale du social-impérialisme
révisionniste soviétique, et montré la nature fasciste de
celui-ci.
Depuis que la clique des renégats révisionnistes
soviétiques a usurpé la direction du Parti et de l’Etat, la couche
privilégiée de la bourgeoisie soviétique a considérablement accru
son pouvoir politique et économique ; elle occupe une position
dominante dans le Parti, le gouvernement et l’armée ainsi que dans
les domaines économique et culturel, et au sein de cette couche
s’est formée une bourgeoisie monopoliste bureaucratique,
c’est-à-dire une grande bourgeoisie de type nouveau, qui a en main
l’ensemble de la machine d’Etat et dispose de toutes les richesses de
la société.
Cette bourgeoisie monopoliste bureaucratique de
type nouveau, profitant du pouvoir d’Etat qu’elle contrôle, a
converti la propriété socialiste en propriété des responsables
engagés dans la voie capitaliste, l’économie socialiste en économie
capitaliste et en économie du capitalisme monopoleur d’Etat. Au nom
de l’« Etat », elle pille avec insolence la trésorerie
et recourt à toutes sortes de moyens pour s’approprier à volonté
les fruits du labeur du peuple soviétique et vivre dans le luxe et
la débauche, en exerçant son despotisme.
Cette bourgeoisie monopoliste bureaucratique de
type nouveau est une bourgeoisie qui a transformé l’espoir d’une
restauration en tentatives de restauration.
Elle soumet à la répression les fils et filles
héroïques de la Révolution d’Octobre, pèse de tout son poids sur
les populations des diverses nationalités soviétiques et a instauré
une petite cour contre-révolutionnaire à elle.
C’est pour ces raisons qu’elle est
archiréactionnaire, qu’elle hait et craint le peuple au plus haut
point.
Cette bourgeoisie monopoliste bureaucratique de
type nouveau, comme toute classe réactionnaire décadente, recèle
en son sein de multiples contradictions.
Pour conserver coûte que coûte les pouvoirs
qu’elle a usurpés, ses éléments agissent en complicité, en même
temps qu’ils intriguent les uns contre les autres et cherchent à
s’évincer mutuellement. Plus difficile est leur situation, plus
violentes se font les luttes, ouvertes ou secrètes, qui les
opposent.
Cette bourgeoisie monopoliste bureaucratique de
type nouveau, pour amasser un maximum de profits et maintenir sa
domination réactionnaire, doit nécessairement se livrer avec
frénésie à l’agression et à l’expansion, se joindre à
l’impérialisme mondial dans le partage du monde et poursuivre une
féroce politique social-impérialiste, tout en exploitant et en
opprimant le peuple de son pays.
Cette bourgeoisie monopoliste bureaucratique de
type nouveau est la base de classe du social-impérialisme
révisionniste soviétique. Brejnev est à l’heure actuelle le
représentant général de cette classe.
Il pratique sans retenue le révisionnisme
khrouchtchévien, qu’il a encore développé, parachevant
l’évolution, commencée sous Khrouchtchev, de la restauration
capitaliste au social-impérialisme.
Depuis son arrivée au pouvoir, Brejnev a étendu
à tous les domaines le prétendu « nouveau système
économique » et entériné par décret le principe capitaliste
du profit, intensifiant ainsi l’exploitation du peuple travailleur
par l’oligarchie monopoliste bureaucratique.
Indifférente au sort du peuple, celle-ci le met
en coupe réglée, applique la politique hitlérienne dite « des
canons et pas de beurre » et accélère la militarisation de
l’économie nationale, pour répondre aux besoins de l’expansion des
armements et des préparatifs de guerre du social-impérialisme.
Les mesures rétrogrades prises par la clique des
renégats révisionnistes soviétiques ont causé un préjudice
incommensurable aux forces productives de la société et ont
entraîné de graves conséquences : déclin de l’industrie,
baisse de la production agricole, diminution du cheptel, inflation,
défaillances du ravitaillement, grave pénurie sur le marché d’Etat
et paupérisation croissante du peuple travailleur.
Les renégats révisionnistes soviétiques n’ont
pas seulement dilapidé les richesses accumulées par le peuple
soviétique grâce à plusieurs décennies de dur labeur, ils
s’avilissent jusqu’à quémander des crédits à l’Allemagne de
l’Ouest, pays vaincu de la Seconde guerre mondiale, voire jusqu’à
brader les ressources naturelles du pays et à ouvrir la Sibérie à
la pénétration du capital monopoleur japonais.
L’économie soviétique se débat aujourd’hui dans
des crises inextricables.
En tant qu’amis du peuple soviétique, le peuple
chinois et les autres peuples du monde éprouvent la plus vive
indignation à l’égard des renégats révisionnistes soviétiques
qui ont réduit à un état si lamentable la patrie du léninisme ;
ils ressentent une profonde sympathie pour le peuple soviétique, sur
qui retombent toutes les souffrances causées par la restauration
généralisée du système capitaliste.
La clique des renégats révisionnistes
soviétiques a affirmé un jour que « la dictature du
prolétariat… a cessé d’être une nécessité en U.R.S.S. »
et que l’Union soviétique « s’est convertie … en Etat de
tout le peuple » ( »Programme du P.C.U.S. » adopté
au « XXIIe Congrès » du RÉVISIONNISME soviétique).
Maintenant, elle s’administre une gifle en prétendant que « l’Etat
de tout le peuple poursuit l’œuvre de la dictature du prolétariat »
(« Pour le 100ème anniversaire de la naissance de Vladimir
Ilitch Lénine », « Thèses » du révisionnisme soviétique)
et que « l’Etat de tout le peuple » est « du même
type » qu’un « Etat de dictature du prolétariat »
(Pravda, journal du révisionnisme soviétique, 5 mars 1970).
De plus, elle mène grand tapage à propos du
« renforcement de la direction du Parti », du
« renforcement de la discipline » et du « renforcement
de la centralisation », etc.
C’est tantôt l’ »Etat de tout le peuple »,
tantôt la « dictature du prolétariat » ; vouloir
accoupler arbitrairement ces deux notions fondamentalement
contradictoires ne peut avoir d’autre but que de tromper les masses
et de voiler la dictature de la grande bourgeoisie.
Pour cette clique, la « direction du
Parti », c’est le contrôle politique d’une poignée
d’oligarques social-fascistes sur les membres du Parti •et les
masses. Sa « discipline », c’est la répression contre
tous les mécontents que suscite sa domination.
Sa « centralisation », c’est
concentrer encore davantage le pouvoir politique, économique et
militaire dans ses mains. Bref, autant de prétextes pour renforcer
sa dictature fasciste et se préparer à la guerre d’agression.
En difficulté à l’intérieur et à l’extérieur,
la clique des renégats révisionnistes soviétiques recourt de plus
en plus ouvertement à la violence contre-révolutionnaire pour
maintenir sa domination réactionnaire qui est une trahison envers
Lénine et la Révolution d’Octobre.
Aujourd’hui, en Union soviétique, agents secrets
et mouchards font régner l’arbitraire, et on promulgue des décrets
réactionnaires sans discontinuer.
Faire la révolution est devenu un crime, et dans
tout le pays les prisons se remplissent d’innocents ; la
contre-révolution est récompensée et les renégats se congratulent
pour leur promotion.
Un grand nombre de révolutionnaires et
d’innocents sont jetés dans des camps de concentration ou des
« asiles d’aliénés ». La clique révisionniste
soviétique va jusqu’à envoyer des tanks et autres véhicules
blindés pour réprimer avec sauvagerie la résistance populaire.
Lénine a dit : « Nulle part au monde
la majorité de la population du pays n’est aussi opprimée »
qu’en Russie et les nationalités autres que russe y sont « en
tant qu’allogènes ». (V. I. Lénine : « Le
socialisme et la guerre »)
L’oppression « a accumulé chez les
nationalités, privées de droits égaux, la haine la plus profonde
contre les monarques » (V. I. Lénine : « Discours
prononcé au premier Congrès de la marine de guerre de Russie »).
A présent, les nouveaux tsars révisionnistes
soviétiques reprennent à leur compte la politique d’oppression
tsariste à l’encontre des nationalités minoritaires, pressurent et
persécutent celles-ci par d’odieux procédés comme la
discrimination, la déportation, la division et l’emprisonnement,
faisant de l’Union soviétique une « prison des peuples »
(V. I. Lénine : « Le prolétariat révolutionnaire et le
droit des nations à disposer d’elles-mêmes »).
La clique des renégats révisionnistes
soviétiques exerce une dictature bourgeoise intégrale dans tous les
domaines ide l’idéologie.
Elle s’emploie avec rage à étouffer et à
détruire l’idéologie et laculture socialistes du prolétariat, tout
en ouvrant l’écluse au flot de l’idéologie et de la culture
bourgeoises pourries jusqu’à la moelle.
Elle exalte sans aucune retenue le militarisme, le
chauvinisme et le racisme, et fait de la littérature et de l’art un
instrument pour la mise en pratique de son social-impérialisme.
Stigmatisant la domination ténébreuse du
tsarisme, Lénine a écrit : Quel degré doivent avoir atteint
l’arbitraire policier, les persécutions inquisitoriales et la
démoralisation « pour faire hurler jusqu’aux pierres. » (V. I.
Lénine : « Revue de politique intérieure »)
On ferait bien de mettre en parallèle la
domination de la clique des renégats révisionnistes soviétiques et
le tsarisme flétri par Lénine.
Le coup d’Etat contre-révolutionnaire de la
clique renégate de Khrouchtchev-Brejnev a joué un rôle qu’aucun
impérialiste ou réactionnaire n’eût été en mesure de jouer.
Tout comme Staline l’a dit, « c’est de
l’intérieur que les forteresses s’enlèvent le plus facilement »
(Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l’U.R.S.S. (précis)).
Inexpugnable devant l’intervention armée de pays,
la rébellion de la Garde blanche, les attaques des millions de
soldats deshordes hitlériennes, et les innombrables sabotages et
tentatives de subversion, le blocus et l’encerclement des
impérialistes, cette forteresse socialiste a été enlevée de
l’intérieur par une poignée de renégats !
La clique de Khrouchtchev-Brejnev est donc un
ramassis des plus grands renégats qu’ait connus l’histoire du
mouvement communiste international, une bande de criminels que
l’histoire a condamnés sans rémission pour leurs abominables
forfaits.
IV. SOCIALISME EN PAROLES,
IMPÉRIALISME
DANS LES FAITS
Lénine a stigmatisé les renégats de la IIe
Internationale en ces termes : « . . . socialisme en
paroles, impérialisme dans les faits, transformation de
l’opportunisme en impérialisme ». (V. I. Lénine : « Les
tâches de la IIIe Internationale »)
De même, la clique des renégats révisionnistes
soviétiques est passée du révisionnisme au social-impérialisme.
La différence, c’est que les social-impérialistes de la IIe
Internationale, tels que Kautsky et consorts, ne détenaient pas le
pouvoir d’Etat et devaient se contenter de recueillir quelques
miettes des surprofits provenant de la spoliation d’autres peuples,
en servant l’impérialisme de leur propre pays.
Les social-impérialistes révisionnistes
soviétiques, en revanche, se livrent directement au pillage et à
l’asservissementdes peuples d’autres pays en utilisant le pouvoir
d’Etat usurpé. L’expérience historique nous apprend que, quand le
pouvoir tombe aux mains d’une clique révisionniste, un pays
socialiste se transforme en un Etat social-impérialiste comme
l’Union soviétique, ou est réduit à l’état de pays dépendant ou
de colonie comme la Tchécoslovaquie et la République populaire de
Mongolie.
Maintenant on se rend clairement compte que
l’accession au pouvoir de la clique renégate de Khrouchtchev-Brejnev
signifie au fond la transformation de l’Etat socialiste fondé par
Lénine et Staline en un pays suzerain social-impérialiste.
La clique des renégats révisionnistes
soviétiques parle de léninisme, de socialisme et
d’internationalisme prolétarien, mais ses agissements sont
impérialistes à cent pour cent.
En paroles, elle affirme pratiquer
l’« internationalisme » à l’égard des « pays
frères », mais en fait, elle se sert de réorganisation du
Pacte de Varsovie », du « Conseil d’Assistance économique
mutuelle » et d’autres chaînes pour maintenir emprisonnés
certains pays est-européens et la République populaire de Mongolie
dans les barbelés de la prétendue « communauté socialiste »,
et en disposer à sa guise.
Se prévalant de sa condition de suzerain, elle
s’emploie, par la « division internationale du travail »,
la « spécialisation de la production » et
l’ »intégration économique », à contraindre ces pays à
adapter leur économie nationale aux besoins du révisionnisme
soviétique et à devenir ses marchés, usines auxiliaires de
transformation, vergers, exploitations maraîchères et fermes
d’élevage, pour s’y livrer à une scandaleuse exploitation
super-économique.
Elle recourt aux moyens les plus arbitraires et
les plus impitoyables pour soumettre ces pays à un contrôle sévère
et y implante ses troupes en masse ; elle a même envoyé
carrément des centaines de milliers de ses soldats en
Tchécoslovaquie pour l’écraser sous sa botte et y installer un
pouvoir fantoche à la pointe des baïonnettes.
Ce ramassis de renégats, tout comme les anciens
tsars stigmatisés par Lénine, base entièrement « ses
rapports avec ses voisins » « sur le principe féodal des
privilèges » (V. I. Lénine : « De la fierté
nationale des Grands-Russes »).
En paroles, elle affirme qu’elle apporte une
« aide » aux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine, mais en fait, elle cherche sous ce prétexte à inclure des
pays de ces continents dans sa sphère d’influence, disputant la zone
intermédiaire à l’impérialisme américain.
Par ses exportations de matériel militaire et de
capitaux, et par des échanges commerciaux inéquitables, le
révisionnisme soviétique pille leurs ressources, s’ingère dans
leurs affairesintérieures et guette l’occasion de s’assurer des
bases militaires.
Lénine a dit : « Aux nombreux
‘anciens’ mobiles de la politique coloniale le capital financier a
ajouté la lutte pour les sources de matières premières, pour
l’exportation des capitaux, pour les ‘zones d’influence’ … et,
enfin, pour le territoire économique en général. » (V.I.
Lénine : « L’impérialisme, stade suprême du
capitalisme »)
C’est suivant cette voie de l’impérialisme
capitaliste que progresse le social-impérialisme révisionniste
soviétique.
En paroles, la clique des renégats révisionnistes
soviétiques affirme qu’elle apporte son « plein soutien »
à la lutte révolutionnaire des divers pays, mais en fait, elle agit
en collusion avec les forces les plus réactionnaires du monde pour
saboter la lutte révolutionnaire des peuples de tous les pays. Elle
vilipende furieusement les masses révolutionnaires des pays
capitalistes, les traitant d’« extrémistes », de
« vandales », et elle divise et désagrège les
mouvements populaires dans ces pays.
En fournissant de l’argent et des armes aux
réactionnaires de l’Indonésie, de l’Inde et d’autres pays, elle les
aide directement à massacrer les révolutionnaires ; elle se
creuse la tête pour éteindre les flammes rugissantes de la lutte
armée populaire en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et
réprimer lesmouvements de libération nationale. A l’instar de
l’impérialisme américain, elle assume un rôle de gendarme mondial.
En paroles, elle se prononce pour la « lutte
antiimpérialiste » et lance de temps à autre quelques
invectives à l’adresse des Etats-Unis, mais en fait, cette clique et
l’impérialisme américain sont les plus grands impérialismes en
quête de l’hégémonie mondiale.
La prétendue « opposition » du
révisionnisme soviétique aux Etats-Unis et la lutte des peuples des
divers pays contre l’impérialisme américain sont deux choses tout à
fait différentes.
Pour se repartager le monde, le révisionnisme
soviétique et l’impérialisme américain se disputent tout en
collaborant. Les faits et gestes du révisionnisme soviétique sur
une série d’importants problèmes, et notamment ceux de l’Allemagne,
du Moyen-Orient, du Sud-Est asiatique, du Japon et de l’armement
nucléaire, constituent autant de preuves de sa dispute et de sa
collaboration avec l’impérialisme américain.
Tous deux pratiquent, au détriment des intérêts
des différents peuples, la politique de puissance propre à
l’impérialisme. S’il y a quelques compromis entre eux, il ne peut
s’agir que d’accords temporaires conclus entre bandits.
Lénine a dit : « Le militarisme
moderne est le résultat du capitalisme. » (V. I. Lénine :
« Le militarisme militant et la tactique antimilitariste de la
social-démocratie »)
La guerre de notre temps « découle de la
nature même de L’IMPÉRIALISME » (V. I. Lénine : « Le
VIIIème Congrès du P.C.(b) R. »).
Depuis que Brejnev est au pouvoir, la clique des
renégats révisionnistes soviétiques est allée toujours plus loin
dans la voie du militarisme.
Reprenant à son compte le principe stratégique
militaire khrouchtchévien de chantage nucléaire, elle a développé
avec de grands moyens les fusées à ogives nucléaires, tout en
intensifiant l’expansion de l’armement classique, en renforçant à
tous les égards ses armées de terre, de mer et de l’air, et en
poursuivant, à l’échelle mondiale, la « politique de la
canonnière » propre à l’impérialisme.
Sur la question de la guerre, Khrouchtchev a
préconisé en termes hypocrites un monde « sans armes, sans
armées et sans guerres », pour camoufler une expansion des
armements et des préparatifs de guerre bien réels. Aujourd’hui,
Brejnev et consorts ont changé quelque peu de ton.
Ils s’emploient de toute leur énergie à attiser
le fanatisme guerrier, prétendant à cor et à cri que l’actuelle
situation internationale « porte en elle les menaces d’une
nouvelle guerre mondiale » (Outchitiélskaya Gaziéta, journal
du révisionnisme soviétique, 5 février 1970.); se faisant
menaçants, ils affirment vouloir « prendre de vitesse
l’adversaire », et vantent leurs « fusées stratégiques »
qui seraient « à même de détruire tout objectif où qu’il se
trouve » (Article de A. Gretchko, ministre de la Défense
nationale du révisionnisme soviétique. Voir Kommunist, revue du
révisionnisme soviétique, N° 3, 1969).
Redoublant de frénésie, ils accroissent leurs
dépenses militaires et intensifient la mobilisation et les
préparatifs en vue d’une guerre d’agression, dans le dessein
sinistre de déclencher une guerre éclair de type hitlérien.
La clique des renégats révisionnistes
soviétiques a occupé la Tchécoslovaquie par une attaque surprise.
Elle a commis des intrusions dans l’île Tchenpao,
la région de Tiéliékehti et d’autres territoires chinois et menace
notre pays de ses armes nucléaires.
Ce qui met complètement à nu le caractère
agressif et aventureux du social-impérialisme révisionniste
soviétique.Tout comme l’impérialisme américain, l’oligarchie
social-impérialiste révisionniste soviétique est devenue un autre
archicriminel qui s’apprête à déclencher une guerre mondiale.
V. LA PRÉTENDUE « DOCTRINE DE BREJNEV »
EST UNE DOCTRINE D’HÉGÉMONIE PURE ET SIMPLE
Pour intensifier l’application de la politique
social-impérialiste d’agression et d’expansion, la clique
renégate de Brejnev a développé le révisionnisme khrouchtchévien
et confectionné une série de « théories » fascistes
connues sous le nom de « doctrine de Brejnev ».
Voyons maintenant ce qu’est au juste cette
« doctrine ».
Premièrement, la théorie de la « souveraineté
limitée ». Brejnev et consorts prétendent que défendre leurs
« intérêts socialistes », c’est défendre la
« souveraineté suprême » (Vie Internationale, revue du
révisionnisme soviétique, N° 11, 1968).
Ils proclament ouvertement que le révisionnisme
soviétique peut décider du destin d’un autre pays, « y
compris du destin de sa souveraineté » (Krasnaya Zvezda,
journal du révisionnisme soviétique, février 1969).
« Intérêts socialistes » !
C’est vous, et nul autre, qui avez renverséle régime socialiste en
Union soviétique et appliqué la ligne
révisionniste de la restauration du capitalisme
dans certains pays est-européens et en République populaire de
Mongolie. Ce que vous appelez « intérêts socialistes »,
ce sont ceux du social-impérialisme révisionniste soviétique, ceux
du colonialisme.
Vous imposez la « souveraineté suprême »
d’un suzerain aux autres peuples, ce qui veut dire que la
souveraineté des autres pays est « limitée » tandis que
votre droit de disposer de ces pays est « illimité ».
En d’autres termes, vous avez le droit de disposer
des autres pays et ils n’ont pas le droit de se dresser contre vous ;
vous avez le droit de démembrer les autres pays et ils n’ont pas le
droit de vous résister. Hitler avait hurlé à pleins poumons qu’il
avait « le droit de dominer les autres » (voir Le Procès
de Nuremberg, tome 2).
Dulles et ses semblables claironnèrent aussi que
« le concept de la souveraineté . . . est devenu périmé »
(Voir Foreign Affairs, revue trimestrielle américaine, octobre 1957)
et qu’il fallait remplacer la « souveraineté d’un Etat »
par une « souveraineté conjointe » (P. C. Jessup :
Droit international moderne). Il en ressort que la théorie de la
« souveraineté limitée » prônée par Brejnev n’est
autre qu’une nouvelle version de propos démentiels des
impérialistes.
Deuxièmement, la théorie de la « dictature
internationale ». Brejnev et consorts proclament qu’ils ont le
droit d’entreprendre « une action comme l’aide militaire à un
pays frère pour couper court au danger qui menace le régime
socialiste » (Intervention de L. I. Brejnev au « Ve
Congrès » du révisionnisme polonais, 12 novembre 1968).
Ils disent encore : « Lénine a prévu
que le développement historique nécessiterait que la dictature du
prolétariat se transforme de nationale en internationale, ce qui la
rendrait susceptible d’exercer une influence décisive sur toute la
politique mondiale. » ( Rapport de K. T. Mazourov au « meeting
de célébration » pour la Révolution d’Octobre, à Moscou, 6
novembre 1968)
Ce ramassis de renégats ont complètement déformé
la pensée de Lénine.
Dans son article : Première ébauche des
thèses sur les questions nationale et coloniale, Lénine parla de
« la transformation de la dictature du prolétariat, de
nationale (c’est-à-dire existant dans un seul pays et incapable de
déterminer une politique mondiale) en internationale (c’est-à-dire
la dictature du prolétariat d’au moins plusieurs pays avancés et
susceptible d’avoir une influence décisive sur toute la politique
mondiale) » (V. I. Lénine : « Première ébauche
des thèses sur les questionsnationale et coloniale »). S’en
tenir à l’internationalisme prolétarien et œuvrer à la propagande
en faveur de la révolution mondiale du prolétariat, voilà ce que
Lénine veut dire ici.
Or, la clique des renégats révisionnistes
soviétiques n’a pas hésité à vider ce passage de Lénine de son
esprit révolutionnaire prolétarien et à inventer cette prétendue
théorie de la « dictature internationale » en guise de
« fondement théorique » pour justifier l’intervention et
l’occupation militaires auxquelles elle a soumis certains pays
d’Europe orientale et la République populaire de Mongolie.
Ce que vous appelez « dictature
internationale », c’est tout simplement la domination et
l’asservissement des autres pays par les nouveaux tsars.
Croyez-vous que le recours au prétexte de r »aide
à un pays frère » vous donne le droit de faire appel à votre
puissance militaire pour malmener un autre pays ou d’envoyer à votre
guise vos armées faire la loi dans un autre pays ?
Arborant la bannière des « troupes
alliées », vous envahissez la Tchécoslovaquie ; y a-t-il
là la moindre différence avec l’invasion de la Chine par les forces
coalisées des 8 puissances en 1900, avec l’intervention armée des
pays en Union soviétique et l’agression des « 16 pays »
organisée par l’impérialisme américain contre la Corée ?
Troisièmement, la théorie de la « communauté
socialiste ». Brejnev et consorts claironnent que « la
communauté des pays socialistes est une entité indivisible »
(Izvestia, journal du révisionnisme soviétique, 2 juillet 1968) et
qu’il est nécessaire de renforcer son « unité d’action »
(Document principal adopté par la sinistre conférence de Moscou
tenue en juin 1969).
Quelle « communauté socialiste » !
C’est tout bonnement baptiser d’un autre nom l’empire colonial dont
vous êtes la métropole.
Les relations entre pays socialistes authentiques,
grands ou petits, doivent être fondées sur le marxisme-léninisme,
sur les principes de l’égalité totale, du respect de l’intégrité
territoriale, du respect de la souveraineté et de l’indépendance
nationale, de la non-ingérence mutuelle dans les affaires
intérieures, et sur les principes internationalistes prolétariens
du soutien réciproque et de l’entraide.
Et ce que vous faites, c’est de fouler aux pieds
les autres pays, pour les réduire à un état de dépendance et de
subordination. L’ »unité » dont vous parlez, c’est
l’« unité », sous votre contrôle, de la politique, de
l’économie et des affaires militaires des autres pays. Et par le
terme « indivisible », vous entendez interdire aux autres
pays d’échapper à votre contrôle et à votre asservissement.
N’est-ce pas chercher ouvertement à réduire les autres peuples en
esclavage ?
Quatrièmement, la théorie de la « division
internationale du travail ». Brejnev et consorts ont apporté
de considérables développements à cette notion absurde vantée il
y a longtemps par Khrouchtchev ; non contents de pratiquer la
»division internationale du travail », comme nous l’avons dit
plus haut, dans certains pays d’Europe orientale et en République
populaire de Mongolie, ils l’ont encore étendue à des pays d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine.
Ils disent que ce n’est qu’en « coopérant »
avec le révisionnisme soviétique que les pays de ces continents
seront en mesure de « mettre sur pied une économie nationale
indépendante » (Intervention de L.I. Brejnev à la sinistre
conférence de Moscou, 7 juin 1969 ).
« Pour l’Union soviétique, ajoutent-ils,
cette coopération ouvre de nouvelles possibilités de tirer un
profit encore plus grand des avantages de la division internationale
du travail. Nous pourrons acheter à ces pays, dans des proportions
de plus en plus grandes, leurs produits traditionnels — coton,
laine,peaux, concentrés de minerais de métaux non ferreux, huiles
végétales, fruits, café, fèves de cacao, thé et différentes
autres espèces de matières premières et d’articles fabriqués. »
(Rapport de A. N. Kossyguine au « XXIIIe Congrès » du
révisionnisme soviétique, 5 avril 1966.)
En voilà des « produits traditionnels »
! Cette liste de marchandises n’est malheureusement pas complète ;
il convient d’y ajouter le pétrole, le caoutchouc, la viande, les
légumes, le riz, le jute, le sucre de canne, etc.
Aux yeux de la poignée d’oligarques
révisionnistes soviétiques, les peuples d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine sont condamnés par leur destin à leur fournir,
de génération en génération, ces prétendus « produits
traditionnels ».
Est-ce là une « théorie » ?
Il y a belle lurette que les colonialistes et les
impérialistes ont décrété qu’il fallait déterminer les
productions en fonction des conditions naturelles de chaque pays,
obligeant les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine à se
transformer en sources de matières premières et à rester dans un
état arriéré, afin que les pays industriels capitalistes puissent
procéder, de la façon la plus commode, à l’exploitation coloniale
la plus cruelle. La clique révisionniste soviétique a repris à son
compte cettepolitique coloniale de l’impérialisme. Sa « division
internationale du travail », c’est, au fond, « l’U.R.S.S.
Industrielle, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine agricoles »,
ou encore « l’U.R.S.S. Industrielle avec l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique latine comme usines auxiliaires de transformation ».
Fondés sur les principes de l’égalité et des
avantages réciproques, les échanges faits en fonction des besoins
de chacun ainsi que l’aide mutuelle entre les pays socialistes
authentiques et les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, ont
pour but de promouvoir le développement d’une économie nationale,
indépendante et autonome, dans ces derniers pays, tandis que la
« division internationale du travail » prônée par la
poignée d’oligarques révisionnistes soviétiques vise simplement à
soumettre les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine à
l’infiltration, au contrôle et au pillage, à étendre sa sphère
d’influence et à imposer le nouveau joug du colonialisme
révisionniste soviétique à ces pays.
Cinquièmement, la théorie dite « nos
intérêts sont impliqués ». Brejnev et consorts déclarent
bruyamment : « L’Union soviétique qui, en tant que grande
puissance mondiale, a des liens internationaux très développés, ne
peut rester passive en face d’événements qui sont peut-être
géographiquement éloignés mais qui touchent à notre sécurité
ainsi qu’à celle de nos amis. » (Rapport de A. Gromyko à la
« session du Sovietsuprême », 10 juillet 1969) Ils
affirment avec morgue : « La flotte soviétique »
sera « partout où l’intérêt de la sécurité de notre pays
l’exige » ! (Discours de S. Gorchkov, commandant en chef
de la marine du révisionnisme soviétique, à l’occasion de la
Journée de la marine de l’U.R.S.S. en 1969)
Est-il admissible qu’un pays, parce qu’il est une
grande puissance, situe ses intérêts dans toutes les régions du
globe et mette la main sur le monde entier ?
Est-il admissible qu’il envoie partout ses
canonnières à des fins d’intimidation et d’agression parce qu’il a
des liens internationaux très développés ?
Cette théorie dite « nos intérêts sont
impliqués » est l’argument type dont les impérialistes se
servent pour justifier leur politique d’agression dans le monde.
« Pour les intérêts de la Russie »
est précisément le prétexte invoqué par les anciens tsars
lorsqu’ils se livraient à l’expansion.
De son côté, l’impérialisme américain clame à
tout bout de champ que les Etats-Unis assument la responsabilité
« non seulement » de leur « propre sécurité, mais
encore de la sécurité de toutes les nations libres » et
qu’ils « défendent la liberté partout où cela s’avère
nécessaire » (Discours de l’ex-président des Etats-Unis
Johnson, 3 et 20 juin 1964).
Les propos tenus par les révisionnistes
soviétiques ne ressemblent-ils pas à s’y méprendre à ceux des
anciens tsars et des impérialistes américains ?
La clique des renégats révisionnistes
soviétiques dont la faillite est depuis longtemps consacrée sur les
plans idéologique, théorique et politique, est absolument incapable
de produire quelque chose de valable ; elle n’a pu que présenter
une prétendue « doctrine de Brejnev », faite de vieilles
frusques impérialistes, auxquelles elle s’est contentée d’apporter
quelques retouches.
Cette « doctrine de Brejnev », c’est
un impérialisme affublé de l’étiquette « socialiste »,
une doctrine d’hégémonie pure et simple, un néo-colonialisme qui
s’étale dans toute sa nudité.
VI. LE RÊVE MIRIFIQUE DU RÉVISIONNISME
SOVIÉTIQUE
DE FONDER UN GRAND EMPIRE
Stigmatisant la politique d’agression de la Russie
tsariste voilà cent ans, Marx a dit : « Ses méthodes,
ses tactiques et ses moyens peuvent changer, mais l’objectif de cette
politique — l’hégémonie mondiale — demeure immuable. »
(K. Marx : « Discours au meeting polonais tenu à Londres
le 22 janvier1867 »)
Le tsar Nicolas Ier avait clamé avec insolence :
« Là où le pavillon russe a été hissé, il ne doit plus
redescendre ! » (G. I. Néviélskoï, Les exploits des
officiers de la marine russe dans l’Extrême-Orient russe)
Plusieurs tsars d’ailleurs avaient caressé le
rêve — comme le dit Engels — d’établir un immense « empire
slave » s’étendant de l’Elbe à la Chine, de la mer Adriatique
à l’océan Arctique. Ils avaient même ambitionné de pousser les
confins d’un tel empire jusqu’à l’Inde et aux îles Hawaii. Pour
atteindre ce but, ils s’étaient montrés « aussi doués que
perfides » (F. Engels : « Politique étrangère du
tsarisme russe »).
Les nouveaux tsars révisionnistes soviétiques
ont hérité de toutes les traditions expansionnistes tsaristes,
portant sur leur visage la profonde empreinte de la dynastie des
Romanov. Ils se complaisent à raviver ce rêve irréalisé des
anciens tsars et nourrissent des ambitions agressives bien plus
grandes encore. Les révisionnistes soviétiques ont fait de certains
pays est européens et de la République populaire de Mongolie
leurs colonies et leurs dépendances.
De plus, ils rêvent d’envahir davantage de
territoires chinois et reprennent ostensiblement la politique
chinoise des anciens tsars, en clamant que la frontière
septentrionale de la Chine « suivait la Grande Muraille »
( « Déclaration du gouvernement de l’U.R.S.S. » en
date du 13 juin 1969).
Ils ont pris pied au Sud-Est asiatique, au
Moyen-Orient, en Afrique et jusqu’en Amérique latine, envoyé
leurs flottes en Méditerranée, dans l’océan Indien, le Pacifique
et l’Atlantique, avec l’espoir d’établir un grand empire
révisionniste soviétique à cheval sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique
et l’Amérique latine.
Telle une bulle de savon, l’ « empire
slave » des anciens tsars s’est depuis longtemps évanoui ;
la domination tsariste elle même a été balayée en 1917 par
la Grande Révolution d’Octobre dirigée par Lénine.
La tyrannie des anciens tsars est finie.
A l’époque actuelle où l’impérialisme va à son
effondrement total, les nouveaux tsars cherchent à établir un
empire encore plus grand qui assoirait leur hégémonie sur le
monde ; cela aussi ne pourra être qu’un vain rêve.
Staline a dit : « Lénine appelait
l’impérialisme le ‘capitalisme agonisant’. Pourquoi ? Parce que
l’impérialisme pousse les contradictions du capitalisme jusqu’à la
dernière limite, jusqu’aux bornes extrêmes, au delà desquelles
commence la révolution. » (J. V. Staline : « Des
principes du léninisme »)
S’étant engagé dans le chemin battu de
l’impérialisme, le révisionnisme soviétique est obligatoirement
soumis aux lois impérialistes et assailli par les contradictions
inhérentes à l’impérialisme.
Le camarade Mao Tsétoung a indiqué : « Les
Etats-Unis sont un tigre en papier ; ne vous laissez pas
impressionner, on peut le transpercer du premier coup. L’Union
soviétique révisionniste en est un également. » (Déclaration
du président Mao lors d’un entretien, janvier 1964)
Le social-impérialisme révisionniste soviétique,
en se livrant avec frénésie à l’agression et à l’expansion,
marche inéluctablement vers le contraire du but recherché et
prépare les conditions mêmes de sa chute.
Le révisionnisme soviétique considère les pays
de la « communauté socialiste » comme son fief, mais il
n’est aucunement en mesure d’imposer de manière durable sa
domination coloniale aux peuples de ces pays, et encore moins
d’atténuer les contradictions qui l’opposent à ces derniers.
L’Europe orientale actuelle est pareille à un baril de poudre,
appelé tôt ou tard à sauter.
Loin d’être une preuve de la puissance du
social-impérialisme révisionniste soviétique, l’entrée de ses
tanks à Prague ne fait que présager le commencement de la débâcle
pour l’empirecolonial révisionniste soviétique. Le
social-impérialisme révisionniste soviétique a maintenant les
pieds si profondément enfoncés dans le bourbier tchécoslovaque
qu’il ne peut plus les en retirer.
En pratiquant l’expansion et le pillage dans les
régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, le révisionnisme
soviétique s’est mis dans une position d’hostilité vis-à-vis des
peuples de ces régions.
Il est allé trop loin dans ses entreprises et
ploie maintenant sous un fardeau écrasant ; il ressemble à un
malade qui aurait enflé de partout.
Même la presse de l’impérialisme américain ne
peut s’empêcher de dire : « Nous nous sommes rendu compte
que les Russes commettent des erreurs aussi graves, sinon pires, que
les nôtres. » (U.S. News and World Report, 5 janvier 1970)
L’entrée du social-impérialisme révisionniste
soviétique dans les rangs de l’impérialisme mondial a encore
aiguisé les contradictions entre impérialistes.
Pour élargir leurs propres sphères d’influence,
le social-impérialisme et l’impérialisme se livrent un duel
acharné. Alors qu’ils se trouvent encerclés de tous côtés par les
peuplesdu monde entier, un tel conflit ne fera que hâter la ruine de
tout le système impérialiste.
Dans son propre pays, le social-impérialisme
révisionniste soviétique a également assis sa domination sur un
volcan. Pendant la réaction stolypinienne, Lénine a écrit : La
lutte de la classe ouvrière russe « peut se développer vite
ou lentement », « mais en tout état de cause, elle est
en marche vers la révolution » (V. I. Lénine : « Le
commencement des manifestations »).
A l’heure actuelle, en Union soviétique,
s’accentuent de jour en jour les conflits et l’antagonisme entre la
bourgeoisie monopoliste bureaucratique de type nouveau d’une part, le
prolétariat, la paysannerie laborieuse et les intellectuels
révolutionnaires asservis d’autre part.
La lutte de classes se développe, indépendante
de la volonté de l’homme, et aboutira un jour à la révolution.
L’Union soviétique était à l’origine une union
multinationale d’Etats socialistes.
C’est seulement dans les conditions du socialisme
et sur la base de l’égalité et du libre consentement qu’une telle
union peut s’établir, se consolider et se développer. Staline a
fait remarquer : « II [le pouvoir soviétique] avait
devant lui lesexpériences malheureuses des Etats multinationaux dans
le monde bourgeois.
Il avait devant lui l’expérience avortée de
l’ancienne Autriche Hongrie. » Toutefois, l’union
multinationale soviétique pouvait « triompher de toutes les
épreuves », car, grâce au régime socialiste, s’était
« établie . . . une véritable collaboration fraternelle des
peuples, au sein de l’Etat fédéral unique » (J. V. Staline :
« Sur le projet de Constitution de l’U.R.S.S. »). La
clique des renégats révisionnistes soviétiques a maintenant
renversé le régime socialiste ; elle exerce une dictature
bourgeoise, substitue l’oppression nationale à l’égalité
nationale, la « loi de la jungle » de la bourgeoisie à
l’entraide fraternelle des différentes nationalités.
L’union initiale ayant été privée de ses bases
prolétariennes et socialistes, l’immense « union »
multinationale, dominée par cette bourgeoisie de type nouveau, ne
risque-t-elle pas de se disloquer un jour comme l’empire
austro-hongrois ?
Pour se dégager des difficultés insurmontables
tant intérieures qu’extérieures, le social-impérialisme
révisionniste soviétique, à l’instar de l’impérialisme américain,
se lance à fond dans le chantage en brandissant ses fusées à
ogives nucléaires, recourt aux aventures militaires et appelle de
tous ses vœux une guerre d’agression de vaste envergure. Mais, la
guerre peut-elle tirer l’impérialisme et le social-impérialisme de
l’impasse où ils se trouvent enfermés ? Non, bien au
contraire.
L’histoire a incontestablement prouvé qu’en
faisant appel à la guerre, l’impérialisme, loin de pouvoir échapper
à sa fin inéluctable, ne fait que précipiter sa ruine.
Le président Mao a dit : « Pour ce qui
est de la guerre mondiale, il n’y a au fond que deux possibilités :
ou c’est la guerre qui provoque la révolution, ou c’est la
révolution qui conjure la guerre. » (Cité dans : Rapport au
IXe Congrès du Parti communiste chinois du camarade Lin Piao)
Le président Mao a encore dit : « Que
les peuples du monde entier s’unissent pour combattre toute guerre
d’agression déclenchée par tout impérialisme ou le
social-impérialisme, et notamment la guerre d’agression qui
recourrait à la bombe atomique !
Si une telle guerre éclate, les peuples du monde
devront écraser la guerre d’agression par la guerre
révolutionnaire ; ils doivent y être préparés dès
maintenant ! » (Cité dans « Allons au-devant des
grandes années 70 » — Editorial du Nouvel An du Renmin
Ribao, du Hongqi et du Jiefangjun Bao, paru dans le Renmin Ribao du
1er janvier 1970)
Le président Mao, en formulant cette grande
directive en fonction de la situation internationale actuelle, a
indiqué au prolétariat et aux peuples révolutionnaires du monde
entier l’orientation à suivre dans leur lutte.
Tous les peuples du monde doivent maintenir une
haute vigilance et faire tous les préparatifs afin d’être
constamment prêts à infliger une riposte résolue et foudroyante à
l’agresseur qui oserait déclencher la guerre.
Durant ces dernières années, la clique des
renégats révisionnistes soviétiques, reprenant les procédés
habituels des anciens tsars, a suscité et soutenu, officieusement ou
en sous-main, un nouveau « mouvement panslaviste », et
insisté sur le prétendu « caractère sacré de l’esprit
national russe », pour essayer de corrompre les masses
travailleuses et la jeunesse soviétiques au moyen de ce courant
d’idées réactionnaires et de manœuvrer le peuple soviétique afin
qu’il serve d’instrument à la politique d’agression et de guerre
pratiquée par la poignée d’oligarques révisionnistes soviétiques.
Nous désirons sincèrement mettre en garde le
peuple soviétique frère pour qu’il ne se laisse en aucun cas
prendre au piège du « panslavisme ».
Qu’est-ce que le « panslavisme » ?
Démasquant les tsars, Marx et Engels ont indiqué
de façon pénétrante : « Le panslavisme est une
trouvaille du cabinet de
Saint-Pétersbourg. » (K. Marx et F. Engels,
L’alliance de démocratie socialiste et l’association internationale
des ouvriers)
Et Engels a souligné par ailleurs : Les
tsars se servent de cette supercherie pour préparer la guerre,
« dernière lueur d’espérance pour sauver le système tsariste
et la réaction en Russie ». Par conséquent, « le
panslavisme est notre plus féroce ennemi autant que celui des
Russes » (Lettre de F. Engels à K. Kautsky du 7 février
1882).
Tout comme la « supériorité aryenne »
d’Hitler, le « panslavisme » des nouveaux tsars
révisionnistes soviétiques est un racisme ultra-réactionnaire.
Ces conceptions réactionnaires qu’ils propagent
servent uniquement l’expansionnisme d’une poignée de gouvernants
réactionnaires appartenant à leur prétendue « race
supérieure », alors que, pour les masses populaires, elles ne
peuvent signifier que la catastrophe.
Lénine a fait remarquer : « L’oppression
des ‘allogènes’ est une arme à double tranchant. D’une part, elle
frappe l’allogène’ ; de l’autre, le peuple russe. » (V.I.
Lénine, L’égalité en droits des nations)C’est précisément
derrière l’écran de fumée du « panslavisme » que la
poignée d’oligarques révisionnistes soviétiques s’active
actuellement en vue d’une guerre d’agression, tout en redoublant ses
attaques contre les populations soviétiques, y compris la
nationalité russe.
Les intérêts du prolétariat et du peuple
soviétiques sont à l’exact opposé de ceux des nouveaux tsars
révisionnistes soviétiques, mais identiques à ceux des peuples
révolutionnaires du monde entier.
Si ces nouveaux tsars déclenchent une guerre
d’agression de grande envergure, le prolétariat et le peuple
révolutionnaire de l’Union soviétique, se conformant au principe de
Lénine à l’égard de la guerre d’agression impérialiste,
n’accepteront jamais de servir de chair à canon pour la guerre
injuste du social-impérialisme révisionniste soviétique.
Ils poursuivront la cause des fils et filles
héroïques de la Grande Révolution d’Octobre et lutteront pour
renverser les nouveaux tsars et instaurer à nouveau la dictature du
prolétariat.
Flagornant l’impératrice Catherine II pour les
« conquêtes » qu’elle s’était assurées par ses
agressions, un poète russe a écrit voilà deux siècles :
« Avance et l’univers t’appartient. » (G.R. Diérjavine,
Vers la prise de Varsovie)Les nouveaux tsars révisionnistes
soviétiques ont enfourché le coursier des anciens tsars ; déjà
ils « avancent ».
Saisis de vertige, ils caracolent, s’élancent
dans une direction puis dans une autre, maîtrisant leur monture à
grandpeine. Ils semblent avoir complètement oublié que c’est
en tombant du haut de ce cheval que leurs aïeux ont mis un terme à
l’empire des Romanov. Leur sort ne saurait être plus enviable ;
ils seront désarçonnés et viendront s’écraser sur le sol.
VII. QUE LES PEUPLES DU MONDE ENTIER S’UNISSENT
ET LUTTENT POUR ABATTRE L’IMPÉRIALISME AMÉRICAIN, LE RÉVISIONNISME
SOVIÉTIQUE ET TOUTE LA RÉACTION
Le camarade Mao Tsétoung a dit : « L’Union
soviétique fut le premier Etat socialiste, et son Parti communiste,
le parti créé par Lénine.
Bien que la direction du Parti et de l’Etat
soviétiques soit à présent usurpée par les révisionnistes, je
conseille aux camarades d’avoir la ferme conviction que le peuple
soviétique, la grande masse des membres du Parti et des cadres sont
bons et veulent la révolution, et que la domination du révisionnisme
ne sera pas de longue durée. » (Intervention du président Mao
à la réunion du travail élargie du comité central du Parti
communiste de chine, 30 janvier 1962)
Le peuple chinois éprouve des sentiments profonds
envers le peuple soviétique.
Au cours de la Grande Révolution d’Octobre
dirigée par Lénine, les travailleurs chinois se trouvant alors en
Russie ont lutté épaule contre épaule avec les prolétaires
russes. Au cours de la longue lutte révolutionnaire, nos deux
peuples se sont soutenus et entraidés, établissant entre eux
d’étroits liens d’amitié.
La poignée d’oligarques révisionnistes
soviétiques s’emploie avec rage à semer la discorde entre les
peuples chinois et soviétique et à saboter leurs relations ;
mais en définitive, elle ne fait que soulever une pierre pour se la
laisser retomber sur les pieds.
Eduqué par Lénine et Staline, le peuple
soviétique est un grand peuple, riche d’une glorieuse tradition
révolutionnaire, il ne se laissera pas régenter plus longtemps par
les nouveaux tsars. Les conquêtes de la Révolution d’Octobre ont
été réduites à néant par les renégats révisionnistes
soviétiques, mais les principes de cette révolution sont éternels.
Sous le grand drapeau du léninisme, le courant impétueux de la
révolution populaire emportera à coup sûr la carapace de glace de
la domination révisionniste et le printemps du socialisme reviendra
sur la terre de l’Union soviétique !
Le camarade Mao Tsétoung a dit : « En
un mot, que ce soit en Chine ou dans les autres pays du monde, plus
de 90 pour cent de la population en viendront à soutenir le
marxisme léninisme.
Dans le monde, il y a maintenant encore un grand
nombre de gens qui, trompés par la social-démocratie, le
révisionnisme, l’impérialisme et toute la réaction, n’ont toujours
pas pris conscience.
Mais, en fin de compte, ils prendront
graduellement conscience et soutiendront le marxisme-léninisme.
Cette vérité qu’est le marxisme-léninisme est irrésistible.
Les masses populaires en viendront tôt ou tard à
faire la révolution. La révolution mondiale finira par triompher. »
(Ibidem)
Au moment où nous commémorons le centième
anniversaire de la naissance du grand Lénine, nous constatons avec
joie que guidée par le marxisme, le léninisme, la pensée
maotsétoung, la cause révolutionnaire du prolétariat mondial
remporte victoire sur victoire. Les forces marxistes-léninistes
authentiques du monde entier s’accroissent et se renforcent de jour
en jour.
La lutte libératrice des nations et peuples
opprimés se développe avec impétuosité.
Les pays et les peuples, victimes de l’agression,
du contrôle, des ingérences et des vexations de l’impérialisme
américain et du révisionnisme soviétique, sont en train de se
constituer en un front uni des plus larges.
Une nouvelle période historique de la lutte
contre l’impérialisme américain et le révisionnisme soviétique a
d’ores et déjà commencé. Le glas a sonné pour l’impérialisme et
le social-impérialisme.
Le marxisme, le léninisme, la pensée maotsétoung
toujours victorieux est une arme puissante qui permet au prolétariat
de connaître le monde et de le transformer, une arme puissante qui
fait progresser l’histoire.
Une fois intégré aux masses révolutionnaires
qui se chiffrent par centaines de millions et à la pratique concrète
de la révolution du peuple dans tous les pays, le marxisme, le
léninisme, la pensée maotsétoung déploiera une force
révolutionnaire d’une puissance infinie qui brisera complètement
l’ensemble du monde ancien !
Vive le grand marxisme !
Vive le grand léninisme !
Vive la grande pensée maotsétoung !
=>Retour aux documents de la bataille chinoise contre le révisionnisme
=>Retour au dossier sur La Chine populaire
contre l’hégémonie des superpuissances