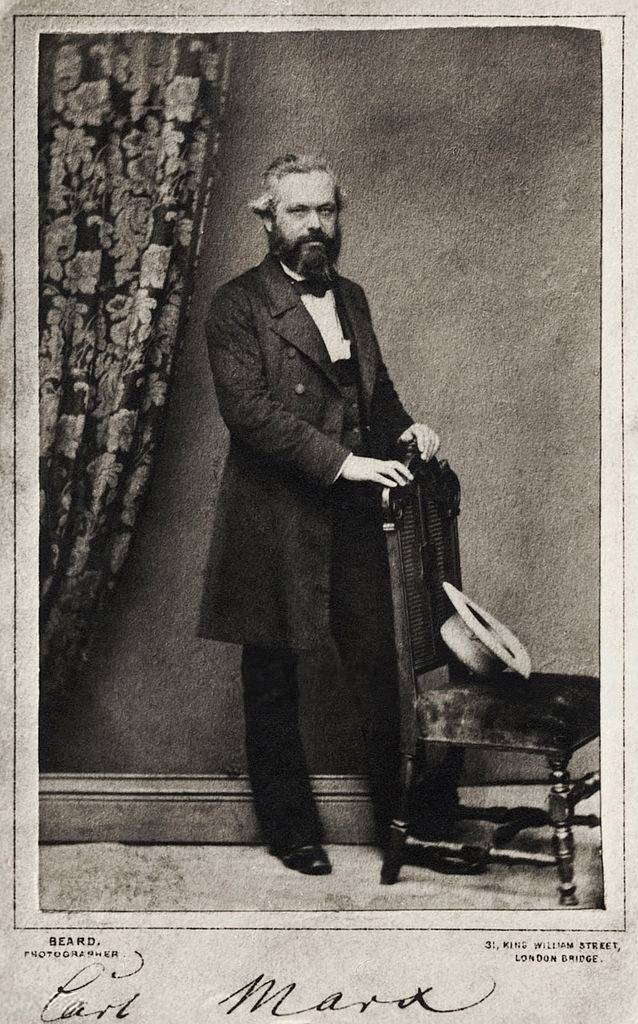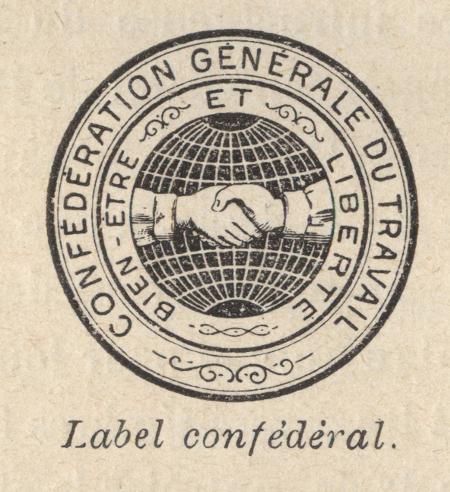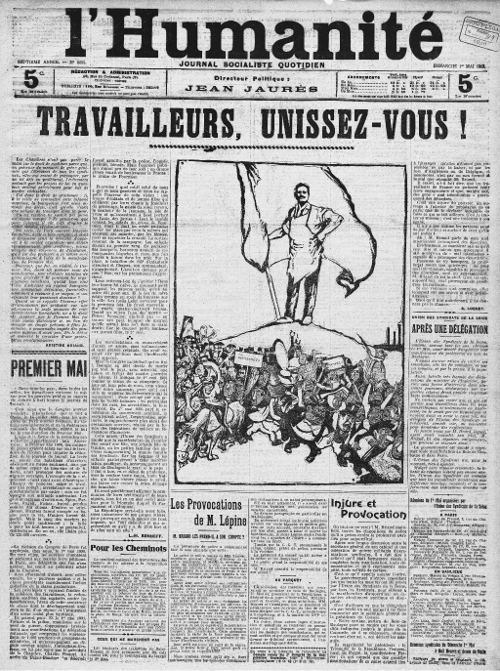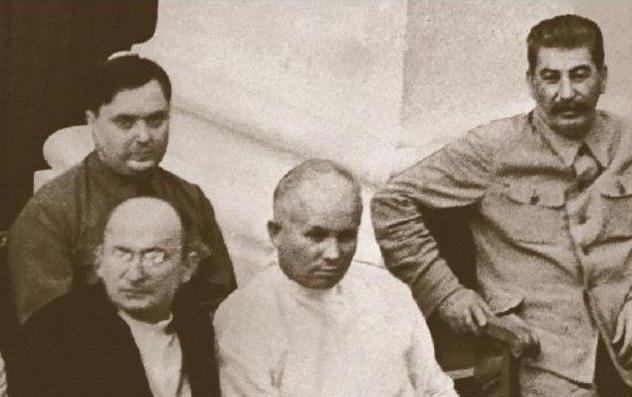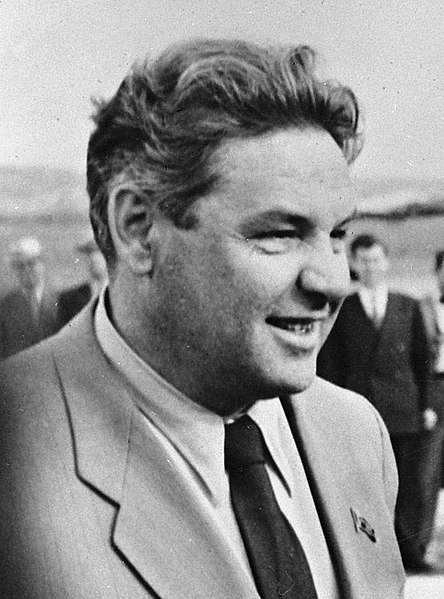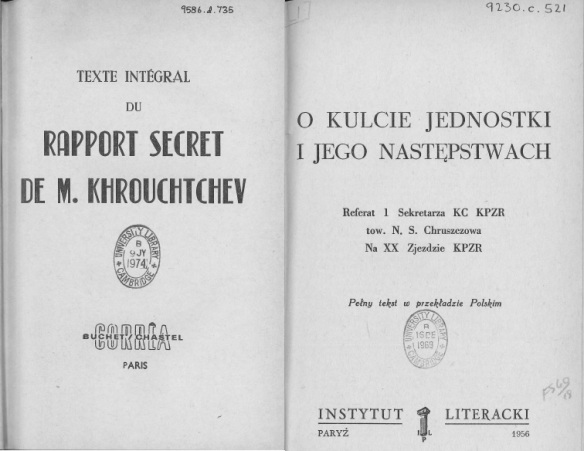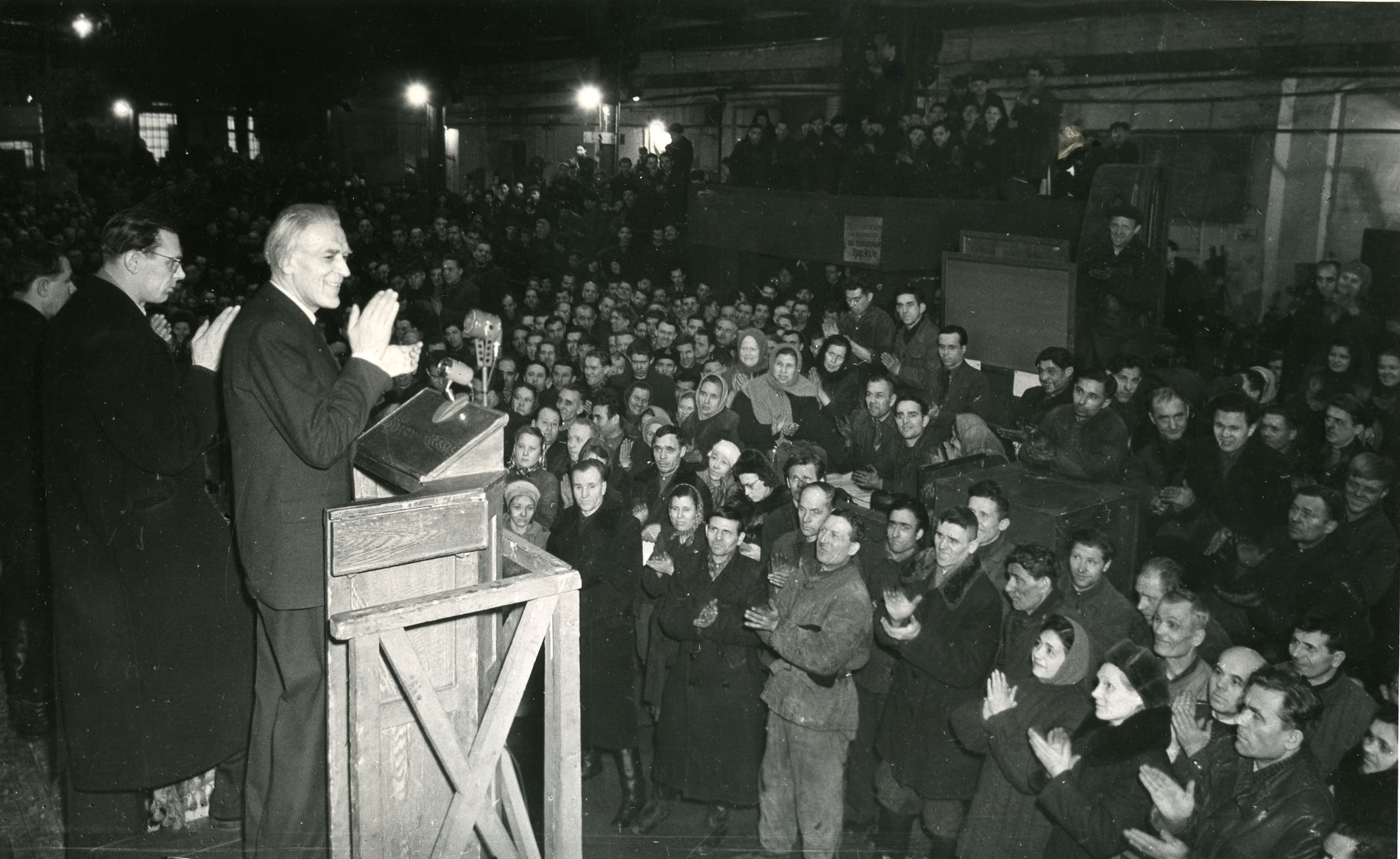En théorie, à la suite de l’unification, seul le Cher et l’Indre ont vu leurs fédérations originaires ne pas dépasser encore les mésententes et parvenir à s’unifier. Le second congrès témoigne de bien plus de faiblesses.
Il a lieu dans la salle du colysée à Chalon-sur-Saône, ville ayant connu un massacre ouvrier, comme par ailleurs Limoges ; lors de l’unification, il avait été tiré au sort pour savoir laquelle des deux villes accueillerait symboliquement le congrès.
Se déroulant les 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 1905, on y apprend dès le départ par le rapport du Conseil national que, somme toute, l’unification n’a pas encore eu lieu et qu’on ne connaît pas vraiment les contours du nouveau Parti !
Voici comment cet aveu d’échec et d’impuissance est formulé :
« Des forces de ce Parti nouveau, de son action déjà engagée, le Conseil national à l’ouverture de ce Congrès aurait voulu dresser un tableau exact et complet. Il aurait souhaité vous présenter le miroir fidèle qui vous eût renvoyé à tous, délégués des Fédérations, l’image d’ensemble de ce vaste corps dont vous êtes, dont nous sommes, nous et nos commettants, les unités intégrantes.
Ce souhait ne pouvait recevoir malheureusement entière satisfaction et vous serez obligés de vous en tenir à une image imparfaite.
L’année qui s’achève est, en effet, une année de transition. Sans doute les vieilles organisations ont disparu ; mais elles vivaient il y a six mois à peine et par les liens contractés, les formalités remplies, les cotisations versées, nous restons les uns et les autres, nos groupes, nos fédérations, marqués jusqu’au terme de l’année à leur sceau particulier.
Les uns et les autres nous ne serons en totalités les hommes du nouveau Parti qu’en janvier 1906, lorsqu’une carte identique délivrée par les soins d’un même organisme central, nous aura consacrés tous dans l’apparence – comme il est déjà dans la réalité – membres d’une même famille, combattants d’une même armée.
Jusque-là il nous est interdit de connaître dans le détail nos contingents non plus que nos ressources financières. Nous en sommes réduits à des approximations. »
Étrange aveu d’une direction qu’en fait, elle ne sait pas ce qu’elle dirige, et que donc elle ne le dirige pas vraiment.
Et cela alors que, parallèlement aux 40 000 adhérents dans 2 000 groupes locaux qui ne sont donc pas réellement unifiés, il y a 38 députés, une centaine d’élus départementaux, entre 1500 et 2000 élus municipaux, c’est-à-dire un véritable appareil lié aux élections.
Le thème des élections obnubile d’ailleurs le Congrès, notamment la question du second tour. Le Parti socialiste SFIO est tellement marqué par cette obsession qu’il refuse de prendre position pour le second tour, appelant les Fédérations à décider d’un éventuel soutien aux radicaux.
C’était là ne pas trancher la question fondamentale de la situation de la France alors, mais cette question relevant du matérialisme historique ne se pose nullement pour des socialistes visant une sorte de Parti syndicaliste, avec les élections comme levier. Le rapport du congrès se conclut d’ailleurs de la manière suivante :
« [Emile] Landrin, président, se félicite de l’œuvre du Congrès, qui a resserré les liens qui unissent tous les membres du Parti. Les partis bourgeois escomptaient nos divisions. C’est un parti plus cohérent et plus fort qui sort de ce congrès.
La question électorale a tenu une grande place dans nos débats, mais parce que l’actualité même l’imposait à nos préoccupations.
C’est n’est pas que ce soit pour nous la seule question. Nous l’avons du reste prouvé par le vote rendu à l’unanimité pour la réduction de la journée de travail à 8 heures, affirmant ainsi notre solidarité avec l’organisme économique du prolétariat.
La question électorale n’est pour nous qu’un moyen parmi les moyens. Le but est la Révolution sociale. Vive l’Internationale ouvrière ! Vive la Révolution sociale ! Vive le Parti unifié !
C’est sur ce cri, par tous répété, que le Congrès est levé. »
Ce volontarisme ne cacha pas les débats nécessaires, car l’immense croissance numérique attendue ne vint pas. Ainsi, jusqu’en 1914, le Parti socialiste SFIO mit en place des débats pour établir une ligne commune, sans parvenir à bloquer les énormes forces centrifuges agissant en son sein.