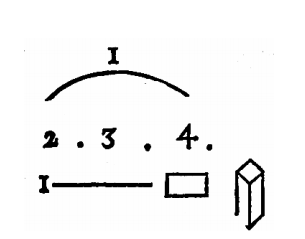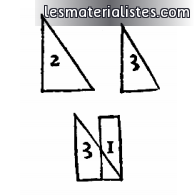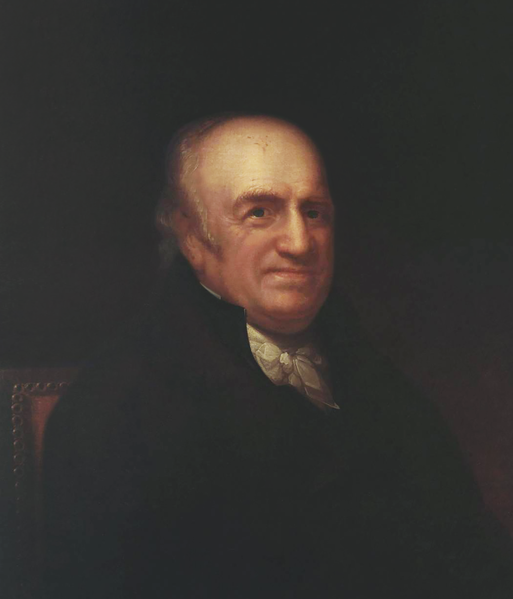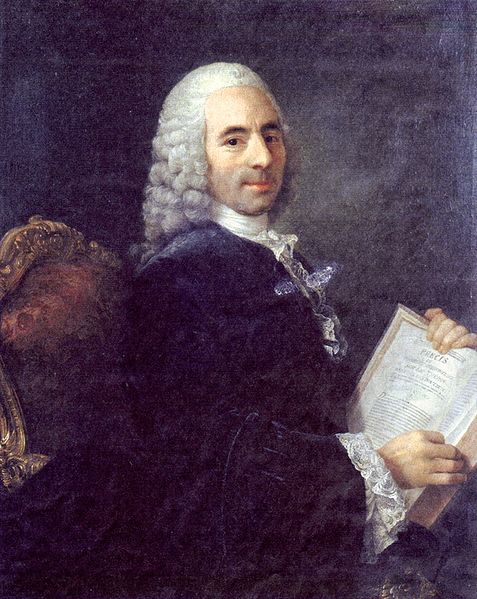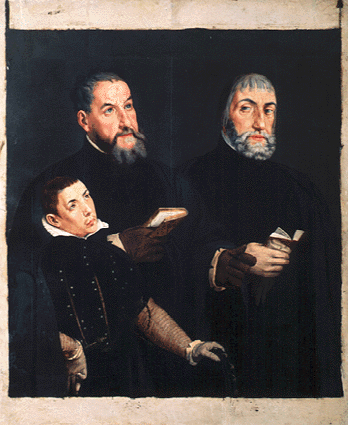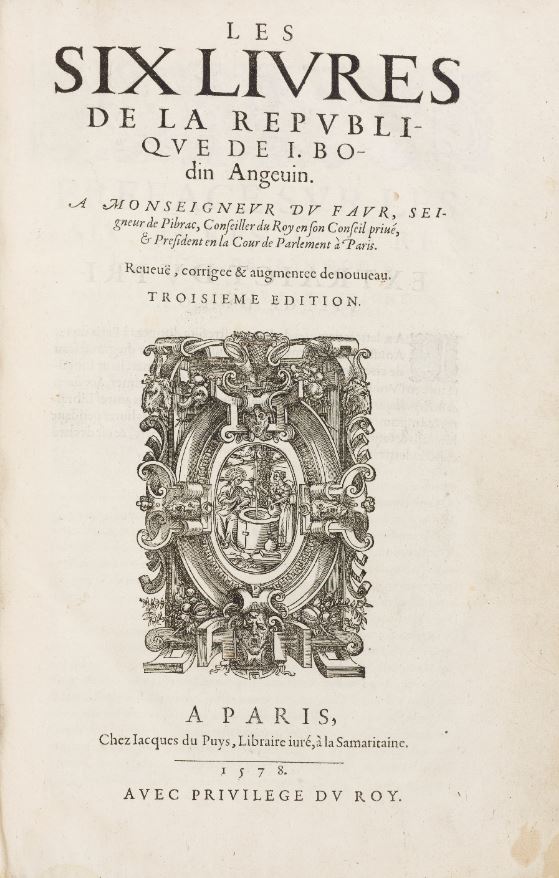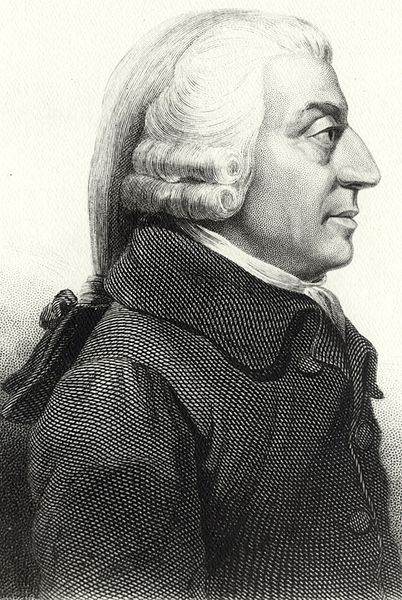L’article de J. Staline : Le
Marxisme et les problèmes de linguistique paru le 20 juin 1950
dans La Pravda, à la suite d’un débat qui s’y déroula sur
les problèmes de linguistique en Union soviétique, constitue une
réponse aux questions que lui posa à ce sujet un groupe d’étudiants
soviétiques et aux essais publiés dans les colonnes du journal,
dont les principaux titres sont : « Sur la voie de la
linguistique matérialiste » de Boulakhovski, membre de
l’Académie des Sciences d’Ukraine, « L’Histoire de la
linguistique en Russie et la théorie de Marr » de Nikiforov, « Du
caractère de classe de la langue » de Koudriavtsev.
Un
groupe de jeunes camarades m’a demandé d’exposer dans la presse
mon opinion sur les problèmes de linguistique, notamment en ce qui
concerne le marxisme en linguistique. N’étant pas linguiste, je ne
puis évidemment pas donner pleine satisfaction aux camarades. Quant
au marxisme en linguistique, comme dans les autres sciences sociales,
c’est une question dont je peux parler en connaissance de cause.
C’est pourquoi j’ai accepté de répondre à une série de
questions posées par les camarades.
QUESTION :
Est-il vrai que la langue soit une superstructure au-dessus de la
base ?
RÉPONSE :
Non, c’est faux.
La
base est le régime économique de la société à une étape donnée
de son développement. La superstructure, ce sont les vues
politiques, juridiques, religieuses, artistiques, philosophiques de
la société et les institutions politiques, juridiques et autres qui
leur correspondent.
Toute
base a sa propre superstructure, qui loi correspond. La base du
régime féodal a s a superstructure, ses vues politiques, juridiques
et autres, avec les institutions qui leur correspondent ; la
base capitaliste a sa superstructure à elle, et la base socialiste
la sienne. Lorsque la base est modifiée ou liquidée. sa
superstructure est, à sa suite, modifiée ou liquidée ; et
lorsqu’une base nouvelle prend naissance, à sa suite prend
naissance une superstructure qui lui correspond.
La
langue, à cet égard, diffère radicalement de la superstructure.
Prenons, par exemple, la société russe et la langue russe. Au cours
des trente dernières années, l’ancienne base, la base
capitaliste, a été liquidée en Russie, et il a été construit une
base nouvelle, socialiste.
En
conséquence, la superstructure de la base capitaliste a été
liquidée, et il a été créé une nouvelle superstructure
correspondant à la base socialiste. Aux anciennes institutions
politiques, juridiques et autres se sont donc substituées des
institutions nouvelles, socialistes. Mais en dépit de cela, la
langue russe est demeurée, pour l’essentiel, ce qu’elle était
avant la Révolution d’Octobre.
Qu’y
a-t-il de changé depuis lors dans la langue russe ?
Le
vocabulaire de la langue russe a changé en une certaine mesure ;
il a changé dans ce sens qu’il s’est enrichi d’un nombre
considérable de mots nouveaux et d’expressions nouvelles qui ont
surgi avec l’apparition de la nouvelle production socialiste, avec
l’apparition d’un nouvel Etat, d’une nouvelle culture
socialiste, d’un nouveau milieu social, d’une nouvelle morale et,
enfin, avec le progrès de la technique et de la science ;
quantité de mots et d’expressions ont changé de sens et acquis
une signification nouvelle ; un certain nombre de mots surannés
ont disparu du vocabulaire.
En
ce qui concerne le fonds essentiel du vocabulaire et le système
grammatical de la langue russe, qui en constituent le fondement, loin
d’avoir été liquidés et remplacés, après la liquidation de la
base capitaliste, par un nouveau fonds essentiel du vocabulaire et un
nouveau système grammatical de la langue, ils se sont au contraire
conservés intacts et ont survécu sans aucune modification un peu
sérieuse ; ils se sont conservés précisément comme fondement
de la langue russe d’aujourd’hui.
Poursuivons.
La superstructure est engendrée par la base, mais cela ne veut point
dire qu’elle se borne à refléter la base, qu’elle soit passive,
neutre, qu’elle se montre indifférente au sort de la base, au sort
des classes, au caractère du régime.
Au
contraire, une fois en existence, elle devient une immense force
active, elle aide activement sa base à se cristalliser et à
s’affermir ; elle met tout en oeuvre pour aider le nouveau
régime à achever la destruction de la vieille base et des vieilles
classes, et à les liquider.
Il ne saurait en être autrement. La superstructure est justement engendrée par la base pour servir celle-ci, pour l’aider activement à se cristalliser et à s’affermir, pour lutter activement en vue de liquider la vieille base périmée avec sa vieille superstructure.
Il suffit que la superstructure se refuse à jouer ce rôle d’instrument, il suffit qu’elle passe de la position de défense active de s a base à une attitude indifférente à son égard, à une attitude identique envers toutes les classes, pour qu’elle perde sa qualité et cesse d’être une superstructure.
La
langue à cet égard diffère radicalement de la superstructure. La
langue est engendrée non pas par telle ou telle base, vieille ou
nouvelle, au sein d’une société donnée, mais par toute la marche
de l’histoire de la société et de l’histoire des bases au cours
des siècles.
Elle
est l’oeuvre non pas d’une classe quelconque, mais de toute la
société, de toutes les classes de la société, des efforts des
générations et des générations. Elle est créée pour les besoins
non pas d’une classe quelconque, mais de toute la société, de
toutes les classes de la société.
C’est
pour cette raison précisément qu’elle est créée en tant que
langue du peuple tout entier, unique pour toute la société et
commune à tous les membres de la société.
Par
suite, le rôle d’instrument que joue la langue comme moyen de
communication entre les hommes ne consiste pas à servir une classe
au détriment des autres classes, mais à servir indifféremment
toute la société, toutes les classes de la société. C’est là
précisément la raison pour laquelle la langue peut servir l’ancien
régime agonisant aussi bien que le nouveau régime ascendant,
l’ancienne base aussi bien que la nouvelle, les exploiteurs aussi
bien que les exploités.
Ce
n’est un secret pour personne que la langue russe a aussi bien
servi le capitalisme russe et la culture bourgeoise russe avant la
Révolution d’octobre qu’elle sert actuellement le régime
socialiste et la culture socialiste de la société russe.
Il
faut en dire autant des langues ukrainienne, biélorusse, ouzbèque,
kazakhe, géorgienne, arménienne, estonienne, lettone, lituanienne,
moldave, tatare, azerbaïdjanaise, bachkire, turkmène et autres
langues des nations soviétiques, qui ont aussi bien servi l’ancien
régime bourgeois de ces nations qu’elles servent le régime
nouveau, socialiste.
Il
ne saurait en être autrement. La langue existe, la langue a été
créée précisément pour servir la société comme un tout, en tant
que moyen de communication entre les hommes, pour être commune aux
membres de la société et unique pour la société, pour servir au
même titre les membres de la société indépendamment de la classe
à laquelle ils appartiennent.
Il
suffit que la langue quitte cette position d’instrument commun à
tout le peuple, il suffit qu’elle prenne une position tendant à
préférer, à soutenir un groupe social quelconque au détriment des
autres groupes sociaux pour qu’elle perde sa qualité, pour qu’elle
cesse d’être un moyen de communication entre les hommes dans la
société, pour qu’elle devienne le jargon d’un groupe social
quelconque, pour qu’elle déchoie et se voue à la disparition.
Sous
ce rapport, la langue, qui diffère par principe de la
superstructure, ne se distingue cependant pas des instruments de
production, des machines par exemple, qui, indifférents à l’égard
des classes comme l’est la langue, peuvent servir également le
régime capitaliste et le régime socialiste.
Ensuite,
la superstructure est le produit d’une époque au cours de laquelle
exista et fonctionne une base économique donnée.
C’est
pourquoi la vie de la superstructure n’est pas d’une longue
durée : celle-ci est liquidée et disparaît avec la
liquidation et la disparition de la base donnée.
La
langue, au contraire, est le produit de toute une série d’époques
au cours desquelles elle se cristallise, s’enrichit, se développe
et s’affine.
C’est
pourquoi la vie d’une langue est infiniment plus longue que celle
d’une base quelconque, que celle d’une superstructure quelconque.
C’est
ce qui explique justement que la naissance et la liquidation, non
seulement d’une base et de sa superstructure, mais de plusieurs
bases et des superstructures qui leur correspondent, ne conduisent
pas dans l’histoire à la liquidation d’une langue donnée, à la
liquidation de sa structure et à la naissance d’une langue
nouvelle avec un nouveau vocabulaire et un nouveau système
grammatical.
Plus
de cent ans se sont écoulés depuis la mort de Pouchkine. Durant ce
temps, les régimes féodal et capitaliste furent liquidés en
Russie, et il en a surgi un troisième, le régime socialiste. Par
conséquent, deux bases avec leurs superstructures ont été
liquidées, et il en est apparu une nouvelle, la base socialiste,
avec sa nouvelle superstructure. Mais si l’on prend par exemple la
langue russe, on constate que, pendant ce long intervalle de temps,
elle n’a subi aucune refonte et que, par sa structure, la langue
russe de nos jours diffère peu de celle de Pouchkine.
Qu’y
a-t-il eu de changé pendant ce temps dans la langue russe ?
Son
vocabulaire s’est, pendant ce temps, notablement enrichi ; un
grand nombre de mots surannés ont disparu du lexique ; le sens
d’une quantité importante de mots s’est modifié ; le
système grammatical de la langue s’est amélioré. Quant à la
structure de la langue de Pouchkine avec son système grammatical et
le fonds essentiel de son lexique, elle s’est conservée dans ses
grandes lignes comme fondement de la langue russe d’aujourd’hui.
Cela
se conçoit fort bien. En effet, pourquoi serait-il nécessaire
qu’après chaque révolution la structure existante de la langue,
son système grammatical et le fonds essentiel de son lexique soient
détruits et remplacés par de nouveaux, comme cela a lieu
ordinairement pour la superstructure ?
A
quoi servirait-il que « eau », « terre », « montagne »,
« forêt », « poisson », « homme »,
« marcher », « faire », « produire »,
« commercer », etc. ne s’appellent plus eau, terre,
montagne, etc., mais autrement ?
A
quoi servirait-il que les changements des mots dans la langue et la
combinaison des mots dans la proposition aient lieu, non pas d’après
la grammaire existante, mais d’après une grammaire tout autre ?
Quelle
utilité la révolution retirerait-elle de ce bouleversement dans la
langue ? L’histoire en général ne fait rien d’essentiel
sans que la nécessité ne s’en impose tout spécialement.
On
se demande quelle serait la nécessité de ce bouleversement
linguistique, lorsqu’il a été prouvé que la langue existante,
avec sa structure, est, dans ses grandes lignes, parfaitement apte à
satisfaire aux besoins du nouveau régime !
On
peut, on doit détruire la vieille superstructure et lui en
substituer une nouvelle en quelques années, afin de donner libre
cours au développement des forces productives de la société, mais
comment détruire la langue existante et établir à sa place une
langue nouvelle en quelques années, sans apporter l’anarchie dans
la vie sociale, sans créer la menace d’une désagrégation de la
société ?
Qui
donc, sinon quelque Don Quichotte, pourrait s’assigner une tâche
pareille ?
Enfin,
il y a encore une différence radicale entre la superstructure et la
langue. La superstructure n’est pas liée directement à la
production, à l’activité productrice de l’homme. Elle n’est
liée à la production que de façon indirecte, par l’intermédiaire
de l’économie, par l’intermédiaire de la base.
Aussi
la superstructure ne reflète-t-elle pas les changements survenus au
niveau du développement des forces productives d’une façon
immédiate et directe, mais à la suite des changements dans la base,
à travers le prisme des changements intervenus dans la base par
suite des changements dans la production. C’est dire que la sphère
d’action de la superstructure est étroite et limitée.
La
langue, au contraire, est liée directement à l’activité
productrice de l’homme, et pas seulement à l’activité
productrice, mais à toutes les autres activités de l’homme dans
toutes les sphères de son travail, depuis la production jusqu’à
la base, depuis la base jusqu’à la superstructure.
C’est
pourquoi la langue reflète les changements dans la production d’une
façon immédiate et directe, sans attendre les changements dans la
base. C’est pourquoi la sphère d’action de la langue, qui
embrasse tous les domaines de l’activité de l’homme, est
beaucoup plus large et plus variée que la sphère d’action de la
superstructure. Bien plus, elle est pratiquement illimitée.
Voilà
la raison essentielle pour laquelle la langue, plus précisément son
vocabulaire, est dans un état de changement à peu près
ininterrompu.
Le
développement ininterrompu de l’industrie et de l’agriculture,
du commerce et des transports, de la technique et de la science exige
de la langue qu’elle enrichisse son vocabulaire de nouveaux mots et
de nouvelles expressions nécessaires à cet essor. Et la langue, qui
reflète directement ces besoins, enrichit en effet son vocabulaire
de nouveaux mots et perfectionne son système grammatical.
Ainsi :
a)
Un marxiste ne peut considérer la langue comme une superstructure
au-dessus de la base ;
b)
Confondre la langue avec une superstructure, c’est commettre une
grave erreur.
QUESTION :
Est-il vrai que la langue ait toujours eu et garde un caractère de
classe, qu’il n’existe pas de langue commune et unique pour la
société, de langue qui n’ait pas un caractère de classe, mais
qui soit celle du peuple tout entier ?
RÉPONSE :
Non, c’est faux.
Il
n’est pas difficile de comprendre que dans une société sans
classes il ne saurait être question d’une langue de classe.
Le
régime de la communauté primitive, le régime des clans, ignorait
les classes et, par conséquent, il ne pouvait y avoir de langue de
classe ; la langue y était commune, unique pour toute la
collectivité. L’objection suivant laquelle il faut entendre par
classe toute collectivité humaine, y compris celle de la communauté
primitive, n’est pas une objection, mais un jeu de mots qui ne
mérite pas d’être réfuté.
En
ce qui concerne le développement ultérieur, des langues de clans
aux langues de tribus, des langues de tribus aux langues de
nationalités, et des langues de nationalités aux langues
nationales, – partout, à toutes les phases du développement, la
langue comme moyen de communication entre les hommes dans la société
a été commune et unique pour la société, a servi au même titre
les membres de la société indépendamment de leur condition
sociale.
Je
ne parle pas ici des empires des périodes esclavagiste ou médiévale,
par exemple, des empires de Cyrus ou d’Alexandre le Grand, de César
ou de Charlemagne, qui étaient dépourvus d’une base économique
propre et représentaient des formations militaires et
administratives éphémères et peu solides. Ces empires n’avaient
ni ne pouvaient avoir de langue unique pour tout l’empire et
intelligible pour tous ses membres.
Ils
représentaient un conglomérat de tribus et de nationalités qui
vivaient de leur propre vie et possédaient leurs langues propres.
Il
ne s’agit donc pas de ces empires et d’autres semblables, mais
des tribus et des nationalités qui faisaient partie de l’empire,
possédaient une base économique propre et avaient des langues
formées d’ancienne date. L’histoire nous apprend que les langues
de ces tribus et nationalités ne portaient pas un caractère de
classe, mais étaient des langues communes aux populations, aux
tribus et aux nationalités et comprises par tous leurs membres.
Certes,
il existait parallèlement des dialectes, des parlers locaux, mais la
langue unique et commune de la tribu ou de la nationalité prévalait
sur ces parlers et se les subordonnait.
Par
la suite, avec l’apparition du capitalisme, avec la liquidation du
morcellement féodal et la formation d’un marché national, des
nationalités se développèrent en nations, et les langues des
nationalités en langues nationales.
L’histoire
nous apprend qu’une langue nationale n’est pas une langue de
classe, mais une langue commune à l’ensemble du peuple, commune
aux membres de la nation et unique pour la nation.
Il
a été dit plus haut que la langue comme moyen de communication
entre les hommes dans la société sert également toutes les classes
de la société et manifeste à cet égard une sorte d’indifférence
envers les classes.
Mais
les hommes, les divers groupes sociaux et les classes sont loin
d’être indifférents envers la langue. Ils s’attachent à
l’utiliser dans leur intérêt, à lui imposer leur vocabulaire
particulier, leurs termes particuliers, leurs expressions
particulières. Sous ce rapport, se distinguent particulièrement les
couches supérieures des classes possédantes qui se sont détachées
du peuple et qui le haïssent : l’aristocratie nobiliaire et
les couches supérieures de la bourgeoisie.
Il
se forme des dialectes et jargons « de classe », des
« langues » de salon. En littérature, ces dialectes et
jargons sont souvent qualifiés à tort de langues : la « langue
noble », la « langue bourgeoise », par opposition à la
« langue prolétarienne », à la « langue paysanne ».
C’est pour cette raison que certains de nos camarades, si étrange
que cela puisse paraître, en arrivent à conclure que la langue
nationale est une fiction, qu’il n’existe en réalité que des
langues de classe.
Je
pense qu’il n’y a rien de plus erroné que cette conclusion.
Peut-on regarder ces dialectes et ces jargons comme des langues ?
Non,
c’est impossible. Impossible d’abord, parce que ces dialectes et
ces jargons n’ont pas de système grammatical ni de fonds de
vocabulaire propres, – ils les empruntent à la langue nationale.
Impossible ensuite, parce que les dialectes et les jargons ont une
sphère étroite de circulation parmi les couches supérieures de
telle ou telle classe, et ne conviennent nullement, comme moyen de
communication entre les hommes, à la société dans son ensemble.
Qu’est-ce
qu’on y trouve donc ? On y trouve un choix de mots spécifiques
qui reflètent les goûts spécifiques de l’aristocratie ou des
couches supérieures de la bourgeoisie ; un certain nombre
d’expressions et de tournures qui se distinguent par leur
raffinement et leur galanterie, et qui ne comportent pas les
expressions et tournures « grossières » de la langue
nationale ; on y trouve enfin un certain nombre de mots
étrangers.
L’essentiel
cependant, c’est-à-dire l’immense majorité des mots et le
système grammatical, est emprunté à la langue nationale commune à
toue le peuple. Par conséquent, les dialectes et les jargons
constituent des rameaux de la langue nationale commune à tout le
peuple, privés de toute indépendance linguistique et condamnés à
végéter. Penser que dialectes et jargons puissent devenir des
langues distinctes, capables d’évincer et de remplacer la langue
nationale, c’est perdre la perspective historique et abandonner les
positions du marxisme.
On
se réfère à Marx, on cite un passage de son article « Saint
Max », où il est dit que le bourgeois a « sa langue »,
que cette langue « est un produit de la bourgeoisie » [1],
qu’elle est pénétrée de l’esprit de mercantilisme et de
marchandage.
Certains
camarades veulent démontrer par cette citation que Marx aurait admis
le « caractère de classe » de la langue, qu’il niait
l’existence d’une langue nationale unique. Si ces camarades
avaient fait preuve d’objectivité dans cette question, ils
auraient dû citer encore un autre passage du même article « Saint
Max », où Marx, traitant des voies de formation d’une langue
nationale unique, parle de « la concentration des dialectes en
une langue nationale unique, en fonction de la concentration
économique et politique » [2].
Par
conséquent, Marx reconnaissait la nécessité d’une langue
nationale unique, en tant que forme supérieure à laquelle sont
subordonnés les dialectes en tant que formes inférieures.
Dès
lors, qu’est-ce donc que la langue du bourgeois, qui, d’après
Marx, « est un produit de la bourgeoisie » ? Marx la
considérait-il comme une langue telle que la langue nationale avec
sa structure linguistique propre ? Pouvait-il la considérer
comme une telle langue ? Évidemment non ! Marx voulait
dire simplement que les bourgeois avaient souillé la langue
nationale unique avec leur vocabulaire de mercantis, que les
bourgeois avaient donc leur jargon de mercantis.
Il
s’ensuit que ces camarades ont déformé la position de Marx. Et
ils l’ont déformée parce qu’ils ont cité Marx non en
marxistes, mais en scolastiques, sans aller au fond des choses.
On
se réfère à Engels, on cite de son oeuvre : La
Situation de la classe laborieuse en Angleterre les
passages où il dit que « … la classe ouvrière anglaise est
devenue à la longue un peuple tout autre que la bourgeoisie
anglaise » ; que « les ouvriers parlent un autre
dialecte, ont d’autres idées et d’autres conceptions, d’autres
mœurs et d’autres principes moraux, une autre religion et une
autre politique que la bourgeoisie » [3].
Forts
de cette citation, certains camarades en viennent à conclure
qu’Engels a nié la nécessité d’une langue nationale commune à
tout le peuple, qu’il affirmait, par conséquent, le « caractère
de classe » de la langue. Engels, il est vrai, ne parle pas ici
de la langue, mais du dialecte ; il comprend fort bien que le
dialecte en tant que rameau de la langue nationale ne peut remplacer
celle-ci. Mais ces camarades, visiblement, ne se montrent guère
sensibles à la différence entre langue et dialecte…
Il
est évident que la citation est faite mal à propos, car Engels ne
parle pas ici de « langues de classe », mais principalement
des idées, des conceptions, des mœurs, des principes moraux, de la
religion, de la politique de classe. Il est tout à fait juste que
les idées, les conceptions, les mœurs, les principes moraux, la
religion et la politique sont directement opposés chez les bourgeois
et les prolétaires. Mais que vient faire ici la langue nationale ou
le « caractère de classe » de la langue ?
Est-ce
que l’existence des contradictions de classe dans la société peut
servir d’argument en faveur du « caractère de classe » de
la langue ou contre la nécessité d’une langue nationale unique ?
Le marxisme dit que la communauté de langue est un des caractères
les plus importants de la nation, tout en sachant parfaitement qu’il
y a des contradictions de classe à l’intérieur de la nation. Les
camarades en question reconnaissent-ils cette thèse marxiste ?
On
se réfère à Lafargue [4] en rappelant que, dans sa
brochure : La
Langue française avant et après la Révolution,
il reconnaît le « caractère de classe » de la langue et
qu’il nie, dit-on, la nécessité d’une langue nationale commune
à tout le peuple. C’est faux. Lafargue parle effectivement de la
langue « noble » ou « aristocratique » et des
« jargons » des diverses couches de la société.
Mais
ces camarades oublient que Lafargue, qui ne s’intéresse pas à la
différence qui existe entre la langue et le jargon, et qui qualifie
les dialectes, soit de « langue artificielle », soit de
« jargon », déclare explicitement dans sa brochure que « la
langue artificielle qui distinguait l’aristocratie… était
extraite de la vulgaire, parlée par le bourgeois et l’artisan, la
ville et la campagne ».
Lafargue
reconnaît donc l’existence et la nécessité d’une langue
commune à tout le peuple, et comprend fort bien le caractère
subordonné et la dépendance de la « langue aristocratique »
et des autres dialectes et jargons par rapport à la langue commune à
tout le peuple.
Il
s’ensuit que la référence à Lafargue manque son but.
On
se réfère au fait qu’à une époque donnée, en Angleterre, les
féodaux anglais ont parlé le français « durant des siècles »,
alors que le peuple anglais parlait la langue anglaise, et l’on
voudrait en faire un argument en faveur du « caractère de
classe » de la langue et contre la nécessité d’une langue
commune à tout le peuple. Mais ce n’est point là un argument,
c’est plutôt une anecdote.
Premièrement,
à cette époque, tous les féodaux ne parlaient pas le français,
mais seulement un nombre insignifiant de grands féodaux anglais à
la cour du roi et dans les comtés.
Deuxièmement,
ils ne parlaient pas une « langue de classes quelconque, mais la
langue française ordinaire, commune à tout le peuple français.
Troisièmement,
on sait que cet engouement de ceux qui s’amusaient à parler la
langue française a disparu ensuite sans laisser de trace, faisant
place à la langue anglaise commune à tout le peuple.
Ces
camarades pensent-ils que les féodaux anglais et le peuple anglais
se sont « durant des siècles » expliqués au moyen
d’interprètes, que les féodaux anglais ne se servaient pas de la
langue anglaise, qu’il n’existait pas alors de langue anglaise
commune à tout le peuple, que la langue française était alors en
Angleterre quelque chose de plus qu’une langue de salon, uniquement
employée dans le cercle étroit de la haute aristocratie anglaise ?
Comment peut-on, sur la base de tels « arguments »
anecdotiques, nier l’existence et la nécessité d’une langue
commune à tout le peuple ?
Les
aristocrates russes se sont également amusés un certain temps à
parler français à la cour des tsars et dans les salons. Ils se
vantaient de ce qu’en parlant le russe ils y mêlaient souvent du
français et de ce qu’ils ne savaient parler le russe qu’avec un
accent français.
Est-ce
à dire qu’il n’existait pas alors en Russie une langue russe
commune à tout le peuple, que la langue commune au peuple entier
était une fiction, que les « langues de classe »
constituaient une réalité ?
Nos
camarades commettent ici, pour le moins, deux erreurs.
La
première erreur est qu’ils confondent la langue avec la
superstructure. Ils pensent que si la superstructure a un caractère
de classe, la langue de même ne doit pas être commune à tout le
peuple, mais doit porter un caractère de classe. J’ai déjà dit
plus haut que la langue et la superstructure sont deux notions
différentes. et qu’il n’est pas permis à un marxiste de les
confondre.
La
seconde erreur est que ces camarades conçoivent l’opposition des
intérêts de la bourgeoisie et du prolétariat, leur lutte de
classes acharnée, comme une désagrégation de la société, comme
une rupture de tous les liens entre les classes hostiles.
Ils
estiment que, puisque la société s’est désagrégée et qu’il
n’existe plus de société unique, mais seulement des classes, il
n’est plus besoin d’une langue unique pour la société, il n’est
plus besoin d’une langue nationale. Que reste-t-il donc si la
société s’est désagrégée et s’il n’y a plus de langue
nationale, commune à tout le peuple ?
Restent
les classes et les « langues de classe ». Il va de soi que
chaque « langue de classe » aura sa grammaire « de
classe », grammaire « prolétarienne », grammaire
« bourgeoise)). Il est vrai que ces grammaires n’existent pas
en réalité ; mais cela n’embarrasse guère ces camarades :
ils sont persuadés que ces grammaires verront le jour.
Il
y avait chez nous, à un moment donné, des « marxistes » qui
prétendaient que les chemins de fer restés dans notre pays après
la Révolution d’octobre étaient des chemins de fer bourgeois ;
qu’il ne nous seyait pan, à nous marxistes, de nous en servir ;
qu’il fallait les démonter et en construire de nouveaux, des
chemins de fer « prolétariens ». Cela leur valut le surnom
de « troglodytes »…
Il
va de soi que ces vues d’un anarchisme primitif sur la société,
sur les classes, sur la langue n’ont rien de commun avec le
marxisme. Mais elles existent incontestablement et continuent
d’habiter les cerveaux de certains de nos camarades aux idées
confuses.
Il
est évidemment faux que, par suite d’une lutte de classes
acharnée, la société se soit désagrégée en classes qui
économiquement ne sont plus liées les unes aux autres au sein d’une
société unique. Au contraire, aussi longtemps que le capitalisme
existe, bourgeois et prolétaires seront attachés ensemble par tous
les liens de la vie économique, en tant que parties constitutives
d’une société capitaliste unique.
Les
bourgeois ne peuvent vivre et s’enrichir s’ils n’ont pas à
leur disposition des ouvriers salariés ; les prolétaires ne
peuvent subsister s’ils ne s’embauchent pas chez les
capitalistes. La rupture de tous liens économiques entre eux
signifie la cessation de toute production ; or, la cessation de
toute production conduit à la mort de la société, à la mort des
classes elles-mêmes.
On
conçoit qu’aucune classe ne veuille se vouer à l’autodestruction.
C’est pourquoi la lutte de classes, si aiguë soit-elle, ne peut
conduire à la désagrégation de la société. Seules l’ignorance
en matière de marxisme et l’incompréhension totale de la nature
de la langue ont pu suggérer à certains de nos camarades cette
fable sur la désagrégation de la société, sur les langues « de
classe », sur les grammaires « de classer.
On
se réfère ensuite à Lénine, et l’on rappelle que Lénine
reconnaissait l’existence en régime capitaliste de deux cultures,
bourgeoise et prolétarienne ; que le mot d’ordre de culture
nationale, sous le capitalisme, est un mot d’ordre nationaliste.
Tout
cela est juste, et Lénine sur ce point a tout à fait raison.
Mais
que vient faire ici le « caractère de classe » de la
langue ? En invoquant les paroles de Lénine sur les deux
cultures en régime capitaliste, ces camarades veulent apparemment
donner à entendre au lecteur que l’existence dans la société de
deux cultures, bourgeoise et prolétarienne, signifie qu’il doit y
avoir également deux langues, la langue étant liée à la culture ;
c’est dire que Lénine nie la nécessité d’une langue nationale
unique, c’est dire que Lénine reconnaît l’existence des langues
« de classer. L’erreur de ces camarades consiste ici à
identifier et à confondre la langue avec la culture.
Or
la culture et la langue sont deux choses différentes. La culture
peut être bourgeoise ou socialiste, tandis que la langue, comme
moyen de communication entre les hommes, est toujours commune à tout
le peuple ; elle peut servir et la culture bourgeoise et la
culture socialiste.
N’est-ce
pas un fait que les langues russe, ukrainienne, ouzbèque servent
actuellement la culture socialiste de ces nations tout aussi’ bien
qu’elles servaient leur culture bourgeoise avant la Révolution
d’octobre ? Par conséquent, ces camarades se trompent
gravement en affirmant que l’existence de deux cultures différentes
mène à la formation de deux langues différentes et à la négation
de la nécessité d’une langue unique.
En
parlant de deux cultures, Lénine partait justement de cette thèse
que l’existence de deux cultures ne peut conduire à la négation
d’une langue unique et à la formation de deux langues, que la
langue doit être unique.
Lorsque
les bundistes [5] accusèrent Lénine de nier la nécessité
de la langue nationale et de regarder la culture comme étant « sans
appartenance nationale », Lénine, on le sait, protesta vivement
contre cette accusation et déclara qu’il combattait la culture
bourgeoise et non la langue nationale dont il considérait la
nécessité comme incontestable. Il est étrange de voir certains de
nos camarades marcher sur les traces des bundistes.
En
ce qui concerne la langue unique, dont Lénine aurait soi-disant nié
la nécessité, il conviendrait d’entendre les paroles suivantes de
Lénine :
« La
langue est le plus important des moyens de communication entre les
hommes. L’unité de la langue et le libre développement sont parmi
les conditions les plus importantes d’un commerce vraiment libre,
vraiment large et correspondant au capitalisme moderne, du groupement
libre et large de la population dans chaque classe prise en
particuliers » [6].
Il
s’ensuit donc que nos honorables camarades ont déformé les
opinions de Lénine.
On
se réfère enfin à Staline.
On
cite de Staline le passage suivant : « La bourgeoisie et ses
partis nationalistes ont été et demeurent, en cette période, la
principale force directrice de ces nations. » [7] Tout
cela est juste. La bourgeoisie et son parti nationaliste dirigent
effectivement la culture bourgeoise, de même que le prolétariat et
son parti internationaliste dirigent la culture prolétarienne. Mais
que vient faire ici le « caractère de classe » de la
langue ?
Ces
camarades ne savent-ils pas que la langue nationale est une forme de
la culture nationale, que la langue nationale peut servir la culture
bourgeoise comme la culture socialiste ? Est-ce que nos
camarades ignoreraient la formule bien connue des marxistes, suivant
laquelle les cultures actuelles russe, ukrainienne, biélorusse et
autres sont socialistes par le contenu et nationales par la forme,
c’est-à-dire par la langue ? Sont-ils d’accord avec cette
formule marxiste ?
L’erreur
de nos camarades est qu’ils ne voient pas de différence entre la
culture et la langue, et ne comprennent pas que la culture change de
contenu à chaque nouvelle période de développement de la société,
tandis que la langue reste, pour l’essentiel, la même pendant
plusieurs périodes et sert aussi bien la nouvelle culture que
l’ancienne.
Ainsi :
a)
La langue, comme moyen de communication, a toujours été et reste
une langue unique pour la société et commune à tous ses membres ;
b)
L’existence des dialectes et des jargons, loin d’infirmer,
confirme l’existence d’une langue commune au peuple entier,
langue dont ils constituent les rameaux et à laquelle ils sont
subordonnés ;
c)
La formulation « caractère de classe » de la langue relève
d’une thèse erronée, non marxiste.
QUESTION :
Quels sont les traits caractéristiques de la langue ?
REPONSE :
La langue compte parmi les phénomènes sociaux qui agissent pendant
toute la durée de l’existence de la société. Elle naît et se
développe en même temps que naît et se développe la société.
Elle
meurt en même temps que la société.
Pas
de langue en dehors de la société.
C’est
pourquoi l’on ne peut comprendre la langue et les lois de son
développement que si l’on étudie la langue en relation étroite
avec l’histoire de la société, avec l’histoire du peuple auquel
appartient la langue étudiée et qui en est le créateur et le
dépositaire.
La
langue est un moyen, un instrument à l’aide duquel les hommes
communiquent entre eux, échangent leurs idées et arrivent à se
faire comprendre. Directement liée à la pensée, la langue
enregistre et fixe, dans les mots et les combinaisons de mots formant
des propositions, les résultats du travail de’ la pensée, les
progrès du travail de l’homme pour étendre ses connaissances, et
rend ainsi possible l’échange des idées dans la société
humaine.
L’échange
des idées est une nécessité constante et vitale, car, sans cela,
il serait impossible d’organiser l’action commune des hommes dans
la lutte contre les forces de la nature, dans la lutte pour la
production des biens matériels nécessaires, sans cela, impossible
de réaliser des progrès dans l’activité productrice de la
société, impossible, par conséquent, qu’exista même la
production sociale.
Il
s’ensuit que, sans une langue intelligible pour la société et
commune à ses membres, la société s’arrête de produire, se
désagrège et cesse d’exister en tant que société. Dans ce sens,
la langue, instrument de communication, est en même temps un
instrument de lutte et de développement de la société.
Comme
on sait, l’ensemble de tous les mots existant dans une langue
forment ce qu’on appelle son vocabulaire. Le principal dans le
vocabulaire d’une langue, c’est le fonds lexique essentiel, dont
le noyau est constitué par les radicaux. Ce noyau est beaucoup moins
étendu que le vocabulaire de la langue, mais il vit très longtemps,
durant des siècles, et fournit à la langue une base pour la
formation de mots nouveaux.
Le
vocabulaire reflète l’état de la langue : plus le
vocabulaire est riche et varié, plus riche et évoluée est la
langue.
Cependant,
le vocabulaire pris en lui-même ne constitue pas encore la langue, –
il est plutôt le matériau nécessaire pour construire la langue. De
même que les matériaux de construction dans le bâtiment ne sont
pas l’édifice, encore qu’il soit impossible, sans eux, de bâtir
l’édifice, de même le vocabulaire d’une langue ne constitue pas
la langue elle-même, encore que sans lui toute langue soit
impossible.
Mais
le vocabulaire d’une langue prend une énorme importance quand il
est mis à la disposition de la grammaire de cette langue ; la
grammaire définit les règles qui président à la modification des
mots. à la combinaison des mots dans le corps d’une proposition,
et donne ainsi à la langue un caractère harmonieux et logique.
La
grammaire (morphologie et syntaxe) est un recueil de règles sur la
modification des mots et leur combinaison dans le corps d’une
proposition. Par conséquent, c’est précisément grâce à la
grammaire que la langue a la possibilité de revêtir la pensée
humaine d’une enveloppe matérielle, linguistique.
Le
trait distinctif de la grammaire est qu’elle fournit les règles de
modification des mots, en considérant, non pas des mots concrets,
mais des mots en général, vidés de tout caractère concret ;
elle donne les règles de la formation des propositions en
considérant, non pas des propositions concrètes, par exemple on
sujet concret, un prédicat concret, etc., mais d’une façon
générale toutes les propositions indépendamment de la forme
concrète de telle ou telle proposition.
Par
conséquent, faisant abstraction du particulier et du concret, aussi
bien dans les mots que dans les propositions, la grammaire prend ce
qu’il y a de général à la base des modifications des mots et de
la combinaison des mots au sein d’une proposition, et elle en tire
les règles grammaticales, les lois grammaticales. La grammaire est
le résultat d’un travail prolongé d’abstraction de la pensée
humaine, l’indice d’immenses progrès de la pensée.
A
cet égard, la grammaire rappelle la géométrie qui énonce ses lois
en faisant abstraction des objets concrets, en considérant ceux-ci
comme des corps dépourvus de caractère concret et en définissant
les rapports entre eux, non point comme des rapports concrets entre
tels ou tels objets concrets, mais comme des rapports entre les corps
en général, dépourvus de tout caractère concret.
A
la différence de la superstructure qui n’est pas liée à la
production directement, mais par l’intermédiaire de l’économie,
la langue est directement liée à l’activité productrice de
l’homme, de même qu’à toutes ses autres activités dans toutes
les sphères de son travail, sans exception.
Aussi
le vocabulaire d’une langue, étant le plus susceptible de
changement, se trouve-t-il dans un état de transformation à peu
près ininterrompue ; en même temps, à la différence de la
superstructure, la langue n’a pas à attendre la liquidation de la
base, elle apporte des changements à son vocabulaire avant la
liquidation de la base et indépendamment de l’état de la base.
Cependant,
le vocabulaire de la langue change, non pas comme la superstructure,
en abolissant ce qui est ancien et en construisant du nouveau, mais
en enrichissant le vocabulaire existant de mots nouveaux engendrés
par les changements survenus dans le régime social, par le
développement de la production, le progrès de la culture, de la
science, etc.
En
même temps, bien qu’un certain nombre de mots surannés
disparaissent en général du vocabulaire de la langue, il s’y
agrège un nombre bien plus considérable de mots nouveaux. Quant au
fonds essentiel du vocabulaire, il se conserve dans ses grandes
lignes, et est employé comme base du vocabulaire de la langue.
Cela
se conçoit. Point n’est besoin de détruire le fonds essentiel du
vocabulaire, alors qu’il peut être employé avec succès pendant
plusieurs périodes historiques, sans compter que la destruction du
fonds essentiel du vocabulaire accumulé pendant des siècles
amènerait, vu l’impossibilité d’en constituer un nouveau à
bref délai, la paralysie de la langue et la désorganisation totale
des relations des hommes entre eux.
Le
système grammatical de la langue change avec encore plus de lenteur
que le fonds essentiel du vocabulaire.
Élabore
au long de plusieurs époques et faisant corps avec la langue, le
système grammatical change encore plus lentement que le fonds
essentiel du vocabulaire. Bien entendu, il subit à la longue des
changements, il se perfectionne, il améliore et précise ses règles,
s’enrichit de règles nouvelles ; mais les bases du système
grammatical subsistent pendant une très longue période, étant
donné, comme le montre l’histoire, qu’elles peuvent servir avec
succès la société pendant plusieurs époques.
Ainsi,
le système grammatical de la langue et le fonds essentiel du
vocabulaire constituent la base de la langue, l’essence de son
caractère spécifique.
L’histoire
atteste l’extrême stabilité et la résistance énorme de la
langue à une assimilation forcée. Certains historiens, au lieu
d’expliquer ce phénomène, se bornent à marquer leur étonnement.
Mais il n’y a là aucun sujet d’étonnement. La stabilité de la
langue s’explique par la stabilité de son système grammatical et
du fonds essentiel de son vocabulaire.
Durant
des siècles, les assimilateurs turcs se sont attachés à mutiler, à
détruire et à anéantir les langues des peuples balkaniques. Au
cours de cette période, le vocabulaire des langues balkaniques a
subi de sérieuses transformations, bon nombre de mots et
d’expressions turcs furent adoptés, il y eut des « convergences »
et des « divergences », mais les langues balkaniques ont
résisté et survécu. Pourquoi ? Parce que le système
grammatical et le fonds du vocabulaire de ces langues se sont pour
l’essentiel conservés.
De
tout cela il ressort que la langue et sa structure ne sauraient être
considérées comme le produit d’une époque quelconque. La
structure de la langue, son système grammatical et le fonds
essentiel de son vocabulaire sont le produit d’une suite d’époques.
Il
est probable que les éléments de la langue moderne ont été créés
dès la plus haute antiquité, avant l’époque de l’esclavage.
C’était une langue peu complexe, avec un vocabulaire très pauvre,
possédant toutefois un système grammatical à elle, primitif il est
vrai, mais qui était cependant un système grammatical.
Le
développement ultérieur de la production, l’apparition des
classes, l’apparition de l’écriture, la naissance d’un Etat,
qui avait besoin, pour son administration, d’une correspondance
plus ou moins ordonnée, le développement du commerce, qui avait
encore plus besoin d’une correspondance ordonnée, l’apparition
de la presse à imprimer, les progrès de la littérature, tous ces
faits apportèrent de grands changements dans l’évolution de la
langue.
Pendant
ce temps, les tribus et les nationalités se fragmentaient et se
dispersaient, se mêlaient et se croisaient ; l’on vit
apparaître ensuite des langues nationales et des Etats nationaux, il
y eut des révolutions, les anciens régimes sociaux firent place à
d’autres.
Tous
ces faits apportèrent plus de changements encore dans la langue et
dans son évolution.
Cependant,
ce serait une grave erreur de croire que la langue s’est développée
de la même manière que se développait la superstructure,
c’est-à-dire en détruisant ce qui existait et en édifiant du
nouveau. En réalité, la langue s’est développée, non pas en
détruisant la langue existante et en en constituant une nouvelle,
mais en développant et perfectionnant les éléments essentiels de
la langue existante.
Et
le passage d’une qualité de la langue à une autre qualité ne se
faisait point par explosion, en détruisant d’un seul coup tout
l’ancien et en construisant du nouveau, mais par la lente
accumulation, pendant une longue période, des éléments de la
nouvelle qualité, de la nouvelle structure de la langue, et par
dépérissement progressif des éléments de l’ancienne qualité.
On
dit que la théorie de l’évolution de la langue par stades est une
théorie marxiste, car elle reconnaît la nécessité de brusques
explosions comme condition du passage de la langue de l’ancienne
qualité à une qualité nouvelle. C’est faux, évidemment, car il
est difficile de trouver quoi que ce soit de marxiste dans cette
théorie. Et si la théorie de l’évolution par stades reconnaît
effectivement de brusques explosions dans l’histoire du
développement de la langue, tant pis pour la théorie.
Le
marxisme ne reconnaît pas les brusques explosions dans le
développement de la langue, la brusque disparition de la langue
existante et la brusque constitution d’une langue nouvelle.
Lafargue avait tort lorsqu’il parlait de « la brusque
révolution linguistique qui s’accomplit de 1789 à 1794 » en
France (voir la brochure de Lafargue : La Langue française
avant et après la Révolution).
A
cette époque, il n’y a eu en France aucune révolution
linguistique, et encore moins une brusque révolution. Bien entendu,
durant cette période, le vocabulaire de la langue française s’est
enrichi de mots nouveaux et d’expressions nouvelles ; des mots
surannés ont disparu, le sens de certains mots a changé, mais c’est
tout.
Or,
de tels changements ne décident aucunement des destinées d’une
langue.
Le
principal dans une langue, c’est le système grammatical et le
fonds essentiel du vocabulaire. Mais, loin de disparaître au cours
de la révolution bourgeoise française, le système grammatical et
le fonds essentiel du vocabulaire de la langue française se sont
conservés sans subir de changements notables ; et pas seulement
conservés, ils continuent d’exister dans la langue française
actuelle.
Sans
compter que, pour liquider une langue existante et constituer une
nouvelle langue nationale (« brusque révolution
linguistique » !), un délai de cinq à six ans est
ridiculement bref, – il faut pour cela des siècles.
Le
marxisme estime que le passage de la langue d’une qualité ancienne
à une qualité nouvelle ne se produit pas par explosion ni par
destruction de la langue existante et constitution d’une nouvelle,
mais par accumulation graduelle des éléments de la nouvelle
qualité, et donc par l’extinction graduelle des éléments de la
qualité ancienne.
Il
faut dire en général, à l’intention des camarades qui se
passionnent pour les explosions, que la loi qui préside au passage
de la qualité ancienne à une qualité nouvelle au moyen
d’explosions n’est pas seulement inapplicable à l’histoire du
développement de la langue, mais qu’on ne saurait non plus
l’appliquer toujours à d’autres phénomènes sociaux qui
concernent la base ou la superstructure.
Ce
processus est obligatoire pour une société divisée en classes
hostiles. Mais il ne l’est pas du tout pour une société qui ne
comporte pas de classes hostiles.
En
l’espace de huit à dix ans, nous avons réalisé, dans
l’agriculture de notre pays, le passage du régime bourgeois de
l’exploitation paysanne individuelle au régime socialiste,
kolkhozien. Ce fut une révolution qui a liquidé l’ancien régime
économique bourgeois à la campagne et créé un régime nouveau,
socialiste. Cependant, cette transformation radicale ne s’est pas
faite par voie d’explosion, c’est-à-dire par le renversement do
pouvoir existant et la création d’un pouvoir nouveau, mais par le
passage graduel de l’ancien régime bourgeois dans les campagnes à
un régime nouveau. On a pu le faire parce que c’était une
révolution par en haut, parce que la transformation radicale a été
réalisée sur l’initiative du pouvoir existant, avec l’appui de
la masse essentielle de la paysannerie.
On
dit que les nombreux cas de croisement de langues qui se sont
produits dans l’histoire donnent lieu de supposer que, lors du
croisement, il se constitue une langue nouvelle par voie d’explosion,
par le brusque passage de la qualité ancienne à une qualité
nouvelle.
C’est
absolument faux.
On
ne saurait considérer le croisement des langues comme un acte
unique, un coup décisif donnant des résultats en quelques années.
Le croisement des langues est un long processus qui s’échelonne
sur des siècles. Il ne saurait donc être question ici d’aucune
explosion.
Poursuivons.
Il serait absolument faux de croire que le croisement de deux
langues, par exemple, en produit une nouvelle, une troisième, qui ne
ressemble à aucune des langues croisées et se distingue
qualitativement de chacune d’elles. En réalité, l’une des
langues sort généralement victorieuse du croisement, conserve son
système grammatical, conserve le fonds essentiel de son vocabulaire
et continue d’évoluer suivant les lois internes de son
développement, tandis que l’autre langue perd peu à peu sa
qualité et s’éteint graduellement.
Par
conséquent, le croisement ne produit pas une langue nouvelle, une
troisième langue, mais conserve l’une des langues ; son
système grammatical et le fonds essentiel de son vocabulaire, et lui
permet donc d’évoluer suivant les lois internes de son
développement.
Il
est vrai qu’il se produit alors un certain enrichissement du
vocabulaire de la langue victorieuse aux dépens de la langue
vaincue, mais cela, loin de l’affaiblir, la fortifie.
Il
en fut ainsi, par exemple, de la langue russe, avec laquelle se sont
croisées, a u cours du développement historique, des langues
d’autres peuples, et qui est toujours demeurée victorieuse.
Evidemment,
le vocabulaire de la langue russe s’est élargi alors par
assimilation du vocabulaire des autres langues, mais ce processus,
loin d’affaiblir la langue russe, l’a, a u contraire, enrichie et
fortifiée.
Quant
à l’originalité nationale de la langue russe, elle n’a pas subi
la moindre atteinte, car en conservant son système grammatical et le
fonds essentiel de son vocabulaire, la langue russe a continué
d’évoluer et de se perfectionner suivant les lois internes de son
développement.
Il
est hors de doute que la théorie du croisement ne peut rien apporter
de sérieux à la linguistique soviétique. S’il est vrai que
l’étude des lois internes du développement de la langue constitue
la tâche principale de la linguistique, il faut reconnaître que la
théorie du croisement ne peut accomplir cette tâche ; bien
plus, elle ne l’envisage même pas ; tout simplement, elle ne
la remarque pas, ou bien ne la comprend pas.
QUESTION : La
Pravda a-t-elle eu raison d’ouvrir un débat libre sur les
problèmes de linguistique ?
RÉPONSE :
Oui, elle a eu raison.
C’est
au terme du débat que le sens dans lequel seront résolus les
problèmes de la linguistique apparaîtra clairement. Mais, dès à
présent, il est permis de dire que le débat a été très utile.
Le
débat a établi avant tout que dans les institutions de
linguistique, au centre comme dans les Républiques, il régnait un
régime incompatible avec la science et la qualité d’hommes de
science.
La
moindre critique de la situation dans la linguistique soviétique,
même les tentatives les plus timides pour critiquer la « doctrine
nouvelle » en linguistique, étaient poursuivies et étouffées
par les milieux dirigeants de la linguistique.
Pour
une attitude critique à l’égard de l’héritage de N. Marr, pour
la moindre désapprobation de la doctrine de N. Marr, des
travailleurs et chercheurs de valeur en linguistique étaient relevés
de leurs postes ou rétrogradés. Des linguistes étaient appelés à
des postes dirigeants, non pour leurs mérites, mais parce qu’ils
acceptaient inconditionnellement la doctrine de N. Marr.
Il
est universellement reconnu qu’il n’est point de science qui
puisse se développer et s’épanouir sans une lutte d’opinions,
sans la liberté de critique.
Mais
cette règle universellement reconnue était ignorée et foulée aux
pieds sans façon. Il s’est constitué un groupe restreint de
dirigeants infaillibles qui, après s’être prémunis contre toute
possibilité de critique, ont sombré dans le bon plaisir et
l’arbitraire.
Voici
un exemple : le Cours de Bakou (conférences faites dans cette
ville par N. Marr), considéré comme défectueux et dont la
réimpression avait été interdite par son auteur même, a été
cependant, sur l’ordre de la caste des dirigeants (le camarade
Mechtchaninov les appelle les « disciples » de N. Marr),
réimprimé et inclus parmi les manuels recommandés aux étudiants
sans réserve d’aucune sorte.
C’est
dire qu’on a trompé les étudiants en leur présentant un cours
reconnu défectueux pour un manuel de valeur. Si je n’étais pas
convaincu de la probité du camarade Mechtchaninov et des autres
spécialistes de la linguistique, je dirais qu’une pareille
conduite équivaut à du sabotage.
Comment
cela a-t-il pu se produire ? Cela s’est produit parce que le
régime à la Araktchéev [8], institué dans la linguistique,
cultive l’esprit d’irresponsabilité et favorise de tels excès.
Le
débat s’est révélé fort utile avant tout parce qu’il a tiré
au grand jour ce régime à la Araktchéev et l’a démoli à fond.
Mais
là ne se borne pas l’utilité du débat. Il n’a pas seulement
démoli l’ancien régime dans la linguistique, il a montré aussi
l’incroyable confusion d’idées qui règne sur les problèmes les
plus importants de la linguistique, dans les milieux dirigeants de ce
domaine de la science. Jusqu’à ce que le débat fût engagé, ils
se taisaient et passaient sous silence le fait que cela n’allait
pas bien dans la linguistique.
Mais
le débat une fois ouvert, il n’était plus possible de garder le
silence, ils durent exposer leur opinion dans la presse.
Et
alors ? Il s’est avéré que la doctrine de N. Marr comporte
nombre de lacunes, d’erreurs, de problèmes non précisés, de
thèses insuffisamment élaborées. La question se pose :
pourquoi les « disciples » de N. Marr se sont-ils mis à
parler seulement maintenant, après l’ouverture du débat ?
Pourquoi
ne l’ont-ils pas fait plus tôt ?
Pourquoi
ne l’ont-ils pas dit en temps opportun, ouvertement et en toute
franchise, comme il sied à des hommes de science ?
Après
avoir reconnu « certaines » erreurs de N. Marr, les
« disciples » de celui-ci pensent, paraît-il, qu’on ne
peut développer plus avant la linguistique soviétique que sur la
base d’une version « corrigée » de la théorie de N. Marr,
qu’ils considèrent comme marxiste. Eh bien non, faites-nous grâce
du « marxisme » de N. Marr. Effectivement, N. Marr voulait
être marxiste, et il s’y est efforcé, mais n’a su le devenir.
Il n’a fait que simplifier et banaliser le marxisme, dans le genre
des membres du « Proletkult » ou du R.A.P.P.
N.
Marr a introduit dans la linguistique la thèse erronée, non
marxiste, de la langue considérée comme une superstructure, il s’y
est empêtré lui-même et y a empêtré la linguistique.
Il
est impossible de développer la linguistique soviétique sur la base
d’une thèse erronée.
N.
Marr a introduit dans la linguistique cette autre thèse, également
erronée et non marxiste, du « caractère de classe » de la
langue, il s’y est empêtré et y a empêtré la linguistique.
Il
est impossible de développer la linguistique soviétique sur la base
d’une thèse erronée qui est en contradiction avec toute la marche
de l’histoire des peuples et des langues.
N.
Marr a introduit dans la linguistique un ton d’immodestie, de
vantardise et d’arrogance, incompatible avec le marxisme et
conduisant à nier gratuitement et à la légère tout ce qu’il y
avait dans la linguistique avant N. Marc.
N.
Marr dénigre tapageusement la méthode historique comparée qu’il
qualifie d’ »idéaliste ». Disons que la méthode
historique comparée, malgré ses défauts graves, vaut cependant
mieux que l’analyse à quatre éléments, véritablement idéaliste,
elle, de N. Marr [9], car la première pousse au travail, à
l’étude des langues, tandis que la seconde ne pousse qu’à
rester couché sur le flanc et à lire dans le marc de café le
mystère de ces fameux quatre éléments.
N.
Marr rejette avec hauteur toute tentative d’étudier les groupes
(familles) de langues, comme une manifestation de la théorie de la
« langue-mère » [10].
Or,
on ne saurait nier que la parenté linguistique de nations telles que
les nations slaves, par exemple, ne fait aucun doute ; que
l’étude de la parenté linguistique de ces nations pourrait être
d’une grande utilité quant à l’étude des lois de développement
de la langue.
Sans
compter que la théorie de la « langue-mère » n’a rien à
voir ici.
A
entendre N. Marr et surtout ses « disciples », on croirait
qu’avant Marr, il n’existait aucune linguistique ; que la
linguistique a commencé avec l’apparition de la « doctrine
nouvelle » de N. Marr. Marx et Engels étaient bien plus
modestes ; ils estimaient que leur matérialisme dialectique
était le produit du développement des sciences, y compris la
philosophie, durant la période antérieure.
Ainsi,
le débat a été également utile en ce sens qu’il a mis à jour
les lacunes idéologiques de la linguistique soviétique.
Je
pense que plus tôt notre linguistique se débarrassera des erreurs
de N. Marr, plus rapidement on pourra la sortir de la crise qu’elle
traverse à l’heure actuelle.
Liquider
le régime à la Araktchéev dans la linguistique, renoncer aux
erreurs de N. Marr, introduire le marxisme dans la linguistique,
telle est, à mon avis, la voie qui permettra de donner une base
saine à la linguistique soviétique.
Pravda,
20 juin 1950.
A PROPOS DE QUELQUES PROBLÈMES DE LINGUISTIQUE –
RÉPONSE A LA CAMARADE E. KRACHENINNIKOVA
Camarade
Kracheninnikova,
Je
réponds à vos questions.
1.
QUESTION : Dans votre article, vous montrez de façon
convaincante que la langue n’est ni une base, ni une
superstructure. Serait-on en droit de considérer la langue comme un
phénomène propre et à la base et à la superstructure, ou
serait-il plus juste de considérer la langue comme un phénomène
intermédiaire ?
REPONSE :
Il est évident que l’élément commun présent dans tous les
phénomènes sociaux, y compris la base et la superstructure, est
également propre à la langue en tant que phénomène social,
c’est-à-dire qu’elle est au service de la société comme tous
les autres phénomènes sociaux, y compris la base et la
superstructure.
Mais
c’est à cela précisément que s’arrête l’élément commun
présent dans tous les phénomènes sociaux, Ensuite, les phénomènes
sociaux commencent à se différencier sérieusement.
Le
fait est qu’à part cet élément commun, les phénomènes sociaux
ont leurs particularités spécifiques qui les distinguent les uns
des autres et qui ont pour la science une importance primordiale.
Les
particularités spécifiques de la base résident dans le fait
qu’elle est au service de la société du point de vue économique.
Les particularités spécifiques de la superstructure résident dans
le fait qu’elle met au service de la société les idées
politiques, juridiques, esthétiques et autres, et crée pour la
société les institutions politiques, juridiques et autres
correspondantes.
En
quoi consistent les particularités spécifiques de la langue qui la
distinguent des autres phénomènes sociaux ?
En
ceci que la langue est au service de la société en tant que moyen
pour les hommes de communiquer entre eux, en tant que moyen d’échange
des idées dans la société, en tant que moyen permettant aux hommes
de se comprendre entre eux et de mettre au point un travail commun
dans toutes les sphères de l’activité humaine, aussi bien dans le
domaine de la production que dans celui des rapports économiques,
dans le domaine de la politique que dans celui de la culture, dans le
domaine de la vie sociale que dans celui de la vie de tons les jours.
Ces
particularités ne sont propres qu’à la langue et c’est
justement parce qu’elles ne sont propres qu’à la langue que la
langue fait l’objet de l’étude d’une science indépendante :
la linguistique. Sans ces particularités de la langue, la
linguistique perdrait son droit à une existence indépendante.
En
bref, on ne peut ranger la langue ni dans la catégorie des bases, ni
dans celle des superstructures.
On
ne peut non plus la ranger dans la catégorie des phénomènes
« intermédiaires » entre la base et la superstructure, étant
donné qu’il n’existe pas de phénomènes « intermédiaires »
de ce genre.
Mais
peut-être pourrait-on ranger la langue dans la catégorie des forces
productives de la société, dans celle, disons, des instruments de
production ? Il est vrai qu’entre la langue et les instruments
de production, il existe une certaine analogie : les instruments
de production, tout comme la langue, manifestent une espèce
d’indifférence à l’égard des classes et peuvent servir de la
même manière les différentes classes de la société, les
anciennes comme les nouvelles.
Cette
circonstance nous autorise-t-elle à ranger la langue dans la
catégorie des instruments de production ?
Nullement.
Il
fut un temps où, voyant que sa formule *la langue est une
superstructure au-dessus de la base » rencontrait des objections,
N. Marr a décidé de changer de système et a déclaré que « la
langue est un instrument de production)). N. Marr avait-il raison de
ranger la langue dans la catégorie des instruments de production ?
Non, il avait absolument tort.
Le
fait est que la similitude entre la langue et les instruments de
production s’arrête à l’analogie dont je viens de parler.
Mais,
par ailleurs, il existe une différence radicale entre la langue et
les moyens de production.
Cette
différence réside dans le fait que les instruments de production
produisent des biens matériels, tandis que la langue ne produit rien
du tout, ou encore ne « produit » que des mots. Pour être
plus précis, les hommes qui ont des instruments de production
peuvent produire des biens matériels ; cependant, les mêmes
hommes ayant la langue, mais n’ayant pas d’instruments de
production, ne peuvent pas produire de biens matériels.
Il
n’est pas difficile de comprendre que si la langue pouvait produire
des biens matériels, les bavards seraient les gens les plus riches
de la terre.
2.
QUESTION : Marx et Engels définissent la langue comme la
« réalité immédiate de la pensée », comme la « conscience
réelle… pratique ». « Les idées, dit Marx ;,
n’existent pas en dehors de la langue. » Dans quelle mesure, à
votre avis, la linguistique doit-elle s’occuper du sens de la
langue, de la sémantique, de la sémasiologie historique et de la
stylistique, ou bien la linguistique ne doit-elle avoir que la forme
pour objet ?
REPONSE :
La sémantique (sémasiologie) est une des parties importantes de la
linguistique. L’aspect sémantique des mots et des expressions a
une importance sérieuse dans l’étude de la langue.
C’est
pourquoi la sémantique (sémasiologie) doit recevoir, dans la
linguistique, la place qui lui convient.
Cependant,
quand on étudie les questions de la sémantique et qu’on en
utilise les données, il ne faut en aucun cas surestimer son
importance, et encore bien moins en abuser.
J’ai
en vue certains linguistes qui ont une passion exagérée pour la
sémantique et négligent la langue en tant que « réalité
immédiate de la pensées, indissolublement liée à la pensée, qui
détachent la pensée de la langue et affirment que la langue arrive
au terme de son existence, que l’on peut se passer d’elle.
Voyez
ce que dit N. Marr :
La
langue n’existe que dans la mesure où elle s’exprime dans les
sens ; l’opération de la pensée se produit aussi sans
s’exprimer. Le langage (phonétique) a commencé dès aujourd’hui
à transmettre ses fonctions aux inventions modernes qui triomphent
sans réserve dans l’espace, tandis que la pensée, partant de ce
que le langage a accumulé dans le passé sans s’en servir, et de
ce qu’il a acquis récemment, marche vers les sommets, étant
appelée à destituer et à remplacer complètement le langage.
La
langue de l’avenir, c’est la pensée grandissant dans une
technique libérée de la matière naturelle. Aucun langage ne pourra
lui résister, même le langage phonétique, cependant lié aux
règles de la nature (Cf. N. Marr : Œuvres choisies).
Si
l’on traduit en langage simple ce grimoire « magique », on
peut conclure que :
a)
N. Marr détache la pensée de la langue ;
b)
N. Marr estime que les hommes peuvent communiquer entre eux sans
l’usage de la langue, à l’aide de la pensée même, libérée de
la « matière naturelle », libérée des « règles de la
nature » ;
c)
En détachant la pensée du langage et en la « libérant » de
sa « matière naturelle », le langage, N. Marr tombe dans le
marais de l’idéalisme.
On
dit que les pensées viennent à l’esprit de l’homme avant de
s’exprimer dans le discours, qu’elles naissent sans le matériau
de la langue, sans l’enveloppe de la langue, nues pour ainsi dire.
Mais
c’est absolument faux.
Quelles
que soient les pensées qui viennent à l’esprit de l’homme et
quel que soit le moment où ces pensées apparaissent, elles ne
peuvent naître et exister que sur la base du matériau de la langue,
que sur la base des termes et des phrases de la langue.
Il
n’y a pas de pensées nues, libérées des matériaux du langage,
libérées de la ((matière naturelle » qu’est le langage. « La
langue est la réalité immédiate de la pensée » (Marx). La
réalité de la pensée se manifeste dans la langue. Seuls des
idéalistes peuvent parler d’une pensée détachée de la « matière
naturelle », le langage, d’une pensée sans langage.
En
bref, parce qu’il a surestimé la sémantique et en a fait abus, N.
Marr en est arrivé à l’idéalisme.
Par
conséquent, si l’on préserve la sémantique (sémasiologie) des
exagérations et des abus du genre de ceux que commettent N. Marr et
certains de ses « disciples », elle peut être d’un grand
profit pour la linguistique.
3.
QUESTION : Vous dites, avec pleine raison, que les idées, les
notions, les mœurs et les principes moraux du bourgeois et du
prolétaire sont directement opposés. Le caractère de classe de ces
phénomènes s’est incontestablement reflété dans l’aspect
sémantique de la langue (et parfois aussi dans sa morphologie, dans
son vocabulaire, ainsi que cela est justement indiqué dans votre
article).
Quand
on analyse un matériau linguistique concret et, en premier lieu,
l’aspect sémantique d’une langue, peut-on parler de l’essence
de classe des conceptions qu’elle exprime, principalement quand il
s’agit de l’expression par la langue, non seulement de la pensée
de l’homme, mais aussi de son attitude à l’égard de la réalité,
attitude où son appartenance de classe se manifeste avec une netteté
particulière ?
REPONSE :
En bref, vous voulez savoir si les classes influent sur la langue, si
elles apportent dans la langue leurs mots et expressions spécifiques,
s’il est des cas où les hommes donnent à un seul et même mot, à
une seule et même expression une signification différente selon
leur appartenance de classe.
Oui,
les classes influent sur la langue, apportent dans la langue leurs
mots et expressions spécifiques et comprennent parfois différemment
un seul et même mot, une seule et même expression. Cela ne fait pas
de doute.
Cependant,
il ne s’ensuit pas que les mots et expressions spécifiques, de
même que les différences dans la sémantique, puissent avoir une
importance sérieuse pour le développement d’une langue unique,
commune à tout le peuple, qu’ils soient capables d’affaiblir son
importance ou de modifier son caractère.
Premièrement,
il y a, dans une langue, si peu de ces mots et expressions
spécifiques, si peu de ces cas de différences sémantiques qu’ils
constituent à peine un pour cent de tout le matériau de la langue.
Par conséquent, toute la grande masse des mots et expressions
restants. ainsi que leur sémantique, sont communs à toutes les
classes de la société.
Deuxièmement,
les mots et expressions spécifiques qui ont une nuance de classe ne
sont pas utilisés dans le discours selon les règles de je ne sais
quelle grammaire « de classe », qui n’existe pas dans la
réalité, mais d’après les règles de la grammaire de la langue
existante, commune à tout le peuple.
Donc,
l’existence de mots et d’expressions spécifiques, ainsi que de
différences dans la sémantique d’une langue, n’infirme pas,
mais confirme, au contraire, l’existence et la nécessité d’une
langue unique, commune à tout le peuple.
4.
QUESTION : Dans votre article, vous donnez une appréciation
tout à fait juste de Marr, comme quelqu’un qui a banalisé le
marxisme. Cela veut-il dire que les linguistes, et parmi eux nous,
les jeunes, nous devions rejeter tout l’héritage linguistique de
Marr dans lequel il y a cependant une série de recherches
linguistiques de valeur (dont ont parlé les camarades Tchikobava,
Sanjéïev et d’autres au cours du débat) ? Pouvons-nous, en
ayant une attitude critique à l’égard de Marr, prendre cependant
chez lui ce qu’il y a d’utile et ce qui a de la valeur ?
REPONSE :
Evidemment, les oeuvres de N. Marr ne contiennent pas que des
erreurs. N. Marr a commis des erreurs grossières quand il introduit
dans la linguistique des éléments du marxisme en les déformant,
quand il a essayé de créer une théorie indépendante de la langue.
Mais
il y a chez N. Marr quelques bons ouvrages, écrits avec talent, où,
oubliant ses prétentions théoriques, il étudie consciencieusement
et avec habileté, il faut le dire, certaines langues.
Dans
ces ouvrages-là, on peut trouver un assez grand nombre de choses de
valeur et instructives. Il est clair qu’il faut prendre ces choses
chez N. Marr et les utiliser.
5.
QUESTION : Beaucoup de linguistes considèrent que le formalisme
est une des principales causes de la stagnation dans la linguistique
soviétique.
Je
voudrais bien savoir en quoi, à votre avis, consiste le formalisme
en linguistique et comment le vaincre ?
REPONSE :
N. Marr et ses « disciples » taxent de « formalisme »
tous les linguistes qui ne partagent pas la « doctrine nouvelle »
de N. Marr. Evidemment, ce n’est pas sérieux et ce n’est pas
raisonnable.
N.
Marr estimait que la grammaire était une « chose de pure forme »
et que les gens qui considéraient la structure grammaticale comme la
base de la langue étaient des formalistes.
C’est
pure sottise.
Je
crois que le « formalisme » a été inventé par les auteurs
de la « doctrine nouvelle » pour faciliter leur lutte contre
leurs adversaires en linguistique.
La
cause de la stagnation dans la linguistique soviétique, ce n’est
pas le « formalisme » inventé par N. Marr et ses
« disciples », mais le régime à la Araktchéev et les
lacunes théoriques en linguistique. Ce sont les « disciples »
de N. Marr qui ont instauré le régime à la Araktchéev.
La
confusion théorique a été apportée dans la linguistique par N.
Marr et ses plus proches compagnons d’armes. Pour qu’il n’y ait
plus de stagnation, il faut faire disparaître l’un et l’autre :
La disparition de ces plaies assainira la linguistique soviétique,
lui ouvrira de larges perspectives et lui permettra de prendre la
première place dans la linguistique mondiale.
29
juin 1950.
Pravda,
4 juillet 1950.
RÉPONSE AUX CAMARADES
AU
CAMARADE SANJEIEV
Estimé
Camarade Sanjéïev,
Je
réponds à votre lettre avec un grand retard, car c’est seulement
hier qu’elle m’a été transmise par les services du Comité
central.
L’interprétation
que vous donnez de ma position dans la question des dialectes est
incontestablement juste.
Les
dialectes « de classe », qu’il serait plus exact d’appeler
des jargons, servent non pas les masses populaires. mais une mince
couche au sommet de la hiérarchie sociale. De plus, ils n’ont ni
système grammatical, ni fonds essentiel de vocabulaire propres. De
ce fait, ils ne peuvent aucunement se transformer en langues
indépendantes.
Les
dialectes locaux (*régionaux »), au contraire, servent les
masses populaires et ont leur système grammatical et leur fonds
essentiel de vocabulaire. C’est pourquoi certains dialectes locaux,
dans le processus de formation des nations, peuvent devenir la base
des langues nationales et se transformer en langues nationales
indépendantes.
C’est
ce qui est arrivé, par exemple, avec le dialecte de Koursk-Orel
(« parler » de Koursk-Orel) de la langue russe qui a
constitué la base de la langue nationale russe.
On
doit en dire autant du dialecte de Poltava-Kiev de la langue
ukrainienne qui est devenu la base de la langue nationale
ukrainienne. En ce qui concerne les autres dialectes de ces langues,
ils perdent leur originalité, se fondent dans ces langues et
disparaissent en elles.
Des
processus inverses peuvent se produire, quand la langue unique d’un
peuple, qui n’est pas encore devenu une nation à cause de
l’absence des conditions économiques nécessaires à son
développement, meurt par suite de la désagrégation de ce peuple en
tant qu’Etat, et quand les dialectes locaux, qui n’ont pas encore
eu le temps de se brasser en une langue unique, revivent et sont à
l’origine de la formation de langues indépendantes.
Il
se peut qu’il en ait été justement ainsi, par exemple, avec la
langue mongole unique.
11
juillet 1950.
Pravda,
2 août 1950.
AUX
CAMARADES D. BELKINE ET S. FOURER
J’ai
reçu vos lettres.
Votre
erreur est d’avoir confondu deux choses différentes et substitué
à l’objet examiné dans ma réponse à la camarade Kracheninnikova
un autre objet.
1.
Dans cette réponse, je critique N. Marr qui, parlant du langage
(phonétique) et de la pensée, détache la langue de la pensée et
tombe ainsi dans l’idéalisme. Il s’agit donc, dans ma réponse,
de gens normaux jouissant de la faculté de parler. J’affirme que
chez de telles gens les pensées ne peuvent surgir que sur la base du
matériau de la langue, que des pensées dénudées, sans liaison
avec le matériau de la langue, n’existent pas chez eux.
Au
lieu d’adopter ou de rejeter cette thèse, vous introduisez des
gens présentant des anomalies, des gens incapables de parler, des
sourds-muets qui ne jouissent pas de la faculté de parler et dont
les pensées, évidemment, ne peuvent surgir sur la base du matériau
de la langue. Comme vous voyez, c’est un tout autre sujet, que je
n’ai pas abordé et que je ne pouvais pas aborder, car la
linguistique s’occupe de gens normaux, capables de parler, et non
de gens présentant des anomalies, de sourds-muets, qui ne peuvent
parler.
Vous
avez substitué au thème discuté un autre thème qui n’a pas été
mis en discussion.
Il
ressort de la lettre du camarade Belkine qu’il met sur un même
plan le « langage parlé » (langage phonétique) et le
« langage des gestes » (langage « des mains »,
d’après N. Marr).
Il
pense visiblement que le langage des gestes et le langage parlé sont
équivalents, qu’il fut une époque où la société humaine
n’avait pas de langage parlé, que le langage « des mains »
remplaçait alors le langage parlé venu plus tard.
Mais
si le camarade Belkine pense véritablement ainsi, il commet une
grave erreur.
Le
langage phonétique ou langage parlé a toujours été l’unique
langage de la société humaine capable d’être un moyen pleinement
valable de communication entre les hommes.
L’histoire
ne connaît aucune société humaine, aussi arriérée soit-elle, qui
ne possède son langage phonétique. L’ethnographie ne connaît
aucun petit peuple arriéré – fut-il aussi ou encore plus primitif
que, par exemple, les Australiens ou les habitants de la Terre de Feu
au siècle dernier – qui ne possède son langage phonétique.
Le
langage phonétique est, dans l’histoire de l’humanité, une des
forces qui ont aidé les hommes à se distinguer du monde animal, à
se rassembler en sociétés, à développer leur faculté de penser,
à organiser la production sociale, à mener avec succès la lutte
contre les forces de la nature et à arriver au progrès que nous
connaissons aujourd’hui.
Sous
ce rapport, l’importance du langage dit des gestes est
insignifiante, du fait de son extrême pauvreté et de son caractère
limité.
A
proprement parler, ce n’est pas un langage, ce n’est même pas un
ersatz de langage pouvant, d’une façon ou d’une autre, remplacer
le langage phonétique, mais un moyen auxiliaire, aux possibilités
très limitées, dont use parfois l’homme pour souligner tel ou tel
moment de son discours. On ne peut pas plus comparer le langage des
gestes au langage phonétique qu’on ne peut comparer la houe de
bois primitive au tracteur moderne à chenilles avec sa charrue à
cinq socs ou son semoir tracté.
3.
Ainsi, vous vous intéressez d’abord aux sourds-muets et ensuite
seulement aux problèmes de la linguistique. Il est clair que c’est
cette circonstance même qui vous a conduits à me poser une série
de questions. Eh bien, si vous insistez, je suis prêt à satisfaire
à votre demande. Alors, comment la chose se présente-t-elle avec
les sourds-muets ?
Possèdent-ils
la faculté de penser ?
Ont-ils
des pensées ?
Oui,
ils possèdent la faculté de penser, ils ont des pensées.
Il
est clair que, puisque les sourds-muets sont incapables de parler,
leurs pensées ne peuvent se former sur la base du matériau de la
langue. Cela veut-il dire que les pensées des sourds-muets sont
dénudées, sans lien avec les « règles de la nature »
(l’expression est de N. Marr) ?
Non,
les pensées des sourds-muets ne se forment et ne peuvent exister que
sur la base des images, des perceptions, des représentations qui
surgissent chez eux dans la vie courante à propos des objets du
monde extérieur et des rapports de ces objets entre eux grâce aux
sens de la vue, du toucher, du goût et de l’odorat.
En
dehors de ces images, perceptions, représentations, la pensée est
vide, elle est dépourvue de tout contenu, c’est-à-dire qu’elle
n’existe pas.
22
juillet 1950.
Pravda,
2 août 1950
AU
CAMARADE A. KHOLOPOV
J’ai
reçu votre lettre.
J’ai
tardé un peu à répondre parce que j’ai été surchargé de
travail.
Votre
lettre procède implicitement de deux suppositions : de la
supposition qu’il est permis d’extraire une citation des ouvrages
de tel ou tel auteur en la détachant de la période historique
traitée dans la citation, et, deuxièmement, de la supposition que
telles ou telles conclusions et formules du marxisme tirées de
l’étude d’une des périodes du développement historique sont
justes pour toutes les périodes du développement et doivent, par
conséquent, rester immuables.
Je
dois dire que ces deux suppositions sont profondément erronées.
Je
veux en donner quelques exemples.
1.
Dans les années 40 du siècle dernier, lorsqu’il n’y avait pas
encore de capitalisme monopoliste, lorsque le capitalisme se
développait d’une façon plus ou moins régulière, en suivant une
ligne ascendante et en s’étendant à de nouveaux territoires
encore inoccupés par lui, et lorsque la loi sur le développement
inégal ne pouvait encore se manifester avec pleine vigueur, Marx et
Engels sont arrivés à la conclusion que la révolution socialiste
ne pouvait triompher dans un pays quelconque pris à part, qu’elle
ne pouvait être victorieuse qu’à la suite d’un assaut général
déclenché dans tous les pays civilisés ou dans la plupart d’entre
eux.
Cette
conclusion est devenue ensuite un principe directeur pour tous les
marxistes.
Cependant,
au début du XX° siècle, surtout dans la période de la Première
Guerre mondiale, lorsqu’il est devenu clair pour tous que le
capitalisme prémonopoliste s’était manifestement transformé en
capitalisme monopoliste, lorsque le capitalisme ascendant se fut
transformé en capitalisme agonisant, lorsque la guerre eut mis à nu
les faiblesses incurables du front impérialiste mondial et lorsque
la loi du développement inégal eut prédéterminé la révolution
prolétarienne à mûrir à des époques différentes dans les
différents pays, Lénine, partant de la théorie marxiste, est
arrivé à la conclusion que, dans les conditions nouvelles du
développement, la révolution socialiste pouvait très bien être
victorieuse dans un seul pays pris séparément, que la victoire
simultanée de la révolution socialiste dans tous les pays ou dans
la plupart des pays civilisés était impossible par suite du
mûrissement inégal de la révolution dans ces pays, que la vieille
formule de Marx et d’Engels ne correspondait plus aux nouvelles
conditions historiques.
Comme
on le voit, nous avons ici deux conclusions différentes sur la
question de la victoire du socialisme, conclusions qui non seulement
se contredisent, mais encore s’excluent mutuellement.
Des
clercs et des talmudistes, qui, sans aller au fond des choses, font
mécaniquement des citations en les détachant des conditions
historiques, peuvent dire que l’une de ces conclusions doit être
rejetée comme absolument erronée et que l’autre doit être
étendue, comme absolument juste, à toutes les périodes du
développement.
Mais
les marxistes ne peuvent pas ne pas savoir que les clercs et les
talmudistes se trompent, ils ne peuvent pas ne pas savoir que ces
deux conclusions sont justes, mais non pas de façon absolue, que
chacune d’elles est juste pour son temps : la conclusion de
Marx et d’Engels pour la période du capitalisme prémonopoliste,
et la conclusion de Lénine pour la période du capitalisme
monopoliste.
2.
Engels a dit dans son Anti-Dühring qu’après la
victoire de la révolution socialiste, l’Etat doit dépérir. C’est
pour cette raison qu’après la victoire de la révolution
socialiste dans notre pays, les clercs et les talmudistes dans notre
Parti ont commencé à exiger que le Parti prenne des mesures pour
faire dépérir au plus vite notre Etat, pour dissoudre les
organismes d’Etat et renoncer à une armée permanente.
Cependant,
sur la base de l’étude de la situation mondiale de notre époque,
les marxistes soviétiques sont arrivés à la conclusion qu’étant
donné l’encerclement capitaliste, alors que la victoire de la
révolution socialiste n’a eu lieu que dans un seul pays et que le
capitalisme domine dans tous les autres, le pays de la révolution
victorieuse doit non pas affaiblir, mais consolider par tous les
moyens son Etat, les organismes d’Etat, les services de
renseignements, l’armée, si ce pays ne veut pas être écrasé par
l’encerclement capitaliste.
Les
marxistes russes sont arrivés à la conclusion que la formule
d’Engels a en vue la victoire du socialisme dans tous les pays ou
dans la plupart des pays, qu’elle est inapplicable dans le cas où
le socialisme triomphe dans un seul pays pris séparément, alors que
le capitalisme domine dans tous les autres pays.
Comme
on le voit, nous avons ici deux formules différentes, qui s’excluent
mutuellement, en ce qui concerne les destinées de l’Etat
socialiste.
Les
clercs et les talmudistes peuvent dire que cette circonstance crée
une situation intolérable, qu’il faut rejeter l’une des formules
comme absolument erronée et étendre l’autre, comme absolument
juste, à toutes les périodes du développement de l’Etat
socialiste.
Mais
les marxistes ne peuvent pas ne pas savoir que les clercs et les
talmudistes se trompent, car ces deux formules sont justes, mais non
pas de façon absolue, chacune d’elles est juste pour son époque :
la formule des marxistes soviétiques pour la période de la victoire
du socialisme dans un ou plusieurs pays, et la formule d’Engels
pour la période où la victoire successive du socialisme dans des
pays isolés conduira à la victoire du socialisme dans la plupart
des pays et où seront créées ainsi les conditions nécessaires à
l’application de la formule d’Engels.
On
pourrait multiplier de tels exemples.
Il
faut dire la même chose des deux formules différentes à propos du
problème de la langue, extraites d’ouvrages différents de Staline
et citées par le camarade Kholopov dans sa lettre.
Le
camarade Kholopov se réfère à l’ouvrage de Staline A propos du
marxisme en linguistique, où se trouve la conclusion qu’à la
suite du croisement de deux langues, par exemple, l’une d’elles
est généralement victorieuse et l’autre dépérit, et que, par
conséquent, le croisement ne donne pas une nouvelle langue, une
troisième langue, mais conserve l’une des langues.
Il
se réfère ensuite à une autre conclusion tirée du rapport de
Staline au XVI° Congrès du Parti communiste (b.) de l’U.R.S.S. où
il est dit que dans la période de la victoire du socialisme à
l’échelle mondiale, lorsque le socialisme se consolidera et
entrera dans la vie courante, les langues nationales doivent
inévitablement fusionner en une langue commune qui ne sera
certainement ni le russe, ni l’allemand, mais quelque chose de
nouveau. En confrontant ces deux formules et en voyant que non
seulement elles ne coïncident pas, mais s’excluent l’une
l’autre, le camarade Kholopov est pris de désespoir.
« D’après
votre article, écrit-il dans sa lettre, j’ai compris qu’à la
suite du croisement des langues, il ne peut jamais se former une
nouvelle langue, tandis qu’avant cet article j’étais fermement
convaincu, conformément à votre intervention au XVI° Congrès du
Parti communiste (b.) de l’U.R.S.S., que sous le communisme les
langues se fondraient en une seule langue commune. »
Visiblement,
le camarade Kholopov, après avoir découvert une contradiction entre
ces deux formules, profondément convaincu que cette contradiction
doit être liquidée, estime nécessaire de rejeter l’une des
formules comme erronée et de se cramponner à l’autre formule
comme juste pour tous les temps et pour tous les pays.
Mais
à quelle formule se cramponner, il ne sait trop. Il en résulte une
sorte de situation sans issue. Le camarade Kholopov n’a même pas
l’idée que les deux formules peuvent être justes, chacune pour
son époque.
Cela
arrive toujours avec les clercs et les talmudistes qui, sans aller au
fond des choses, citant de façon mécanique, sans égard aux
conditions historiques auxquelles se rapportent les citations,
tombent toujours dans une situation sans issue.
Et
cependant, si l’on examine le fond de la question, il n’y a
aucune raison de considérer la situation comme étant sans issue. Le
fait est que l’opuscule de Staline : A propos du marxisme en
linguistique et l’intervention de Staline au XVI° Congrès du
Parti ont en vue deux époques tout à fait différentes et que, par
conséquent, il s’ensuit des formules différentes.
La
formule donnée par Staline dans son opuscule, là où il est
question du croisement des langues, a en vue l’époque antérieure
à la victoire du socialisme à l’échelle mondiale, lorsque les
classes exploiteuses sont la force dominante dans le monde, que
l’oppression nationale et coloniale demeure très forte, que
l’isolement national et la méfiance mutuelle des nations sont
consacrés par les différences d’ordre étatique, lorsqu’il n’y
a pas encore d’égalité en droits des nations, que le croisement
des langues s’effectue au cours d’une lutte pour la domination de
l’une des langues, qu’il n’existe pas encore les conditions
nécessaires à la collaboration pacifique et amicale des nations et
des langues, lorsque ce ne sont pas la collaboration et
l’enrichissement mutuel des langues qui sont à l’ordre du jour,
mais l’assimilation de certaines langues et la victoire des autres.
On
comprend que dans ces conditions il ne peut y avoir que des langues
victorieuses et des langues vaincues.
La
formule de Staline a précisément en vue ces conditions lorsqu’elle
dit que le croisement de deux langues, par exemple, n’aboutit pas à
la formation d’une nouvelle langue, mais à la victoire d’une des
langues et à la défaite de l’autre.
Quant
à l’autre formule de Staline, tirée de son intervention au XVI°
Congrès du Parti, là où il est question de la fusion des langues
en une seule langue commune, elle a en vue une autre époque et,
précisément, l’époque postérieure à ta victoire du socialisme
à l’échelle mondiale, lorsque l’impérialisme mondial
n’existera plus, que les classes exploiteuses seront renversées,
l’oppression nationale et coloniale liquidée, l’isolement
national et la méfiance mutuelle des nations remplacés par la
confiance mutuelle et le rapprochement des nations, l’égalité en
droits des nations traduite dans la vie, lorsque la politique
d’oppression et d’assimilation des langues sera liquidée,
lorsque sera organisée la collaboration des nations et que les
langues nationales auront la possibilité, dans leur collaboration,
de s’enrichir mutuellement en toute liberté.
On
comprend que dans ces conditions il ne pourra être question de
l’oppression et de la défaite de certaines langues et de la
victoire d’autres langues.
Nous
n’aurons pas ici affaire à deux langues dont l’une subira une
défaite tandis que l’autre sortira victorieuse de la lutte, mais à
des centaines de langues nationales desquelles, par suite d’une
longue collaboration économique, politique et culturelle des
nations, se détacheront d’abord les langues zonales uniques les
plus enrichies, ensuite les langues zonales fusionneront en une seule
langue internationale commune, qui ne sera naturellement ni
l’allemand, ni le russe, ni l’anglais, mais une langue nouvelle
qui aura absorbé les meilleurs éléments des langues nationales et
zonales.
Par
conséquent, ces deux formules différentes correspondent à deux
époques différentes du développement de la société et,
précisément parce qu’elles leur correspondent, les deux formules
sont justes, chacune pour son époque.
Exiger
que ces formules ne se contredisent pas et ne s’excluent pas est
aussi absurde que d’exiger que l’époque de la domination du
capitalisme ne soit pas en contradiction avec l’époque de la
domination du socialisme, que le socialisme et le capitalisme ne
s’excluent pas.
Les
clercs et les talmudistes considèrent le marxisme, les différentes
conclusions et formules du marxisme comme un assemblage de dogmes qui
ne changent « jamais » même lorsque changent les conditions
du développement de la société.
Ils
pensent que s’ils apprennent par cœur ces conclusions et ces
formules et se mettent à les citer à tort et à travers, ils seront
en mesure de résoudre n’importe quelle question, escomptant que
les conclusions et les formules apprises leur serviront pour tous les
temps et pour tous les pays, pour toutes les circonstances de la vie.
Or,
seuls peuvent penser ainsi les gens qui ne voient du marxisme que la
lettre, mais n’en voient pas l’essence, qui apprennent par coeur
les textes des conclusions et des formules du marxisme, mais n’en
comprennent pas le contenu.
Le
marxisme est la science des lois du développement de la nature et de
la société, la science de la révolution des masses opprimées et
exploitées, la science de la victoire du socialisme dans tous les
pays, la science de l’édification de la société communiste.
Le
marxisme en tant que science ne peut rester stationnaire : il se
développe et se perfectionne.
Dans
son développement, le marxisme ne peut manquer de s’enrichir
d’expériences nouvelles et de connaissances nouvelles ; par
conséquent, certaines de ses formules et de ses conclusions ne
peuvent manquer de changer avec le temps, ne peuvent manquer d’être
remplacées par des formules et des conclusions nouvelles qui
correspondent aux nouvelles tâches historiques.
Le
marxisme n’admet pas de conclusions et de formules immuables,
obligatoires pour toutes les époques et toutes les périodes. Le
marxisme est l’ennemi de tout dogmatisme.
28
juillet 1950.
Pravda,
2 août 1950.
NOTES
[1] Oeuvres
complètes de K. Marx et F. Engels, tome 3.
[2] Ibidem
, tome 3.
[3] Ibidem
, tome 2.
[4] Paul
Lafargue (1842-1911), militant bien connu du mouvement ouvrier
français et du mouvement ouvrier international, éminent
propagandiste et publiciste marxiste. Il fut un des fondateurs du
Parti ouvrier français, disciple et compagnon d’armes de Man et
d’Engels, et époux de La fille de Marx, Laura.
[5] Bundistes,
membres du Bund, c’est-à-dire de l’Union générale des Ouvriers
juifs de Lituanie. de Pologne et de Russie. Le Bund était une
organisation opportuniste petite-bourgeoise juive fondée à un
congrès tenu à Vilna en octobre 1897 ; il menait ses activités
principalement parmi Les artisans juifs. Au 1er Congrès du
P.O.S.D.R. (1898), il adhéra au Parti « en qualité
d’organisation autonome dom la compétence propre se Limite aux
questions concernant exclusivement le prolétariat juif. »
Cependant, après son adhésion au Parti. il propagea le nationalisme
et le séparatisme au sein du mouvement ouvrier russe. Sa position
relevant du nationalisme bourgeois fut sévèrement critiquée par
l’Iskra, journal fondé par Lénine.
[6] V.
I. Lénine : « Du droit des nations à disposer
d’elles-mêmes », Oeuvres, tome 20.
[7] J.
Staline : « La Question nationale et le léninisme »,
Oeuvres, tome II
[8] Le
régime à la Araktchéev, régime auquel le nom du politicien
réactionnaire, le comte Alexis Araktchéev, reste attaché, était
une dictature policière sans frein instaurée en Russie dans le
premier quart du XIX° siècle, dictature sous laquelle l’arbitraire
militariste et la violence sévissaient. Staline fait allusion ici à
la domination absolue de Marr dans les milieux linguistiques
soviétiques.
[9] A
l’origine de toutes les langues, N. Marr prétendait retrouver
quatre éléments primitifs, les quatre sons suivants (transcrits en
lettres latines) : sal-ber-roch-ion.
[10] La théorie de la « langue-mère » – la doctrine de l’école indo-européenne, qui soutient qu’une famille de langues consiste en un groupe de patois (dialectes), provenant de la division d’une langue-mère primitive commune.
Par exemple, l’italien, le français, l’espagnol, le portugais et le roumain modernes sont des langues soeurs dérivées du latin, et n’étaient à l’origine que des parois différents. Toutefois, comme il n’existe pas de documents pour prouver l’existence d’une langue-mère pour la plupart des dialectes ou langues modernes, les savants de l’école indo-européenne ont élaboré une langue-mère hypothétique, principalement pour des commodités d’explication des règles des changements phonétiques, mais rien ne prouve jusqu’à quel point tout cela est vrai.
=>Oeuvres de Staline