Au début de l’année 1919, de vastes grèves en France débouchaient sur la reconnaissance légale de la journée de 8 heures.
Or, l’exploitation agricole est alors en concurrence avec l’industrie, et la journée de 8 heures et le mode de vie urbain attirent bien davantage que l’isolement social et culturel et les 12 à 16 heures de travaux ruraux.
La petite et la moyenne paysannerie, propriétaire ou fermière, celle dont le recours à la main d’œuvre est essentielle, va alors chercher à s’opposer à cette prolétarisation des ouvriers agricoles.
Et cela produit une panique petite-bourgeoise devant l’affaiblissement du statut paysan et de son poids social. Henri Dorgères joue alors le rôle de catalyseur.
Diffusé à plus de 26 000 exemplaires, le journal qu’il dirige, Le Progrès Agricole de l’Ouest, lui permet de diffuser des éléments agricoles techniques et de proposer une aide juridique concernant les ennuis avec les administrations fiscales.
Son objectif assumé est la sauvegarde de la communauté d’intérêt du paysan-villageois, ou du village paysan, en cherchant à former une communauté « historique », opposée à la lutte des classes.
Il faut ainsi arriver, coûte que coûte, à unifier le grand producteur de betterave du Nord, le petit vigneron de la Loire, les maraîchers du Bassin parisien :
« Nous avons créé une fierté paysanne qui n’existait pas, un esprit de corps qui s’opposait à l’esprit de classe du prolétariat. Nous répétions sans cesse qu’on ne pouvait bien défendre un métier qu’à la condition d’en être fier.
A l’époque, un complexe d’infériorité atteignait presque toute la Paysannerie et il en a fallu des efforts pour chasser ce complexe. »
Évidemment, l’agriculture recoupe des réalités différentes, de statuts (métayage, fermage), de conditions, ouvriers agricoles ou propriétaires, de cultures. Henri Dorgères pouvait cependant s’appuyer sur un processus de concentration agricole encore très lent.
En 1920, il y a en France 32 000 exploitations de plus de 100 hectares pour 2 685 000 de moins de 10 hectares, avec un inégal développement entre l’Île-de-France, le sud avec des exploitations mécanisés et concentrés, et le reste du pays où subsiste la petite et moyenne exploitation, plutôt familiale.
Il fallut donc d’autant plus renforcer l’aspect agressif, avec une contestation typiquement petite-bourgeoise qui est la lutte contre l’imposition.
C’est après l’instauration de la loi Loucheur du 5 avril 1928 sur les assurances sociales pour les ouvriers agricoles que Henri Dorgères adhère à la Ligue des contribuables et se lance dans les premières batailles. Selon lui, cela augmente les charges sociales et entraîne une voile administratif intolérable dans une communauté villageoise préservée du contractualisme libéral (assigné au monde urbain opposant capitalistes et ouvriers).
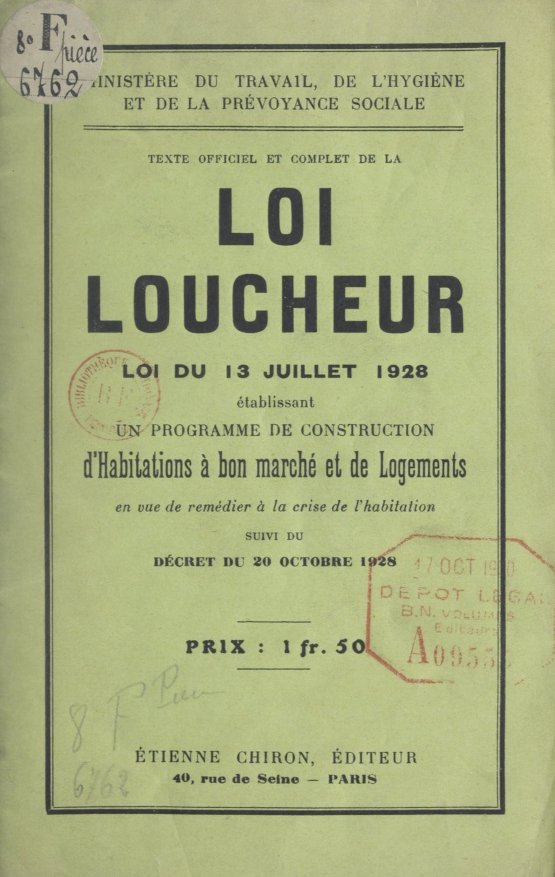
Le 28 février 1928, ce sont 12 000 personnes qui manifestent à Vannes contre la loi Loucheur et où Henri Dorgères prend la première fois la parole.
Jusqu’au début de l’année 1933, Henri Dorgères se présentera sous l’étiquette de la Ligue des contribuables, mouvement anti-fiscaliste qui bascule dans le fascisme en 1934 sous la présidence de Jacques Lemaigre-Lebreuil, actionnaire principal des huiles Lesieur et soutien du journal de Dorgères avec des encarts publicitaires.
L’essentiel était l’organisation des paysans – dans une forme paysanne populiste – et c’est pourquoi Dorgères mit en place, avec une trentaine de paysans, au début du mois de janvier 1929 un « Comité de défense contre les assurances sociales » dans les locaux du journal Le Progrès Agricole de l’Ouest, à Rennes, en même temps qu’une pétition qui va recueillir plus de 150 000 signatures en un mois et demi.
Toute l’instabilité de la petite-bourgeoisie passe alors par la couche de la moyenne paysannerie, qui réclame tout à la fois moins de taxes et d’impôts, et plus de protectionnisme.
Henri Dorgères explique alors à ce sujet :
« La Défense Paysanne c’était les « Etats-Généraux » de la Paysannerie appuyés sur la masse des petits cultivateurs et dressés contre un Etat qui les oppressait. Nous n’étions nous que leurs mandants, que leurs « délégués » et c’est d’ailleurs ce titre de délégué général qui m’avait été attribué. »
Et en 1935 il raconte dans « Haut les fourches » :
« Chaque cultivateur syndiqué, chaque syndicat local, chaque union régionale doit comprendre que l’action commune ne libérera la terre de la double hypothèque libérale et marxiste, dont elle acquitte depuis de trop longues années le lourd tribut, que lorsque leurs aspirations collectives pourront se faire jour sur le plan national.
Dussions-nous fonder 10 000 syndicats nouveaux, enregistrer 500 000 adhésions nouvelles, rien ne sera fait tant que l’Union nationale ne sera pas devenue un instrument aussi efficace et redouté que la C.G.T. ou le Comité des Forges.
Guerre de classes ? Non pas.
Nous entendons tout au contraire imposer sur le terrain syndical ce tiers parti, fier de ce qu’il a su réaliser dans la fraternité des sillons, mais plus fier encore d’être dès maintenant le précurseur de l’ordre corporatif de demain. »
Henri Dorgères va jusqu’à parler d’un « État paysan », d’une « dictature paysanne ». Il a été au cœur d’un mouvement paysan-populiste, qui converge entièrement avec le Fascisme se développant dans les années 1920-1930 comme expression de la contre-révolution.
=>Retour au dossier sur le populiste paysan
Henri Dorgères et les chemises vertes