La formalisation de la doctrine sociale de l’Église catholique à partir de 1891 était à la fois un point de départ et un aboutissement.
Issue de la féodalité et alliée à la bourgeoisie conservatrice, l’Église catholique ne pouvait pas aller dans le sens du libéralisme.
Elle ne pouvait que mettre en avant un romantisme idéalisant le passé, l’époque des corporations médiévales.
C’est le sens de l’encyclique Rerum novarum, avec sa mise en valeur des corporations.
En même temps, l’expérience avait montré que l’Église ne pouvait pas impulser d’elle-même des organisations ouvrières, et d’ailleurs l’encyclique souligne bien qu’il ne saurait y avoir de modèle.
Toute l’activité de l’Église devait donc être de happer des ouvriers pour les chapeauter, avec comme centre de gravité les corporations.
Les débuts étaient forcément expérimentaux.
On a ainsi le patron Léon Harmel qui appliqua directement les principes de l’encyclique dans son usine, établissant une première expérience majeure ; l’abbé Six fut de son côté une figure majeure de l’organisation des ouvriers sur ces principes, dans le Nord de la France.

On a, surtout, un long et patient travail d’intégration d’ouvriers, avec des appels d’air par l’intermédiaire d’associations et d’œuvres, de conférences et de congrès.
On a ainsi un congrès international catholique qui se réunit en 1886 à Liège en Belgique et rejette le travail comme marchandise.
Le socialisme est évidemment rejeté et le congrès prône le travail comme fonction sociale au sein d’une société où chaque partie a son rôle spécifique à jouer : les composantes de la société doivent s’organiser en corporations et s’unir dans des entités mixtes.
Pour la France, le processus est lent et difficile.
Il y a surtout à Lyon, en 1886, une corporation de la soierie lyonnaise, comme syndicat mixte puis uniquement avec des employés ; à Saint-Étienne se met en place un syndicat des passementiers, à Paris un syndicat des voyageurs et des représentants.
Un congrès se tient à Reims en 1893 ; si c’est un congrès ouvrier, tous relèvent cependant d’entités mixtes avec les patrons, sauf le regroupement des « Vrais travailleurs » de Roubaix.
Le congrès appelle néanmoins à un corporatisme avec intermédiaire, puisqu’il propose des regroupements ouvriers indépendants, pour s’unir nécessairement avec des équivalents patronaux.
C’est dans le Nord de la France que cette option corporatiste prend le plus. Une Union syndicale textile se fonde à Lille en juin 1893, avec Leclercq, suivie immédiatement d’une Union syndicale métallurgique dans la même ville.
Ces deux structures fondent, avec un équivalent à Roubaix, un syndicat du textile à Halluin et un syndicat de mineurs à Arras, une Union démocratique du Nord publiant le journal Le peuple.
Cette Union ne progressera guère ; elle se verra rejointe seulement par un syndicat du bâtiment de Rennes et une association d’ouvriers et d’employés d’Annonay, puis en 1903 par une Union ouvrière textile à Armentières à la suite d’une grève.
La bourgeoisie conservatrice s’oppose en effet formellement à l’initiative, refusant l’embauche aux travailleurs de ces unions syndicales, dont le nombre ne dépasse pas 2500.
En effet, pour la bourgeoisie, tout doit passer immédiatement par les « syndicats » mixtes et rien ne doit atténuer la dimension corporatiste.
L’Église catholique s’aligne sur cette position et sa presse, massive alors, soutient les « Jaunes », qui agissent comme briseurs de grève au nom du respect de la propriété privée et de la collaboration de classe.
Et lorsque l’Union des associations ouvrières catholiques se réunit en 1906 à Lourdes, elle considère comme juste la position des jaunes.
Un événement va tout changer.
En effet, en 1887, le frère Hiéron qui travaille dans les écoles chrétiennes et cherche à améliorer le placement des élèves sur la base de l’association de persévérance religieuse Saint Benoît Labre.
Il fonde alors en 1887 le SECI – Syndicat des employés de commerce et d’industrie.
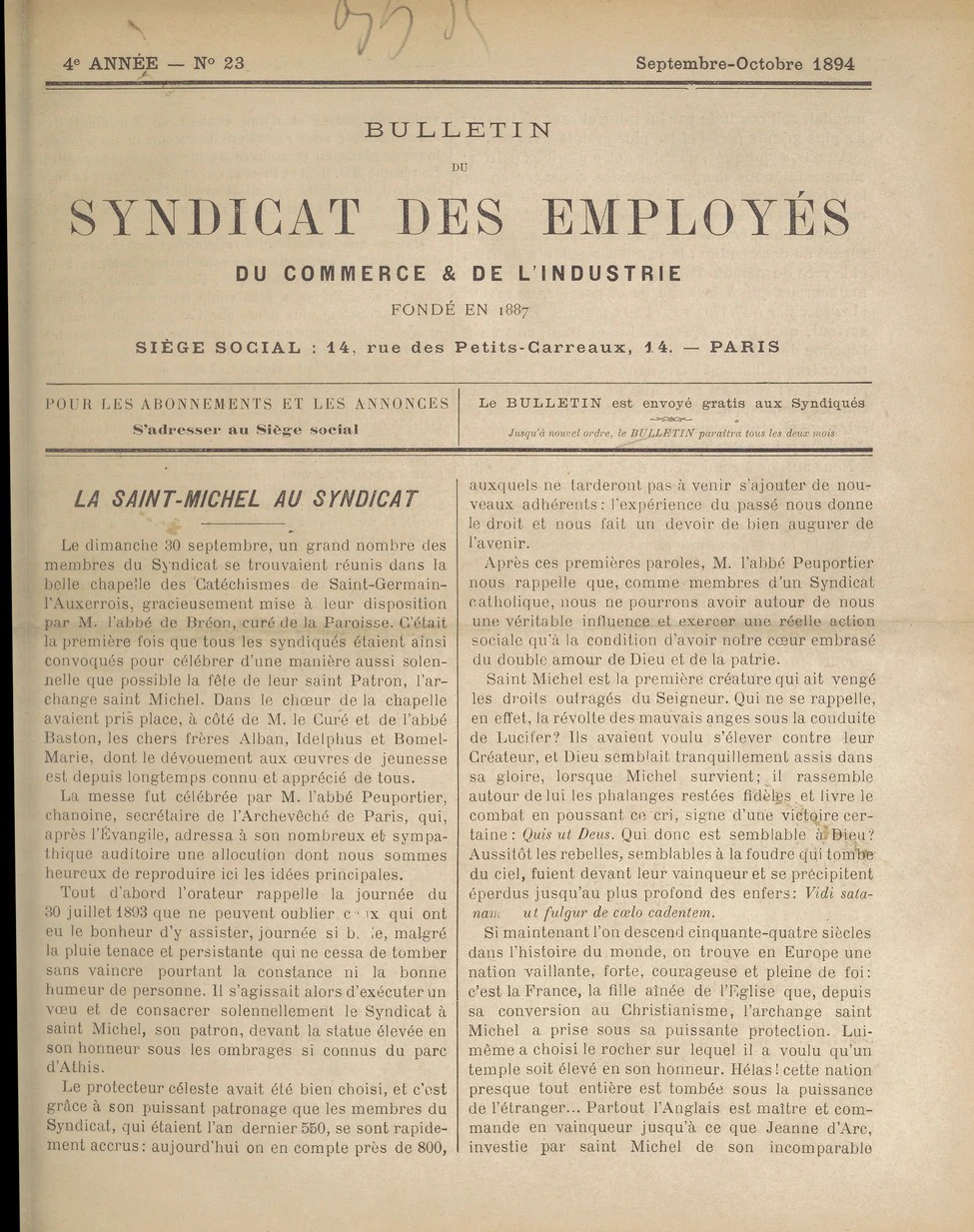
L’initiative est entièrement corporatiste, puisqu’il s’agit d’aider les élèves et que ceux-ci s’entraident.
Il faut être catholique, avoir une bonne réputation, être coopté par deux membres et passer par une année de probation.
Il y a toutefois le principe d’organiser des conférences pour comprendre l’économie et c’est cet aspect qui va jouer un rôle essentiel.
C’est d’autant plus vrai que l’entité est tellement dans une optique corporatiste qu’elle réfute la tentative du patron Léon Harmel de mise en place d’un « comité protecteur » (même si de l’argent sera accepté).
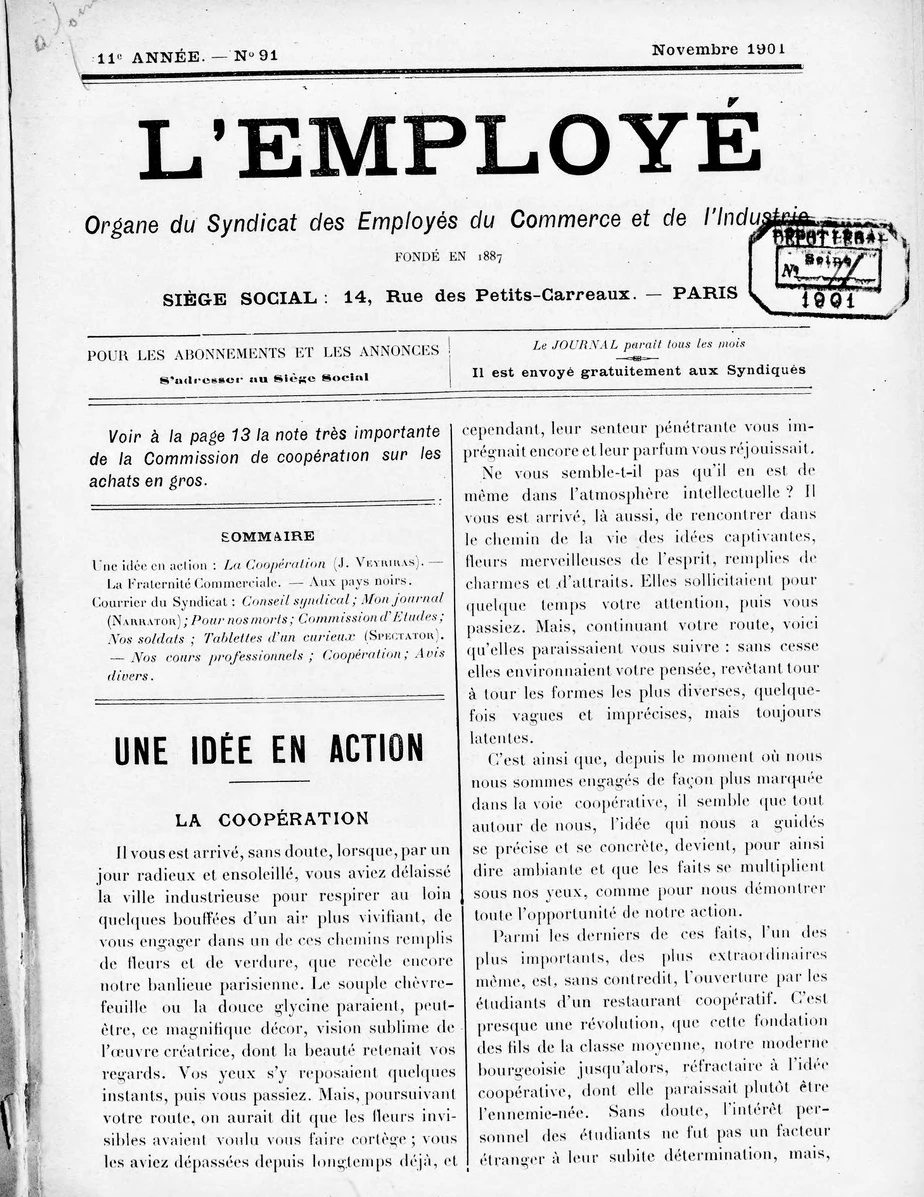
C’est Marc Sangnier (1973-1950), avec le mouvement nommé Le Sillon, qui publie L’Éveil démocratique à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, qui va se faire le chantre de cette indépendance corporatiste, en faisant la promotion de l’acceptation d’ouvriers non catholiques du moment qu’ils acceptent la perspective proposée.

Le Vatican rejettera finalement le « Sillon » en 1910, lui reprochant son « modernisme social ».
Cela va toutefois donner un mouvement où ce sont les thèses corporatistes catholiques qui forment la substance, sans pour autant que cela soit présenté tel quel.
Le SECI ne se dit jamais chrétien, ne mentionne jamais le clergé ou la doctrine sociale de l’Église dans son journal L’Employé.
Il se présente comme une expression des travailleurs seulement, même si le cas échéant le dirigeant Gaston Teissier a à sortir les textes du pape pour ramener l’ordre dans les rangs.
C’est le point de départ du syndicalisme catholique, qui ne se veut surtout pas dépendant de l’Église, se contentant de souligner la nécessité de syndicats de production et de consommateurs s’unifiant de manière interclassiste à l’échelle du pays, pays présenté comme déstructuré par la Révolution française.
Pour le SECI, il faut donc le corporatisme à tous les niveaux, « l’entente des classes » et toujours refuser la violence et la « guerre sociale ».
Ce discours est d’autant plus facile à développer que le SECI se tourne avant tout vers les employés, qui n’ont pas le vécu des ouvriers.
Il s’implante dans cette couche sociale notamment à Paris, Lille, Rennes, Reims, Nantes, Angers, Besançon, Calais ; la seule autre couche sociale où le SECI a une influence tient aux instituteurs des écoles privées, qui s’organisent en fédération en 1905.
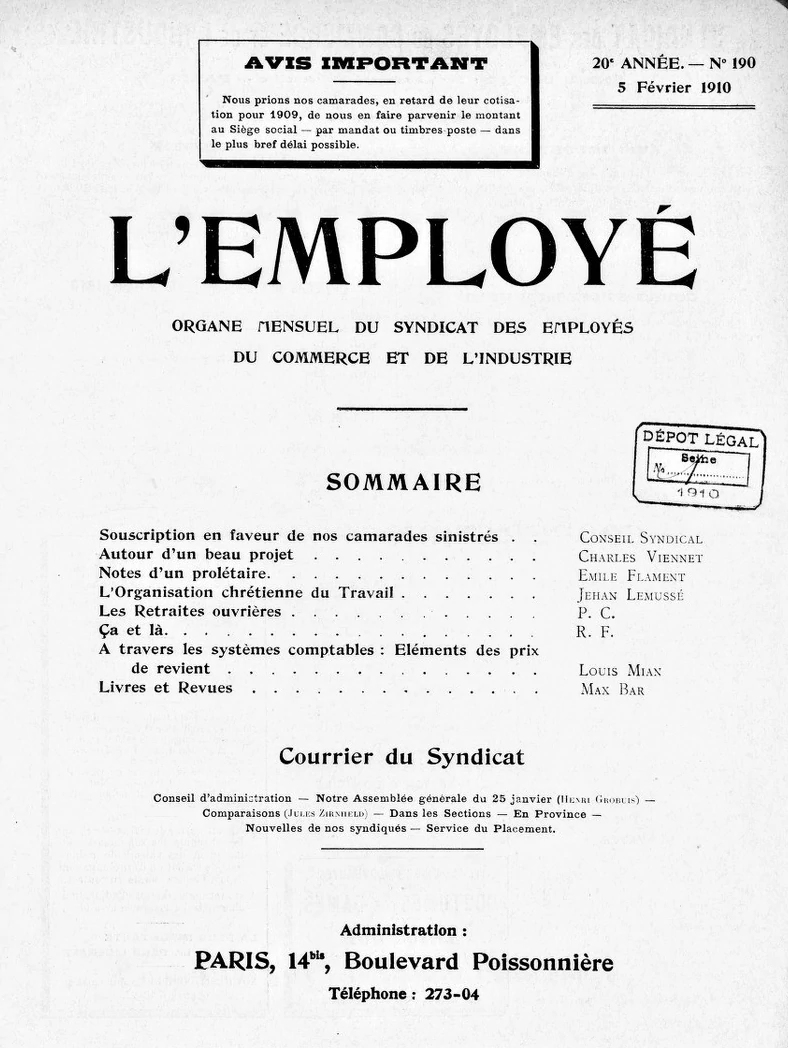
Dans la classe ouvrière, les initiatives restent éparses et isolées ; on a un syndicat à l’arsenal de Brest, des syndicats ouvriers catholiques parisiens dans l’ameublement, le livre, la métallurgie, l’habillement, le bâtiment et l’alimentation…
Et si on a très peu d’ouvriers, la dimension féminine-religieuse est significative, avec des regroupements ne concernant que des femmes, unies en une Union centrale des syndicats féminins formant le « syndicat de l’Abbaye ».
On trouve ainsi à Lyon un syndicat d’employées de commerce, un syndicat d’ouvrières de l’aiguille, un syndicat d’ouvrières en soie…
On a à Voiron un syndicat du tissage, à Grenoble un syndicat de la ganterie et de l’aiguille et un syndicat des employées… et à Paris des syndicats d’ouvrières et d’employées du textile et du vêtement.
Le mouvement est également présent à Bourges, Angers, Saumur, Poitiers.
Et c’est à partir de cette base féminine à Paris que le SECI décide de proposer une entité nationale : la Confédération française des travailleurs chrétiens.
->Retour au sommaire du dossier
De la CFTC à la CFDT