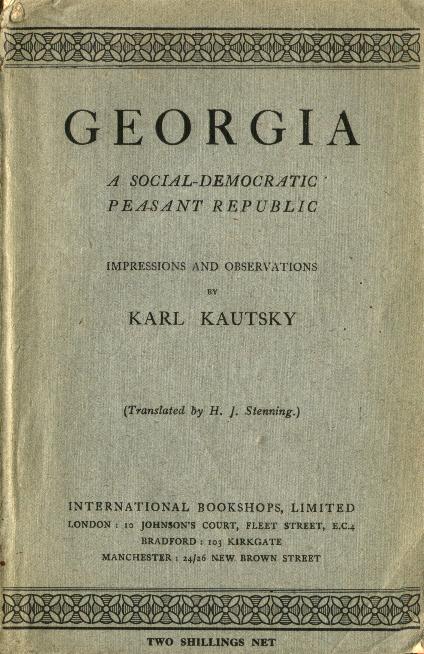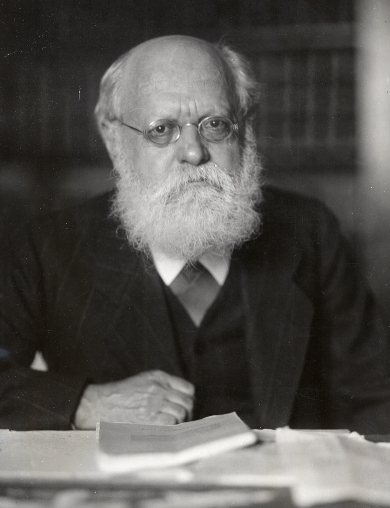I : Disparition de la petite industrie.
1 : Petite industrie et propriété privée.
Plus d’une personne croit faire preuve de sagesse quand elle nous déclare : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Il en est aujourd’hui comme il en a toujours été et comme il en sera toujours. » Rien de plus inexact, de plus faux que cette affirmation. La science la plus récente nous enseigne qu’il n’y a jamais repos, que, dans la société comme dans la nature, on peut observer une constante évolution.
Nous savons aujourd’hui, qu’à l’origine, l’homme, comme l’animal, ne vivait que des produits que la nature lui offrait spontanément et qu’il recueillait.
Mais peu à peu il inventa des armes, des outils de plus en plus perfectionnés. Il devint pêcheur, chasseur, pasteur, enfin agriculteur sédentaire et artisan. L’évolution progressa de plus en plus, rapidement jusqu’à ce qu’aujourd’hui, à l’époque de la vapeur, et de l’électricité, sa marche ait pris une accélération telle, sans comparaison avec les périodes. antérieures, que nous pouvons la suivre nos propres yeux.
Et il se trouve encore des gens qui, prenant. un air de supériorité, veulent nous apprendre qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil !
La façon dont l’homme crée sa subsistance, crée (produit) les richesses nécessaires dépend de la qualité des outils, des matières premières, bref des moyens dont il dispose pour établir des produits, dépend des moyens de production. L’homme n’a jamais travaillé isolément, mais au contraire toujours en sociétés plus ou moins grandes, dont la forme est déterminée par le mode de production qui règne à une époque.
A l’évolution de la production répond donc une évolution sociale.
Les formes de la société et les rapports de ses membres entre eux sont donc intimement liés aux formes de propriété que cette société reconnaît et maintient. L’évolution de la propriété suit donc pas à pas l’évolution de la production.
Un exemple va nous l’expliquer. Nous l’emprunterons à l’économie paysanne.
Une exploitation paysanne régulière comprend deux domaines économiques: l’élève du bétail et l’agriculture . Chez nous, jusqu’au XVIIe siècle, le système du pâturage prédominait dans l’élevage du bétail. Mais ce procédé implique la propriété commune du sol. Il serait absurde que le paysan voulût isoler pour lui seul son petit lopin, l’enclore, entretenir un berger particulier pour ses quelques bestiaux.
Aussi là où le système du pâturage est encore en vigueur, le paysan s’attache-t-il obstinément au maintien du pâturage communal, du berger communal.
Il en est autrement dans l’agriculture quand on l’exerce avec les simples instruments que possède le paysan sans avoir recours aux machines.
Dans ces circonstances, la culture collective de toute la terre arable d’une commune n’est ni nécessaire ni favorable à la production. Les instruments dont dispose l’agriculture paysanne imposent une condition; il faut que le paysan, soit seul, soit assisté de quelques aides peu nombreux (d’un groupe tel que le constitue la famille paysanne), cultive particulièrement un petit lopin de terre.
La culture sera d’autant plus scrupuleuse, le rendement sera d’autant plus abondant que le cultivateur pourra plus librement disposer de sa terre et profitera plus pleinement des fruits de son travail et des améliorations apportées à son champ. L’agriculture à ses débuts entraîne la petite exploitation, mais celle-ci, pour se développer complètement, exige la propriété privée des moyens de production.
Aussi voyons nous, chez les anciens Allemands par exemple, la propriété commune du sol, qui prédomina chez eux tant que le système du pâturage (et la chasse) constitua le meilleur procédé de gagner leur subsistance, disparaître de plus en plus et faire place à la propriété privée de la terre à mesure que progressait la petite agriculture.
La substitution de l’étable au pâturage donna le coup de grâce à la propriété commune de la terre.
Ainsi, sous l’influence de l’évolution économique, par suite des progrès de l’agriculture, le paysan, de communiste qu’il était, est devenu un partisan fanatique de la propriété privée.
Ce que nous avons dit du petit paysan s’applique également à l’artisan. Le métier n’exige pas qu’un grand nombre d’ouvriers travaillent en commun.
Chaque artisan produit soit seul, soit avec le concours d’un ou deux aides, d’un au deux compagnons, qui font partie de sa famille, de son ménage. Comme le paysan, l’artisan seul, ou avec l’aide de sa famille, suffit aux nécessités de son exploitation.
Aussi l’artisan, comme le petit paysan, a-t-il besoin de la propriété privée des moyens de production qu’il emploie et des produits qu’il crée pour pouvoir développer pleinement sa productivité, sa force productive. Dans la petite industrie, le produit de l’ouvrier dépend de sa personnalité, de son habileté technique, de son application, de sa persévérance.
Il le réclame comme sa propriété personnelle. Mais il ne peut développer pleinement sa personnalité au cours de la production que s’il est, personnellement libre et s’il dispose librement de ses moyens de production, en un mot que si ces derniers sont sa propriété privée.
Le parti socialiste l’a reconnu en termes exprès. Mais il ajoute en même temps que l’évolution économique de la société bourgeoise amène naturellement, nécessairement la disparition de la petite industrie.
Suivons donc cette évolution.
2 : Marchandise et capital.
La petite culture et le métier forment les points de départ de la société bourgeoise.
A l’origine, la famille paysanne satisfaisait seule à tous ses besoins. Elle créait tous les moyens de subsistance et de jouissance qui lui étaient nécessaires, tous les outils, tous les vêtements de ses membres, elle bâtissait elle-même sa maison, etc. Elle produit tout ce qui lui était nécessaire, mais pas davantage.
Mais avec le temps et les progrès de l’agriculture aidant, elle arriva à créer un excédent de produits dont elle-même n’avait pas immédiatement besoin. Elle put ainsi échanger ce superflu contre des produits qu’elle ne savait pas établir, ou qu’elle n’arrivait pas à créer en quantité suffisante, mais qui n’en étaient pas moins les bienvenus; c’étaient, par exemple, une parure, une arme ou un outil. Par l’échange, ces produits se transforment en marchandises.
Une marchandise est un produit destiné non à être employé ou consommé dans la sphère économique où il a été créé, mais à être échangé contre le produit d’une autre sphère économique.
Le blé que le paysan cultive pour sa consommation personnelle n’est pas une marchandise ; celui qu’il cultive pour le vendre en est une. Vendre signifie seulement échanger une marchandise déterminée contre une autre que tout le monde accepte avec plaisir et qui, de cette façon, devient de l’argent, l’or par exemple.
Comme nous l’avons vu, an cours de l’évolution, le paysan devient un producteur de marchandises. L’artisan dans le métier indépendant qu’il exerce est originellement un producteur de marchandises. Et ce dernier ne se contente pas de vendre un excédent de produits ; chez lui, c’est la production pour la vente qui passe au premier plan.
Mais l’échange des marchandises est soumis à deux conditions il faut, en premier lieu, que les diverses exploitations ne produisent pas toutes le même objet, il faut qu’une division du travail se soit produite dans la société; il faut en second lieu que les échangistes aient la libre disposition des produits qu’ils troquent, que ceux-ci soient leur propriété privée.
A mesure qu’au cours de l’évolution économique la division du travail progresse au sein des diverses professions et que la propriété. privée voit croître son extension et son importance, la production du producteur pour son propre usage perd, en général, de plus en plus du terrain et se voit supplantée par la production de marchandises.
La division du travail aboutit finalement à faire aussi de l’achat et de la vente l’objet d’un métier spécial auquel se consacre exclusivement une classe d’hommes, les marchands. Ils se ménagent un revenu en achetant bon marché et en vendant cher. Cela ne veut pas dire qu’ils peuvent fixer arbitrairement le prix des marchandises. Le prix d’une marchandise dépend en fin de compte de sa valeur.
Mais celle-ci est déterminée par la masse de travail exigée en général pour son établissement. Cependant, le prix d’une marchandise ne coïncide presque jamais exactement avec sa valeur. Il n’est pas, comme la valeur, uniquement déterminé par les conditions de production, mais par les conditions du marché, par le rapport de l’offre et de la demande.
Il dépend de la quantité de marchandises mise sur le marché, de la quantité demandée.
Mais le prix lui aussi est soumis à certaines lois. A des moments déterminés, dans des lieux déterminés, il est également déterminé. Si donc le marchand cherche à se ménager un excès du prix de vente de la marchandise sur son prix d’achat, à s’assurer un bénéfice, un profit , il ne peut ordinairement y arriver qu’en achetant sa marchandise dans un endroit, à un moment où elle est bon marché et en la vendant à un moment ou dans un endroit où elle est chère.
Quand le paysan ou l’artisan achète des marchandises, il le fait parce qu’il en a besoin, lui ou sa famille. Le marchand achète des marchandises non pour les consommer lui-même, mais pour les utiliser de telle façon qu’elles lui assurent un profit. Les marchandises, les sommes d’argent que l’on emploie dans ce but sont du capital.
D’aucune marchandise, d’aucune somme d’argent, en soi et pour soi, on ne peut dire qu’elle est ou n’est pas du capital. Tout dépend de son emploi. Le tabac qu’achète un marchand pour le revendre avec bénéfice, constitue pour lui du capital. Le tabac qu’il achète pour le fumer lui-même ne constitue pas un capital pour lui.
La forme primitive du capital est celle du capital marchand. Le capital usuraire, dont le bénéfice est constitué par l’intérêt que le capitaliste touche pour des marchandises ou des sommes prêtées, est presque aussi ancien.
Le capital se forme quand la production de marchandises est arrivée à un certain stade. Il. se fonde naturellement sur la propriété privée qui forme la base de toute la production de marchandises. Mais sous l’influence du capital, la propriété privée revêt un tout autre aspect, ou plutôt elle présente dès lors deux faces.
Outre son côté petit bourgeois, correspondant aux conditions de la petite industrie, elle offre un côté capitaliste. Les défenseurs de la propriété privée actuelle n’indiquent que son côté petit bourgeois. Il faut cependant être aveugle pour ne pas apercevoir le côté capitaliste de la propriété privée.
Au stade de l’évolution économique dont nous nous occupons maintenant, quand le capital n’est encore que du capital marchand ou du capital usuraire, seuls quelques traits de ce caractère capitaliste sont visibles ; il est vrai de dire qu’ils sont remarquables.
Sous le régime de la petite exploitation, le revenu du paysan ou de l’artisan dépend en première ligne de sa personnalité propre et de celle des membres de sa famille, de son application, de son habileté, etc. Par contre, la masse du profit réalisé par le marchand est d’autant plus considérable qu’il a plus d’argent pour acheter des marchandises, qu’il possède plus de marchandises à vendre.
Si je vends 10 000 livres de tabac, mon profit, toutes choses égales d’ailleurs, sera 100 fois plus important que si je ne puis en vendre que 100 livres. La même observation s’applique à l’usurier. Le revenu du capitaliste, comme capitaliste, dépend donc en première ligne de la grandeur de son capital.
La force de travail et les facultés de l’individu sont limitées ; il en est de même de la quantité de produits qu’un ouvrier peut fabriquer dans certaines conditions.
Il est une certaine moyenne qui ne peut être franchie. Mais où il est possible d’accumuler l’argent à l’infini il n’y a plus là ni terme ni mesure. Et plus quelqu’un possède d’argent, plus cet argent en produit d’autre s’il est employé comme capital. Ainsi la possibilité d’acquérir des richesses immenses est donnée.
Mais la propriété privée rend encore possible une autre éventualité. La propriété privée des moyens de production signifie que chacun peut légitimement les acquérir, elle signifie aussi que chacun a la faculté de les perdre, de perdre la source de son existence, de tomber dans la plus complète indigence.
Le capital usuraire suppose la misère. Quiconque possède ce dont il a besoin n’empruntera pas. Exploitant la gène du miséreux, le capital usuraire constitue un moyen de l’accroître.
Gain sans travail – richesse immense des uns – misère complète des autres – tels sont les traits que nous offre la propriété privée sous son aspect capitaliste.
Mais tant que le capital commercial et le capital usuraire en sont encore à leurs débuts, ces côtés défavorables restent voilés. Le caractère le plus funeste, le paupérisme, ne se manifeste que faiblement, le dénuement est exceptionnel, n’est pas le cas pour de grandes masses populaires.
Comme les autres exploiteurs qui surgissent à leur côté, par exemple au moyen âge le propriétaire foncier, sur lequel nous ne pouvons nous étendre sans risquer de nous écarter du sujet, le marchand et l’usurier sont, à cette période, intéressés au maintien et à la prospérité des petites exploitations à la ville et à la campagne. Le proverbe est encore vrai : Si le paysan a de l’argent, tout le monde en a.
Le commerce ne tue pas la petite industrie, il la favorise dans certaines circonstances.
L’usurier saigne son débiteur, mais n’a pas d’intérêt à sa perte La privation des moyens de production, la pauvreté, dans ces conditions, n’apparaît pas comme un phénomène social régulier ; c’est un malheur particulier résultant d’accidents extraordinaires ou d’une incapacité extraordinaire.
La pauvreté passe pour une épreuve envoyée par Dieu ou pour un châtiment de la paresse, de la légèreté, etc. Cette conception est encore fort en crédit dans la sphère de la petite bourgeoisie, et pourtant le manque de biens est devenu un phénomène tout différent de ce qu’il était alors.
3 : Le mode de production capitaliste.
Au cours du moyen âge, le métier s’est développé de plus en plus en Europe. La division du travail dans la société s’est accrue.
C’est ainsi que le tissage, par exemple, se divisa en tissage de coton, tissage du lin et tissage de la futaine ; diverses professions liées au tissage, celle des tondeurs de draps, par exemple, se constituèrent en métiers distincts. En même temps, le commerce se développe, à la suite surtout des améliorations apportées dans les moyens de transport, en particulier dans la construction des navires.
Il y a 400 ans, le métier était à son apogée, c’était également une époque de prospérité commerciale. On trouva la route qui menait par mer aux Indes, ce pays fabuleux aux richesses immenses. On découvrit l’Amérique avec ses gisements inépuisables d’or et d’argent.
Un flot de richesses se répandit sur l’Europe, richesses que des aventuriers européens avaient ramassées dans les pays nouvellement découverts grâce au commerce, à la tromperie, au vol. La part du lion échut aux maîtres du commerce, capables d’équiper des vaisseaux et de les pourvoir d’un équipage nombreux énergique, aussi audacieux que peu scrupuleux.
Mais à la même époque se constituait aussi l’État moderne, l’État centralisé, militaire, bureaucratique. Il prit d’abord la forme de la monarchie absolue. Cet État répondait aux besoins de la classe capitaliste, mais l’appui de celle-ci ne lui était pas moins indispensable. L’État moderne, où la «production de marchandise est déjà développée » ne tire pas sa force des services personnels, mais de ses recettes, de l’argent qui lui revient.
Aussi les monarques avaient les plus grandes raisons de protéger et de favoriser ceux qui faisaient rentrer de l’argent dans le pays, les marchands, les capitalistes.
Pour reconnaître cette protection les capitalistes prêtèrent de l’argent aux monarques et aux États, en firent leurs débiteurs, les mitent sous leur dépendance et forcèrent le pouvoir public à servir réellement les intérêts capitalistes en rendant la sûreté aux voies de communication, en les développant, en conquérant et en conservant des colonies d’outre-mer, en faisant la guerre aux nations commerciales rivales, etc.
Les manuels d’économie politique enfantins nous racontent qu’il faut chercher la source du capitalisme dans l’épargne, Mais nous avons appris à connaître une origine toute différente du capital.
Les richesses les plus considérables des nations capitalistes sont dues à leur politique coloniale, c’est-à-dire au pillage de pays étrangers, sont nées de la piraterie, de la contrebande, du commerce des esclaves, des guerres commerciales.
L’histoire de ces peuples nous offre jusqu’au cours de notre siècle des exemples suffisants de ces méthodes d’épargner du capital. L’aide de l’État a montré qu’elle était un moyen puissant de favoriser cette épargne si particulière.
Mais les découvertes de nouvelles régions, de nouvelles routes commerciales n’eurent pas seulement pour effet de rapporter aux commerçants des richesses considérables, elles dotèrent de marchés plus vastes l’industrie des nations européennes adonnées à la navigation, de l’Angleterre en particulier, qui devint la maîtresse des mers.
Le métier était incapable de satisfaire aux exigences si rapidement croissantes du marché. L’écoulement par masses appelait la production par masses ; le marché, devenu plus vaste, rendait indispensable une production répondant à ses besoins, c’est-à-dire dépendant absolument des commerçants.
Les négociants avaient tout intérêt à produire eux-mêmes par masses et de satisfaire ainsi aux demandes d’un marché plus étendu. Ils possédaient des moyens financiers suffisants pour acheter en quantité convenable tout ce qui était nécessaire à la production, matières premières, outils, ateliers, forces de travail.
Mais où prendre ces dernières ? Il n’y avait plus en Europe d’esclaves que l’on pût acheter. Mais un ouvrier, possesseur de ses propres instruments de travail ou appartenant à une famille les possédant ne vend pas sa force de travail. Il préfère travailler pour lui-même ou pour sa famille, de façon que tout le produit de son travail lui revienne ou reste entre les mains de sa famille. Il vend le produit de son travail, il ne vend pas sa force de travail.
Remarquons en passant qu’il faut se garder de l’expression : vendre son travail. On ne peut vendre le travail qui est une activité.
Mais, habituellement, on use du terme travail non seulement pour désigner une activité, mais encore pour dénoter le résultat de cette activité, le produit du travail, et également pour dénoter la force qui se manifeste dans le travail, la force de travail. L’emploi du terme de travail dans le cas précédent permet à tous les économistes qui veulent maintenir les travailleurs et les petits bourgeois dans l’ignorance de leur situation de confondre, d’identifier les choses les plus différentes.
Mais revenons à notre marchand que nous avons laissé en quête d’ouvriers. Il ne peut s’agir pour lui d’employer les possesseurs des petits métiers ou leurs familles.
Le marchand doit chercher des ouvriers ne possédant pas de moyens de production, qui ne disposent que de leur force de travail, si bien qu’ils se voient contraints de la vendre pour pouvoir vivre. Le développement pris par la production des marchandises et par la propriété privée avait, comme nous l’avons vu, déjà donné naissance à de semblables non-possédants.
Mais à l’origine ils étaient peu nombreux ; pour la plus grande partie, ils se composaient soit de personnes incapables de travailler, infirmes, malades, vieillards, ou de paresseux. Le nombre des travailleurs complètement libres qui étaient dénués de toute propriété était minime.
Mais une circonstance heureuse pourvut à cette nécessité précisément au moment où chez les marchands, la demande de travailleurs privés de propriété devenait considérable, des masses d’ouvriers furent dépouillés de ce qu’ils possédaient et jetés sur le pavé où les riches négociants n’avaient plus qu’à les choisir.
C’était également une des conséquences de la production de marchandises.
L’extension du marché dévolu à l’industrie exercée dans les villes eut sa répercussion sur l’agriculture.Dans les cités, la demande de moyens de subsistance et de matières premières, bois, laine, lin, matières tinctoriales, etc., devenait plus grande. Aussi la production agricole se transformait-elle de plus en plus, établissant des marchandises et produisant pour vendre.
Le paysan dès lors eut de l’argent entre les mains. Ce fut un malheur pour lui. Cette circonstance excita les convoitises de ses exploiteurs, les seigneurs fonciers et les princes. Tant que son superflu consista surtout en produits naturels, ils ne lui en prirent que ce qu’ils en pouvaient consommer. Mais l’argent sert toujours, plus on en a, mieux cela vaut.
Plus le marché réservé aux paysans s’étendait, plus il recevait d’argent en échange de ses marchandises, et plus aussi les seigneurs fonciers et les princes le pressuraient, plus les impôts et les taxes augmentaient. Bientôt les seigneurs ne se contentèrent plus du superflu que son travail leur procurait en outre de sa subsistance ; ils le dépouillèrent de plus en plus du nécessaire .
Il n’est donc pas étonnant que le paysan se soit abandonné au désespoir ; plus d’un surtout après que toute tentative de résistance eût été réfrénée dans les guerres des paysans, abandonnant maison et biens, se réfugia dans la ville.
Souvent une autre circonstance contribuait encore à ce résultat. Si dans les villes l’extension prise par le marché provoquait une production industrielle par masses, à la campagne elle nécessitait une production agricole par masses. Ce que le marchand tentait dans les villes, le seigneur foncier le tentait à la campagne. Celui-ci, qui jusqu’alors n’avait été d’une manière générale qu’un paysan haut placé, chercha à étendre son exploitation.
Il ne manquait pas de force de travail puisqu’il avait su astreindre les paysans à des services, à la corvée. Mais souvent il n’avait pas besoin de nouvelles forces de travail.
La production de la laine, ou du bois, par exemple, l’utilisation des pâturages et des forêts exigent beaucoup moins de travailleurs que l’agriculture. Quand les seigneurs fonciers abandonnèrent l’agriculture pour passer au pâturage ou à l’économie forestière, ils rendirent superflus les ouvriers agricoles.
Mais ce dont le propriétaire foncier avait dès lors besoin en toutes circonstances, c’était une étendue de terrain plus grande que celle qu’il exploitait. Il ne pouvait l’obtenir qu’aux dépens des paysans des alentours. S’il voulait étendre son exploitation, il lui fallait les chasser de leurs biens. Il lui en coûta peu. L’éviction des paysans commença et se poursuivit sur une grande échelle jusqu’il y a une centaine d’années.
Tandis que les seigneurs du commerce s’enrichissaient en pillant les colonies, les nobles et les princes s’enrichissaient en pillant leurs propres sujets. Et les seigneurs féodaux n’hésitaient pas plus que les capitalistes à employer la tromperie et la violence, le vol et le feu quand ces actes leur paraissaient convenir à leurs buts. L’histoire nous enseigne à ce propos d’étranges façons d’épargner.
Quelle conduite devaient donc suivre les masses des campagnards dépourvus de propriété, les uns fuyant les corvées et les redevances, les autres dépouillés par la ruse ou la violence de leurs maisons et de leur bien ? Ils ne pouvaient plus produire par leurs propres moyens. Les moyens de production dont ils avaient été séparés leur faisaient défaut. Ils ne pouvaient apporter aucun produit sur le marché.
Il ne leur restait plus qu’une issue, se présenter eux-mêmes sur le marché et vendre pour un temps plus ou moins long la seule valeur qu’ils possédaient encore, leur force de travail. Les uns devinrent des journaliers agricoles, employés par le même maître peut-être qui les avait expulsés.
Les autres s’engagèrent comme soldats et prêtèrent ainsi leur appui aux pillages du seigneur qui les avait pillés eux-mêmes ; d’autres encore tombèrent plus bas et devinrent mendiants ou criminels.
Mais beaucoup aussi, et non les pires, se tournèrent vers l’industrie, et lui demandèrent du travail. Les artisans pensèrent se défendre contre ces nouvelles forces de travail, ces concurrents qui menaçaient de les déborder en constituant leur métier en corporation fermée. Cette attitude ne fit que pousser davantage les travailleurs rendus disponibles à avoir recours à ces marchands qui cherchaient des salariés pour leurs exploitations industrielles.
Ainsi les bases. de l’industrie capitaliste, du mode de production capitaliste furent ménagées par une expropriation, une révolution, et l’histoire universelle n’en vit jamais de plus sanglante, de plus cruelle.
C’était, il est vrai, une révolution accomplie par les riches et les puissants, au détriment des petits et des faibles. Aussi fait-on de l’époque où elle s’est produite l’âge de l’humanisme, de la libération des esprits ; et aujourd’hui, c’est ce que crient bien haut tous ceux qui s’indignent le plus vivement des intentions révolutionnaires du parti socialiste.
La production capitaliste exigeait nécessairement qu’au préalable de grandes masses d’ouvriers fussent séparées de leurs moyens de production, qu’ils fussent transformés en non-possédants, en prolétaires.
L’évolution économique rendait ce phénomène inévitable. Mais, comme toujours, les classes qui s’élevaient ne se sont pas contentées d’attendre tranquillement le progrès de cette évolution ; ils ont fait appel à la force pour défendre leurs intérêts et accélérer encore son cours. Ce fut la force, sous sa forme la plus brutale, la plus cruelle, qui accoucha la société capitaliste.
4 : La petite industrie lutte contre la mort.
Au commencement, le nouveau mode de production ne présentait que peu de différence avec l’ancien. Tout à fait à l’origine, il se présentait sous la forme suivante : le capitaliste fournissait la matière première aux ouvriers qu’il avait loués, à ses salariés : le fil, par exemple, s’ils étaient tisserands, ils le mettaient en œuvre chez eux et livraient le produit au capitaliste.
Sans doute, déjà sous cette forme même, qui se rapprochait beaucoup du métier, la production capitaliste créait une différence considérable entre l’artisan indépendant et le salarié travaillant à domicile. Au cours d’un développement ultérieur, nous examinerons les modifications que le nouveau mode de production apporte à la situation de l’ouvrier. Nous allons d’abord suivre ce mode de production dans son évolution.
Le capitaliste commença d’abord par ne plus faire travailler les ouvriers à domicile; il les réunit dans son propre atelier, où il lui était possible de mieux les surveiller et de les pousser à produire davantage.
La base de la grande exploitation capitaliste, de la grande industrie proprement dite, était créée. Mais elle contenait également le principe de ce bouleversement des modes d’exploitation qui depuis se poursuit avec une accélération de plus en plus grande.
Le travail effectué en commun par de nombreux ouvriers dans un atelier rendit dès lors possible la division du travail au sein de l’industrie.
Sous le règne de la petite industrie, la division du travail avait conduit à multiplier le nombre des branches, à diminuer les espèces d’objets créés par chaque travailleur individuel. Cependant chaque ouvrier établissait un produit complet.
Dans la boulangerie, la division du travail avait conduit au résultat suivant : chaque boulanger ne fabriquait plus toutes les espèces de pains; les uns faisaient exclusivement du pain blanc, les autres du pain noir. Mais chacun fabriquait des pains tout entiers. Il en est autrement quand la division du travail s’établit au sein d’une même exploitation.
Elle a pour effet de confier les diverses opérations exigées par la fabrication d’un produit à certains ouvriers entre les mains desquels l’objet repasse. Le travailleur individuel voit donc son œuvre se borner de plus en plus à des opérations isolées qu’il doit constamment répéter. Une grande exploitation où l’on produit suivant cette méthode est une manufacture. Le rendement, la productivité du travail de l’individu s’en est trouvée extraordinairement augmentée.
Un autre effet de ce procédé est le suivant. Du moment que la division du travail avait fait assez de progrès dans une branche de production pour que la fabrication du produit fût réduite aux opérations les plus simples, que l’ouvrier fût tombé au rang de machine, il n’y avait plus qu’un faible pas à faire pour remplacer l’ouvrier par une machine.
Ce pas fut fait. Le développement des sciences naturelles favorisa ce progrès, surtout la découverte de la force motrice de la vapeur grâce à laquelle pour la première fois on disposait d’une énergie indépendante des caprices des éléments et entièrement soumise à l’homme.
L’introduction de la machine dans l’industrie avait la signification d’une révolution économique. Grâce à elle, la grande exploitation capitaliste prit sa forme la plus élevée, la plus parfaite, celle de la fabrique.La production capitaliste possédait dans la machine son arme la plus puissante, qui, comme en se jouant, renversait tout obstacle, et changeait le cours de l’évolution économique en une marche triomphale du capital.
Vers 1760, on inventa les premières machines pratiques convenant à l’industrie des tissus en Angleterre, et on les y introduisit. L’invention de la machine à vapeur remonte à la même époque.
Dès lors, la machine conquiert rapidement les branches d’industrie, les pays, les uns après les autres. Jusque vers 1840 la fabrique capitaliste n’existait que peu en dehors le l’Angleterre; vers 1850 elle prit un grand développement en France; vers 1860 et surtout vers 1870 elle conquit les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche.
Dans ces dernières dizaines d’années, elle s’est établie dans la Russie barbare, dans les Indes, en Australie ; elle commence déjà à s’introduire dans l’Asie orientale, dans l’Afrique du Sud et dans l’Amérique du Sud. Que sont les empires les plus puissants des siècles passés si on les compare à l’empire gigantesque que l’industrie capitaliste- s’est soumis ?
En 1837 le nombre des machines à vapeur employées en Prusse dans l’industrie s’élevait à 423 de 7.500 chevaux-vapeur. Par contre, en 1901 on y comptait 70.832 machines à vapeur fixes. La Prusse possède plus de 4 millions de chevaux-vapeur, utilisés dans l’industrie ou dans l’agriculture.
Le travail accompli par les machines à vapeur du monde entier est évalué au travail fourni par 200 millions de chevaux ou mille millions d’hommes.
La machine à vapeur bouleverse constamment tout le monde de production. Une invention, une découverte succède à l’autre.
D’abord, la machine conquiert chaque jour des domaines où s’exerçait encore le travail manuel. Puis, dans les branches d’industrie soumises déjà au régime de la fabrique, chaque jour de nouvelles machines, plus productives, mettent les anciennes hors service. Souvent même, d’un seul coup, une nouvelle invention crée toute une nouvelle branche d’industrie ; d’anciennes branches sont condamnées à disparaître.
Il y a trente ans déjà, un ouvrier travaillant à la machine à filer livrait un produit cent fois supérieur à celui d’une fileuse à la main.
L’enquête de 1898 de l’Office du travail américain (Department of Labor de Washington) démontrait que la machine dans l’industrie de la filature produisait 163 fois plus que le travail à la main. La machine fournissait en 19 heures 7 minutes autant de filé (100 livres) qu’une fileuse à la main en 3.117 heures 30 minutes.
Quelle importance peut encore avoir le petit métier qu’exerce un artisan ?
A son stade inférieur, quand l’industrie domestique est exploitée suivant la méthode capitaliste, l’industrie capitaliste se montre supérieure au métier.
Nous ne tiendrons pas compte de ce qu’elle renferme l’ouvrier dans une spécialité et accroît ainsi sa productivité. L’avantage dont le capitaliste jouit comme marchand vis-à-vis de l’artisan est beaucoup plus important. Il achète en gros ses matières premières et ses autres moyens de production.
Il connaît beaucoup mieux le marché que l’artisan, il sait mieux à quel moment on peut acheter bon marché et vendre cher. Ses moyens lui permettent d’attendre l’instant favorable.
La supériorité du capitaliste sur l’artisan est déjà si forte que celui-ci ne peut plus soulever la concurrence même de l’industrie à domicile dans toutes les sphères où règne la production par masse, la production en vue du commerce. Même dans les branches où prédomine exclusivement le travail manuel exercé par l’ouvrier à son domicile, l’indépendance du travailleur cesse dès que ces branches deviennent des industries d’exportation.
Transformer un métier exercé par des artisans en une industrie produisant pour l’exportation, c’est tuer le métier, c’est en faire une industrie à domicile exploitée suivant la méthode capitaliste. On voit combien sont avisés ces réformistes qui veulent sauver un métier menacé en lui ménageant un débouché plus considérable.
Ainsi donc, à l’origine même de la production capitaliste, quand elle est encore toute simple, elle se montre supérieure au métier dans tous les domaines où règne la production par masses. La machine rend cette supériorité tout à fait écrasante.
Le métier ne peut se maintenir que dans les branches où il s’agit encore non de production d’objets en masse, mais de production d’objets isolés, où le marché est encore extrêmement restreint.
Mais la machine n’a pas seulement bouleversé l’industrie, elle a encore transformé les moyens de communication. Les bateaux à vapeur et les chemins de fer font tomber de plus en plus les coûts de transports des objets, relient de plus en plus les localités les plus éloignées et les moins accessibles aux régions industrielles et augmentent de jour en jour les débouchés de celles-ci.
C’est grâce à ces circonstances que la machine peut développer pleinement toute son efficacité. L’augmentation gigantesque de la production, amenée par l’introduction de la machine, exige un accroissement correspondant des débouchés.
A mesure que les moyens de circulation se développent et se perfectionnent, que le marché s’étend pour certaines branches d’industrie, le domaine réservé au métier se restreint. Le proverbe : « Il n’est si petit métier qui ne nourrisse son maître », a depuis longtemps perdu toute signification. Le nombre des industries et des régions où ce mode d’exploitation peut encore subsister est déjà suffisamment limité, il diminue à vue d’œil. Le régime de la fabrique l’emporte et les jours du métier sont comptés.
Ce que nous venons de dire de la petite industrie s’applique également à la petite exploitation paysanne. Là où l’agriculture est devenue principalement une production de marchandises, une production pour la vente et non pour l’usage personnel, la grande exploitation, quand bien même elle n’est pas plus productive, jouit vis-à-vis de la petite exploitation du même avantage que le capitaliste a partout sur le petit commerçant : il voit mieux le marché et peut mieux s’en rendre maître.
Mais aussi le grand propriétaire foncier, bien pourvu de capital, ou son fermier, peut rendre son exploitation plus fructueuse que le paysan, se procurer, employer de meilleurs outils et instruments aratoires, de meilleurs animaux reproducteurs et bêtes de trait, de meilleurs engrais et de meilleures semences.
La supériorité technique et commerciale de la grande exploitation agricole a été, dans ces dernières dizaines d’années, quelque peu diminuée par la concurrence de l’agriculture d’outre-mer qui a atteint plus durement la grande exploitation agricole que la petite, d’abord parce qu’elle s’est consacrée plus spécialement à la culture du blé où se manifeste particulièrement la supériorité de la grande exploitation sur la petite.
Dans la grande agriculture prédomine surtout la production du blé, et cette dernière est le plus exposée à souffrir de la concurrence de la culture américaine. La grande exploitation est donc plus atteinte par la concurrence étrangère parce qu’elle produit pour le marché tandis que la petite exploitation consomme elle-même une grande partie de ses produits.
Mais ces conditions favorables à la petite industrie ne tarderont pas à disparaître. La concurrence étrangère ne s’en tient pas à la production du blé ; elle développe également l’élevage et chez le paysan, la production pour l’usage personnel se restreint de plus en plus et cède le pas à la production marchande, à la production en vue de la vente.
C’est surtout le développement pris par les chemins de fer et l’accroissement des impôts qui favorisent les progrès de la production marchande dans l’agriculture.
Par les chemins de fer, le paysan est relié au marché universel ; les impôts l’obligent à chercher un débouché ; il ne peut en effet les payer s’il n’a pas vendu une quantité proportionnée de ses produits.
A mesure que les impôts augmentent, le paysan doit avoir de plus en plus recours au marché, sa production devient de plus en plus une production de marchandises, de plus en plus il est exposé à la concurrence de la grande exploitation.
L’augmentation des impôts est plus funeste pour le petit paysan que pour toute autre classe de la société.
Le militarisme est aujourd’hui la cause de beaucoup la plus importante de cette augmentation. Mais les mêmes gens qui se proclament les plus grands amis du paysan, les grands propriétaires fonciers, sont les protecteurs les plus zélés du militarisme.
Pour eux, en effet, le militarisme ne présente que des avantages : il entraîne nécessairement des livraisons considérables de subsistances destinées aux hommes et aux chevaux, livraisons dont seul le grand propriétaire foncier peut se charger.
Le militarisme ménage encore aux fils du grand propriétaire des emplois d’officiers bien payés. Le militarisme enlève au paysan sa meilleure force de travail, son fils. Il lui impose des impôts écrasants et le pousse sur le marché où il est condamné à succomber devant la concurrence victorieuse des grandes exploitations de son pays et le l’étranger.
Les classes dominantes voient dans la classe paysanne et le militarisme les deux seuls appuis sûrs de l’état existant. Mais elles n’observent pas que l’un de ces deux appuis repose sur l’autre et l’écrase de son poids toujours plus considérable.
Dans l’agriculture, il y a vingt ans encore, la décadence de la petite exploitation paysanne indépendante était fort sensible. Le paysan était prolétarisé, parce que son exploitation était absorbée par une grande exploitation ou que son bien était morcelé, parcellé.
Cette évolution se poursuit encore ; mais dans bien des régions elle s’est arrêtée sous l’influence de la concurrence d’outremer dont nous avons parlé. La statistique nous fournit par exemple les chiffres suivants :
| En France Biens fonds de | 1882-1892 Diminution (-) ou Augmentation (+) | En Allemagne Biens fonds de | 1882-1895 Diminution (-) ou Augmentation (+) |
| Hectares | Hectares | Hectares | Hectares |
| Moins de 1 | + 243.420 | Moins de 2 | – 17.494 |
| De 1 à 5 | – 108.834 | de 3 à 5 | + 95.781 |
| De 5 à 10 | – 13.140 | 6 à 20 | + 563.477 |
| De 10 à 40 | – 532.243 | 21 à 100 | – 38.333 |
| Plus de 40 | + 197.288 | Plus de 100 | + 45.533 |
Mais partout nous observons une diminution de la petite exploitation agricole indépendante du capital.L’affermage et l’endettement augmentent. Dans l’empire allemand, l’endettement de la propriété foncière s’est accru en dix ans, de 1886 à 1895, de 23.000 millions de marks en chiffres ronds. Le nombre des exploitations de terres prises à ferme est passé, de 1882 à 1895, de 2.322.899 à 2.607.210 ; il à donc augmenté de 284.311 unités.
Nous remarquons enfin une décroissance de la population agricole totale. Dans l’Empire allemand, elle s’élevait en 1882 à I8.704.038 habitants ; en 1895, à 17.015.187 seulement ; la diminution est donc presque d’un million.
La décadence de la petite exploitation est encore bien plus surprenante dans l’industrie que dans l’agriculture. Elle est ici absolue. Dans l’Empire allemand on comptait :
| Importance des exploitations | En 1882 | En 1895 | Diminution (-) ou Augmentation (+) |
| Petites (1 à 5 ouvriers) | 2.175.857 | 1.989.572 | – 8,6 % |
| Moyennes (6 à 50 ouvriers). | 85.001 | 139.459 | + 64,1 % |
| Grandes (plus de 50 ouvriers) | 9.841 | 17.941 | + 89,3 % |
Au même moment la population augmentait de 14,5 %.
En 1882, le nombre des ouvriers employés dans les petites exploitations industrielles comprenait beaucoup plus de la moitié (59 %) des travailleurs employés par l’industrie (4.335.822 pour 7.340.789); en 1895, elle n’en comptait plus que 46,5 % (4.770.669 pour 10.269.269). Par contre, le nombre d’ouvriers de la grande industrie doublait dans la même période (passant de 1.613.247 à 3.044.26).
Ce sont là des chiffres tout à fait surprenants si l’on considère combien est jeune le capitalisme allemand. La décadence de la petite exploitation est en général un processus lent.
Un exemple nous fera comprendre clairement la chose. Le tissage à la machine (surtout anglais) faisait déjà vers 1840-1850 une concurrence si vive au tissage à la main que la misère des tisserands devint proverbiale et suscita des révoltes amenées par la famine.
Cependant, d’après la statistique de 1882, on comptait encore dans l’Empire allemand, sur 491.796 tisserands, 284.544 employés dans de petites exploitations n’occupant que 1 à 5 personnes, soit plus de la moitié. Il ne peut venir à l’esprit de personne de vouloir en tirer la conclusion que le tissage à la main a encore un avenir devant lui et que sa disparition n’est pas nécessaire.
En Angleterre, le dernier tisseur à la main est depuis longtemps mort de faim; en Allemagne, ses jours sont comptés.
Le nombre des tisserands employés dans de petites exploitations est tombé de 285.444 à 156.242 de 1882 à 1895. S’il existe encore tant de tisserands à la main, cela ne prouve pas que la petite industrie puisse résister à la concurrence, mais que le tisserand à la main est particulièrement capable d’endurer la faim.
La disparition complète de la petite industrie n’est pas le premier, mais le dernier acte de la tragédie qui a pour titre : la décadence de la petite industrie.
Le premier effet de la concurrence de la production capitaliste est le suivant : l’artisan, et ce que nous disons de lui s’applique également au paysan, sacrifie peu à peu tout le bien-être que son assiduité au travail ou celle de ses ancêtres lui avait ménagé. Les petites gens s’appauvrissent ; pour lutter contre cet appauvrissement, on redouble d’assiduité.
Le temps de travail est prolongé bien avant dans la nuit; femmes et enfants participent au travail rémunéré; des apprentis, peu coûteux, viennent remplacer les compagnons adultes qui coûtent cher ; le nombre des apprentis s’accroît outre mesure.
Et tandis que le temps de travail s’allonge, que l’activité devient fiévreuse, qu’on ne connaît plus ni pause ni répit, l’alimentation diminue, les dépenses consacrées au logement et aux vêtements sont de plus en plus restreintes.
Rien de plus lamentable, de plus misérable que l’existence d’un petit industriel ou d’un petit paysan qui lutte contre la concurrence de la grande industrie.
Ce n’est pas sans raison que l’on dit que les ouvriers salariés sont aujourd’hui en meilleure situation que les petits paysans ou les maîtres artisans.
On voudrait prouver que les ouvriers n’ont pas sujet d’être mécontents. Mais le trait décoché contre la critique socialiste n’atteint que la propriété privée.
En fait, si des ouvriers dépourvus de propriété sont en meilleure posture que les artisans qui possèdent, quelle valeur peut donc présenter pour ceux-ci la propriété ? Elle cesse de leur être utile, elle commence à leur être nuisible.
Si, par exemple, le tisserand à domicile s’attache à son métier insuffisant, alors qu’il pouvait gagner davantage dans la fabrique, il ne le fait que parce qu’il possède encore quelque chose, une petite maison, quelques champs de pommes de terre, qu’il lui faudrait abandonner s’il quittait son métier.
Pour les petites gens, la propriété des moyens de production n’est plus une protection contre la misère, c’est un lien qui les enchaîne à la misère. L’effet de la propriété privée s’est changé en son contraire.
Ce qui, il y a cent ans, était encore une bénédiction pour le paysan, pour l’artisan, est une malédiction pour eux.
Mais, dira-t-on, l’artisan et le petit paysan achètent au prix de cette misère une indépendance et une liberté plus grandes que celles dont jouit le salarié sans propriété. Cette observation est également fausse.
Là où la petite industrie doit entrer en concurrence avec la grande industrie, celle-là ne tombe que trop vite sous la dépendance complète de celle-ci. Le petit artisan devient un industriel à domicile qui paie son tribut au capitaliste. Sa maison est une succursale de la fabrique.
Ou bien encore, il devient un agent du capitaliste, un vendeur des produits de la fabrique qui exécute par surcroît des réparations, des raccommodages. Dans un cas comme dans l’autre, il dépend absolument du capitaliste. Et le paysan, qui ne peut supporter la concurrence comme paysan, se résout soit à exercer l’industrie à domicile au service d’un capitaliste, soit à devenir journalier aux gages d’un grand agriculteur.
Il peut encore devenir un travailleur, nomade, ou bien il entre à la fabrique, ou à la mine et laisse à la femme et à ses enfants non encore adultes le soin de cultiver son petit bien.
Que devient alors son indépendance et sa liberté? Sa propriété le distingue seule du prolétaire, mais cette même propriété l’empêche de profiter des meilleures conditions de travail ; elle l’enchaîne à la glèbe et le rend moins libre que la salarié qui ne possède rien. La propriété privée des moyens de production accroît non seulement la misère matérielle, mais encore la dépendance du petit propriétaire.
A ce point de vue encore, ses effets se sont changés en leur contraire.
La propriété était un rempart de la liberté, elle est devenue un moyen d’asservissement.
Mais, dit-on encore, la propriété privée assure au paysan et à l’artisan la propriété des produits de leur travail.
C’est là une faible consolation quand la valeur des produits est tellement tombée, qu’elle ne permet plus de satisfaire les besoins du producteur et de sa famille. Mais même cette consolation devient illusoire.
Elle ne s’adresse plus à la grande masse de ceux qui doivent avoir recours à l’industrie à domicile ou au travail à la journée pour s’assurer l’existence. Mais elle ne s’adresse pas non plus à la majorité de ces petits artisans et de ces petits paysans que la concurrence de la grande exploitation n’a pas suffisamment atteint encore et qui se croient assez heureux pour conserver leur apparente indépendance.
Elle ne s’adresse pas à tous ceux qui ont des dettes. L’usurier qui à une hypothèque sur le bien d’un paysan a plus de droit au produit du travail du prolétaire que ce dernier même. Il faut d’abord satisfaire l’usurier ; ce qui reste appartient au paysan.
Peu importe à l’usurier qu’il suffise ou non à entretenir le paysan et sa famille. Le paysan et l’artisan travaillent autant que le salarié pour le capitaliste.
A ce point de vue, la propriété privée n’établit que la différence suivante entre le travailleur qui possède et celui qui ne possède pas ses instruments de travail ; le salaire de ce dernier se règle, en général sur ses besoins habituels, tandis que le revenu du premier ne connaît pas cette limite.
Dans certaines circonstances, il peut arriver que les intérêts de l’usurier absorbent complètement le produit du travailleur qui possède ses moyens de travail, il peut arriver que celui-ci travaille absolument inutilement, gratuitement… grâce à la petite propriété (1).
Quel est le résultat final de cette lutte douloureuse contre la toute puissante concurrence de la grande exploitation ? Quelle récompense le paysan, l’artisan retire-t-il de son « économie », de son « application », auxquelles il sacrifie sa liberté, celle de sa femme et de ses enfants, pour lesquelles il se ruine corporellement et intellectuellement ? Sa récompense, c’est la banqueroute, la complète expropriation ; il est séparé de ses moyens de production, il tombe dans le prolétariat.
Tel est, dans la société actuelle, le terme inévitable de l’évolution économique, tout aussi inévitable que la mort.
Et de même que le patient en proie à une douloureuse maladie voit dans le trépas un sauveur, de même, aux yeux de l’artisan et du petit paysan, la banqueroute n’est que trop souvent le salut, elle le sauve d’une propriété devenue pour lui une charge accablante.
La persistance de la petite exploitation conduit à une telle démoralisation, à une telle misère que l’on peut se demander de quel droit on pourrait s’opposer à sa disparition, si le pouvoir nous en était réellement donné. Serait-il plus désirable que les artisans et les paysans tombassent tous dans la situation des tisserands à domicile au lieu de devenir des salariés de la grande industrie ?
C’est cependant là la seule espérance de l’avenir pour ceux qui tentent de maintenir la petite industrie. Il est impossible en effet de faire refleurir le métier et la petite exploitation paysanne à l’époque de la vapeur et de l’électricité.
Sans doute, cette vérité ne manque pas d’amertume.
Elle est amère non seulement à ceux qui se trouvent atteints, mais encore à tous ceux qui ont quelque intérêt au maintien de la société actuelle. Paysans et artisans ont toujours été les soutiens les plus puissants de la propriété privée.
Aussi ne veut-on, ne peut-on croire que cette institution est devenue caduque et va s’effondrer. Tous ceux qui sont intéressés à l’exploitation des classes inférieures de la population, et par suite des paysans et des artisans, tous ceux qui les ruinent, les grands propriétaires fonciers, les fabricants, etc., se donnent subitement pour leurs amis et cherchent avec eux les moyens de maintenir les petites exploitations.
Et il ne manque pas de charlatans pour recommander leurs formules, des formules infaillibles.
Quand on y regarde de près, elles sont, certes, fort anciennes ; il y a cent ans et plus qu’elles ont prouvé leur inefficacité et même leurs dangers, le régime des corporations, par exemple.
Dans la mesure où elles ont quelque valeur, elles ne peuvent jamais que permettre à quelques petits paysans ou artisans placés dans des conditions particulièrement favorables de s’élever à une forme d’exploitation supérieure, ce qui veut dire de renoncer à la petite exploitation, de devenir des capitalistes,des concurrents qui hâtent la disparition de leurs rivaux, moins favorisés.
Toutes les « réformes sociales », tous les moyens de sauver le paysan et l’artisan, dans la mesure où ils sont efficaces, ressemblent à une loterie. Quelques-uns peuvent tomber sur un billet gagnant, mais la majorité ne tire que des billets blancs et se voit obligée de payer non seulement les lots, mais encore les frais de toute l’entreprise. Si quelque pauvre diable se trouvait riche parce qu’il a dans la poche un billet de loterie, on le tiendrait pour fou.
Cependant un trop grand nombre de paysans et d’artisans ressemblent à ce pauvre diable ; ils se croient ce qu’ils voudraient être et non ce qu’ils sont. Ils se conduisent en capitalistes et n’en sont pas plus avancés que les prolétaires.
(1) S’il y avait encore dans des régions écartées des paysans et des artisans non endettés, les dettes publiques sont là pour remédier à cet état de chose et pour leur faire payer des intérêts au capital. Dans l’intérêt des hypothèques, des billets souscrits, etc., les paysans et les artisans ne payent du moins que les intérêts d’un capital qu’ils ont eux-mêmes touché.
Dans les impôts, qui servent à payer les intérêts des dettes publiques, ils paient les intérêts d’un capital que l’Etat a emprunté pour enrichir ainsi à leurs dépens leurs concurrents et leurs exploiteurs, fournisseurs, entrepreneurs de construction, grands industriels, grands propriétaires fonciers, etc.
Le militarisme et les dettes publiques sont les deux puissants moyens grâce auxquels l’Etat actuel soumet le village le plus reculé à l’exploitation capitaliste et hâte la disparition de la petite agriculture paysanne et du métier.