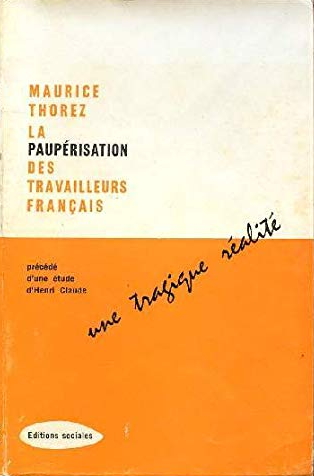Le Capital de Karl Marx est connu pour être une œuvre longue et difficile. En réalité, c’est une œuvre très simple d’accès, à condition d’avoir les clefs pour la comprendre.
C’est ce que nous allons faire ici ; nous allons voir pas à pas que ce que dit Karl Marx est absolument limpide. Et pour cela, nous allons non pas regarder Le Capital de l’extérieur, mais avec les yeux de Karl Marx : ce n’est qu’ainsi qu’on peut comprendre ce qu’il a vu, compris et, enfin, expliqué.
Cela sera naturellement un peu long, de par le nombre de détails abordés, mais cela sera toujours limpide dans la mise en perspective. Rentrons dans le vif du sujet.
De quoi parle Karl Marx ? De la vie des êtres humains et leurs besoins
Il est bien connu que Karl Marx utilise le terme de « mode de production » ; en effet, tout ce que dit Karl Marx dans cette œuvre est un exposé du capitalisme comme mode de production.
C’est le point de départ de sa vision. Mais de quoi parle-t-il précisément ?
Karl Marx parle de la vie quotidienne. Quand on vit, on a besoin de se nourrir, de s’habiller, de dormir, etc., c’est-à-dire de satisfaire des besoins. Karl Marx regarde comment ces besoins sont satisfaits.
La manière avec laquelle ces besoins sont satisfaits s’appelle un « mode de production » – c’est une « manière » de produire.
La première chose qu’il faut ainsi voir, c’est qu’un mode de production est un moyen de produire des choses qui permettent à l’humanité de vivre, en satisfaisant des besoins, au moins les principaux, c’est-à-dire ceux qui sont vitaux.
Une société produit sa nourriture, ses logements, les moyens de s’habiller, de prendre soin de la santé des gens, etc. Un mode de production permet cela, de manière ou plus moins bonne.
Il y a plusieurs manières de satisfaire ses besoins
Évidemment, si les gens doivent réaliser eux-mêmes, individuellement, tout ce dont ils ont besoin, c’est compliqué.
C’est pour cela que la division du travail s’est instaurée, de manière toujours plus grande.
Historiquement, les villes sont ainsi nées comme lieu du marché, les artisans proposant leurs biens dans un endroit unique, les personnes des environs venant y chercher ce dont elles avaient besoin.
Il y a une modification de la manière dont les besoins sont réalisés. On est ainsi passé des êtres humains chassant et cueillant à ceux domestiquant et pratiquant l’élevage. On est passé du paysan isolé dans son champ à l’agriculteur s’appuyant sur des machines, comme les moissonneuses-batteuses, etc.
Il y a donc plusieurs modes de production, qui sont déterminés par l’élévation plus ou moins grande de leurs capacités à produire. Karl Marx considère qu’on passe justement d’un mode de production à un autre, parce qu’il y a un blocage des forces productives, mais que ce blocage n’est que temporaire, parce que les forces nouvelles permettant une production meilleure finissent par triompher.
Cependant, avant d’aborder cette question, il faut d’abord comprendre ce qu’est un mode de production, et en l’occurrence le mode de production capitaliste.
En effet, un mode de production n’est pas statique, il ne fait pas que « produire » des biens satisfaisant les besoins : il doit également refaire cette production, sans s’arrêter. Un mode de production est également un mode qui re-produit la production déjà faite.
C’est là un aspect très important.
Les besoins doivent être satisfaits de manière répétée
Une fois qu’on a un jour satisfait ses besoins, on est obligé de le recommencer le lendemain. Une fois achetée de la nourriture, par exemple, il faut en racheter encore par la suite ; de la même manière, si le marteau que l’on a acheté s’est cassé, il faut en acheter un autre, etc.
C’est ainsi à travers le mode de production que les moyens de vivre sont produits, et c’est également à travers le mode de production que ces moyens de vivre sont re-produits.
Le mode de production connaît donc des cycles. Il produit, puis recommence, puis recommence, etc.
Il n’y a donc pas simplement un mode de production d’un côté et des besoins de l’autre. La satisfaction des besoins est au cœur même de l’existence du mode de production. On ne produit pas pour « produire » abstraitement, mais pour satisfaire des besoins.
Il n’y a pas de mode de production sans besoins, et inversement.
La manière de produire est elle-même reproduite
Par conséquent, et logiquement donc, puisqu’il y a de nouveau aujourd’hui les mêmes besoins qu’hier pour vivre, alors la production va être re-produite, et donc la manière de produire va l’être aussi.
Chaque cycle reprend la méthode précédente. A quoi est-ce que cela ressemble dans le capitalisme ?
Karl Marx explique qu’il y a les moments suivants : déjà l’utilisation initiale d’une force de travail au moyen d’une somme d’argent (le salaire payant donc ici les ouvriers), puis la production réalisée (par les ouvriers), et enfin la vente de la production sur le marché.
Avec les bénéfices réalisés au final, on recommence le cycle, puisque le mode de production exige que soit de nouveau produit des biens.
Dans Le Capital, Karl Marx nous dit à ce sujet :
« Quelle que soit la forme sociale que le procès de production revête, il doit être continu, ou, ce qui revient au même, repasser périodiquement par les mêmes phases. Une société ne peut cesser de produire non plus que de consommer.
Considéré, non sous son aspect isolé, mais dans le cours de sa rénovation incessante, tout procès social de production est donc en même temps procès de reproduction. »
Tout procès social de production est donc en même temps procès de reproduction, car le mode de production permet la satisfaction des besoins vitaux, impérativement nécessaire. C’est la première grande leçon permettant de comprendre la vision de Karl Marx.