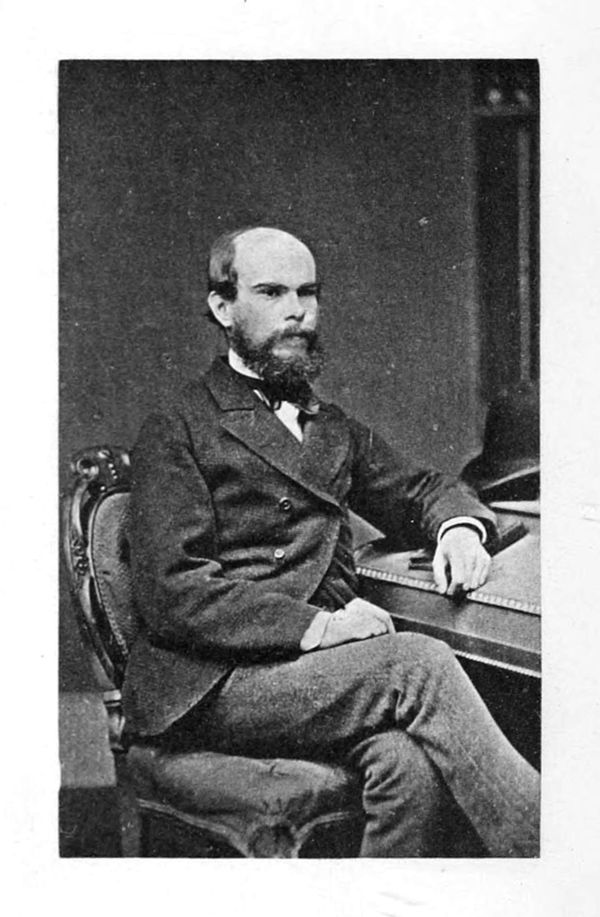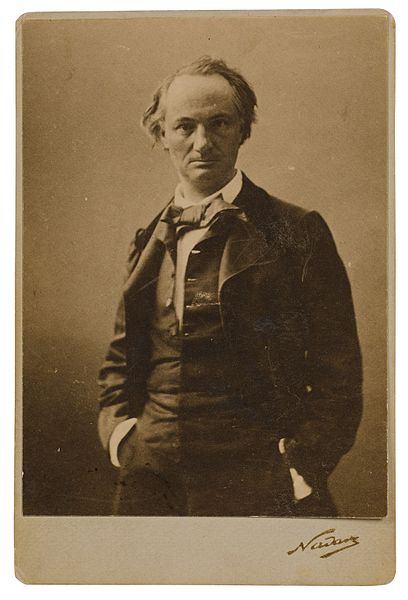Le poème Promenade sentimentale, tiré
des Poèmes saturniens,
est très proche de Soleils couchants,
mais sans la dimension compactée : c’est une
tentative de se rapprocher de la densité du poème classique, ce
qui indique la mauvaise direction de Paul Verlaine, qui justement
correspond à cette dimension « compactée », bien
choisie, des termes propres à une société plus éduquée.
Le poème, qui
fait partie à la première
œuvre de Paul Verlaine, les
Poèmes saturniens, a
une approche d’ailleurs relevant du Parnasse.
C’est pourtant un échec complet sur ce plan,
car la dimension mélodique, avec en quelque sorte des refrains
intériorisés au poème, est bien trop prégnante. La musicalité
l’emporte, brisant l’approche parnassienne.
De plus on a des références systématisées à
la nature et une dynamique dialectique par l’opposition du pointu
au trouble, correspondant de
manière particulièrement vigoureuse à toute la « nervosité »
qu’il s’agit d’exprimer
désormais.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Voici le repérage des éléments de la nature et du mouvement. Toute la force du poème réside en effet au cadrage par la nature, sans quoi tout s’étiolerait, ce qui est le cas dans les autres œuvres de Paul Verlaine.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Voici le repérage du pointu et du trouble, c’est-à-dire des éléments pointus, agressifs pour ainsi dire, et inversement des éléments aux contours indéfinis, non seulement troubles ou vagues, mais surtout correspondant à quelque chose de troublé.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Voici le repérage des éléments revenant à
plusieurs reprises, formant la mélodie. On remarquera que « parmi
la saulaie » encadre une sorte de partie intermédiaire où il
n’y a justement pas de répétition. Le découpage est fait pour
faciliter la vue de cette structuration.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Voici le repérage de la lumière, du transparent, par opposition à l’opaque, aux ténèbres. Il faut noter que les ténèbres ont un sens plus fort que celui d’obscurité, de par son côté indéfini, oppressant. Il y a une dimension nerveuse qui s’ajoute au concept d’obscurité.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Il
faut saisir également ici que les rayons sont pointus et que la
plaie a été causée par un objet pointu. Il y a toutefois le fait
que le soleil est couchant et que par conséquent les rayons ont
moins de vigueur. On est dans une souffrance – mais indéfinie.
Telle
est la manière dont Paul Verlaine cherche à saisir, définir la
nervosité.
Voici
maintenant le repérage des dimensions, de la spatialisation, de
l’occupation de l’espace, un
aspect absolument
fondamental du poème.
Il
faut rappeler ici également que les nénuphars poussent depuis la
base des cours d’eaux, qu’elles occupent elles-mêmes un espace.
A cela s’ajoute que les
nénuphars blancs s’ouvrent
et se ferment selon le jour ou la nuit, ce
qui correspond à l’opposition jour/nuit mentionnée.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
On a ici vraiment la démarche de Paul Verlaine,
quand elle réussit (ce qui est plus que très rarement le cas) :
on a la nature et les sentiments d’un côté, la concision. Il faut
également en voir la musicalité, au-delà simplement de la mélodie.
Voici le repérage des sons « é »
et « o »,
qui
respectivement est empreint de légèreté, le second étant marqué.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
Voici le repérage de la lettre « l »
ainsi que des sons « ou » et « an »,
avec pareillement une
opposition entre l’atténuation et un
son continu et marquant.
PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes
Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;
Les grands nénuphars entre les roseaux,
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l’étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j’errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
La dimension compactée n’est pas là, toutefois
le poème
ne consiste pas en alexandrins, mais en décasyllabes. On a
déjà le style d’expression concise, déterminée, qui passe de
l’alexandrin au pentasyllabe, ici masqué par les décasyllabes
formant même souvent une double pentasyllabe.
On ici une véritable virtuosité quant à la présentation de la nervosité. Mais le poème s’étale et il manque d’accessibilité.
=>Retour au dossier sur Paul Verlaine et la nervosité expressive