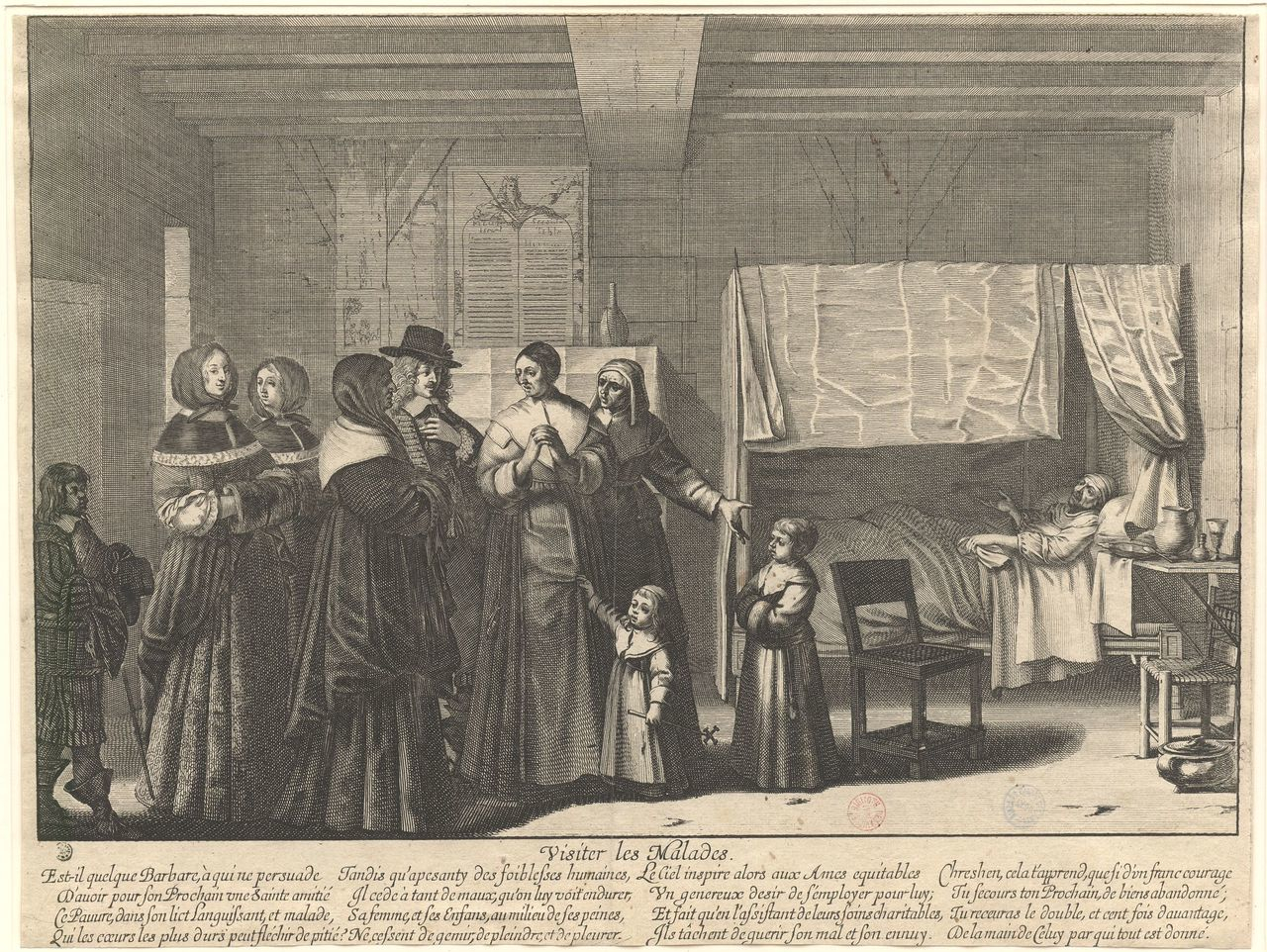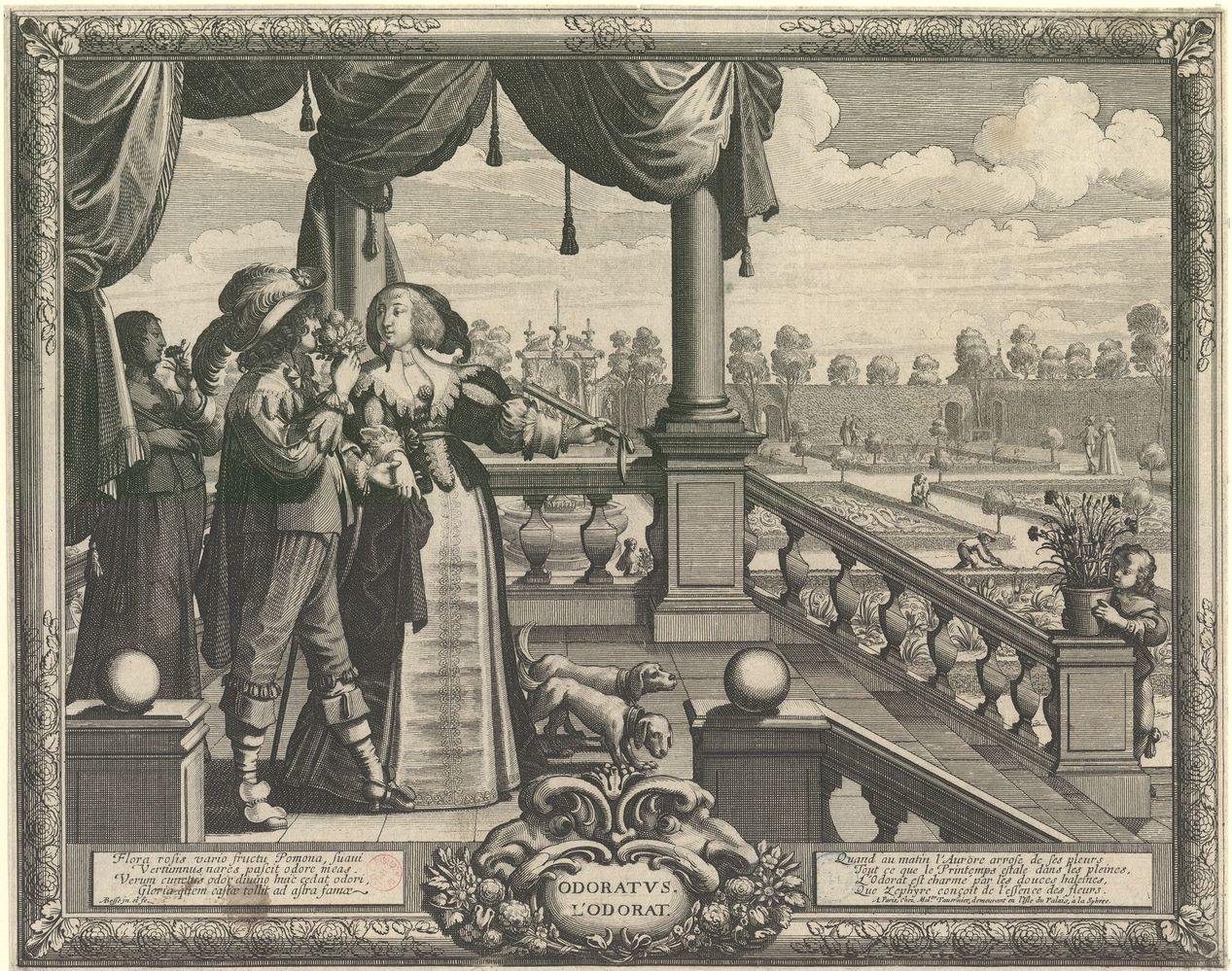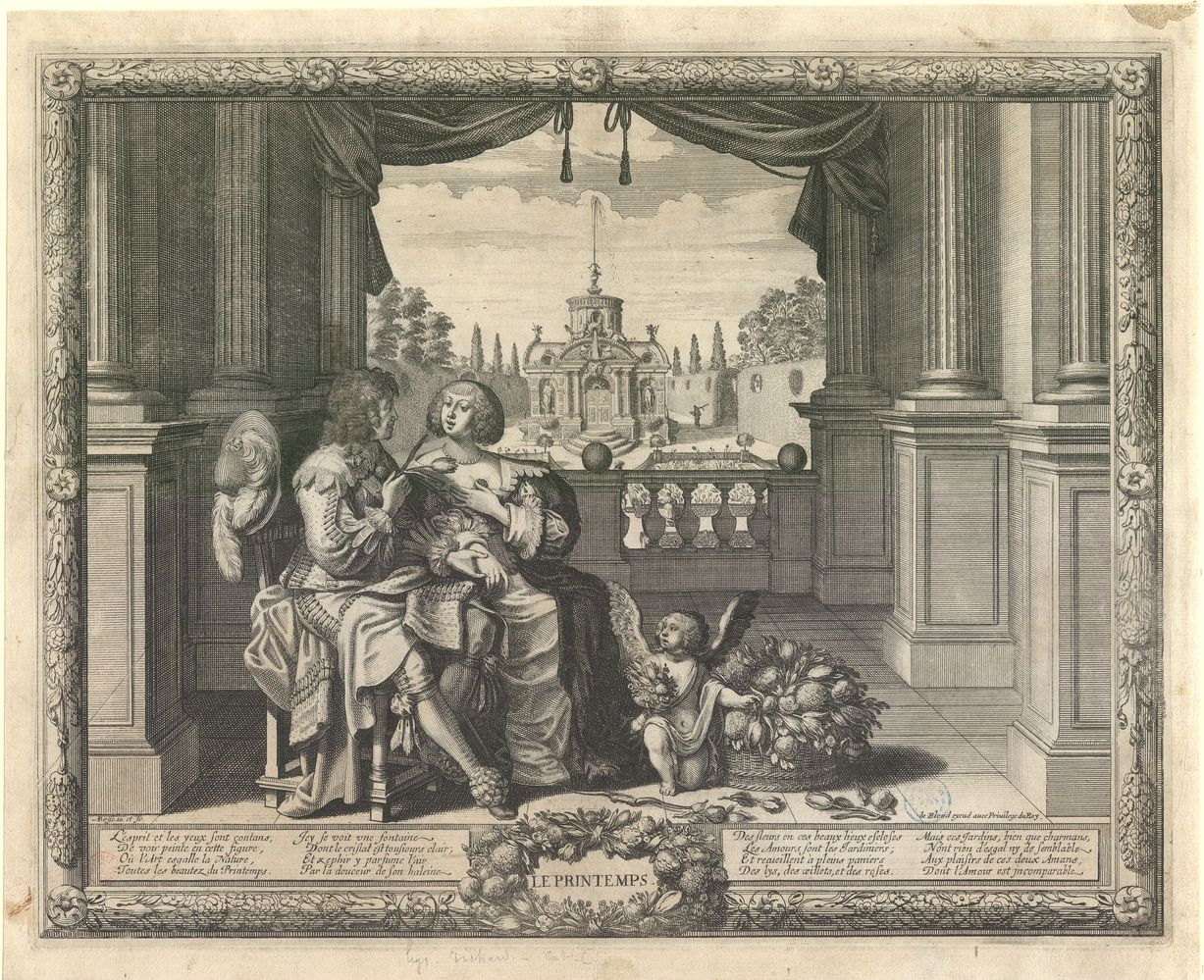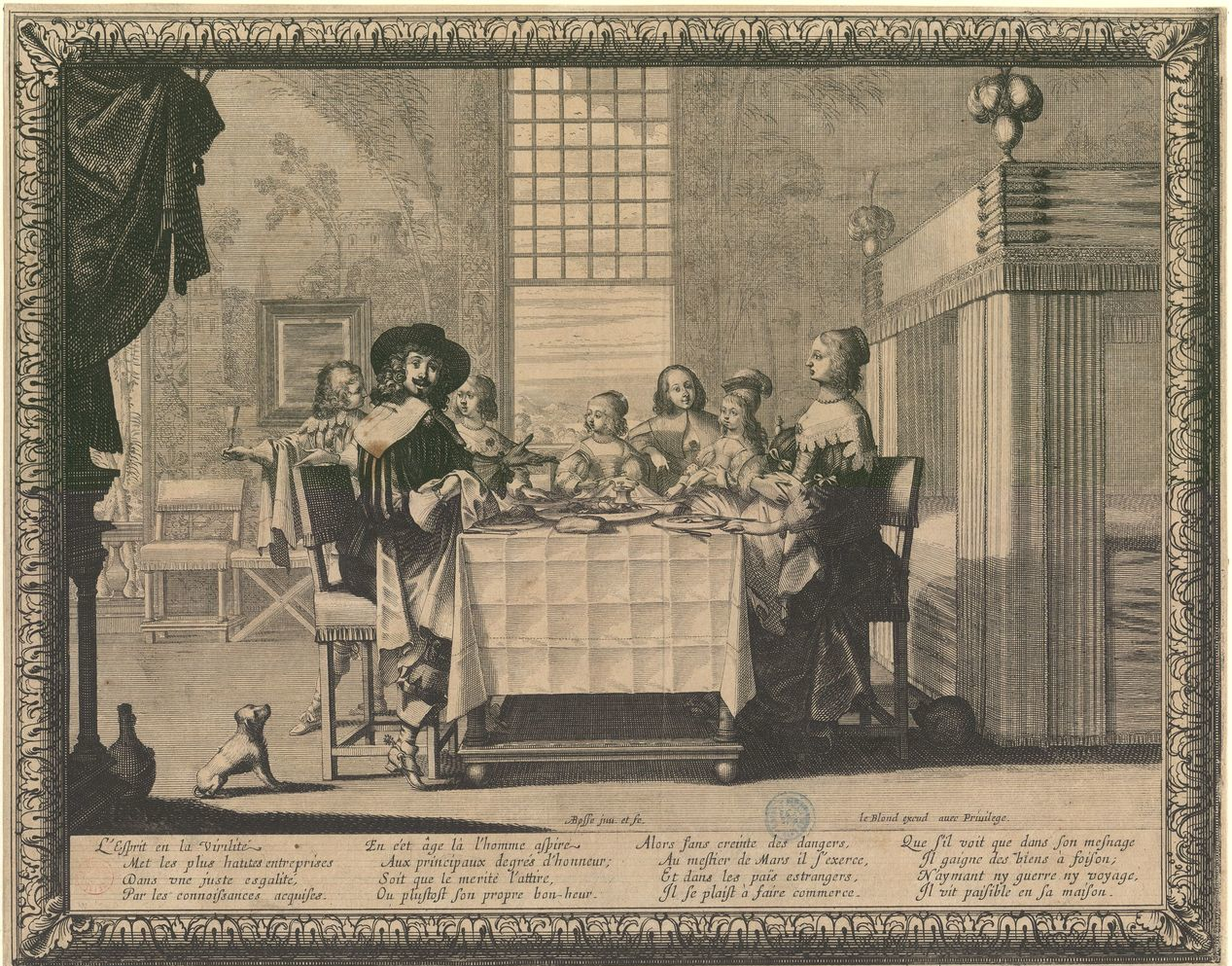1. — La Situation Internationale
1. La phase démocratico-pacifiste
Ce qui frappe surtout lorsqu’on considère l’état politique international actuel, c’est le début d’une phase démocratico-pacifiste.
Ce zigzag de la politique de la bourgeoisie avait été prédit par le 4e Congrès de l’IC qui se tint à l’apogée de la réaction universelle.
Cette apparence de phase démocratico-pacifiste est à l’heure actuelle caractérisée par les faits suivants :
En Angleterre un gouvernement soi-disant «travailliste» ayant à sa tête les chefs de la 2e Internationale, est au pouvoir. En France, les élections ont donné la victoire au bloc des gauches et le Parti Socialiste, un des plus importants de la 2e Internationale, est pratiquement une partie intégrante du gouvernement.
En Allemagne, la propagande pour le rapport des experts dénote une tendance au renforcement des illusions démocratico-pacifistes et de la social-démocratie, interprète de cette politique ; par contre les classes dominantes prétendent se servir de ce rapport des experts et de la social-démocratie pour redoubler de cynisme et de brutalité dans l’exploitation des travailleurs et la répression du mouvement révolutionnaire.
La social-démocratie demeure, sous quelque aspect que ce soit, un Parti collaborant au pouvoir avec la bourgeoisie et, d’une façon ou de l’autre, consolidant la dictature de la bourgeoisie sur le prolétariat.
En Allemagne, malgré le résultat des élections parlementaires, qui ont fortifié les deux ailes extrêmes, un gouvernement d’opinion moyenne reste au pouvoir, s’appuyant également en fait sur la social-démocratie qui sous des aspects divers demeure un Parti gouvernemental de la bourgeoisie et coopère, d’une façon ou d’une autre, à l’exercice de sa dictature contre le prolétariat.
En Amérique a triomphé l’aile démocratico-pacifiste de l’impérialisme, qui consent à intervenir dans les affaires européennes et est prête soutenir les conclusions des Experts. Le mouvement croissant pour la formation d’un tiers Parti petit-bourgeois donne également une idée du progrès des dispositions démocratico- pacifistes.
Au Japon, la bourgeoisie «démocratique» marche également à la conquête du pouvoir et se prépare à remplacer au gouvernail le Parti féodal. Le changement récent de gouvernement est aussi interprété comme une victoire de la «démocratie» et du pacifisme.
Au Danemark, un gouvernement soi-disant ouvrier, ayant à sa tête un des représentants les plus en vue de la 2 e Internationale, est au pouvoir.
En Belgique, les prochaines élections peuvent amener au pouvoir les chefs du Parti «ouvrier» qui sont déjà de fait ministres sans portefeuille.
En Autriche, la social-démocratie a remporté une grande victoire électorale et elle constitue pratiquement une des colonnes du régime bourgeois.
En Tchécoslovaquie, en Pologne et aussi particulièrement dans des Balkans, où la bourgeoisie est sous la dépendance des impérialistes des grandes puissances de l’Entente, s’annonce la répercussion des changements qui ont eu lieu en Angleterre et en France.
2. Le sens réel de l’étape actuelle de la politique internationale
En réalité ce qui se passe n’est nullement l’aurore d’une stabilisation de l’ordre capitaliste consolidé fondé sur la «démocratie» et la paix. C’est seulement un paravent avec lequel la réaction, bourgeoisie universelle exacerbée trompe une fois de plus le peuple.
Non seulement la phase « démocratico-pacifiste » n’a pas abouti et ne peut aboutir à la réduction des armements, mais ces armements ne font que croître avec une vitesse effrayante. Les intrigues de la diplomatie secrète sont plus florissantes que jamais. Chaque démocratie s’arme plus ou moins ouvertement en vue de conflits impérialistes inconciliables avec une démocratie « amie ».
Le conflit fondamental entre les impérialismes américain et japonais n’est nullement réglé. Le mobile intérieur de ce conflit, qui amènera nécessairement à une nouvelle explosion de guerres impérialistes, continue son action mécanique.
Les oppositions d’intérêts entre les coteries impérialistes d’Angleterre et de France ne sont nullement résolues par la victoire de la «démocratie» dans l’un et l’autre pays. Il n’y a que la forme de changée.
Le pillage des colonies et des pays semi-coloniaux demeure la condition naturelle du «progrès», et de la «civilisation».
3. La conclusion des experts
L’Évangile du «pacifisme» et de la «démocratie» contemporains ce sont les conclusions des experts. En réalité ce document a pour but l’exploitation des travailleurs d’Allemagne et constitue une tentative d’impérialistes, bien encore ennemis, pour rétablir leurs affaires aux dépens des travailleurs de leurs propres pays.
L’occupation de la Ruhr n’a pas abouti au résultat attendu par les impérialistes français. Le pillage déclaré n’a pas réussi.
La seule issue aux problèmes des réparations est dans un détroussement prolongé, couvert sous des phrases démocratico- pacifistes.
C’est à quoi procèdent les impérialistes de l’Entente, soutenu par les éléments les plus intéressés de la bourgeoisie allemande et par la social-démocratie au service de la bourgeoisie.
Les conclusions des experts, auxquelles se rallie toute la social-démocratie internationale contre-révolutionnaire, sont véritablement le document le plus honteux de notre temps. C’est la corde au cou des travailleurs non seulement d’Allemagne, mais de nombre d’autres pays.
En appuyant les conclusions des experts, la social-démocratie ne trahit pas moins la cause ouvrière que lors de la guerre impérialiste, car les conclusions des experts ne sont que la continuation de la guerre par d’autres moyens.
Les conclusions des experts même si elles reçoivent un commencement d’exécution, ne peuvent en aucune façon résoudre les conflits d’intérêts entre les divers groupements impérialistes. Ces d’intérêts ne tentent de s’accorder actuellement sur le papier que pour s’entrechoquer avec une force décuplée à bref délai.
4. La situation internationale de l’URSS
La seule contrée qui poursuive systématiquement et jusqu’au bout sa politique de paix, c’est l’URSS. Le premier pays où la Révolution prolétarienne a triomphé, entouré de tous côtés d’ennemis bourgeois, poursuit héroïquement et infatigablement une politique de paix.
Pendant la période qui vient de s’écouler, l’URSS a sensiblement fortifié sa situation internationale. La prospérité croissante à l’intérieur, l’appui de tout ce qu’il y a de honnête et de conscient dans la classe ouvrière internationale et l’habile politique du gouvernement soviétique ont conduit à la reconnaissance de [illisible] de l’URSS par quelques-uns des États les plus puissants du monde.
Cependant c’est pas impossible que précisément cette phase démocratico-pacifiste soit marquée pour le premier État prolétarien par de nouvelles difficultés, est hors de doute que la fraction la plus traîtresse de la « démocratie » travaille actuellement à constituer en politique internationale un front unique contre l’URSS pour mettre à genoux la Révolution prolétarienne victorieuse et la forcer à payer les vieilles dettes du tsarisme, soit sous une forme analogue aux conclusions des experts, soit sous une autre.
Il ne faut pas oublier que l’ère démocratico-pacifiste est une des dernières phases du capitalisme, plus la position devient difficile pour la bourgeoisie internationale, et plus une aventure militaire contre l’URSS devient vraisemblable.
La participation des social-démocrates aux gouvernements «démocratiques» ne fait qu’augmenter le danger. Les chefs contre- révolutionnaires de la social-démocratie dans leur haine sans borne des Soviets, se résoudront encore plus vite une aventure militaire que certains bourgeois.
La classe ouvrière doit être prête à ce que la réaction qui opère aujourd’hui sous le pavillon du pacifisme «démocratique» arrive à créer ce front unique contre l’URSS Les ouvriers du monde entier lutteront avec un dévouement sans réserve contre cet politique des classes dominantes et feront le nécessaire pour briser la chaîne avant qu’elle se soude.
5. La politique internationale de la social-démocratie
La social-démocratie contre-révolutionnaire, qui au mois d’août 1919 a dû jeter le masque et soutenir ouvertement dans chaque pays sa bourgeoisie, suit aujourd’hui la même politique sous une forme déguisée. Partout où elle est une force importante elle soutient comme par le passé «ses» impérialistes, en masquant cette trahison des mots sonores de démocratie et de
Ce sont les chefs de la social-démocratie qui sont actuellement des partisans les plus ardents et des conclusions des experts, et d’un nouvel isolément de l’URSS, avec même attaque directe du capital international contre la première Révolution prolétarienne du monde.
Cependant pour endormir la vigilance des masses ils prodiguent dans leurs Congrès les phrases mensongères sur la grève générale, comme moyen d’empêcher la guerre.
Entre les chefs politiques de la bourgeoisie et ceux de la Social-démocratie contre-révolutionnaire il y a seulement division du travail : les premiers créent une apparence d’ère démocratico-pacifiste, les seconds tâchent de développer les illusions « démocratico-pacifistes » au sein des classes laborieuses.
2. — Le Problème du Pouvoir
1. L’ébranlement du régime bourgeois
Le régime bourgeois a pour un certain laps de temps sauvé son existence, bien que la première guerre impérialiste mondiale ait provoqué sur la fin une immense explosion de mécontentement populaire spontané. Les forces du prolétariat international n’étaient pas suffisamment organisées. Les Partis de coup d’État prolétarien étaient trop faibles et c’est pourquoi la victoire de la révolution prolétarienne à la fin de la guerre impérialiste était impossible.
Mais cette guerre n’en a pas moins causé des secousses profondes.
Ses suites se manifesteront encore pendant bien des années. Ses conséquences sociales et politiques ne sont encore qu’esquissées.
Les traités impérialistes n’ont été, comme l’occupation de la Ruhr l’a montré, qu’une continuation de la guerre avec d’autres moyens ; ils n’ont pas guéri les blessures faites par la guerre. Les conséquences de la guerre ne sont pas écartées et ne le seront pas par les méthodes capitalistes.
En tout cas, à la suite de la première guerre impérialiste mondiale, le régime capitaliste apparaît sapé et ébranlé à la fois économiquement et politiquement. Les symptômes de la fragilité du capitalisme se montrent parfois avec une évidence plus frappante encore dans la politique que dans l’économie.
Le changement rapide et incessant des gouvernements est un de ces symptômes. Dans maints pays le problème du pouvoir est à l’ordre du jour, sous une forme inconnue avant la guerre.
2. Les deux politiques de la bourgeoisie
L’après-guerre et en partie la période qui la précéda ont révélé deux tendances politiques de la bourgeoisie : L’une franchement réactionnaire et l’autre démocratico-réformiste. L’incarnation la plus marquante de la première est Poincaré et de la seconde Lloyd George.
Dans ces années de crise révolutionnaire, ce phénomène n’est pas fortuit. Quand le sol tremble sous les pieds de la bourgeoisie, quand l’ère «normale» de sa domination stable entre dans le passé, quand les évènements révolutionnaires s’annoncent manifestement et les forces du coup d’État prolétarien grandissent, deux systèmes de politique doivent nécessairement se présenter aux chefs de la classe dominante : l’un qui voudrait écraser et réprimer les forces révolutionnaires avant qu’elles aient grandi, par une furieuse campagne contre elles ; l’autre, a plus longues vues, qui au moyen de petites concessions, en corrompant les dirigeants de la classe ouvrière, en un mot par la démocratie, le pacifisme et le réformisme, s’efforce de modifier le rapport des forces en faveur de la bourgeoisie.
3. Entre la social-démocratie et le fascisme
La bourgeoisie ne peux plus gouverner avec les anciennes méthodes. C’est un des symptômes de l’approche lente, mais sûre, de la révolution prolétarienne. La bourgeoisie a recours tantôt aux bons offices du fascisme et tantôt a ceux de la social-démocratie. Dans les deux cas, elle tâche de masquer le caractère capitaliste de sa domination et de lui donner des traits plus ou moins «populaires».
Fascistes (première période de Mussolini) et social-démocrates (première période de Noske) servent la bourgeoisie en tant qu’organisation de combat, bandes armées, troupes de choc contre l’armée prolétarienne naissante.
Avec l’aide du fascisme et de la social-démocratie, la bourgeoisie essaye de regrouper les forces sociales en fabriquant l’apparence d’une victoire politique de la petite bourgeoisie et d’une participation du peuple à l’exercice du pouvoir.
4. La social-démocratie, tiers Parti de la bourgeoisie
En Amérique il se fait beaucoup de bruit autour de la création d’un tiers Parti de la bourgeoisie (la petite bourgeoisie). En Europe, la social-démocratie est déjà en un certain sens ce tiers Parti.
La chose est particulièrement visible en Angleterre, où, aux deux Partis classiques de la bourgeoisie qui jadis se relevaient pratiquement l’un l’autre au pouvoir, c’est ajouté comme facteur gouvernemental le Labour Party, qui fait en réalité à peu près la politique d’une des ailes de la bourgeoisie. Les chefs traîtres du Labour Party sont appelés à coopérer plusieurs années, sous une forme ou sous une autre, à l’exercice du pouvoir de la bourgeoisie.
Il est également hors de doute qu’en France, en Angleterre et dans beaucoup d’autres pays, les leaders de la 2e Internationale jouent le rôle de misérables bourgeois et sont pratiquement à la tête d’une fraction de la bourgeoisie «démocratique».
Depuis longtemps déjà l’aile droite du mouvement ouvrier, dégénère de plus en plus en aile gauche de la bourgeoisie et par endroits en aile du fascisme. C’est pourquoi il est historiquement faux de parler de victoire du fascisme sur la social-démocratie. Le fascisme et la social-démocratie (dans la mesure où il s’agit des dirigeants) sont la main droite et la main gauche du capitalisme contemporain ébranlé par la première guerre impérialiste mondiale et par les premières révoltes des travailleurs.
5. La social-démocratie de nouveau au pouvoir
Pendant la guerre et immédiatement après la guerre nous avons vu les leaders de la 2e Internationale au pouvoir dans un certain nombre de pays. Le fait s’expliquait par le besoin pratique brutal des impérialistes d’opposer le mouvement ouvrier des pays ennemis.
À l’heure actuelle la bourgeoisie invite les chefs de la social-démocratie à partager le pouvoir pour la seconde fois. En situation «normale» et sans guerre, ce phénomène témoigne de l’instabilité de l’hégémonie bourgeoise, de colossales anormalités et de terribles crises que recèle pour la bourgeoisie cette situation normale.
6. Entre la terreur blanche et les «gouvernements ouvriers»
Malgré une apparence de consolidation du régime bourgeois sa puissance est en réalité de plus en plus minée. La position devient de plus en plus instable. Le parlementarisme vit ses derniers moments.
Sur les ruines du vieux parlementarisme, la bourgeoisie a de plus en plus de peine à bâtir un équilibre tant soit peu solide. Les dernières élections en France et en Allemagne en sont une illustration : voilà deux Parlements bourgeois de deux grands États d’Europe qui n’ont pas de majorité stable. La bourgeoisie sera ballottée d’un côté à l’autre de la terreur blanche au «gouvernement ouvrier».
Il peut arriver que dans un avenir prochain nous voyons des «gouvernements ouvriers» non pas dans un pays ou dans deux, mais dans beaucoup. Ils seront le résultat de la lutte du prolétariat pour le pouvoir et des hésitations de la bourgeoisie, inévitables dans la période actuelle.
Objectivement, ces «gouvernements ouvriers», peuvent être un progrès en ce sens qu’ils témoigneront de la dislocation progressive du régime bourgeois et du manque de suite dans la politique des classes dominantes. Le gouvernement «ouvrier» contre- révolutionnaire (en réalité, libéral) de McDonald est un progrès.
Mais le rôle des véritables partisans de la révolution prolétarienne doit consister non pas à porter aux nuées de semblables gouvernements «ouvriers», mais à grouper l’armée prolétarienne pour la lutte révolutionnaire intransigeante et franchir au plus vite ce gouvernement soi-disant ouvrier pour faire triompher la dictature du prolétariat.
7. La signification objective et les perspectives probables de la phase démocratico-pacifiste
La signification objective de la phase démocratico-pacifiste que nous traversons consiste en ceci que la bourgeoisie ne peut plus se maintenir au pouvoir au moyen des anciennes méthodes. Elle est l’expression de la faiblesse du régime capitaliste et de son déclin.
Les gouvernements démocratico-pacifistes, actuellement au pouvoir, de même que tous les gouvernements de type analogue qui peuvent y venir, non seulement ne mèneront pas une politique réellement démocratique et pacifique, mais au contraire se teinteront très vite de fascisme. La lutte de classes, loin de se calmer, s’exaspérera encore dans le cadre de cette «démocratie», de ce «pacifisme». L’alternance des régimes (démocratie-fascisme- démocratie) sapera encore plus profondément la base du capitalisme déjà ébranlée.
De chaque changement les masses populaires et, au premier chef, les masses prolétariennes, sortiront enrichies d’expérience politique et plus décidées à la lutte, tandis que la bourgeoisie et les leaders social-démocrates qui la servent en sortiront chaque fois affaiblis, plus démoralisés et perdant davantage la foi en eux-mêmes et en leur politique.
Ainsi croîtront les forces de la Révolution prolétarienne, jusqu’au jour de sa victoire décisive.
3. — La Création de Grands PC, Problème Central de Toute une Époque
1. La crise du capitalisme et le facteur subjectif
Si la bourgeoisie mondiale n’a pas été vaincue au terme de la guerre impérialiste, c’est surtout parce que nous n’avions pas dans les pays décisifs de grands PC capables d’organiser la Révolution et de mener au combat les masses spontanément levées contre les fauteurs de la guerre. Le capitalisme a dû à cette circonstance un certain répit.
À un moment où le capitalisme ne peut plus régner sans la social-démocratie, où le mal qui le mine, bien que chronique, devient de plus en plus irrémédiable, le facteur subjectif c’est-à-dire le degré d’organisation du prolétariat et de son avant-garde, les PC, devient dominant.
2. Aux masses
Le mot d’ordre, lancé par le 3e Congrès Mondial : Aux masses !, reste en vigueur totalement. Les succès remportés par l’IC dans la période écoulée n’en sont que les premiers fruits. Certaines Sections ne les ont pas encore consolidés, et si, dans la conquête des masses, nous n’avançons pas, nous pouvons facilement reculer.
3. La conquête de la majorité
Le 3e et 4e Congrès s’expriment de la façon suivante au sujet de la conquête de la majorité :
«§3. La conquête de la majorité :
Dans ces conditions, l’indication fondamentale du e Congrès Mondial : «Conquérir une influence communiste dans la majorité de la classe ouvrière et mener au combat la partie décisive de cette classes», subsiste dans toute sa force.
La conception suivant laquelle, dans l’équilibre instable actuel de la société bourgeoise, la plus grave crise peut subitement éclater par suite d’une grande grève, d’un soulèvement colonial, d’une nouvelle guerre, ou même d’une crise parlementaire, garde toute sa force aujourd’hui encore plus qu’à l’époque du 3e Congrès.
Mais c’est précisément pour cela que le facteur «subjectif» c’est-à-dire le degré de conscience, de volonté, de combat et d’organisation de la classe ouvrière et son avant-garde, acquiert une importance énorme.
La majorité de la classe ouvrière d’Amérique et d’Europe doit être gagnée ; c’est la tâche essentielle de l’IC à présent comme auparavant.
Dans les pays coloniaux et semi-coloniaux l’IC a deux tâches : 1) créer un noyau de PC qui défend les intérêts généraux du prolétariat, et 2) appuyer de sautes ses forces le mouvement national révolutionnaire dirigé contre l’impérialisme, devenir l’avant-garde de ce mouvement et mettre en relief et renforcer le mouvement social au sein du mouvement national.
Le 5e Congrès confirme intégralement les formules des 3e et 4e Congrès. Il repousse catégoriquement comme erronées, d’une part, les tendances de droite qui exigent la conquête préalable de la majorité statistique de toute la classe ouvrière et estime ne saurait être question de batailles révolutionnaires sérieuses avant l’acquisition au communisme de 99 % des travailleurs ; et d’autre part, l’opinion de l’extrême-gauche qui n’a pas encore compris la portée universelle et décisive du mot d’ordre : Aux masses !
Et, qui a l’air parfois de croire que les PC peuvent être des organisations d’une minorité prolétarienne terroriste et que, sans embrasser les masses ; ils peuvent les conduire au combat n’importe quand.
4.— Les Conditions de la Formation de PC de Masse
Ces conditions sont les suivantes :
§1. La construction du Parti sur la base des Cellules d’usines. L’immense majorité des PC d’Europe conserve les vieux principes d’organisation, empruntés à la social-démocratie. C’est le vestige d’une époque où le Parti était considéré comme une machine électorale auxiliaire. II ne peut être question de créer un PC de masses sérieux et solide tant que ce Parti n’a pas à sa base des Cellules dans les entreprises mêmes (la même remarque se rapporte aux jeunesses, aux femmes, etc…)
Ce n’est pas seulement une question d’organisation, c’est une question profondément politique. Aucun PC ne pourra mener au combat des masses prolétariennes décisives ni vaincre la bourgeoisie tant qu’il n’aura pas une base solide à l’usine et tant que chaque grande entreprise ne sera devenue une citadelle du PC
§2. L’action communiste à l’intérieur des syndicats. La formation effective, et non-verbale, d’un réseau de fractions communistes dans les syndicats (légalement si possible, illégalement là où il le faut), une campagne systématique, prolongée pendant des années pour la conquête des syndicats, la réponse à l’invitation des leaders social-démocrates à la scission et à la désertion par un effort encore plus grand d’unité au sein même des syndicats, voilà encore des prémices essentielles de la formation de PC de masses solides.
§3. La Fondation des Comités d’usines. Le mouvement des Comités d’usines est une nouvelle forme d’organisation du prolétariat, dont il sortira peu à peu de nouveaux syndicats réellement révolutionnaires et qui, dans des circonstances favorables, servira d’embryon aux Soviets de députés ouvriers. Le PC qui n’a pas encore réussi à faire naître un sérieux mouvement de Comités d’usines ou à conquérir une influence importante dans le mouvement déjà existant, ne peut être considéré comme un PC de masse.
La solution des problèmes énumérés dans ces 5 paragraphes constitue la condition essentielle et élémentaire de l’existence de grands PC Il est impossible autrement d’aborder sérieusement les autres questions de la politique communiste.
§4. Le Parti et les paysans. Non seulement dans les pays agraires et semi-agraires, mais aussi dans les pays typiquement industriels, la crise provoquée par la guerre impérialiste a rendu des fractions importantes de la population paysanne beaucoup plus accessible aux idées révolutionnaires des communistes.
Le prolétariat ne peut vaincre ni édifier le régime des Soviets s’il n’a pas, longtemps avant, travaillé à neutraliser certains éléments de la classe paysanne et à gagner les sympathies de certains autres. Les PC qui veulent devenir de grands Partis révolutionnaires ne peuvent se contenter d’avoir des thèses sur la question paysanne, ils doivent savoir établir un contact vivant entre l’avant-garde prolétarienne et l’élite des paysans.
Ce contact (qui présente une énorme importance pour leur liaison avec l’armée recrutée surtout parmi les paysans) peut être obtenu principalement par l’intermédiaire des ouvriers. Il faut prendre pour règle que les ouvriers révolutionnaires des entreprises où les communistes jouissent d’une grande influence envoient systématiquement dans les campagnes de grandes délégations et recueillent pour cela les ressources matérielles nécessaires. Le manque d’attention pour question paysanne est un vestige de social-démocratie.
Les PC qui n’ont pas su organiser l’action révolutionnaire chez les paysans ne peuvent être reconnus comme des Partis de masse posant sérieusement la question de la conquête du pouvoir. II va de soi que nos Sections n’en demeurent pas moins des Partis ouvriers marxistes et ne doivent pas dégénérer en Partis ouvriers et paysans.
§5. La question des nationalités. Dans un certain nombre de pays, le partage du monde, effectué après la guerre impérialiste, a renforcé l’oppression et l’enchevêtrement des nationalités. En Europe, et plus encore dans les colonies et semi-colonies, s’est accumulée une quantité de matières explosives capables de faire sauter la domination bourgeoise.
Une bonne politique des communistes dans la question nationale, telle qu’elle est fondée en détail dans les thèses du 2e Congrès Mondial, est une des parties essentielles de la conquête des masses et de la préparation d’une révolution victorieuse. Le nihilisme et les déviations opportunistes dont font preuve à l’égard de la question coloniale un certain nombre de PC est le point faible de ces Partis qui, s’ils persistent dans leur erreur, ne pourront jamais remplir leur mission historique.
5. — Entre Deux Vagues de la Révolution Prolétarienne
Au cours de l’année dernière ont apparu les premiers indices d’une nouvelle vague révolutionnaire. Les combats d’Allemagne, les insurrections de Bulgarie et de Pologne, les grandes grèves économiques de plusieurs autres pays, annoncent de nouveaux événements révolutionnaires.
Ce sont précisément les époques intermédiaires entre deux révolutions ou entre deux vagues révolutionnaires qui sont d’ordinaire grosses de déviations opportunistes vers la droite et de déviations d’extrême-gauche vers une passivité cachée sous le radicalisme des mots, vers un menchévisme à rebours.
6. — Guerre Sans Merci aux Déviations Opportunistes de Droite
La période écoulée entre le 4 e et le 5 e Congrès a montré des déviations opportunistes, dans le mouvement communiste, plus fortes qu’on n’aurait pu le soupçonner. Un certain nombre de Sections, venues de la social-démocratie, en ont apporté des résidus de traditions non encore effacées. À mesure que les Partis de l’IC deviennent des Partis de masse, les déviations de droite peuvent être plus dangereuses.
Au Congrès, le fait s’est définitivement éclairci que, dans certains des pays les plus importants pour le mouvement ouvrier, les représentants de la droite ont essayé de déformer la tactique du front unique et du gouvernement ouvrier et paysan en l’interprétant comme une étroite alliance politique, comme une coalition organique de «tous les Partis ouvriers», c’est-à-dire comme l’union politique des communistes avec la social-démocratie.
Pour l’IC, la tactique du front unique avait pour but principal de combattre les chefs de la social-démocratie contre-révolutionnaire et de libérer les ouvriers social-démocrates de leur influence ; la droite l’a interprétée comme équivalant à une union politique avec la social-démocratie.
Le Congrès condamne résolument cette déviation petite- bourgeoise, repousse catégoriquement l’altération de la tactique du front unique qui s’est marquée dans plusieurs Sections et déclare qu’il combattra sans merci cette politique radicalement contraire aux décisions de l’IC.
7. — Les Déviations d’Extrême-gauche
Le bolchévisme s’est constitué dans une lutte acharnée non seulement contre le menchévisme et le centrisme, mais aussi contre les déviations d’extrême-gauche. L’IC, organisation internationale du bolchévisme, fait dès ses premiers jours une guerre impitoyable à la fois à l’opportunisme de droite et aux déviations d’extrême-gauche qui souvent ne sont que le revers de l’opportunisme.
Entre le 4 e et le 5 e Congrès, les déviations d’«extrême-gauche» ont revêtu un aspect particulièrement dangereux dans la question du travail dans les syndicats réactionnaires. Le mouvement en faveur de l’abandon des syndicats est gros de dangers immenses pour le communisme.
Si l’IC ne donne pas une riposte catégorique à ces tendances qui font uniquement le jeu des chefs contre-révolutionnaires de la social-démocratie, désireux d’être débarrassés de la présence des communistes dans les syndicats, nous n’aurons jamais de Partis véritablement bolchéviks.
Les déviations d’ «extrême-gauche» se sont manifestées également dans le rejet par principe de la manœuvre en général et, en particulier, dans l’incompréhension de la tactique du front unique, dans une mauvaise volonté à la mettre en pratique, ou bien dans son admission seulement en matière économique et pas en politique, etc.
Mais la manœuvre ne doit naturellement pas donner prétexte à méthodes opportunistes.
Tout en combattant sans merci les déviations opportunistes de droite, l’IC doit systématiquement expliquer la terreur et la nocivité de la déviation d’«extrême-gauche», hostile la création de Partis de masses aptes à la manœuvre.
8. — La Tactique du Front Unique
En dépit de grandes erreurs opportunistes et de sa déformation par la droite au point d’entraîner parfois une dégénération des PC, la tactique du front unique, entre le 4e et le 5e Congrès de l’IC, a en somme été utile et nous a rapprochés de la transformation de plusieurs Sections en grands Partis.
Pendant la période où les PC des principaux pays restent en minorité, où la social-démocratie, par suite de toutes sortes de circonstances historiques, entraîne encore à sa suite une fraction considérable du prolétariat, où l’offensive capitaliste continue sous une forme ou sous une autre, où la classe ouvrière n’a pas encore la force même de se défendre sérieusement, la tactique du front unique était et demeure absolument juste et indispensable.
L’expérience de la tactique du front unique, à laquelle l’IC a déjà fait allusion, demeure et il est apparu que de simples formules ne mènent plus à rien, que, dans la période actuelle, les Partis de l’IC ne peuvent rien entreprendre avec la tactique du front unique en soi et que cette tactique, de méthode bolchévique et révolutionnaire, menace de se changer en tactique opportuniste et en source de révisionnisme.
La tactique du front unique est simplement un moyen d’agiter et de mobiliser les masses pour toute une période. Vouloir interpréter cette tactique comme une coalition politique avec la social-démocratie contre-révolutionnaire, c’est un opportunisme repoussé par l’IC.
La tactique révolutionnaire du front unique n’est justement appliquée que si chaque Section, en pleine conscience de ses dangers et sans adopter des formules mécaniques, se propose concrètement de mobiliser les masses pour certains buts et revendications partiels, de les organiser, pour toujours s’orienter sur la révolution et l’entraînement au combat de la majorité des couches décisives du prolétariat afin de réaliser enfin l’assaut à la bourgeoisie.
1. La tactique du front unique par en bas est nécessaire toujours et partout, à l’exception peut-être des rares moments de lutte décisive où les ouvriers révolutionnaires communistes doivent tourner leurs armes même contre les groupes du prolétariat qui, dans leur inconscience, se battent contre nous. Mais même dans ces moments exceptionnels, il faut faire tout son possible pour réaliser l’unité par en bas avec les ouvriers qui ne marchent pas encore avec les communistes. L’expérience de la révolution russe et de la lutte révolutionnaire en Allemagne a montré que cela est possible.
2. L’unité par en bas et les pourparlers par en haut à la fois sont une méthode à employer assez souvent dans les pays où la social- démocratie est encore une force. Ces pourparlers avec les chefs ne doivent pas lier l’indépendance communiste du Parti. Ici la base doit encore être l’unité par en bas. L’appel aux organes officiels de la social-démocratie (lettres ouvertes, etc.) ne doit pas devenir une routine.
Le principal est de créer au préalable parmi les ouvriers (y compris les ouvriers social-démocrates) un état d’esprit favorable à l’action projetée, à la campagne à entamer pour, après seulement, s’adresser aux organes officiels de la social-démocratie, les placer ainsi en face du fait accompli d’une classe ouvrière déterminée ou, s’ils refusent de la soutenir, les démasquer devant les masses.
Il va de soi que les PC doivent conserver leur pleine et entière indépendance et, à tout moment des pourparlers, leur physionomie communiste. À cet effet, tous les pourparlers avec les dirigeants social-démocrates doivent être menés à découvert et les communistes doivent tout faire pour fixer sur eux l’attention des ouvriers.
3. L’unité seulement par en haut est une méthode que l’IC repousse catégoriquement et résolument.
Le plus important est le front unique par en bas, c’est-à-dire l’union réalisée, sous la direction du PC, entre les ouvriers communistes, social-démocrates et sans-Parti d’une entreprise, d’un Comité d’usine, d’un syndicat, d’un seul centre industriel ou de toute une région, d’une profession ou de tout le pays, etc.
Il va de soi que la tactique du front unique peut et doit varier avec la situation concrète de chaque pays et de chaque période. Une application routinière et globale la priverait de toute signification, la transformerait en son contraire.
En concrétisant les méthodes tactiques, il faut tenir compte de toute la situation du pays, de sa structure, de l’état de la Section en portant le centre de gravité sur la mobilisation des masses par en bas, la création d’organes de combat, la liaison avec les principaux éléments des masses laborieuses (prolétariat, paysans, ouvriers agricoles) qui doivent être appelés au combat.
La tactique du front unique a été et reste une méthode de révolution et non d’évolution pacifique. Elle a été et reste une tactique de manœuvre stratégique révolutionnaire de l’avant-garde communiste entourée d’ennemis et luttant tout d’abord contre les chefs traîtres de la social-démocratie contre-révolutionnaire ; elle n’est en aucun cas une tactique d’alliance avec eux.
Elle a été et reste une tactique consistant à gagner progressivement à notre cause les ouvriers social-démocrates et les meilleurs des sans-parti, mais en aucun cas à rabaisser nos objectifs au degré de compréhension des ouvriers.
9. — Le Gouvernement Ouvrier et Paysan
Le mot d’ordre du gouvernement ouvrier et paysan a été et est encore compris par l’IC comme une déduction de la tactique du front unique dans l’acception ci-dessus indiquée.
Les éléments opportunistes de l’IC ont essayé, dans la période écoulée, d’altérer non seulement le mot d’ordre du front unique, mais aussi celui du gouvernement ouvrier et paysan, en l’interprétant comme un gouvernement «dans le cadre de la démocratie bourgeoise », comme une alliance politique avec la social-démocratie.
Le 5e Congrès Mondial repousse catégoriquement une telle interprétation. Le mot d’ordre du gouvernement ouvrier et paysan est, pour l’IC, traduit dans la langue de la révolution, dans la langue du peuple, la dictature du prolétariat. La formule du gouvernement ouvrier et paysan, née de l’expérience de la Révolution russe, a été et ne peut être qu’un moyen d’agiter et de mobiliser les masses en vue du renversement révolutionnaire de la bourgeoisie et de l’instauration du régime soviétiste.
Pour former un gouvernement véritablement ouvrier ou ouvrier et paysan, il faut avant tout renverser la bourgeoisie, qui actuellement détient partout le pouvoir, sauf dans l’URSS. Abattre et mettre hors d’état de nuire la bourgeoisie, réprimer sa résistance et créer les prémisses réelles d’un véritable gouvernement ouvrier et paysan, tout cela n’est possible que par le soulèvement armé du prolétariat entraînant les meilleurs des paysans, et par la victoire de travailleurs dans la guerre civile.
Le mot d’ordre du gouvernement ouvrier et paysan a été et demeure la formule pour aborder les masses, l’ensemble des travailleurs.
Dans la période présente, où les chefs social-démocrates s’engagent de plus en plus dans des combinaisons gouvernementales avec la bourgeoisie, tandis que les ouvriers qui suivent encore la social-démocratie sont aux prises avec une misère de plus en plus profonde, il se crée une situation qui est souvent très favorable à l’application de la tactique du front unique et du gouvernement ouvrier et paysan.
Si, précisément dans la période où la social-démocratie officielle devient le «tiers parti » gouvernemental de la bourgeoisie et où ses chefs s’enfoncent de plus en plus dans les combinaisons gouvernementales de la bourgeoisie, nous réussissons, nous autres communistes, par un habile emploi de tactique du front unique, à entraîner un nombre considérable d’ouvriers social-démocrates d’abord dans les combats économiques, puis dans les combats politiques côte à côte avec nous, nous obtiendrons par là même une conjoncture on ne peut plus propre à ruiner l’influence de la social-démocratie et à attirer au communisme de nombreux éléments travailleurs.
Le mot d’ordre du gouvernement ouvrier et paysan n’est en aucun cas, pour les communistes, une tactique d’accords et de transactions parlementaires avec les social-démocrates.
Bien au contraire, l’activité parlementaire des communistes doit, elle aussi, avoir pour objet de démasquer le rôle contre-révolutionnaire de la social-démocratie et d’expliquer aux travailleurs la falsification et l’imposture des gouvernements «ouvriers » créés par la bourgeoisie et qui ne sont en réalité que des gouvernements bourgeois libéraux.
10. — Revendications Partielles
La tactique de l’IC non seulement n’exclut pas, mais sous-entend l’emploi, dans notre agitation et dans notre politique, des revendications partielles. Il faut seulement ne pas perdre de vue trois circonstances :
a) les revendications partielles que nous formulons doivent être vivantes, c’est-à-dire pouvoir être soutenues par les travailleurs ;
b) elles doivent être dans la ligne de la révolution ;
c) elles doivent toujours être rattachées au but final ; nous devons aller du particulier au général, des revendications partielles à tout le système de revendications dont l’ensemble constitue la révolution sociale.
Tandis que les réformistes formulent les revendications partielles au lieu et place de la Révolution prolétarienne, les communistes s’en servent pour mieux préparer la révolution prolétarienne. Toute l’agitation des communistes en faveur des revendications partielles lei de la façon la plus étroite chacune de ces revendications au programme de la Révolution, surtout dans les pays où il y a crise du régime bourgeois.
11. — Les Illusions Démocratico-pacifistes
La situation actuelle engendre inévitablement pour un temps, parmi certains éléments des travailleurs, des illusions démocratico-pacifistes. Les chefs de la social-démocratie feront tout leur possible pour les encourager.
La lutte contre ces illusions, qui sera pour les communistes une des tâches principales de cette période, n’exclut en aucune façon l’application de la tactique du front unique.
Bien au contraire, c’est justement l’application habile de cette tactique (participation des ouvriers social-démocrates à la lutte économique des communistes, revendications politiques élémentaires impossibles cependant à satisfaire pour les gouvernements démocratiques et «ouvriers» qui sera le meilleur moyen de venir à bout des illusions démocratico- pacifistes.
L’application de la tactique du front unique ne sera couronnée de succès qu’à une condition : c’est que les illusions démocratico- pacifistes ne pénétreront pas dans nos rangs et que les communistes ne perdront pas de vue les dangers du front unique et du gouvernement ouvrier et paysan, plus d’une fois signalés par l’IC.
12. — Occident et Orient
L’IC est l’organisation de la Révolution universelle. Cependant un certain nombre de circonstances ont fait que ses efforts ont été trop tournés vers l’Occident. Il est indispensable de porter une attention beaucoup plus grande sur l’Orient, au sens le plus large. Aux Indes, au Japon, en Chine, en Turquie se sont créées les premières Cellules d’un mouvement communiste.
Dans tous ces pays commence une vaste lutte économique des ouvriers. L’IC doit accorder une attention renforcée à ce mouvement et en outre prêter son concours au mouvement de toutes les nationalités opprimées contre l’impérialisme, dans l’esprit de la résolution du 2e Congrès, en se rappelant que ces mouvements sont une partie intégrante du grand mouvement d’affranchissement qui seul peut conduire à la Révolution non seulement en Europe, mais dans le monde.
13. — Deux Perspectives
L’époque de la révolution internationale est ouverte. La vitesse de son développement et en particulier la vitesse de l’évolution révolutionnaire sur tel ou tel continent, dans tel ou tel pays, est impossible à prévoir avec exactitude. Deux perspectives sont possibles : un développement ralenti de la Révolution prolétarienne n’est pas exclu ; d’un autre côté le terrain est à tel point miné sous le capitalisme et ses antagonismes s’exaspèrent avec une telle rapidité que la solution peut intervenir ici ou là à temps très court.
L’IC doit bâtir sa tactique sur ces deux éventualités. Sa manœuvre doit consister à savoir rapidement s’adapter aux changements de vitesse de l’histoire et en tout cas, même si cette vitesse diminue, elle doit rester le grand PC intransigeant de la Révolution prolétarienne et en cette qualité grouper les masses et les former à la lutte révolutionnaire pourvoir.
14. — La Bolchévisation des Partis et la Formation du PC Universel
L’objectif essentiel de cette période de l’IC est la bolchévisation de ses Sections. Ce mot d’ordre ne doit en aucune façon être compris comme la transposition automatique de toute l’expérience du Parti bolchévik aux autres Partis. Les traits essentiels d’un Parti réellement bolchévik se ramènent à ce qui suit :
a) le Parti doit être une véritable organisation de masses, c’est-à- dire, légal ou illégal, se maintenir en contact étroit et indispensable avec les ouvriers et exprimer leurs besoins et leurs espoirs.
b) il doit être capable de manœuvrer, c’est-à-dire ne pas avoir une tactique dogmatique et sectaire, mais employer contre l’ennemi n’importe quel manœuvre stratégique sans cesser de rester lui- même : c’est la faute capitale de nos Partis de souvent ne pas le comprendre ;
c) il doit être un Parti essentiellement révolutionnaire et marxiste, poursuivant irrésistiblement son but dans toutes les circonstances et faisant le maximum d’efforts pour rapprocher l’heure de la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie ;
d) il doit être un Parti centralisé, n’admettant ni fractions, ni tendances, ni groupements, un Parti monolithe fondu d’un seul bloc ;
e) doit se livrer dans l’armée bourgeoise à un travail systématique de propagande et d’organisation.
La bolchévisation des Partis, cela signifie le transfert dans nos Sections de tout ce qui dans le bolchévisme a été et est encore d’une portée internationale.
C’est seulement à mesure que les principales Sections de l’IC se transforment en Partis bolchéviks, que l’IC deviendra vraiment le Parti bolchévik universel pénétré du léninisme.
15. — Objectifs des Principales Sections de l’IC
1. Angleterre. — Dans la situation actuelle, c’est l’Angleterre avec ses possessions qui joue généralement le premier rôle dans toutes les questions internationales. Il s’ensuit que le PC anglais acquiert une importance exceptionnelle.
Mettre ce Parti en état de répondre aux tâches qui lui incombent doit être un des objectifs essentiels de l’IC Le PC anglais, dans ses rapports avec le Gouvernement travailliste, s’est rendu coupable de certaines déviations de doctrine et de tactique. Il doit dans la période qui commence, concentrer ses efforts sur les buts suivants :
a) soutenir et encourager l’aile gauche existant à l’intérieur du Labour Party, de façon à ce qu’il devienne une véritable fraction révolutionnaire, et en même temps développer une action intense au sein de l’opposition syndicale ;
b) combattre dans les masses, clairement et sans ambiguïté le «Gouvernement ouvrier» de McDonald en démasquant son caractère bourgeois hostile la masse ouvrière ;
c) dans les élections partielles et dans la prochaine campagne électorale, avoir une ligne communiste nette et bien tranchée ;
d) conduire les conflits économiques de façon à donner la prépondérance aux organes ouvriers du front unique (Comités de grives, conseils d’usines, etc.) et à rendre évident aux ouvriers le sens politique de ces conflits ;
e) engager une active campagne pour créer des Comités d’action dans les entreprises et dans les syndicats, pour que, par leur pression, ils obligent le Gouvernement à réaliser la partie de son programme qui a laissé tomber, à savoir, la socialisation des chemins de fer et des mines, l’augmentation de l’allocation aux chômeurs, la construction de maisons ouvrières, etc..
C’est en démontrant par la misère quotidienne des ouvriers, la trahison du Gouvernement travailliste, c’est en cherchant à gagner les masses au combat pour les buts énumérés plus haut, que le PC détruira les illusions subsistant à l’égard du Gouvernement du Labour Party ;
f) se mettre en liaison avec les colonies, soutenir les mouvements de libération nationale des pays coloniaux, traiter systématiquement les questions du militarisme, du marinisme, du désarmement, des rapports de l’Angleterre avec la Russie soviétiste et la France impérialiste, du rapport des experts ;
g) s’appliquer à s’étendre son influence sur les sans-travail ;
h) travailler à la réforme intérieure du parti, au recrutement de nouveaux membres parmi les ouvriers ; à la constitution de Cellules d’entreprises, l’éducation communiste des membres, à l’extension des connaissances sur le mouvement ouvrier international.
France.— Le Congrès enregistre avec satisfaction les progrès sensibles faits par le Parti français, qui a exclu tous les éléments douteux et devient un véritable Parti du prolétariat.
Cependant il signale au Parti frère de France l’instante nécessité :
a) de créer un véritable appareil, sans lequel l’existence d’un Parti prolétarien est impossible ;
b) de travailler sérieusement les centres industriels particulièrement ceux où, comme l’ont montré les dernières élections, les socialistes jouissent encore d’une grande influence. Paris est indubitablement d’une grande importance, mais on ne saurait songer à la victoire tant que les principaux centres industriels ne seront pas acquis ;
c) de faire un sérieux travail parmi les paysans ;
d) d’appliquer comme il convient la tactique du front unique. Les chefs du socialisme français n’ont pas osé entrer ouvertement dans le gouvernement Herriot, mais ils en font partie en fait. De là la nécessité de changer noire mode d’agitation, tout en restant dans les limites de la tactique du front unique ;
e) d’accorder la plus sérieuse attention à la création de Cellules d’entreprises, sans quoi il ne peut y avoir de PC de masse ;
f) la Seine doit se proposer d’avoir sous peu 25,000 membres. La même campagne de recrutement doit être faite partout ;
g) de faire tout pour créer un vaste mouvement de Comités d’usines ;
h) de venir à bout des vestiges des tendances de droite et de rassembler tout le Parti sous le drapeau au de l’IC en constituant un centre solide et vraiment capable de fonctionner. Tous frottements entre la gauche et l’ancien centre doivent cesser. Tout le Parti doit être une gauche ne faisant qu’un avec l’IC ;
i) de raffermir à tout prix les liaisons internationales et avant tout d’entretenir un contact constant avec le Parti allemand. La grosse industrie française joue un rôle d’une importance toujours croissante dans les antagonismes impérialistes et dans la politique intérieure.
Le PCF a à combattre l’influence croissante de cette grande industrie, avant tout à propos de l’exécution du rapport des experts et en accord étroit avec le Parti allemand.
j) de hâter l’entrée, dans le Parti de tous les éléments communistes murs de la CGTU.
Les chefs de la CGTU doivent prendre une position plus nette contre l’anarchisme et le syndicalisme vulgaire de la vielle école.
Dans cette lutte aucune place ne doit être accordée à la théorie fausse de la neutralité dans les questions fondamentales touchant le communisme.
Il ne faut pas oublier un seul instant que, malgré tous les progrès accomplis, ni le Parti, ni les syndicats révolutionnaires n’ont encore vraiment gagné les masses et consolidé leur influence organiquement, de sortie qu’ils ne sont pas encore l’avant-garde authentique du prolétariat français.
Le mot d’ordre du gouvernement ouvrier et paysan reste particulièrement opportun dans la France contemporaine. La propagande de ce mot d’ordre dans l’esprit du 5e Congrès sera l’axe de toute agitation du PC français.
2. Allemagne. — Dans son essence les perspectives de la Révolution restent les mêmes que celles qui ont été tracées par l’Exécutif en automne 1923. Il se peut que la victoire du pacifisme démocratique en Angleterre et en France redonne une certaine force à la bourgeoisie et à t la social-démocratie d’Allemagne.
Les illusions démocratico-pacifistes venant par ricochet d’Angleterre et de France, peuvent atteindre l’Allemagne. Il n’est pas exclu que les gouvernements de MacDonald et d’Herriot relèvent provisoirement le prestige parlementaire de la social-démocratie allemande et même la remettent en selle.
Tout cela complique la situation politique et rend possible une évolution lente. II n’en est pas moins vrai que la situation internationale de la bourgeoisie et de la social-démocratie allemandes reste absolument désespérée, si disposées qu’elles soient à renier trois fois l’intérêt de la «patrie» et a bénir les Experts. La crise intérieure peut s’aggraver très rapidement. Cela est attesté par les grands combats de classes de ces derniers temps.
La crise du Parti, en somme est surmontée. Mais pour en rendre le retour impossible, le CC actuel doit : d’une main de fer donner la riposte à toute tendance d’abandon des syndicats social-démocrates ; engager tous les militants à appliquer en conscience la tactique de l’IC et du Congrès de Francfort dans les syndicats ; opérer énergiquement et résolument la réorganisation du Parti sur la base des Cellules d’entreprises ; cela rendra des services inappréciables en particulier en cas de travail illégal ; repousser catégoriquement et impitoyablement les tendances qui, sous les masque du radicalisme, veulent introduire dans le Parti le révisionnisme théorique et les déviations menchéviques ; utiliser tous les militants indépendamment de leur appartenance à telle ou telle des anciennes fractions ; appliquer énergiquement et fermement les principes de l’IC sur la question paysanne ; faire de même pour la question nationale ; au travail parlementaire, unir l’intransigeance et la brutalité communiste au savoir faire ; accorder beaucoup plus d’attention au mouvement des Comités d’usines.
Le CEIC et toutes les Sections sœurs doivent offrir au CC du PCA un concours illimité. Dans ces conditions le Parti n’aura aucune difficulté à maîtriser les déviations de droite qui lui ont porté un si grand préjudice et qui ci et là peuvent encore renaître.
3. Tchécoslovaquie. — Les tendances de droite qui en Allemagne sont arrivées a leur terme logique et, par conséquent ont manifesté toute leur inconsistance, ont été observées et s’observent encore clans le Parti tchécoslovaque aussi. Si elles n’y ont pas fait aussi évidemment faillite qu’en Allemagne c’est simplement parce que le cours de la vie politique tchécoslovaque est plus lent. Au sein de I’IC, les Sections prennent connaissance de leurs fautes réciproques et peuvent ainsi les éviter. C’est ce que doit faire le Parti tchécoslovaque, qui est constitué pour la plupart par d’excellents éléments prolétariens, mais qui cependant n’est pas arrivé encore à se transformer en un véritable Parti bolchévik. II lui faut :
a) redresser sa ligne théorique :
b) reconnaître l’erreur des formules qui figurent dans les Résolutions de Prague et de la dernière Conférence de Brunn ;
c) inspirer à tout le Parti l’opinion qu’il ne suffit pas d’embrasser les masses, mais qu’il est nécessaire de les conduire aux luttes partielles révolutionnaires et de les préparer par l’idéologie et l’organisation à la lutte finale ;
d) dans l’application de la tactique du front unique, combattre les tendances de droite et exécuter sans hésitations les décisions du 5 e Congrès ;
e) déployer plus d’activité parmi les paysans’;
f) avoir un programme colonial et pratiquer une politique nationale dans un sens clairement léniniste ;
g) conduire son activité parlementaire dans le sens du parlementarisme révolutionnaire ;
h) raffermir l’activité du CC, rendre la direction plus constante, plus attentive, plus énergique ;
i) renforcer le CC d’éléments nouveaux tirés de l’élite ouvrière ; j) accueillir avec camaraderie et sans préventions les exigences fondées de la minorité manifestées au 5e Congrès, surtout des jeunesses.
=>Retour au dossier sur le cinquième congrès
de l’Internationale Communiste