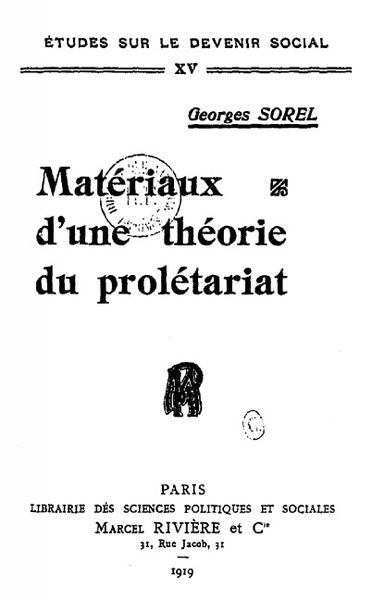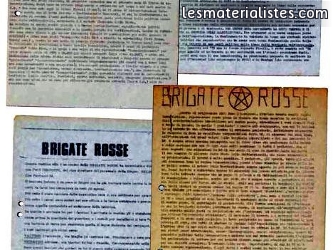[Rome, 17 janvier 1983, les militants des
Brigades Rouges pour la contruction du Parti Communiste Combattant.
Arreni Renato, Bella Enzo, Braghetti
Laura, Gallinari Prospero, Iannelli Maurizio, Novelli Luigi, Padula
Sandro, Pancelli Remo, Petrella Marina, Piccioni Francesco, Ricciardi
Salvatore, Seghetti Bruno.]
Ce n’est pas un hasard si ce procès a été
préparé en toute hâte à la suite de la libération de Dozier, des
trahisons et des arrestations de masse, alors que jusque là, il
semblait ne jamais devoir se dérouler.
L’Etat, qui, avant cela, n’avait pas la force
politique d’affronter le procès du moment le plus significatif de 12
années de lutte armée, saisit l’occasion pour tenter de sanctionner
de façon éclatante la défaite des B.R. et avec elles, de la lutte
armée pour le communisme.
Cet objectif a envahi tous les raisonnements mis
dans la bouche des traîtres, toutes les interventions de la partie
civile: il est le coeur-même de chaque acte du procès et des
déclarations du procureur Amato.
Un refrain obsessionnel qui voulait devenir un
lieu commun, une vérité indiscutable acceptée par tous.
La nature de cet objectif est cependant de plus
vaste portée. Il est une partie importante d’une attaque bien plus
complexe que la bourgeoisie a porté à la classe ouvrière et au
prolétariat métropolitain.
En ce sens, la ratification de la défaite des
B.R. devait représenter un moment important pour réussir à effacer
de la mémoire historique-même du prolétariat, la conscience de la
révolution comme événement possible et nécessaire, le seul qui
soit capable d’apporter une solution réelle aux besoins et aux
intérêts prolétariens.
La publicité la plus grande au refrain de la
défaite est garantie par l’amplification démesurée du moindre
balbutiement du traître de service.
La thèse commune à tous les vautours qui se sont
jetés sur la « pâture » politique que représente ce procès
est celle selon laquelle « les B.R. sont un groupe au service de
quelqu’un de bien plus important ». Chacun tente d’apporter de
l’eau à son moulin.
Et actuellement, c’est l’histoire, le patrimoine,
les militants-mêmes de la lutte armée qui constituent un butin sur
lequel les diverses forces de la bourgeoisie mettent la main pour en
tirer tout ce qui peut être utile à leurs propres jeux de pouvoir.
C’est ainsi que nous avons entendu une anthologie
des thèses complotardes selon lesquelles les B.R. seraient des
marionnettes au service des projets les plus divers.
A en croire les socialistes et une partie de la
D.C., nous ne serions que des russes parlant bien l’italien car,
comme le disait alors déjà Craxi: « il n’est pas pensable que
les B.R. s’entraînent dans les basses-cours.
Pour le F.C.I., nous étions évidemment des
agents de la C.I.A., puisque Moro avait été l’instrument suprême
de son insertion dans l’aire du consensus de la majorité
gouvernementale.
On a fait parier différents trai très afin de
soutenir, partiellement, les diverses thèses complotistes en vogue.
Mai s-même eux n’ont pas été très utiles.
C’est ainsi que chaque parti bourgeois a continué
à fournir sa propre vérité.
Ce pour quoi les traîtres ont été le plus
utilisés a été, par contre, la construction d’une campagne
diffamatoire et provocatrice contre le peuple palestinien et les
forces révolutionnaires qui luttent en Europe et en Méditerranée
contre l’impérialisme américain.
Ce n’est pas un hasard, et nous l’avions dénoncé
dans cette salle d’audience avant que cela ait lieu, si la campagne
menée en Italie et en Europe contre le peuple palestinien a précédé
l’invasion génocide du Liban par l’impérialisme, grâce aux
bouchers sionistes et phalangistes.
Dans les faits donc, ce procès est un procès de
guerre; une attaque, non seulement contre les B.R., mais aussi contre
toute hypothèse politique révolutionnaire dans ce qui, pour les
projets de l’impérialisme américain, doit être un terrain
d’opérations pacifié à l’intérieur et agressif vers l’extérieur.
C’est un procès de guerre, parce que toutes les
« entorses » faites à la législation courante, avec
le5
diverses lois spéciales, ont trouvé un champ
d’application dans ce procès, et ont par là ratifié un
bouleversement global de la sphère juridique dans le sens d’une
législation de « guerre civile ».
C’est un procès de guerre parce que, dans cette
salle d’audience, la torture et les disparitions de prisonniers ont
été officialisées, reconnues et revendiquées par l’Etat comme
méthode « légale » d’enquête.
En effet, alors qu’un de nos camarades inculpé
dans ce procès était séquestré et torturé plusieurs jours durant
dans les locaux de la DIGOS, la Cour et le Procureur, tout en sachant
cela, continuaient le procès, couvrant de la loi du silence ce qui
était en train de se passer.
Après cela, l’ouverture par la Cour d’une soit
disante enquête sur cet épisode n’en était qu’une couverture
supplémentaire: à tel point que les photographies qui témoignaient
des lésions subies par le camarade ont déjà disparu du dossier.
C’est un procès de guerre, parce qu’est devenu
évident dans cette salle le rapport qu’établit l’Etat avec la
société civile et les prolétaires en particulier.
Ce système n’offre plus aucune perspective
d’expansion de la richesse sociale ni d’évolution des valeurs
morales et culturelles.
L’évolution du politique vers la barbarie
sanctionne l’isolement progressif de la bourgeoisie et de son Etat,
son retranchement sur la défense de son pouvoir et de ses
privilèges.
Elle ne peut plus rien garantir au prolétariat.
Le seul rapport que la bourgeoisie parvient à
établir est représenté par les misérables figures qui servent à
jeter de la boue sur l’histoire de la révolution prolétarienne: la
trahison!
L’Etat bourgeois fait « l’acquisition » de
quelques traîtres afin qu’ils « parlent » à la classe,
qu’ils la dissuadent de la possibilité de la révolution
prolétarienne. L’Etat bourgeois encense la figure de l’espion, en
fait la figure utile idéale, un « modèle de vie ».
La misère humaine que met en évidence cette
politique ne peut que renforcer la conscience prolétarienne de la
nécessité d’abattre cet Etat.
MAIS QUELLE EST LA VERITE SUR L’AFFAIRE MORO?
Nous pensons que la seule vérité soit la vérité
historique, qui est légitimée aux yeux des masses par l’avancement
du processus historique réel.
Tout le reste n’est que bavardage, versions de
parti, suivisme d’agitateurs. La vérité d’Amato et de Savasta
peut-elle être considérée comme une nouveauté?
Que Moro ait été séquestré par hasard?
Soyons sérieux!
Ce n’est là qu’une version pour les Imbéciles,
tout juste bonne à cacher le seul fait certain: la « Campagne de
Printemps » a été l’exploitation d’un projet politique
révolutionnaire mis en oeuvre par des avant-gardes communistes
combattantes, qui visait à désarticuler le projet politique
développé par la bourgeoisie sous le nom de « solidarité ».
Ce projet bourgeois se donnait pour objectif la
pacification réactionnaire de l’affrontement social, par
l’utilisation de l’appareil politique révisionniste comme
contrôleur, constructeur du consensus par la force et espion à
l’égard de l’antagonisme de classe.
Comme cette farce de procès
semble ridicule, face à ces années de lutte de classe et de lutte
armée!
Une farce construite autour de via Gradoli, au
cours de fébriles réunions de parlementaires -autour des tables
bancales de quelque devin en quête de réussite et, d’une manière
générale, autour des fantasmes créés par le « syndrome du
complot ».
Aujourd’hui, la vérité historique est sous les
yeux de tous! Le projet de « solidarité nationale » est
définitivement mort et enterré avec son créateur; emporté, non
tant simplement par l’action militaire, que par les dynamiques de
classe qui ont motivé cette action et qui, à partir d’elle, ont
permis la maturation d’un développement plus avancé.
La mise en cage de la classe, de ses tensions et
de sa force n’a pas été possible: le projet a échoué!
Et avec cet échec s’est développé toujours
d’avantage dans la conscience de la classe qu’aucun compromis n’est
possible entre exploiteurs et exploités, que le seul rapport entre
prolétariat et bourgeoisie est l’affrontement de classe!
Nous revendiquons cependant le fait que les B.R.
ai ent parti ci pé et contri bue de façon décisive à la
destruction de ce projet politique antiprolétarien.
Il est donc indéniable que la Campagne de
Printemps constitue un moment important du processus révolutionnaire
en Italie et en Europe.
L’objectif de ce procès est maintenant de nier
cela, ce qui s’est avéré impraticable.
Nous voulons être clairs sur un autre fait,
relatif au mandat assigné à l’un de nos avocats de confiance dans
ce procès.
Chacune de nos pratiques a pour effet de produire
préoccupation et confusion chez la bourgeoisie.
Cela s’est vérifié quand quelque chose s’est mis
à ne plus touner rond, après huit mois de déroulement des
audiences.
Ce quelque chose, c’est la nouveauté du fait
qu’un avocat, même de manière limitée, soit en condition
d’intervenir sur des aspects déterminés présentés par ce procès.
Cette préoccupation et cette confusion se sont
manifestés par la présence de gros bonnets de la contre-révolution
notoires et importants et par la rumeur officieuse que ce que faisait
notre avocat de confiance dans la salle d’audience constituait un
délit.
Voilà qui est significatif du peu de solidité
des nerfs de la bourgeoisie face à ce qui va dans une direction
opposée à la sienne.
A partir de là, deux questions se sont posées:
si cela constituait une nouvelle « stratégie » des B.R. dans
les procès, ou bien si c’était un retour en arrière vers la
pratique du « procès guérilla ».
Disons tout de suite que les B.R. n’ont jamais eu
de stratégie de procès, mais qu’elles appliquent dans les
situations concrètes et spécifiques, et donc aussi dans les procès,
leur ligne politique.
Une ligne politique qui n’a jamais été et ne
peut être la somme de stratégies particulières.
En effet, dans la phase où l’avant-garde devait
affirmer la lutte armée comme rupture politique, et la guérilla
comme moment de cette rupture, nous développions dans les tribunaux
une pratique tendant à désarticuler l’appareil juridique de l’Etat.
Une pratique que nous avons appelée « procès
guérilla », qui répondait aux objectifs fixés par la ligne
politique dans la phase de la « propagande armée ».
Le changement du cadre politique général, et les
tâches différentes découlant de la lutte entre prolétariat et
bourgeoisie, imposent une redéfinition de la ligne politique et de
l’activité de l’avant-garde dans toutes les situations concrètes,
et donc aussi dans les procès.
Face à cette situation, et en présence de
nouvelles tâches, le « procès guérilla » ne parvient à
avoir une incidence efficace, ni sur le plan de la
disfonctionnalisation du procès, ni sur celui de la propagande et de
l’agitation: ainsi se réduit-il, justement parce que les conditions
ont changé, à un simple témoignage du passé.
Au contraire, il s’agit dans les procès, tout en
étant conscients de leur rôle secondaire, non de manifester un
antagonisme idéaliste et abstrait, incompréhensible à la classe,
mais d’être un point de référence concret, politiquement clair et
reconnaissable par le prolétariat; une force révolutionnaire
sachant utiliser sa capacité antagoniste non médiatisable avec les
intérêts de l’Etat, pour être une indication de lutte et de
programme.
Les procès peuvent donc être, même dans les
conditions nouvelles, un moment significatif de l’affrontement
politique avec la bourgeoisie.
Pour cela, il est nécessaire d’assumer la
pratique de la politique révolutionnaire, en profitant de toutes les
occasions pour ramener l’attention de la classe sur les problèmes
concrets de la lutte de classe et de son développement,
l’avant-garde se sert donc aussi des procès pour intervenir
efficacement et désarticuler la manière dont la bourgeoisie
voudrait actuellement les mener, en cherchant à donner d’elle-même
une image de puissance et d’efficacité-.
Et pour, réciproquement, donner une image de
défaite de l’avant-garde révolutionnaire et de la possibilité
révolutionnaire-même.
Tout cel a peut être mené dans les procès par
une présence politique active et articulée sur plusieurs niveaux,
capable d’entrer dans le vif des contradictions que produit la nature
politique-même de ces procès.
Nous clarifierons par la suite, afin qu’il n’y ait
pas d’équivoques, qu’il ne s’agit pas d’accepter les lois de la
bourgeoisie ni de se perdre dans les mécanismes juridiques et de
procédures; mais de déterminer, à chaque fois, l’opportunité
d’une intervention en fonction des diverses contradictions qui se
présentent.
Le processus révolutionnaire, dans chaque pays et
à chaque époque, ne suit jamais un parcours linéaire,
géométriquement croi ssant, mais il est continuellement marqué par
des sauts politiques, qui se traduisent par des ruptures avec les
formes précédentes de l’affrontement.
Des moments où la classe et son avant-garde,
porteurs d’un patrimoine consolidé de luttes et d’initiatives,
doivent affronter une phase nouvelle de de bataille politique,
d’expérimentation. Telle est aussi notre expérience.
La lutte armée naquit en Italie au début 70,
comme hypothèse révolutionnaire pour le communisme. Elle naquit
donc comme rupture subjective de quelques avant-gardes communistes
d’avec 20 ans de révisionnisme, comme construction d’un point de
référence stratégique révolutionnaire enraciné dans la classe.
La légitimation de ce choix stratégique
provenait de la maturité de l’affrontement de classe qui, après les
deux années 68-69, avait vu croître, d’une part, le besoin
stratégique de la classe d’apporter une réponse au problème du
pouvoir et, de l’autre, la nécessité de répondre à la violente
contre-attaque bourgeoise mise en oeuvre pour réprimer le mouvement
de classe (licenciements d’avant-gardes ouvrières, les massacres d ‘
Etat et les « chasses aux subversifs » qui s’en suivirent).
Ce choix de rupture se manifestait comme
initiative combattante pour propager et enraciner dans le prolétariat
la conscience de la nécessité et de la possibilité de la lutte
armée pour le communisme.
Il s’agissait donc d’enraciner une idée-force
parmi les avant-gardes de classe; d’une bataille politique parmi les
communistes pour définir les contours essentiels d’un projet
politique révolutionnaire absent depuis 20 ans.
Dans ce cadre, les B.R. ont repris les catégories
fondamentales du marxisme-léninisme et mis au centre de leur
initiative, justement, le fait d’agir en parti, tout en n’étant
évidemment pas un parti; ainsi que la centralité de la classe
ouvrière, comme expression du plus haut niveau d’antagonisme contre
le capital.
Cela n’avait rien à voir avec une nostalgie
livresque, mais était une réalité quotidienne et visible.
C’est en effet à partir du potentiel de lutte et
de la conscience politique de la classe ouvrière, accumulés au
cours de ces années dans les grandes usines du Nord, de la Pirelli à
la Fiat, que s’exprime et se concrétise le saut à la lutte armée,
le passage nécessaire pour porter cette force à problème du
pouvoir.
Centralité ouvrière donc, comme synthèse de
deux éléments de fond de notre analyse: la méthode
marxiste-léniniste, qui considère comme centrale la production
capitaliste de plus-value, et donc comme centrale la classe ouvrière
au sein du prolétariat métropolitain; et l’accumulation matérielle
de force et de capacité politique de proposition, exprimée par les
luttes au cours de ces années, à leur point le plus élevé.
Cette capacité de rupture et d’affirmation d’une
idée-force a marqué dès lors ces 12 dernières années de lutte.
Cette capacité, que nous avons appelée
« propagande armée », est un patrimoine prolétarien que
personne ne peut nier ni liquider.
L’accumulation de force réalisée à l’intérieur
de l’usine par la rupture avec le révisionnisme imposait un nouveau
saut politique pour porter cette force accumulée à un stade
supérieur.
Un saut permettant de dépasser les limites des
thématiques d’usine et les diverses déviations de l’opéraisme et
du syndicalisme armé qui existaient aussi dans le mouvement
révolutionnaire au cours de ces années.
Un saut politique qui transforme ce potentiel en
projet global de pouvoir contre l’Etat.
La mise en évidence du projet néo-gaulliste et
la séquestration de Sossi matérialisèrent pour la première fois
le mot d’ordre d’ »attaque au coeur de l’Etat », par lequel
la lutte armée dépassa l’idée-force pour devenir hypothèse
politique stratégique, point de référence révolutionnaire pour
l’ensemble du prolétariat, en plus que pour la classe ouvrière.
S’il faut relever l’aspect positif de cette
période de propagande armée: avoir posé au centre de l’initiative,
l’axe stratégique d’attaque « au cœur de l’Etat »; en
revanche, on négligea alors le problème de la tactique et d’une
stratégie révolutionnaire qui puisse, dans ce contexte, orienter
concrètement l’affrontement de classe.
Ou encore, on se limitait à une riposte au coup
par coup contre les projets de l’ennemi, sans cependant expliciter un
quelconque projet prolétarien.
Pendant ces années, cette limite était peu
perceptible, du fait de la nature-même des tâches que la guérilla
se fixait. Elle est devenue explosive après 1978.
Dans les années précédant la Campagne de
Printemps, on assista à un développement incessant de l’antagonisme
prolétarien.
Dans toutes les grandes villes italiennes, ce
développement s’effectua hors des formes d’organisation
prolétariennes traditionnelles et institutionnelles.
Ce phénomène, que nous avons appelé « autonomie
ouvrière », allait bien au-delà du mouvement politique
autonome.
Au cours de ces années, la propagande armée
entra en un large rapport dialectique avec les avant-gardes
prolétariennes de tous les secteurs de classe, en en influençant le
débat, la formation politique, les pratiques politiques de lutte.
Les luttes ouvrières qui sortaient fréquemment
des limites de l’usine, et le mouvement de 77, -avec la multiplicité
et la radicalité de ses formes, donnaient corps et vitalité à un
mouvement antagoniste et à un mouvement révolutionnaire de vastes
dimensions.
Dans le même temps la bourgeoisie, aux prises
avec la crise économique et la forte présence de l’antagonisme
prolétarien, mettait au point un projet politique articulé
permettant d’affronter la nécessité d’une restructuration globale
de la production, en cherchant à contrôler l’affrontement de classe
par toutes les médiations possibles.
C’est à cela que servait l’insertion des
révisionnistes, à qui était confiée la tâche de construire le
consensus prolétarien autour des choix du capital, en échange d’un
« parfum » de participation au gouvernement.
En d’autres termes, en plus que dans la conscience
subjective des B.R., c’est la réalité-même de l’affrontement qui
mit sur le tapis l’exigence prolétarienne de « faire sauter »
le projet néo-corporatiste baptisé « solidarité nationale »
et de construire la force politique révolutionnaire de toute la
classe, capable de rassembler autour d’une stratégie, tout le
potentiel révolutionnaire existant-.
Avec la Campagne de Printemps, les B.R. opèrent
la synthèse politique et la rupture subjective nécessaires
permettant de donner une solution à ces deux exigences.
La D.C. est l’âme noire du système
d’exploitation et de pouvoir en Italie, l’ennemi reconnu et attaqué
lors de 30 années de lutte prolétariennes.
Moro était le stratège le plus important du
projet de « solidarité nationale ».
Comment la bourgeoisie a-t-elle réagi pendant la
Campagne de Printemps?
Elle était coincée entre deux possibilités, qui
toutes deux étaient des défaites.
La Campagne de Printemps avait déjà détruit « le
projet de « solidarité nationale ».
Pour cette rai son, toute possibilité de « sauver
ou non Moro » n’était plus fonction que des différentes
batailles en cours entre les partis pour récupérer, chacun à son
profit, le « cadavre » de la « solidarité nationale ».
Avec la Campagne de Printemps, la capacité de
désarticulation atteinte est telle qu’elle exalte et amplifie le
rôle politique de la lutte armée: au point que de nombreuses
avant-gardes, au sein desquelles sont représentées diverses couches
du prolétariat métropolitain, font leur la pratique combattante,
comme formé de lutte permettant de donner plus de force à leur
« capacité contractuelle ».
L’ample développement de la pratique combattante
et des luttes autour des B.R. crée un climat de profonde attente
politique.
A la lumière de la Campagne de Printemps, les
thèses qui défendent la lutte armée pour des secteurs de classe
antagonistes particuliers, ou comme coordination de la guérilla
diffuse, apparaissent clairement inadéquates.
Mais, plus que la bataille politique interne au
mouvement révolutionnaire, le fait qui compte est que la critique de
masse au révisionnisme et à la ligne liquidatrice du « compromis
historique », posait le problème de la construction du Parti
Communiste Combattant et de la définition d’une stratégie qui,
mettant au centre l’intérêt général de la classe, engendre une
tactique révolutionnaire adaptée au nouveau contexte.
La Campagne de Printemps posait donc le problème
de dépasser la configuration limitative d’O.C.C., pour pouvoir
commencer à occuper, grâce à une stratégie et une tactique
révolutionnaires adéquates, l’espace politique que la conscience de
classe elle-même, à des niveaux de maturité divers, avait
contribué à ouvrir.
L’espace pour une force politique révolutionnaire
et combattante en mesure de diriger l’ensemble de la classe et non
seulement les avant-gardes déjà militantes.
Pour paraphraser Lénine, nous disons qu’une force
politique démontre son sérieux en mettant en lumière sans
réticences les erreurs’qu’elle a commises, sans craindre
l’instrumentalisation que l’ennemi pourrait faire de cette
autocritique.
Notre devoir révolutionnaire à l’égard du
mouvement de classe est de faire ce bilan, afin que se construise une
dialectique donnant vie aux contenus les plus avancés de cette
expérience politique.
Il est de notre devoir de défendre ce patrimoine
contre tous ceux qui veulent le liquider, quand bien même en se
dissimulant derrière une phraséologie pseudo-transgressive,
extrémiste, anarchiste.
La conclusion de la Campagne de Printemps nous a
mis devant un très vaste antagonisme de classe, différencié par
ses niveaux de conscience, ses pratiques de lutte et ses formes
organisées, qui se tournait vers nous comme moment de référence et
comme possible direction révolutionnaire.
Un mouvement qui nous demandait: « Que faire? »
Nous avons répondu à cette question en lançant le mot d’ordre:
« conquérir les masses sur le terrain de la lutte armée ».
Ou plutôt, non avons proposé à toute la classe
les mêmes critères et formules organisationnels qui avaient
caractérisé notre bataille politique parmi les avant-gardes
communistes.
Nous avons simplement proposé l’extension
quantitative de la lutte armée, selon une conception essentiellement
guérillériste du développement du processus révolutionnaire dans
notre pays.
La lutte armée dans les métropoles revêt
certainement la forme de la guérilla, mais ne doit pas en assumer la
conception. Assumer cette conception dans notre pays a été une
erreur.
SUR QUOI REPOSAIT CETTE ERREUR?
La désarticulation complète du projet politique
de « solidarité nationale » avait remis en question les
équilibres entre les bourgeois et entre les classes.
Au-delà des déclarations belliqueuses des
notables de la D.C., il apparaissait clairement que personne n’était
en mesure de postuler au rôle de médiateur entre les coteries
internes.
Mais surtout, personne n’était capable de
formuler une proposition politique de longue haleine. Au cours des
années suivantes, en effet, la « solidarité nationale » a
toujours plus été un « esprit », évocateur d’un projet
politique mort et enterré.
C’était un fait concret et indiscutable. Tout
comme l’était la fin de l’illusion berlinguérienne. Une donnée de
fait que nous interprétions cependant comme l’épuisement de l’usage
de la médiation politique interclassiste par la bourgeoisie.
Nous en arrivions à dire: « dans les
conditions nouvelles créées par la Campagne de Printemps, la
bourgeoisie est contrainte de transférer ouvertement sur le terrain
militaire le contrôle qu’elle réussissait jusque là à exercer à
travers les appareils politico-syndicalo-idéologiques ».
Cette façon de raisonner revenait à nier que
l’Etat, même gravement défait sur un projet politique précis, n’en
continuait pas moins à remplir la fonction de régulateur bourgeois
de l’affrontement soci al, grâce à un savant dosage d’interventions
tant politiques que militaires.
Au point que la bourgeoisie, bien que ne
réussissant pas à définir un projet politique global, réussissait
malgré tout à prendre des initiatives, quand bien même
contradictoires et à court terme, sur les noeuds des politiques
économique et institutionnelle; et à rétablir l’unité des forces
politiques autour des soi-disant lois « antiterroristes » ou
sur l’ensemble des mesures d’attaque tant contre la lutte armée que
contre les formes consolidées de l’antagonisme prolétarien (telles
que la mobilisation de rue).
C’est ainsi que nous avons perdu toute capacité
de découvrir et d’attaquer le projet politique constituant le
véritable « coeur de l’Etat » et nous nous sommes engagés
dans la voie de l’attaque aux structures de l’Etat, au réseau de ses
articulations et de ses appareils.
Cette conception a produit deux erreurs
symétriques et complémentaires: sur le terrain de la pratique
combattante où elle a intensifié et fragmenté l’initiative, la
conduisant à reproposer l’intervention contre la D.C., les corps
militaires et les chefs d’ateliers; sur le terrain de la direction du
mouvement antagoniste, où elle a limité aux niveaux uniquement des
mouvements qui pratiquaient déjà des formes de lutte armée, la
possibilité concrète d’une dialectique politique qui s’offrait à
nous.
C’est ainsi que nous ne placions pas au centre de
notre activité politique tous ces niveaux de conscience et
d’organisation prolétariennes qui, tout en n’assumant pas encore de
pratique armée, se situaient toutefois comme mouvement hors et
contre les représentations parlementaires actuelles, hors et contre
la politique bourgeoise.
Le rapport entre ceux qui, comme les B.R.,
agissaient en parti révolutionnaire et la classe, se dégradait et
se limitait au rapport organisation-mouvement révolutionnaire; un
rapport ne parvenant pas à concevoir le rôle décisif des masses
dans l’affrontement politique général.
Notre analyse erronée de la crise capitaliste
contribuait organiquement à cela. La vision de la crise comme crise
irréversible, permanente, servait de toi le de fond à la fin de la
fonction de la politique dans le rapport d’affrontement entre les
classes.
La dégradation imminente des conditions de vie
aurait contraint la classe à empoigner spontanément les armes pour
défendre ses besoins immédiats.
Cela mène en fin de compte à une vision de la
lutte armée comme le tout de la politique révolutionnaire dans la
métropole. A la fin de cette pente idéaliste, on aboutit à cette
conception déformée de la réalité actuelle comme « guerre
sociale totale », si bien illustrée par la pratique du
« Parti-Guérilla ».
C’est à ce point que l’idéalisme subjectiviste
trouve à s’affirmer au sein des B.R. également.
Un fois perdue la possibilité de cerner le projet
politique dominant de la bourgeoisie, la ligne politique « conquérir
les masses sur le terrain de la lutte armée » se concrétise
comme pratique combattante pour les besoins prolétariens
particuliers, comme propagande pour vaincre sur ces besoins.
Un tel dispositif théorique a produit la
conception dite du « système du pouvoir rouge ».
La caractéristique constante de toute cette
construction théorique était la pratique armée, ce qui nous a
amené à osciller continuellement entre le fait d’assumer comme
réfèrent unique les aires de mouvement déjà combattantes, et le
fait de considérer les mouvements de masse qui s’opposaient et
s’opposent aux processus de restructuration de la bourgeoisie, comme
« sur le point de s’armer ».
En d’autre termes, en parlant à tort et à
travers de masses armées, nous nous limitions à des structures
combattantes plus ou moins restreintes, ou bien nous voyions ces
dernières comme l’anticipation du parcours qu’auraient emprunté les
masses.
TEL N’EST PAS LE PARCOURS DE LA REVOLUTION DANS
LES METROPOLES.
Concevoir la lutte armée comme une « forme de
lutte », comme une méthode pour vaincre sur des besoins
particuliers, est la base théorique qui a mené d’abord au
morcellement des initiatives politiques, puis aux scissions
organisationnelles. Voyons pourquoi.
Le prolétariat n’est pas une totalité homogène,
une somme de figures indistinctes et équivalentes, mais un ensemble
de figures différenciées par leur position propre dans le procès
de production et reproduction des rapports sociaux capitalistes.
Ce sont des différences qui pèsent dans la
compréhension des rapports réels existants, la disposition de
chaque couche de classe particulière.
Chaque couche du prolétariat a donc un ensemble
d’exigences matérielles, culturelles et politiques (que l’on appelle
généralement besoins) qui, d’une part, l’identifient et la
socialisent de manière précise et, de l’autre, la différencient de
toute autre couche.
Le fait de mettre au centre de l’initiative les
« besoins », plutôt que l’attaque au projet politique
dominant, conduit à diviser les initiatives elles-même, en les
calquant sur les différentes particularités.
C’est ce qui s’est vérifié.
A partir de 1980, chacune des colonnes de
l’organisation situées dans les pôles métropolitains a abordé le
problème de l’enracinement dans les situations en assumant certaines
contradictions qui s’exprimaient localement; contradictions différant
d’une ville à une autre. Un plus grand enracinement et la
désagrégation de la ligne politique allèrent de pair.
Privée d’une ligne politique qui saisisse la
contradiction principale (celle entre mouvement de classe et pratique
de la bourgeoisie), et l’aspect principal de cette contradiction : le
projet politique dominant dans une conjoncture donnée; privée donc
d’une identité de ligne, de stratégie générale, mesurée sur une
situation concrète, l’Organisation Brigades Rouges a fini par
revêtir autant d’identités qu’il y avait de pôles principaux
d’intervention.
Les scissions de 1981 sont le couronnement
organisationnel d’un processus de fragmentation politique en œuvre
depuis longtemps.
Pour renverser ce processus de désagrégation, il
était donc nécessaire d’établir un rôle politique de direction
qui se fonde principalement sur la détermination du projet politique
dominant de la bourgeoisie.
Celui-ci se saisissant dans l’aggravation de la
crise de l’impérialisme, contraignant celui-ci à une attitude
toujours plus agressive dans les différentes aires de la chaîne
impérialiste.
On déterminait donc à partir de la fonction de
l’O.T.A.N, en Europe et en Italie, la fonction de ses liens
politico-militaires, en particulier dans notre pays, qui devenaient
par conséquent celle d’augmenter les dépenses militaires aux dépens
des dépenses sociales et, d’une manière générale, celle
d’attaquer les conditions d’existence du prolétariat.
Il a certainement été correct de jouer, avec
l’opération Dozier, un rôle d’avant-garde qui a permis de restituer
une identité politique aux « B.R. pour la construction du
P.C.C. », et aussi parce que cette opération a eu lieu en
liaison dialectique étroite avec les initiatives combattantes
développées par les autres forces révolutionnaires dans toute
l’Europe.
Mais, en attaquant l’OTAN, en privilégiant,
conformément à l’ancienne orientation, le seul aspect de la
désarticulation du projet ennemi, sans nous rapporter concrètement
et politiquement à l’activité générale des masses, nous avons
épuisé notre initiative dans un affrontement frontal (et dans ce
cas perdant) avec l’appareil impérialiste.
Et sans assumer non plus la direction des
mouvements de lutte qui, dans les usines et dans la rue, commençaient
à revêtir une physionomie précise, objectivement
anti-impérialiste. L’opération naquit et mourut dans la mer de
problèmes mal posés qui l’accompagnait.
La défaite subie avec l’opération Dozier et la
vague d’arrestations qui s’ensuivit grâce aux traîtres, la
disparition simultanée d’autres hypothèses de guérilla, nous ont
obligé en tant qu’O.C.C., à remettre en question l’ancienne
configuration politique générale, des noeuds théoriques à la
ligne politique.
En bref, la définition du rôle que doit avoir la
lutte armée dans l’organisation et dans la direction du processus
révolutionnaire en Italie.
Au cours de la dernière année, les « B.R.
pour la construction du P.C.C. » ont commencé à prendre
conscience de l’épuisement de la validité et de l’inadéquation
générale d’une configuration théorico-politique qui, dans la
pratique sociale, a laissé du champ aux principales variantes de
l’idéalisme subjectiviste.
Elles ont donc commencé à rechercher le « Que
faire? » pour construire une nouvel le configuration, en
critiquant dans les faits le caractère linéariste et progressif de
l’ancienne et en se réappropriant le concept de processus
révolutionnaire ininterrompu et par étapes.
Un processus qui connaît des victoires et des
défaites, des reculs et des avancées; un processus qui ne peut se
mesurer uniquement au développement de la forme-guérilla.
D’une manière générale, nous n’avons pas placé
au centre de l’autocritique les « écrits de l’Organisation »,
mais nous avons plutôt relu notre pratique sociale, notre rapport
avec les masses, notre élaboration théori que, à partir de la
réappropriation révolutionnaire du marxisme-léninisme.
L’initiative combattante est, aujourd’hui plus que
jamais, la condition de l’existence et du déploiement de la
politique révolutionnaire, justement parce que l’initiative armée,
si elle se réfère exclusivement à la forme-guérilla, à ses
projet et contenus révolutionnaires, n’a pas de capacité offensive
concrète.
A la longue, elle devient endémique et peut donc
être facilement anéantie par l’Etat.
Ce n’est pas un hasard si toutes les formes de
guérilla qui ont glissé sur la pente de l’idéalisme subjectiviste,
quand ce n’est pas tout bonnement du terrorisme pur et simple, ont
été complètement anéanties, et si leur activité a été durement
critiquée par le mouvement révolutionnaire et considérée comme
étrangère par le mouvement antagoniste de masse.
Pour pouvoir construire une configuration
théorique et politique et une nouvelle ligne, les « B.R. pour la
construction du P.C.C. » ont proposé la « retraite
stratégique » pour replacer au centre de l’initiative l’activité
générale des masses.
La proposition de « retraite stratégique »
était cependant adressée aux O.C.C. et non à la classe, justement
parce qu’on en avait constaté l’arriération, et donc l’absence de
direction réel le de ces organisations, à l’intérieur desquelles,
comme le dit Lénine, « il y a des gens qui sont prêts à
présenter les insuffisances comme des vertus, et même à tenter de
justifier théoriquement leur propre soumission servile à la
spontanéité ».
Une retraite, donc, d’une position qui n’était
pas réellement avancée (comme on a pu bêtement le penser), qui
était une position concrètement inadéquate aux nouvelles tâches
de la phase et donc, en dernière instance, à la traîne des masses.
Se retirer dans les masses n’a cependant jamais
signifié « se dissoudre dans le mouvement pour repartir a zéro »,
ni abandonner la stratégie de la lutte armée pour le communisme.
Cela signifie au contraire reconquérir la
confiance et la solidarité de la classe.
Cela signifie lutter contre les projets de
dissociation et de reddition, reconstruire une direction
politico-militaire au sein de la classe, en se rapportant aux
différents niveaux de l’antagonisme, sans pour autant perdre
l’autonomie relative de notre Organisation.
Cela signifie éviter des erreurs encore pi us
graves que celles commi ses précédemment en abandonnant une
configuration qui, ne plaçant pas au centre l’activité générale
des était évidemment arriérée par rapport à la croissante de
direction révolutionnaire objectivement par le mouvement
antagoniste.
En ce sens, l’Organisation a entamé un processus
de critique-autocritique-transformation au sein du mouvement
révolutionnaire et du mouvement antagoniste du prolétariat
métropolitain.
Elle a analysé la nature des erreurs pour
chercher à les dépasser et pour se mesurer, à travers la
définition d’une politique révolutionnaire, à la réalité
concrète dans laquelle vit, et dans laquelle est possible et
nécessaire, le développement de la révolution prolétarienne.
Dans la dialectique continuité-rupture par
rapport à la pratique sociale, l’Organisation a donné, ces
dernières années, la priorité à la rupture, pour l’abandon d’une
configuration théorico-politique traversée de profonds vices
d’idéalisme subjectiviste, et qui n’était pas basée sur l’analyse
concrète de la réalité concrète.
La rupture avec les erreurs du passé implique
aussi de rétablir la continuité avec l’histoire des B.R., avec leur
pratique sociale de combat, qui a marqué ces dix années de lutte de
classe en Italie, par la réapropriation en particulier de cette
pratique ô combien significative et efficace politiquement que fut
la Campagne de Printemps, qui a donné force et originalité aux
possibilités de développement du processus révolutionnaire dans la
métropole impérialiste.
Cela ne veut pas dire continuer sur la ligne de la
propagande armée, pratique dont cette campagne a marqué
l’épuisement objectif.
Cela signifie réévaluer et exalter la force
politico-militaire que représente le fait de porter l’attaque « au
coeur de l’Etat dans cette conjoncture, de désarticuler un cadre
politico-institutionnel .
Ce patrimoine ne peut être anéanti par la
reddition d’une poignée de traîtres, et encore moins par la ligne ‘
liquidatrice portée par un régiment de « gurus » convertis
au rôle de « nouveaux philosophes ».
On ne peut pas annuler un parcours historiquement
déterminé de la lutte de classe gravé dans la mémoire du
prolétariat.
Telle est la signification de notre choix de
« retraite stratégique », pour reproposer aujourd’hui un
dispositif actif et combattant au sein des tâches nouvelles et
complexes de cette phase du processus révolutionnaire.
Les éléments acquis au cours de ce débat
suffisent à permettre la reprise d’une initiative politique et
combattante mettant au centre l’activité générale des masses.
Avant de poser des points de référence pour un
projet politico-révolutionnaire, il faut entrer au coeur de
l’analyse de cette phase, en analysant les vieilles confusions et
approximations.
La crise actuelle est une crise générale du mode
de production capitaliste.
C’est une crise de surproduction absolue de
capital qui dure depuis plus d’une décennie.
La crise générale caractérise donc la phase
historique actuelle, dans laquelle l’exigence capitaliste d’une
reprise de l’accumulation, et en conséquence le saut de la
composition organique du capital qui permette de valoriser au maximum
la révolution technologico-industriel le contemporaine (déjà en
oeuvre, du reste), ne peuvent être donnés que par la destruction
des forces productives en surplus et des moyens de production
dépassés, tant en termes de valeur qu’en termes physiques.
Les exigences du capital, mises à nu par la
crise, induisent dans le système impéri ali ste une série de
réponses économiques, politiques et militaires: en un mot, de
projets politiques globaux visant à dépasser la crise même.
La mise en pratique de ces réponses globales
provoque des oppositions et des affrontements qui témoignent de
l’aiguisement de la contradiction principale entre bourgeoisie
impérialiste et prolétariat international, et de toutes les
contradictions interimpérialistes et, parmi elles, celle surtout
entre l’aire à domination américaine et le social-impérialisme.
Un fois encore, la tentative bourgeoise de
dépassement de la crise générale du capital prend la forme de la
guerre; et donc aujourd’hui, de la perspective de la guerre
interimpérialiste.
Si telle est la tendance, l’issue obligée, la
perspective dans laquelle se meuvent l’ensemble des dynamiques de
restructuration capitalistes dans cette crise, cette affirmation
demande cependant à être précisée, en indiquant à quel stade de
mûrissement de la perspective de guerre on se trouve.
En effet, la guerre n’est pas une explosion de
violence improvisée et imprévisible, mais la conclusion obligée
d’un processus complexe au cours duquel les caractéristiques
fondamentales de chaque formation économico-sociale se modifient
globalement-.
En d’autres termes, chaque guerre mûrit dans cet
ensemble de modifications, même si le motif- de déclenchement ou le
lieu d’explosion sont fortuits, non prémédités par les parties en
cause.
Il est fondamental de définir en termes
conjoncturels l’état concret de mûrissement de la tendance à la
guerre pour esquisser une stratégie révolutionnaire et une tactique
se basant sur l’analyse concrète d’une situation concrète.
Quand nous parions de « tendance à la
guerre », nous entendons la guerre entre l’impérialisme à
dominante américaine et l’aire à dominante soviétique-.
Nous estimons donc que toute concepti on pariant
d’une guerre entre « système impérialiste mondi al » et
« prolétariat mondial » est absurde et déviante.
Non parce qu’un impérialisme serait préférable
à l’autre, mais parce que l’essence de l’impérialisme est d’être
« l’époque de la guerre entre les grandes puissances pour
l’intensification et l’accroissement de l’exploitation des peuples
et des nations » (Lénine).
En considérant les éléments qui caractérisent
la conjoncture internationale actuelle, nous constatons que c’est la
récession productive qui constitue le principal phénomène
économique.
Qui dit récession dit annulation, voire
inversion, du taux de croissance des activités productives.
Et donc, diminution relative et absolue de la
masse des marchandises produites, des usines en activité, des
ouvriers employés, du capital opérant comme tel.
Une récession aggravée par la restructuration
technologique contemporaine et par les politiques de réduction de
l’inflation.
La gestion contrôlée de la récession est
actuellement le « credo » économique de l’immense majorité
des pays capitalistes avancés.
Comme toutes les politiques « anticycliques »,
elle peut aussi, dans l’immédiat, jouer un rôle de frein; mais à
long ,terme, elle amplifie et multiplie les caractères fondamentaux
de la tendance dominante: la guerre impérialiste.
La majeure partie des procès de restructuration
en cours dans tout l’Occident, constitue un ensemble contradictoire
d’initiatives dont la réalisation fait, de toute façon, effectuer
des sauts en avant concrets dans la perspective de la guerre.
Nous le définissons comme « procès de
restructuration en cours pour la guerre impérialiste ».
C’est donc un procès qui naît de la nécessité,
pour chaque capital particulier, de se tailler sa propre part de
marché et de profits dans le cadre d’une concurrence plus
impitoyable et, pour cela, d’abaisser ses coûts à un ni veau moyen
permettant de continuer à exister comme capital.
Mais dans le même temps, ce procès n’est pas
purement spontané: il se ressent d’une concertation internationale
sur les éléments fondamentaux des flux du commerce et des marchés
financiers-.
Les Etats sont donc les centres névralgiques où
les diverses fractions de la bourgeoisie (autochtone et
multinationale), et les représentations plus ou moins
institutionnalisées du prolétariat médiatisent leurs intérêts
contradictoires en définissant les conditions générales, le
« milieu économique » le plus favorable à l’exploitation de
la classe ouvrière et l’extension de la concurrence.
La « restructuration pour la guerre
impérialiste » n’est donc pas exclusivement économique, mais
globale: elle bouleverse tout l’équilibre des formations
économico-sociales de l’aire impérialiste.
En Italie les nœuds sur lesquels se définit le
sens général de ces procès sont représentés par une
restructuration de l’Etat:
– sur le plan économique: l’adoption d’une
politique déflationniste détruisant les mécanismes de
défense automatique des conditions d’existence du
prolétariat (comme l’échelle mobile); une politique économique
qui inverse la priorité des dépenses, en réduisant de manière
drastique toutes les dépenses d’assistance, de la santé aux
retraites, des allocations à la « cassa inteqrazione », dans
le cadre d’une réduction des dépenses publiques et d’une
augmentation, dans le même temps, des dépenses militaires et des
investissements pour la restructuration.
– sur le plan militaire : le rôle impérialiste
actif joué en Méditerranée, au Moyen-Orient et dans la Corne de
l’Afrique.
Ce qui implique, en plus de l’augmentation des
dépenses militaires, la redéfinition d’une stratégie
internationale de
l’Italie.
– sur le plan institutionnel: des modifications
conformes à la nécessité de rendre de telles transformations
générales opérationnelles.
Ce qui signifie la fin de la politique de
médiation interclassiste entre accumulation et distribution sociale;
ce qui se traduit immédiatement par un attaque générale contre la
classe pour la battre, tant sur le terrain de ses conditions de vie
que sur le terrain politique.
Cet aiguisement de l’affrontement a des
conséquences sur le cadre politique institutionnel et bouleverse la
structure même des institutions étatiques , la sphère juridique,
le rôle des appareils préventive-répressifs, etc..
En conséquence, le scénario politique connaît
lui aussi une polarisation autour des stratégies possibles.
D’un côté, nous voyons apparaître toujours plus
clairement un amas de coteries qui se rassemblent autour d’une ligne
politique globale en harmonie avec les exigences générales de
l’impérialisme.
Le rapport entre cette ensemble et la politique
reaganienne n’est pas, comme nous l’avons simplifié par le passé,
un rapport de dépendance mécanique.
Il consiste plutôt à faire siens les intérêts
impérialistes globaux, à tenter d’imposer dans la formation
économico-sociale italienne les modifications déjà conformes à
ces intérêts, à mettre sur pied un projet politique articulé.
Il ne s’agit cependant pas d’un groupe de
« fonctionnaires de l’empereur », mais d’un personnel
politique qui se propose comme régent et allié fidèle. C’est cet
ensemble que nous appelons « parti de la guerre ».
Non qu’il soit identifiable à un parti ou
banalisé en une série de structures et d’institutions.
Mais parce qu’il se polarise autour de quelques
éléments généraux du projet politique grâce auquel il est
possible d’harmoniser la politique italienne avec la perspective
dominante, accélérée par la politique américaine actuelle.
Nous identifions dans les divers Merloni, De Mita,
Craxi, Lagorio, Benvenuto, les chefs de file du « parti de la
guerre »: certes pas en tant que secrétaires d’un « super-parti »,
mais comme les dirigeants politiques principaux qui, autour du projet
impérialiste luttent (entre eux aussi) pour imposer l’hégémonie
d’une ligne particulière.
La conquête du leadership du « parti de la
guerre » est une bataille où tous les coups sont permis, et qui
trouve un terrain fondamental dans le rapport privilégié avec
l’administration Reagan, et avec la Maison Blanche, une destination
de pèlerinage quotidien.
A ce jeu, De Mita et son équipe se taillent la
part du lion; tout comme le P.S.I., qui en a même trop fait en
attisant les polémiques sur les « pistes de l’Est ».
Sur le front intérieur, la D.C., alors qu’elle
cherche un rapport organique avec le grand patronat et trouve en
Merloni un répondant idéal, est à son tour contrainte de se
restructurer comme parti et comme système de pouvoir; à pas comptés
car elle doit rompre avec dix ans de recherche de la gouvernabilité
par le consensus.
A ce tournant, elle impose au P.S.I. de se situer
sur le fond, en l’attaquant et en lui rognant le terrain sur lequel
Craxi et sa bande avaient fondé leurs prétentions au rôle de
régents: le rapport privilégié avec la grande bourgeoisie
financière et industrielle.
Les contenus essentiels du programme autour duquel
se rassemble ce « parti de la guerre » sont sous les yeux de
tous.
En effet, le gouvernement Fanfani lui-même, après
une première fanfaronnade programmatique, n’a pas du tout fait
marche arrière en opérant des médiations, mais il a réalisé au
contraire, par de savants dosages, un pas en avant consistant dans le
démantèlement de l’Etat providence.
Si, d’une part, ces dosages sont rendus
nécessaires par la forte opposition de classe (avec qui
l’affrontement de classe est toutefois anticipé et recherché); de
l’autre, ils jouent le rôle de médiation avec la nécessité de
sélectionner soigneusement les aires et les intérêts à frapper au
sein même des blocs sociaux qui soutiennent les partis de
gouvernement.
L’augmentation des dépenses militaires éclaire
parfaitement la nature et la direction dans laquelle s’engagent les
procès de restructuration en cours.
On cherche à construire une société « austère »,
où les coûts de reproduction sociale du prolétariat soient
comprimés au maximum, et dont l’unique perspective soit la
participation active à la guerre interimpérialiste.
L’armée italienne elle-même est conçue, dans
cette perspective, comme une armée d’ »expéditions »
parfois sous l’étiquette de la « paix », et non plus comme
les lignes arrières de l’O.T.A.N. avec pour tâche la « défense
des frontières ».
Dans la logique du « parti de la guerre »,
la politique de la Confindustria et la politique du gouvernement
tendent à coïncider dans leurs finalités et à se coordonner
réciproquement dans leur gestion des compétences.
L’irrésistible affirmation du « parti de la
guerre » a contraint la gauche institutionnelle à régler ses
comptes avec la défaite de la ligne du « compromis historique »,
ligne qui a provoqué des dégâts incalculables dans le tissu
prolétarien, en se faisant complice d’une furieuse attaque contre
l’antagonisme prolétarien et la politique révolutionnaire qui, dans
cette conjoncture, orientait la classe contre la D.C. et le projet
néocorporatiste.
Cette nouvelle disposition du cadre politique
déterminera et sera déterminée par l’affrontement de classe. Elle
s’aiguisera sous la poussée des procès de restructuration.
La
nouvelle stratégie du P.C.i, est l’alternative démocratique.
Cette hypothèse se base, dans son imprécision,
sur la possibilité technique que s’affirme, dans le cadre des
alliances de l’O.T.A.N, une ligne européenne, autonomiste et « de
gauche », capable de pousser à ce que prévale une politique de
détente entre l’Est et l’Ouest, pour rompre avec la bipolarisation.
Sur le plan inté-rieur, les éléments de
programme, de politique économique, etc. contenus dans cette
hypothèse, prétendent « faire face en créant, en même temps,
des conditions nouvel les pour le développement des forces
productives.
En substance, alors que l’on repropose les
« réformes » (peut-être une nouvelle fois de « structure »),
on part à la recherche d’une nouvelle disposition des forces pour
les soutenir.
Pour ce faire, le P.C.I. pousse, d’un côte, à la
recherche d’un rapport unitaire avec le P.S.I.; et de l’autre, il met
en oeuvre des initiatives visant à récupérer les tensions du
prolétariat et des mouvements antagonistes qui lui érodent la base
sociale.
Le P.C.I. se trouve porté d’un côté, à
reprendre un rapport avec le P.S.I., et de l’autre, à tenter
d’hégémoniser, en soutien à son hypothèse,les mouvements et les
contenus qu’ils expriment.
Et ceci, tant sur le terrain de l’opposition à la
politique économique du gouvernement, que sur le terrain des
contenus antiimpérialistes (paix, désarmement, etc.).
C’est ainsi que dans l’hypothèse même d’une
alternative, un ensemble de contradictions se meut dès à présent,
qui commencera bien vite à mûrir à l’intérieur du P.C.I., et
entre le P.C.I. et les autres forces de la gauche institutionnelle,
mais surtout entre le P.C.I. et la classe.
Du point de vue de la classe, la nouveauté qu’une
telle situation politique introduira dans l’affrontement pour les
prochaines années, doit être comprise et suivie. En premier lieu
parce que la défaite (historique, celle-là) du compromis avec la
D.C. imposera au P.C.I. et à une partie du syndicat une politique
d’affrontement sur les nœuds principaux.
L’effritement simultané de la chape de plomb
représentée par la solidarité nationale, créera des conditions
favorables au développement de l’autonomie ouvrière, en ouvrant des
espaces objectifs pour une politique révolutionnaire sachant définir
son programme autour de ces noeuds et déterminer la force
prolétarienne avec laquelle se dialectiser sur les terrains de
l’affrontement actuel.
Dans le cadre général de l’attaque politique et
matérielle portée par le « parti de la guerre » contre le
prolétariat, l’affrontement de classe va donc au-delà des
différents sectoriels de couches prolétariennes particulières,
pour se situer au niveau où se redéfinit le rapport entre l’Etat et
la classe.
C’est là une donnée objective que la classe a
saisi ces jours-ci, en déplaçant l’affrontement du terrain
spécifique de l’usine à celui de l’opposition générale à la
bourgeoisie, pour construire un rapport de force qui pèse réellement
sur l’ennemi principal en ce moment: la politique économique du
gouvernement.
Face à l’attaque politique contre tout le
prolétariat, la classe, et principalement la classe ouvrière,
répond sur un terrain politique de pouvoir, fait apparaître dans la
prati que la nécessité de s’opposer en tant que classe, et non en
tant que secteurs particuliers et dispersés.
Contre les aspects immédiats de la
restructuration politico-militaire, et donc contre les conséquences
concrètes découlant du rôle confié à l’Italie dans le dispositif
de l’O.T.A.N., un vaste mouvement de masse contre l’installation des
euromissiles et le doublement des dépenses militaires s’est formé
aussi en Italie.
Par sa valeur objecti vement anti impérialiste,
ce terrain apparaît comme un obstacle important dressé par les
masses devant la poli tique impérialiste dans la zone, et donc en
opposition à l’Etat.
De ce fait, il est en même temps un terrain
fondamental de développement d’une politique de classe
révolutionnaire et antiimpérialiste, parce qu’il ne peut y avoir de
stratégie qui ne tienne compte de l’appartenance à l’O.T.A.N., et
donc qui ne mûrisse en son sein et dans la classe, la conscience que
tout processus de libération du prolétariat métropolitain de
l’exploitation ne peut intervenir que par une dure et longue lutte
contre la guerre et la barbarie impérialistes, pour faire sortir
l’Italie de la chaîne impérialiste.
Ce terrain est aussi celui où se reconstruit un
authentique internationalisme prolétarien qui, par les
caractéristiques de masse qu’il peut et doit recouvrir, ne peut être
contenu et circonscrit dans les seules formes combattantes.
Le procès de restructuration en cours traverse
aussi, évidemment, la sphère répressive-préventive, bouleversant
le droit bourgeois lui-même, introduisant la torture et organisant
la police et les carabiniers en bandes spéciales.
Cette redéfinition des appareils répressifs et
préventifs est aujourd’hui dirigée contre le mouvement
révolutionnaire. Mais elle sera orientée, dans l’affrontement de
classe et en des termes différenciés, contre toute la classe.
Cette redéfinition dirige aujourd’hui ses
initiatives vers la prison en particulier et oeuvre à la liquidation
de l’hypothèse révolutionnaire de la lutte armée pour le
communisme.
Le plan sur lequel se déroule l’affrontement est
donc un plan politique général.
Par le contenu des politiques contre lesquelles
lutte la classe, c’est un plan qui objectivement est un plan de
pouvoir.
La conscience avec laquelle la classe descend sur
ce terrain est cependant déterminée par la position politique qui y
est encore hégémonique, et donc par le P.C.I. qui tente d’orienter
la lutte prolétarienne vers le terrain démocratico-réformiste,
voué à la faillite étant donné le cadre des relations intérieures
et internationales.
Pour la classe, vaincre ou échouer dans cette
conjoncture se mesure par sa capacité de généralisation de la
résistance à l’attaque d’une part, par sa capacité, d’autre part à
entraver et à s’opposer au projet de restructuration actuel afin
qu’il ne passe pas.
Dès aujourd’hui donc, la spontanéité
prolétarienne exprime son activité générale en luttant contre les
mesures spécifiques de la restructurati on pour la guerre: contre la
politique économique de l’Exécutif, contre le doublement des
dépenses militai res, l’installation; des euromissiles et la
perspective de la guerre ».
On peut prévoir l’aiguisement, dans un proche
avenir, de l’affrontement de classe sur ces terrains étant donné
que les mesures contre lesquelles on lutte aujourd’hui ne sont que
des aspects d’une restructuration qui est encore toute à déployer
comme attaque à venir contre l’emploi, le coût du travail et les
dépenses sociales; des mesures qui auront pour contrepartie la
multiplication des bases de l’O.T.A.N. et des bases de missiles,
ainsi que la croissance de la militarisation et du contrôle social.
L’autre aspect auquel se mesurent les victoires et
les défaites de la classe est la capacité de l’avant-garde
communiste combattante à intervenir dans cette résistance pour
faire effectuer un saut au mouvement de classe contre la politique
impérialiste.
Agir dans cette résistance signifie en premier
lieu cerner le projet politique dominant de la bourgeoisie
impérialiste et la manière dont il se matérialise dans la
conjoncture.
L’initiative combattante doit être dirigée
contre ce projet, pour recomposer tout l’antagonisme prolétarien
actuellement fractionné en divers mouvements aux contenus
spécifiques et différenciés.
On peut et on doit réunifier et orienter le
mouvement prolétarien antagoniste, afin qu’il s’oppose consciemment
et unitairement à ce projet même contre lequel il lutte
actuellement de manière partielle et sur des aspects spécifiques.
La politique révolutionnaire est alors
précisément cette capacité à exercer une direction politique en
plaçant au centre l’activité générale des masses, et en agissant
sur les contradictions à partir de la pratique combattante.
Le travail parmi les masses ne doit donc plus
partir de l’indication: « conquérir les masses sur le terrain de
la lutte armée ».
Il se propose au contraire d’orienter toutes les
pratiques de lutte possibles et déjà expérimentées ‘par la
classe, en généralisant et reproposant les plus mûres d’entre
elles dans leurs formes de masse, contre la contradiction principale
dans la conjoncture.
La politique révolutionnaire est donc un ensemble
complexe de pratiques différentes, comprenant le combat, la
critique, l’élaboration théorique, l’agitation, le travail
d’organisation des niasses aux niveaux et dans les formes
historiquement possibles, etc.
Mais elle est un ensemble de pratiques
révolutionnaires parce que se situant toutes et unitairement dans
une stratégie de conquête du pouvoir politique et dans la tactique
conjoncturel le qui en découle.
Le caractère global des procès de
restructuration fait en sorte que, sous la poussée de la sphère
économique, le « politique » tende, avec toujours plus de
force, à assumer le caractère dominant: ainsi, alors que le rapport
entre classe et Etat se transforme, ce dernier se profile avec
netteté sur le devenir de l’affrontement, opposant avec clarté les
intérêts impérialistes aux intérêts prolétariens.
Pour cela nous réaffirmons que, dans cette phase,
la question de l’Etat se pose avec force et clarté, et donc aussi la
question de la construction d’une stratégie révolutionnaire pour la
conquête du pouvoir politique.
C’est justement cette prédominance du caractère
politique de l’affrontement qui nous fait réaffirmer avec d’autant
plus de force la validité et la nécessité pour la lutte
prolétarienne révolutionnaire de construire le Parti Communiste
Combattant.
Avec ces points synthétiques, points d’analyse de
la phase et de la conjoncture, nous ne prétendons pas épuiser la
compréhension des tâches révolutionnaires, et donc les assumer
nous seuls, dans le cadre d’un projet défini et articulé à lancer
aux masses.
Nous voulons plus simplement, avec une tangibilité
révolutionnaire, établir un rapport avec les masses, avec leurs
avant-gardes de lutte et avec le mouvement révolutionnaire: un
rapport nouveau au sein duquel construire une proposition politique
révolutionnaire adaptée à la phase, pour interpréter
l’antagonisme prolétarien et l’orienter vers l’unique solution
positive et historiquement possible: la conquête du pouvoir
politique.
Nous voulons donc être extrêmement clairs sur ce
point: notre Organisation ne constitue pas le « noyau fondateur
du P.C.C., même si elle agit, et veut agir activement pour en
promouvoir la constitution.
Multiples sont les forces et les aires
révolutionnaires qui reconnaissent la nécessité d’un parti
authentique du prolétariat métropolitain, et avec lesquelles la
confrontation politique est non seulement possible, mais nécessaire.
Les formes et les structures du Parti découlent
des tâches stratégiques et tactiques d’un processus révolutionnaire
historiquement déterminé dans le maillon-Italie.
Il s’agit donc d’un Parti dont la pratique sociale
et combattante générale est basée sur la politique révolutionnaire
nécessaire pour donner vie au général dans chaque « particulier »
de l’activité de la classe: c’est-à-dire pour faire vivre dans le
prolétariat métropolitain un programme général qui, faisant siens
les intérêts politiques généraux avancés par les masses, dirige
et organise, dans chaque conjoncture, la lutte et le combat
prolétariens contre les aspects principaux de la « restructuration
pour la guerre impérialiste ».
Un programme qui, dans chaque conjoncture,
construise et atteigne une étape du processus révolutionnaire.
En tant que militants des « B.R. pour la
construction du Parti Communiste Combattant », nous proposons à
une vaste aire de forces révolutionnaires et d’avant-gardes de la
classe, une confrontation politique visant à redéfinir une
politique révolutionnaire capable concrètement de généraliser et
de réunifier les luttes prolétariennes; de développer et de
renforcer les mouvements de masse; et d’orienter l’activité générale
des masses contre les piliers fondamentaux de la « restructuration
pour la guerre impérialiste » et contre le « parti de la
guerre ».
Il s’agit, en pratique, de faire assumer par les
masses un programme révolutionnaire et antiimpérialiste cohérent.
Et donc de réussir à synthétiser ce qui émerge
et vit, même de manière dispersée, dans les mille expressions de
lutte et dans les mots d’ordre spontanés des cortèges prolétariens.
Il s’agit de contribuer à construire une
politique révolutionnaire capable d’intervenir avec un programme
général dans les mille rigoles des spécificités en lesquelles
s’exprime la conflictualité prolétarienne: pour que rien ne soit
dispersé des potentialités de la classe dans ce moment où la
bourgeoisie impérialiste cherche à en fragmenter la résistance;
pour que même la plus petite miette de résistance prolétarienne
contribue à exercer sa force maximum contre les pivots centraux de
la politique de l’ennemi principal.
TRAVAILLER A L’UNITE DES COMMUNISTES
POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI COMMUNISTE COMBATTANT!
LUTTER ET COMBATTRE POUR REPOUSSER L’ATTAQUE CONTRE LA POLITIQUE REVOLUTIONNAIRE!
TRAVAILLER A UNIR, ORGANISER, ORIENTER LA LUTTE DE LA CLASSE ET LA PRATIQUE COMBATTANTE CONTRE LA POLITIQUE ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT, CONTRE LES POUSSEES AU REARMEMENT ET LES DEPENSES MILITAIRES, DANS LA PERSPECTIVE DE LA CONQUETE DU POUVOIR POLITIQUE!
>Sommaire du dossier