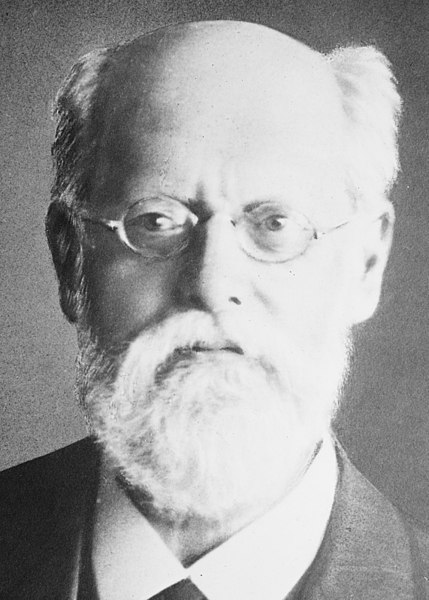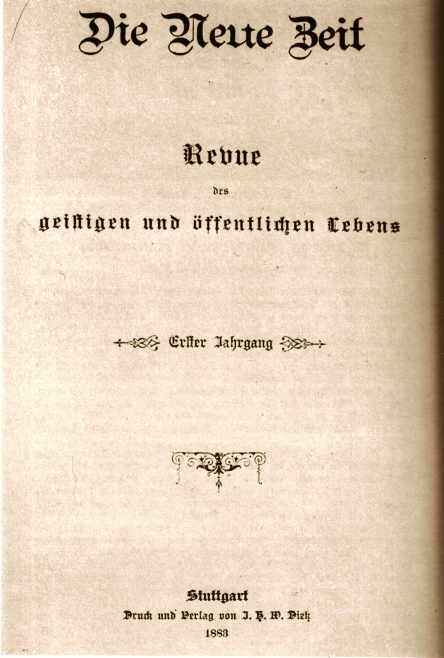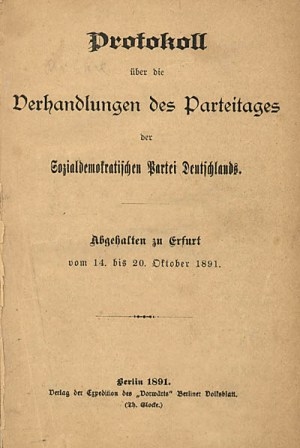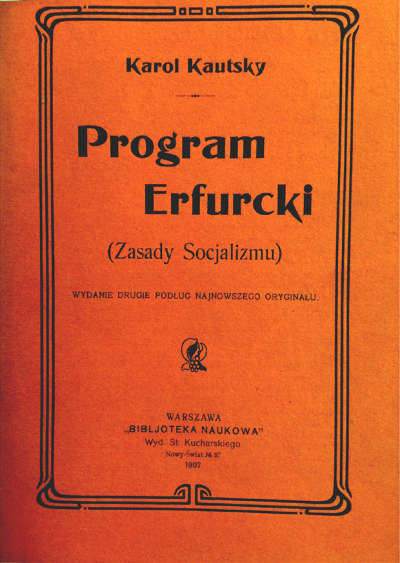Karl Kautsky aborde de manière plus directe la question française dans La république et la social-démocratie en France, série d’articles publiée dans la Neue Zeit en 1904 et en 1905.
A l’arrière-plan, il y a l’opposition idéologique avec Jean Jaurès, qui a une conception de la République « au-delà » de la lutte des classes qui n’est pas considérée comme marxiste.
Tous deux ont d’ailleurs étudié la révolution française, Karl Kautsky publiant en 1899 Les antagonismes de classes à l’époque de la Révolution française. Jean Jaurès se positionnait à la base même contre Karl Kautsky et le marxisme.
En pratique, Karl Kautsky est pour la République ; dans ses écrits il mentionne souvent la Suisse, les États-Unis d’Amérique, l’Angleterre comme références démocratiques. Cependant, il y voit le cadre idéal pour développer au maximum la lutte des classes.
La forme républicaine permet plus aisément la révolution. Chez Jean Jaurès, par contre, la République atténue la lutte des classes, elle est déjà une forme qui dépasserait soi-disant les classes.
L’œuvre est donc une attaque frontale contre Jean Jaurès, accusé de prétendre qu’avec la révolution française une partie du prolétariat aurait été partie prenante de l’élan bourgeois démocratique, au point de pouvoir considérer le socialisme comme le prolongement et l’avènement complet du républicanisme.
Le mouvement ouvrier français a connu de nombreuses formes idéologiques plus ou moins liées au parcours de la Révolution française, avec sa dimension plébéienne, populaire, dont la grande figure est Gracchus Babeuf, qui fit mobiliser des secteurs populaires sous la bannière du jacobinisme.
Les grandes figures ayant tenté de réactiver, à différents niveaux, cette démarche furent Louis Blanc, Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Blanqui. Le soutien populaire aux révolutions de 1830 et de 1848 est également à considérer dans cette perspective. Il a été réel, mais il n’a pas réalisé sa substance, que seul le socialisme peut concrétiser.
Or, la situation ayant totalement changé, le discours républicain ne vise désormais qu’à soutenir un régime pratiquant le colonialisme et une politique anti-ouvrière, où la haute finance, la bureaucratie, les corps d’officiers, les politiciens professionnels, etc. ont une main-mise sur les institutions.
L’ensemble est un compromis entre monarchistes et cléricaux d’un côté, bourgeois de l’autre. Il est donc absurde de chercher à soutenir la République en soutenant la bourgeoisie.
Karl Kautsky résume sa conception de la manière suivante, et on comprend ici tout de suite à quel point il a compris les modalités d’affirmation de la République en France comme régime autoritaire d’esprit monarchique avec sa figure incontournable du « chef ».
« Mais quelle est la base de la menace sur la république ? Il n’y aucune trace à trouver d’un prétendant monarchiste ou bien d’une poussée sérieuse visant à remplacer la république par la monarchie.
La république n’est menacée que par elle-même.
D’un côté, par sa constitution, qui est totalement monarchiste, comme nous l’avons vu, et qui formellement cherche à tout prix une figure personnelle à sa tête.
Ensuite, par sa politique capitaliste-agraire et sa corruption parlementaire.
C’est la déception quant à la république, qui a été saluée par le peuple travaillant comme la sauvant de la misère, qui la menace.
C’est pas en conservant la république capitaliste et sa corruption parlementaire, mais par sa transformation en une véritable république sociale, que cette déception sera supprimée.
Et ce n’est que par l’auto-administration et l’armement populaire qu’elle peut être assurée contre les coups d’État. »
Karl Kautsky parle donc de la « superstition républicaine » ; le ministérialisme, avec ses trahisons et sa corruption, a qui plus est renforcé les tendances anarchistes anti-politiques.
Par conséquent, Karl Kautsky rejette la ligne de Jean Jaurès, au nom de la révolution :
« La troisième république, telle qu’elle est, ne fournit pas le terrain pour l’émancipation, mais seulement pour l’oppression du prolétariat.
Ce n’est que lorsque l’État français sera réorganisé dans le sens de la constitution de la première république et de la Commune, qu’il deviendra la forme de la république, la forme étatique, pour laquelle le prolétariat a depuis onze décennies travaillé, pour laquelle il a versé son sang. »