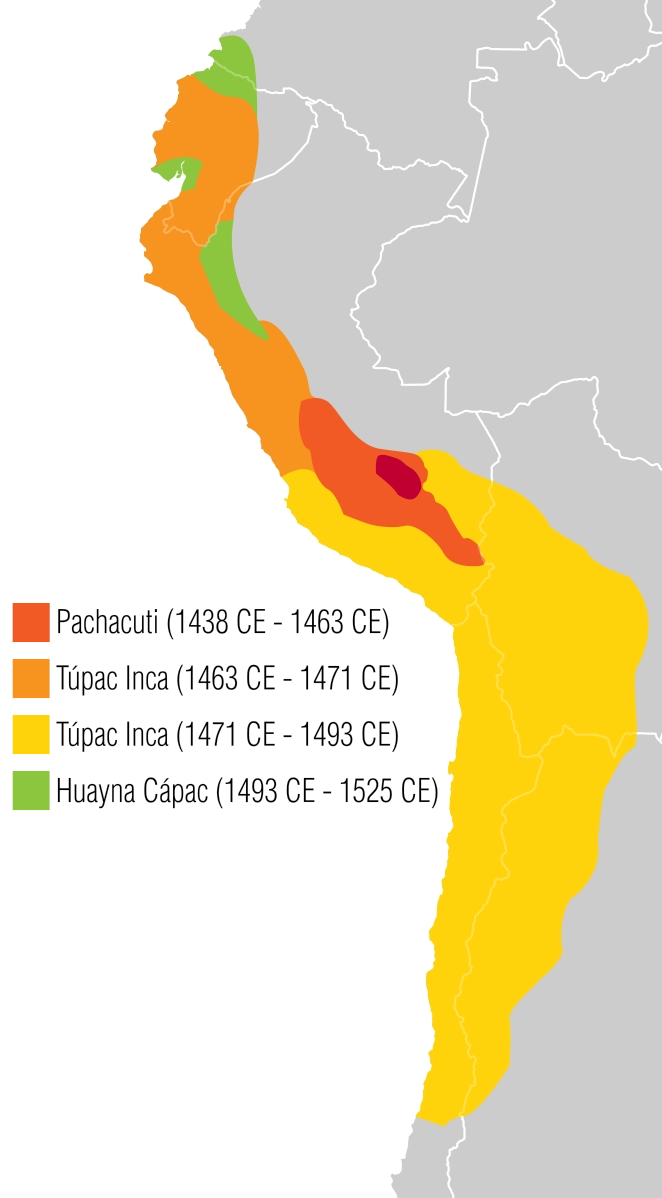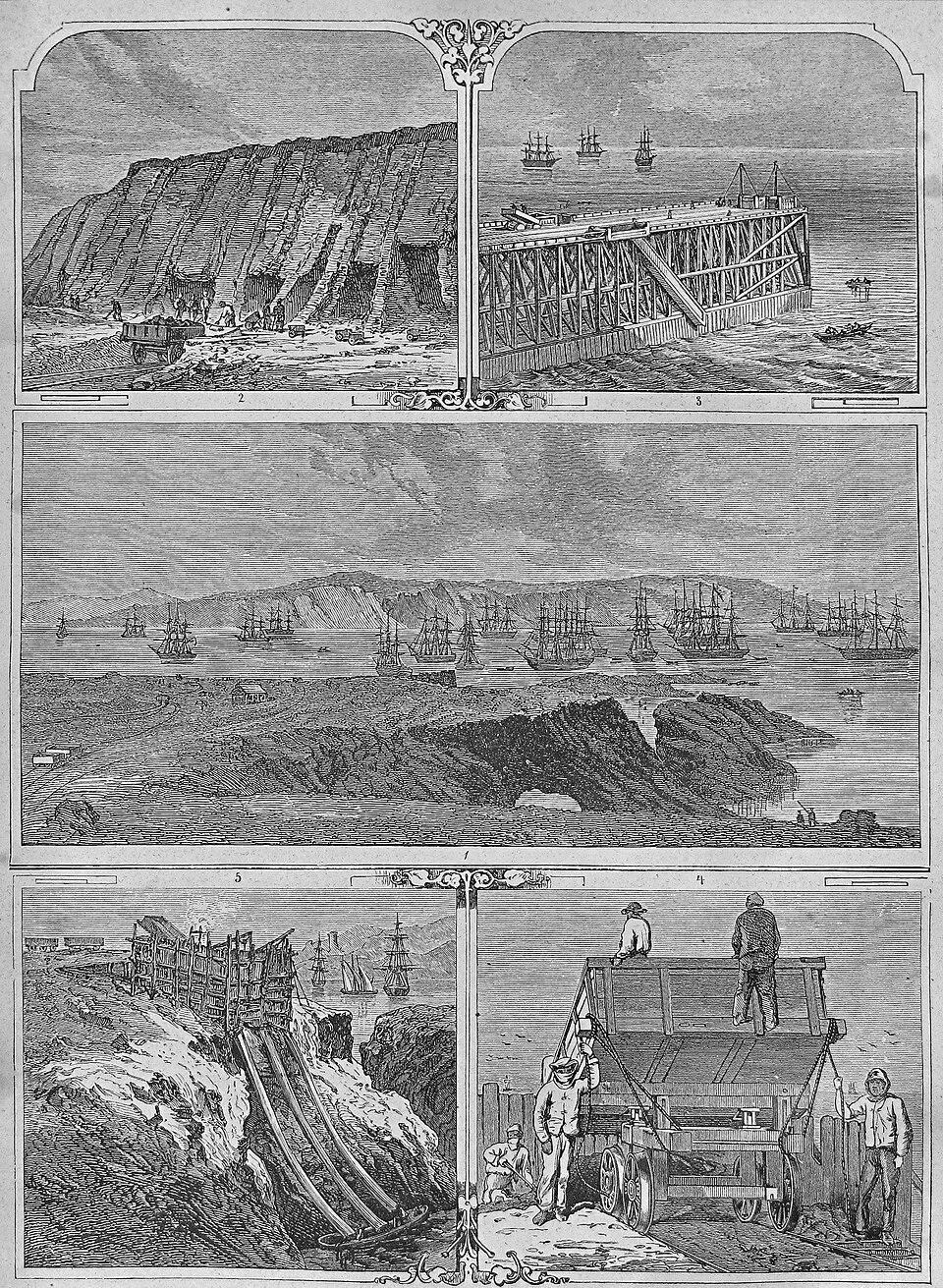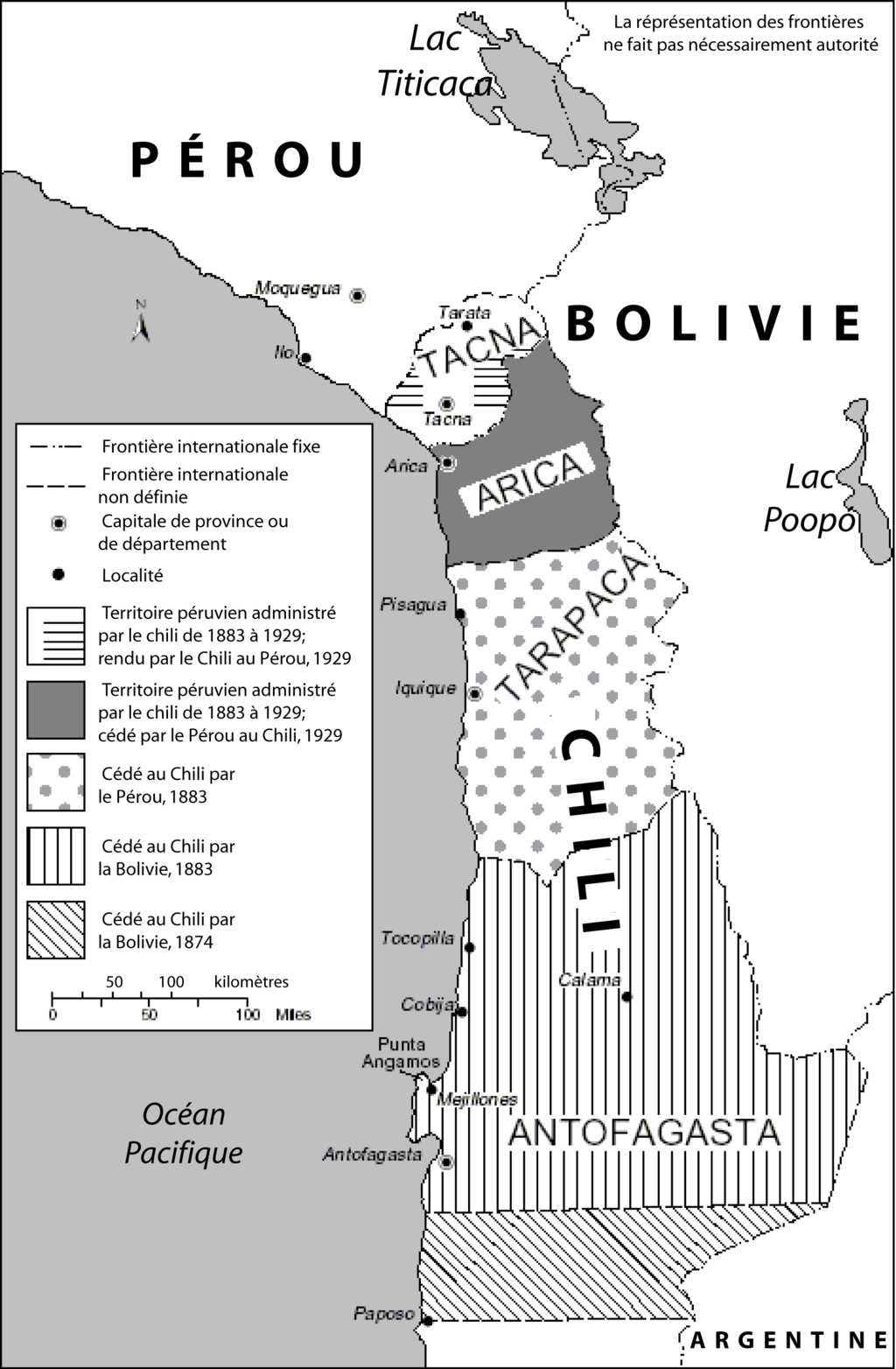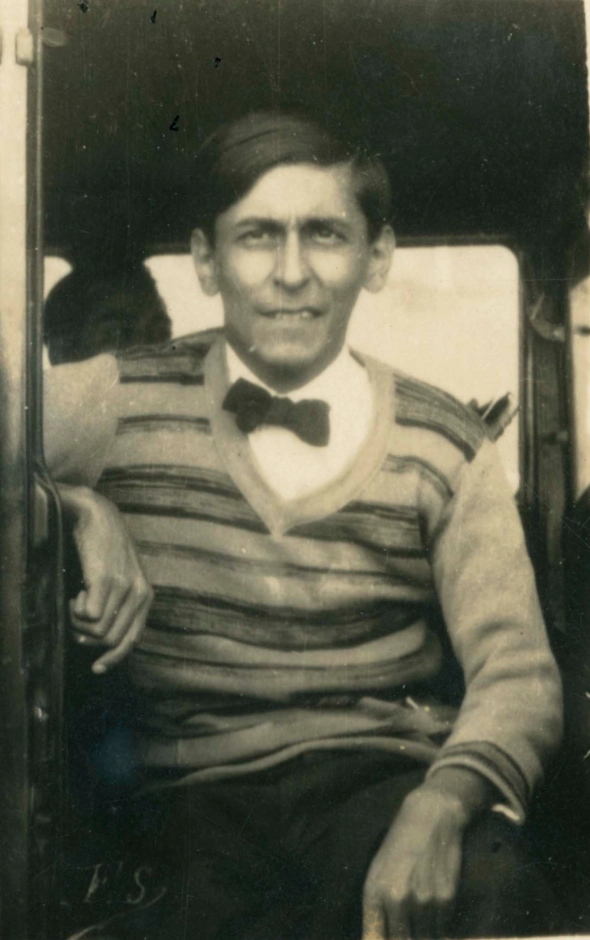Voici le discours clairement révisionniste de Maurice Thorez, à Waziers, le 21 juillet 1945. La convergence avec le capitalisme correspond très clairement à l’abandon des principes de Marx, Engels, Lénine et Staline, alors qu’au même moment Mao Zedong fait avancer la révolution chinoise.
PRODUIRE, FAIRE DU CHARBON
Chers camarades,
C’est pour moi, vous pensez bien, une grande joie d’avoir été chargé par le Bureau politique de présenter le compte-rendu des travaux du Xe Congrès de notre Parti communiste français aux délégués des organisations communistes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, à un moment, où, de l’effort des mineurs, dépend, dans une grande mesure, la renaissance de notre pays et l’indépendance de la France : une grande joie de me retrouver au milieu de tant de vieux camarades avec lesquels j’ai milité voici déjà près de vingt années.
Il me semble que dans la vieille mairie de Waziers, j’étais venu il y a vingt trois ans; celle ci, je l’ai inaugurée aussi il y a une quinzaine d’années.
Je songe à ceux des camarades qui ne sont plus ; à ceux qui sont tombés dans la bataille contre l’Allemand et contre les traîtres de Vichy; ceux à qui nous devons rester fidèles en comprenant quel est actuellement le devoir que nous avons à accomplir vis-à-vis de la classe ouvrière, vis-à-vis de la République, à l’égard de la France.
Le Xe Congrès de notre Parti a été un grand congrès. Grand par le nombre des délégués : plus de 1.300 ouvriers, paysans, fonctionnaires, intellectuels parmi les plus renommés, des francs-tireurs et partisans, des hommes, des femmes, combattants de la Résistance qui, dans toutes les épreuves, ont montré leur fidélité au pays et au communisme dans la grande bataille de ces dernières années.
Un grand congrès par le nombre même des membres de notre Parti. Dans le rapport que j’ai présenté, j’avais indiqué le chiffre de 900.000 cartes, expédiées par notre trésorier aux Fédérations. Le chiffre s’était élevé à 927.000 à la date du 30 juin. Nous allons vers le million, nous y serons bientôt.
Un grand congrès par la profondeur et le sérieux des rapports présentés ; par la profondeur et le sérieux des discussions ; chacun des délégués ayant à l’esprit :
« Comment travailler le plus activement, le plus efficacement à la renaissance du pays » ?
Un grand congrès par l’écho de nos décisions en France et hors de France : en France en dépit des consignes de silence données à la presse, en dépit de ce fait bien singulier qu’en 1937, nous avions obtenu que le discours de clôture fût radiodiffusé par tous les postes et qu’en 1945, alors que nous appelons le peuple à produire, la même radio nous a été refusée.
Un grand congrès par les manifestations émouvantes de solidarité agissante qui accueillirent les délégués des Partis communistes frères de l’Afrique du Nord, communistes d’Algérie, communistes du Maroc, communistes de Tunisie, luttant dans leur pays pour l’union confiante et libre de leur population avec le peuple de France dans une belle bataille pour la liberté et la démocratie ; manifestations de vibrant internationalisme lorsque s’élevaient les acclamations à l’adresse de Staline, le chef des peuples de l’Union soviétique, le chef de l’Armée rouge; manifestations d’internationalisme lorsque le congrès, debout acclamait en Dolorès Ibarruri le peuple d’Espagne en lutte contre Franco et que nous voulons aider à se débarrasser de Franco comme nous sommes parvenus à l’aider malgré la non intervention, responsable pour une grande part des malheurs qui se sont abattus sur la République espagnole; manifestations, acclamations envers les délégués des Partis communistes de la Belgique, de Suisse, qui étaient présents et envers le Parti communiste italien qui nous avait envoyé son salut.
Le rapport du Comité central que j’ai eu l’honneur de présenter, comprenait trois parties :
Une première partie : le compte-rendu d’activité du Comité central de notre parti depuis Arles, il y a presque huit ans, exposé de la politique nationale de notre parti, le seul Parti qui ait pratiqué la seule politique française, la seule politique nationale.
Une deuxième partie : une analyse de la situation actuelle, nos mots d’ordre pour terminer la guerre, furent unir, combattre, travailler et aujourd’hui toujours unir, combattre, travailler.
Une troisième partie : les questions intérieures à notre grande organisation.
Je voudrais aborder ces trois parties successivement.
La première partie du rapport comportait un rappel utile des événements et des attitudes des uns et des autres, établissant les causes véritables et les responsabilités dans la défaite et l’invasion de notre pays, dans les souffrances qui ont accablé notre peuple depuis 1939.
Nous sommes remontés au delà du Congrès d’Arles, jusqu’à l’avènement de Hitler, lorsque la venue au pouvoir du fascisme hitlérien en Allemagne, signifiait un grand péril pour les travailleurs de notre pays, pour la démocratie, pour la France.
Nous avions donné une juste appréciation du fascisme hitlérien, représentant des tendances les plus féroces, les plus rapaces de l’impérialisme germanique assoiffé de revanche contre notre pays. La classe ouvrière nous avait compris. Elle nous comprenait lorsque nous l’appelions à se grouper, à se rassembler dans la bataille contre le fascisme à l’intérieur, condition d’une résistance victorieuse.
Nous avons proposé et fait accepter par le Parti socialiste le Front unique contre la guerre et contre le fascisme en juillet 1934, et non pas, comme on l’a écrit récemment, après la signature du pacte franco soviétique, lequel ne fut signé qu’en mai 1935; nous avons fait accepter le Front unique après la première tentative d’assaut du fascisme le 6 février 1934.
C’est en 1934, que nous avons proposé, lancé et fait triompher l’idée du Front populaire pour la liberté. Quel Français, maintenant, pourrait douter que si le programme du Front populaire avait été appliqué rigoureusement par les gouvernements, bien des malheurs auraient été évités à notre pays ?
Car le programme du Front populaire ne comprenait pas le recul devant les provocations des cagoulards, pour ne parler que de cela sur le plan intérieur, et il ne comportait pas, sur le plan extérieur, la non intervention et la capitulation de Munich. Nous ne nous étions pas contentés d’unir tous les républicains dans le Front populaire, nous avons tendu la main aux travailleurs catholiques.
« Les curés avec nous », vous vous en souvenez, chers camarades, mais oui, les curés avec nous. Si bien des princes de l’Eglise ont été de parfaits hitlériens, la masse des catholiques est restée fidèle au pays. Combien de catholiques et combien de curés se sont battus côte à côte avec les nôtres, avec aussi des socialistes, avec des républicains de toute nature, dans un même combat contre l’Allemand et contre Vichy !
Combien sont tombés, combien ont payé de leur sang ! Bien malheureux ceux qui, à cette époque, se sont moqués de nous, parce que nous proposions l’unité avec les travailleurs catholiques, et qui maintenant pratiquent une certaine unité, qui n’est plus la main tendue aux travailleurs catholiques…
Nous avons proposé le Front français, l’union de tous les Français. C’était désirer éviter à notre pays la honte, l’horreur d’une dictature fasciste, alors que, de l’autre côté, les deux cents familles, les « trusts » comme on dit maintenant, voyaient en Hitler le gardien de leurs privilèges. Et il était de bon ton de dire chez certains : « Plutôt Hitler que le Front populaire ».
Ceux là se mirent à saboter l’économie nationale, à saboter la défense nationale, à provoquer les grèves comme le rappelait tout à l’heure Martel.
C’est vrai que nous seuls, les communistes, avons eu assez d’autorité pour pouvoir, en juin 1936, mettre un terme aux grèves, que nous seuls pouvions avoir assez d’autorité pour dire, il y a cinq mois : il faut finir avec les jeux de guerre civile et ne pas permettre des provocations contre la classe ouvrière et contre notre pays.
Sabotage, par les deux cents familles, de l’économie nationale, si bien que nous nous sommes trouvés en 1940, dans un pays qui est le plus riche en fer, le premier pays producteur de fer, nous nous sommes trouvés presque sans tanks, dans le pays qui est le premier producteur de bauxite en Europe, nous nous sommes trouvés presque sans avions.
Et l’oeuvre de trahison était poursuivie dans tous les domaines, non seulement dans le domaine économique mais dans le domaine militaire où les grands chefs ne croyaient pas à la guerre des moteurs; ils en restaient aux conceptions militaires de 1918.
Les chefs militaires, dont c’est le métier d’étudier la technique, ne comprenaient pas qu’une révolution dans la technique devait apporter une révolution dans l’art militaire ; alors que nous, les militants, nous comprenions mieux qu’eux comment se déroulerait la guerre, alors que nous, les militants, dès avant la guerre, nous indiquions dans quel sens pourrait se dérouler cette guerre.
Vous vous souvenez des campagnes que nous avons menées pour montrer ce que c’est que la guerre des tanks, la guerre de l’avion. Dans le domaine culturel, des écrivains, des artistes ne s’employaient qu’à empoisonner l’âme du peuple, à décrier tout ce qu’il pouvait y avoir de bon, de juste, de sain dans nos propos.
On nous proposait ce qui se faisait chez le voisin, c’est à dire chez le fasciste italien, chez le fasciste allemand. Il y avait un comité France-Allemagne où l’on trouvait tous ceux qui furent les ambassadeurs de Pétain : un François Piétri, et aussi un Jules Romain qui nous revient d’Amérique avec la prétention de nous faire la leçon.
Hitler jouait sur toutes les touches comme un bon organiste. Il jouait sur la touche ouvrière. Il avait, jusque dans les milieux ouvriers, ses agents qui prêchaient un pacifisme réactionnaire. On osait lancer cette formule déshonorante : « Plutôt la servitude que la mort ».
Jamais nous, communistes, même lorsque nous avons lutté dans certaines circonstances contre des guerres impérialistes, contre des guerres injustes, jamais nous n’avons été des pacifistes réactionnaires.
Toujours, nous nous sommes inspirés de cette recommandation : « Si on donne un fusil à ton fils, ne pleure pas ; dis lui qu’il apprenne à s’en servir ».
En même temps, ils organisaient leurs cagoulards. Il paraît qu’ils étaient plusieurs bataillons organisés à Paris avec un état-major, avec leur Deloncle dont le secrétaire M. Passy est actuellement le chef d’une police spéciale.
Le journal Combat dit que trop de cagoulards approchent encore actuellement les membres du gouvernement.
Ces cagoulards s’étaient livrés à une besogne abominable de provocations. Ces cagoulards avaient déposé une bombe dans les locaux de la rue de Presbourg pour pouvoir en accuser les militants ouvriers.
Heureusement, grâce à un journaliste courageux qui savait mener les campagnes, on a pu découvrir que ceux qui avaient déposé la bombe, c’étaient des ingénieurs de M. Michelin, M. Michelin de Clermont-Ferrand.
Toute cette politique de trahison et de désorganisation de la Défense nationale avait pour complément une politique de concessions et de capitulations devant le fascisme. Politique de capitulation inaugurée par Laval, lors des accords de Rome, destinée à livrer l’Abyssinie à Mussolini. Nous avons été seuls, alors, les communistes, à voter contre cette politique.
Et nous avons eu Munich, Munich, dont on disait :
« C’est la paix ». Vous vous souvenez, chers camarades, « Munich c’est la paix », et celui qui venait de signer la plus grande défaite diplomatique préparant la plus grande défaite militaire de notre pays, montait l’avenue des Champs-Elysées, dans une voiture découverte, debout et salué par des gestes à l’hitlérienne par les petits « crevés » de l’Action française.
Chers camarades, à ce moment là, un journal, Le Petit Parisien, ouvrait une souscription pour offrir une villa à M. Chamberlain, afin qu’il puisse se reposer d’une paix si chèrement gagnée.
Et nous seuls, comme Parti, nous avons pris la responsabilité, luttant contre le courant, de dire au peuple :
« On te trompe ; Munich, ce n’est pas la paix. Munich, c’est le noir complot contre les peuples, contre la démocratie, contre la France, contre l’Union soviétique. Munich, c’est le glissement irrésistible à la catastrophe ; il est encore temps, mais il est juste temps si nous voulons sauver la paix, empêcher la guerre ».
Cette politique alla en s’aggravant jusqu’en 1939. Plus le péril grandissait, plus nos gouvernants, aveugles ou traîtres, s’acharnaient à isoler la France.
La vérité sur 1939 : vous vous souvenez encore de ces journaux, chers camarades : la trahison de Staline, la trahison russe, la trahison des communistes ?
On nous avait bâillonnés, on avait interdit notre presse. Le député communiste Quinet, avait remplacé notre Humanité interdite, par une feuille ronéotypée.
On l’a arrêté, condamné à treize mois de prison. Il en est ressorti plus tard pour travailler avec nos militants dans l’activité clandestine contre les Allemands. Il est hélas ! tombé. Ils l’ont assassiné en Allemagne. Il a été l’une des premières victimes de la drôle de guerre, la victime des impérialistes !
Maintenant nous savons que toute la politique de nos gouvernants était une politique de sabotage du pacte franco soviétique. Maintenant tout le monde sait qu’ils pratiquaient ce qu’ils appelaient la politique des mains libres à l’Est, c’est à dire l’invitation à l’attaque contre l’Union soviétique.
Un texte publié à la veille de la guerre, en témoigne : c’est l’interview accordée par Vorochilov, le 26 août 1939, au journal les Isvestia :
« Ce n’est pas, déclarait alors le maréchal Vorochilov , parce que l’URSS. a signé un pacte de non agression avec l’Allemagne que les pourparlers militaires avec la France et l’Angleterre ont été rompus, mais au contraire, parce que les pourparlers militaires avec la France et l’Angleterre se trouvaient dans une impasse par suite de désaccords insurmontables ».
Voilà la vérité. Cette vérité, chers camarades, que beaucoup transformèrent. Nous l’avons su; nous l’avions entendu à la radio de Moscou et comme nous n’avions pas de journaux, nous avons essayé de ronéotyper nos nouvelles et de les distribuer dans toute la France. C’est pour cela que nos premiers militants ont été arrêtés, pourchassés.
Dans son livre publié aux États-Unis , Les Fossoyeurs , Pertinax confirme que les négociateurs français et anglais prétendaient reléguer la Russie à l’arrière plan, ne traiter avec elle qu’après avoir passé contrat avec Varsovie et Bucarest, la ravaler ensuite à la fonction de magasin de ravitaillement où Polonais et Roumains puiseraient à leur aise, selon leurs besoins sans même qu’une promesse d’alliance véritable lui eût été donnée…
La Russie, fournissant des armes, attirerait sur elle l’hostilité de Hitler, et subirait le contre coup des revers polonais. Mais elle ne serait pas autorisée à pousser ses soldats au delà du territoire national. Conception délirante !
Et voici ce qu’Ernest Bevin, chef travailliste, qui était encore, il y a quelques semaines ministre dans le gouvernement d’unité nationale de M. Churchill, a déclaré le mois dernier au congrès du Labour Party :
« Si nous, les travaillistes, nous avions été au pouvoir en 1939, nous aurions envoyé notre ministre des Affaires étrangères négocier avec Moscou ».
On ne peut pas mieux dire que les négociations de Moscou n’avaient pas été menées, du côté des gouvernements de Londres et de Paris, loyalement, avec la volonté d’aboutir à un accord.
En vérité, c’était un traquenard que l’on tendait à l’Union soviétique. On prétendait engager la guerre, une guerre où la Pologne devait s’effondrer rapidement, comme ce fut le cas, et ainsi les armées hitlériennes pourraient déferler rapidement à travers toute l’Union soviétique.
L’Armée rouge avait été mise dans l’impossibilité de préparer sa mobilisation, l’Armée rouge était dans l’impossibilité de faire face à l’agression. C’est vrai que c’était là le plan des provocateurs de guerre. C’était contre l’Union soviétique qu’ils voulaient engager la guerre.
Dans le journal Libération Soir, on a pu lire un extrait des carnets du comte Ciano, gendre de Mussolini, ministre des Affaires étrangères d’Italie. Il dit :
« Au début de 1940, j’ai reçu l’ambassadeur de Finlande, qui m’a remercié pour l’aide que nous avons apportée à son pays et qui m’a demandé des armes ainsi que des techniciens. J’ai répondu, ajoute Ciano : cela n’est possible qu’aussi longtemps que l’Allemagne n’interdira pas le trafic.
Le diplomate me répond que la chose est réglée et va jusqu’à me confier que l’Allemagne a déjà livré des armes à la Finlande, en particulier du matériel pris aux Polonais ».
Vous entendez, chers camarades, l’Allemagne livrait des armes à la Finlande.
Mais je lis dans le Journal officiel du 15 mars 1940, une déclaration de M. Daladier, disant :
« Depuis le 28 février, un corps expéditionnaire de 50.000 hommes est prêt à être embarqué pour la Finlande ».
Et je lis dans Le Temps du 9 mars 1940, que le ministre de l’Air Guy La Chambre avait envoyé 175 avions à la Finlande, avions pris sur les faibles moyens de notre armée de l’air.
Vous comprenez, chers camarades, les Allemands et les Italiens étaient en guerre contre les Français et les Anglais, mais tous ensemble envoyaient des armes, à la Finlande contre l’Union soviétique.
Dans le même moment, il y avait là bas, au Moyen Orient, une armée, l’armée Weygand, qui se préparait aussi à la guerre, non pas contre l’Allemagne, mais contre l’Union soviétique.
Ici également, une lettre adressée par le général Weygand au général Gamelin, le 17 avril 1940, trois semaines avant l’offensive de Hitler, en fait foi. Weygand dit :
« Au point où en est arrivée la préparation de bombardement des régions pétrolifères du Caucase, il est possible d’établir le délai au bout duquel ces opérations seront exécutées (suivent quelques détails techniques).
Ce délai est nécessaire à la Turquie, poursuit Weygand, comme l’a signalé M. Massigli, qui était alors ambassadeur en Turquie et qui est maintenant, hélas ! notre ambassadeur à Londres , pour qu’elle se mette, pendant qu’il s’écoulera, en état de faire face à toutes les actions ennemies qui pourraient se produire contre elle à la suite de ces bombardements ».
Ce n’est pas à bombarder les usines allemandes ni même à bombarder le chemin de fer qui court de l’autre côté du Rhin que l’on songeait, c’était à faire bombarder les centres de pétrole de l’Union soviétique.
C’était la guerre contre l’Union soviétique et la guerre contre le peuple français, la répression contre les militants de la classe ouvrière restés fidèles au peuple, sous le seul prétexte de notre fidélité à l’amitié franco soviétique. Mais, camarades, pourtant, où en serions nous sans l’Union soviétique ?
Où en serions nous sans l’Armée rouge ? Je me permets d’insister parce que ceux qui nous ont calomniés affreusement, loin de faire leur mea culpa, continuent à nous représenter comme un parti nationaliste étranger. Dans sa campagne contre l’unité, Léon Blum nous reproche de demeurer dans un état de dépendance psychique vis-à-vis de Moscou.
Il parle de notre attachement, il dit même « notre amour » pour l’Union soviétique. Chers camarades, et si même nous nous placions sur ce terrain, et si même nous avions cet attachement pour le grand peuple soviétique, pour le premier État socialiste, en serions nous de moins bons Français ?
En 1789, en 1792, les Anglais, les Allemands, les Autrichiens, les Espagnols, les Polonais, les Russes qui tournaient les yeux vers la grande Révolution française, qui vibraient à l’unisson avec les Jacobins, nos ancêtres, étaient ils de mauvais citoyens de leur pays ?
Je tiens qu’ils étaient les meilleurs citoyens de leur pays, parce qu’ils voyaient, dans cette Révolution française, la préfiguration de leur propre avenir, parce qu’ils fondaient une politique juste sur ce qui naît, sur ce qui se développe, sur ce qui doit être.
De même que nous, prolétaires et bons Français, en reconnaissant dans la Révolution soviétique certains traits d’un caractère universel qui préfigurent l’avenir vers lequel nous irons infailliblement selon des voies françaises, j’affirme que nous sommes les seuls à pouvoir préconiser et pratiquer une politique juste, conforme aux intérêts bien compris de notre pays.
Au contraire, ceux qui méconnaissent l’Union soviétique. ceux qui lui ont été constamment hostiles, ceux qui, dans leurs journaux, ne publiaient jamais une ligne favorable à l’Union soviétique, mais qui ont fait écho à toutes les campagnes anti-soviétiques, ceux-là ne pouvaient pas pratiquer une politique juste, ils ne pouvaient pas assurer l’amitié et l’alliance de notre peuple avec le grand peuple soviétique ; ceux-là, ils devaient aller, peut-être par attachement pour les conservateurs anglais, jusqu’à la non intervention et la capitulation de Munich.
Nous avions raison avant et pendant la « drôle de guerre » en menant le combat contre les munichois qui devaient nous conduire à la catastrophe.
Après l’interdiction de notre Parti, le 25 septembre 1939, le Comité central de notre Parti a eu raison de me faire passer à l’action clandestine. Je me suis placé à la tête du Parti avec tout le Comité central, au service du peuple dans la bataille contre les ennemis du peuple.
Certains appelaient cela une désertion ; nous appelions cela faire notre devoir vis-à-vis de la classe ouvrière, vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de la France.
Les premiers, lors de l’assaut hitlérien, nous avons été dans la bataille. Nous seuls, nous avons proposé de défendre Paris les armes à la main.
Le chef du gouvernement, qui avait déjà introduit Pétain dans son gouvernement et placé Weygand à la tête de notre armée, se refusa à accepter les propositions des communistes et nomma Dentz, le traître Dentz, gouverneur militaire de Paris. Le résultat, c’est que Dentz livra Paris à l’occupant.
Dès juillet 1940, nous lancions notre grand appel à la résistance.
« La France, disions nous dans un manifeste signé de Jacques Duclos et de moi même, et diffusé dans le pays à un million d’exemplaires , la France encore toute sanglante, veut vivre libre et indépendante. Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d’esclaves.
La France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé. La France, au passé si glorieux, ne s’agenouillera pas devant une équipe de valets prêts à toutes les besognes. Ce ne sont pas les généraux battus qui peuvent relever la France.
C’est dans le peuple que résident les grands espoirs de libération nationale et sociale, et c’est autour de la classe ouvrière, ardente et généreuse, pleine de confiance et de courage, que peut se constituer le front de la liberté, de l’indépendance et de la renaissance de la France ».
De Londres, le général de Gaulle lançait son appel, organisait les « Force françaises libres ». Nous menions la bataille de la résistance à l’intérieur de notre pays, la lutte contre les occupants, la lutte contre les traîtres, la lutte contre la révolution dite nationale avec sa démagogie, la lutte pour la libération.
La révolution par en haut, cela signifiait simplement la réaction. C’était la crainte de la révolution. Il n’y a pas de révolution si ce n’est le peuple qui l’accomplit, qui la réalise.
La « révolution nationale » de Vichy, sous le couvert d’une démagogie anticapitaliste et de la bataille contre les « trusts », mettait sur pied les Comités d’organisation où se retrouvaient les deux cents familles.
Pétain ne voulait pas entendre parler de la lutte des classes parce qu’il pratiquait la lutte de classe à sens unique avec ses gardes mobiles, sa police, sa gestapo, ses bourreaux, dont fut victime le jeune Caron, guillotiné à la prison de Cuincy, âgé de vingt ans, et qui disait aux bourreaux : « Vous faites un vilain métier, messieurs ».
C’était la lutte de classe à sens unique de Pétain et de ses agents, contre la classe ouvrière et contre le peuple de France. Vichy, ce n’était pas la révolution nationale, c’était la réaction antinationale, c’était un instrument au service de l’ennemi. Toute la France livrée à Hitler : nos hommes, nos ressources, nos matières premières, notre charbon, notre fer, nos locomotives, nos wagons, notre blé, notre bétail, notre vin, tout pour les Allemands, tout pour Hitler, afin qu’il puisse mener sa guerre contre le monde civilisé.
Nous nous sommes battus, nous, les communistes, appelant en même temps à la lutte tous les bons Français, organisant la classe ouvrière, organisant le peuple.
Dès juin 1940, nous manifestions à Paris. Un journal anglais, le Daily Telegraph, à ce moment, écrivait :
« Un seul Parti en France manifeste de l’activité contre les occupants, c’est le Parti communiste ».
En mai 1941, vous n’en avez pas perdu le souvenir, vous faisiez la grande grève des mineurs du Pas-de-Calais, contre les Allemands et contre les vichystes.
C’est le mois suivant que Hitler déclencha son agression contre l’Union soviétique. Il est évident que dès l’instant où Hitler se lançait dans une aventure aussi insensée, il allait à sa perte. Chaque Français, chaque homme de bon sens comprenait que les choses allaient changer. Un nouvel élan fut imprimé à la lutte de la résistance, au sabotage, à la grève.
Il devenait possible d’intensifier l’action armée, ne fût ce que pour cette raison de bons sens qu’au lieu d’avoir sur notre sol 60 ou 70 divisions hitlériennes, et les meilleures – qui étaient parties à l’Est se faire écraser par l’Armée rouge – nous n’avions devant nous que 20, 25 ou 30 divisions et pas parmi les meilleures. C’est alors que nous avons organisé les Francs-Tireurs et Partisans, notamment avec les camarades que nous avions dans le Pas-de-Calais, Debarge, Hapiot et d’autres.
Toute cette bataille s’est développée. Mais l’ennemi a usé de la répression, l’ennemi a pris des otages, les a fusillés par centaines. Au lendemain de Châteaubriant, certains, cédant au chantage de l’ennemi, donnaient l’ordre à la radio de ne plus tuer d’Allemands, et le peuple disait : « Nous en tuerons davantage, nous vengerons ceux qui sont morts » et le cri de : « Mort aux traîtres, mort aux envahisseurs » ! devenait, ici comme dans toute l’Europe opprimée, notre cri de combat.
Nous avons développé l’action armée et l’avons, en multipliant les petits groupes, combinée avec le sabotage, avec la lutte contre la politique de déportation, avec la lutte des paysans contre les réquisitions, nous l’avons combinée avec la préparation de toute une série de grèves partielles, préparation de la grande grève générale.
C’est tout cela qui a conduit à l’insurrection nationale, c’est tout cela qui a aidé si efficacement à la victoire des Alliés, au succès du débarquement et à la rapide campagne en France. Le général Eisenhower et le maréchal Montgomery, dans leurs visites respectives à Paris, ont tous les deux proclamé :
« On ne dira jamais assez ce que nous devons aux Forces françaises de l’Intérieur », dans lesquelles se trouvaient 90 % de nos Francs-tireurs et partisans.
Conclusion de cette première partie : la trahison des « trusts » ; le désarroi, la confusion dans tous les milieux, excepté dans notre Parti ; les masses populaires éclairées, guidées par notre Parti communiste qui a pris leur tête. Grâce au peuple, la France a sa place parmi les nations victorieuses.
L’AVENIR DE LA FRANCE
Mais il ne faut pas se faire d’illusions, et j’aborde ici la deuxième partie de ce rapport : notre pays est très affaibli. Pour nous libérer, malgré tant de sacrifices, et malgré tant d’héroïsme, nous avons eu besoin de nos alliés et nous aurons encore besoin de nos alliés pour l’oeuvre de renaissance de notre pays.
C’est pourquoi, nous suivons d’un œil si sympathique la Conférence des Trois Grands. Tous les Français de bon sens comprennent que l’accord étroit entre les trois grandes nations : les Etats-Unis, l’Angleterre, l’Union soviétique, fut indispensable pour arracher la victoire sur l’Allemagne hitlérienne et que leur accord demeure la condition d’une paix durable et solide.
D’autant plus que la victoire militaire ne signifie pas encore la liquidation du fascisme. Il subsiste encore bien des foyers de fascisme en Europe et dans le monde la réaction est encore forte et ne se résigne pas.
Elle ne pardonne pas à l’Union soviétique d’avoir joué un rôle décisif dans l’écrasement de l’Allemagne hitlérienne. La réaction, sur le plan international, s’efforce de diviser les forces populaires et progressistes, d’isoler la classe ouvrière. Elle recommence les campagnes antisoviétiques et anticommunistes. Nous avons vu les événements qui se déroulèrent en Grèce.
Nous voyons comment on essaie d’imposer de nouveau un roi aux Belges qui n’en veulent plus et nous voyons comment on empêche les Italiens de se débarrasser d’une dynastie qui a soutenu Mussolini, le fasciste, pendant vingt années. Nous voyons aussi comment les trusts internationaux s’efforcent actuellement de sauver la grande industrie allemande, cette base de l’impérialisme fasciste.
J’avais dit, dans mon rapport au Comité central, comment certains trusts. certains monopoles américains et anglais avaient entretenu non seulement avant la guerre, mais même pendant la guerre, des rapports avec des trusts allemands.
Voici l’information que nous avons eue par la suite. C’est un journal anglais qui dit :
« Les grandes industries de produits chimiques en Allemagne n’ont jamais été bombardées. L’immense édifice de l’administration centrale de l’I.G. Farben s’élève maintenant au dessus des ruines de Francfort. Pourtant Francfort a été systématiquement bombardé pendant trois ans.
On aurait pu penser que le grand centre industriel, vital pour le potentiel de guerre allemand, aurait été une des cibles les plus importantes de l’aviation. On se demande s’il ne faut pas chercher l’explication de ces faits étranges dans la politique par trop internationale des grands trusts ».
Ce n’est pas moi qui parle, c’est le journal anglais. Sous prétexte de faciliter le relèvement de ses ruines, on voit de grands trusts essayer de recommencer comme après 1914 1918 où, sous prétexte de permettre à l’Allemagne de payer les réparations, ils ont aidé l’industrie allemande.
On a facilité son essor. On a en quelque sorte permis l’armement de Hitler qui devait servir au déclenchement de la guerre contre tous les peuples civilisés et, en définitive, l’Allemagne n’a pas payé les réparations. L’Allemagne reçut beaucoup plus des capitalistes anglais, américains et français qu’elle ne nous paya.
Ce qui ne veut pas dire que, dans le scandale des réparations, certains, parmi les deux cents familles, chez nous, ne réalisèrent pas de belles opérations. Par exemple : MM. de Wendel qui avaient racheté pour une somme dérisoire de 750 millions, qu’ils ne payèrent jamais d’ailleurs, des entreprises évaluées à plus d’un milliard. Et ils les revendirent à Goering en 1940, pour une somme estimée à 15 ou 20 milliards.
Nous, nous estimons qu’il est juste que les Allemands réparent. Le peuple allemand porte une part des responsabilités, pas la même responsabilité que les chefs, mais les Allemands qui ont suivi leur Hitler dans son entreprise criminelle contre tous les peuples, doivent réparer. C’est d’une justice élémentaire. Ils doivent réparer en travaillant chez eux, chez nous.
Pourquoi n’iraient ils pas reconstruire nos villages qu’ils ont détruits, les usines et les villages polonais, et les villages soviétiques, et les chemins de fer ? Pourquoi ne seraient ils pas employés à déminer ? Actuellement, tant de jeunes Français meurent pour enlever les mines qui ont été placées par les Allemands.
Pourquoi ne les ferions nous pas travailler dans nos fosses où nous manquons actuellement de main-d’œuvre ? Les Allemands doivent payer. Encore une fois, c’est d’une justice élémentaire.
Voici que les groupements financiers sont plus intéressés au relèvement de l’agresseur allemand qu’à celui de notre pays et d’autres pays qui ont été envahis, ravagés et pillés par les Allemands. Et, dans le même moment, nous voyons la réaction en France qui s’efforce d’empêcher la reconstruction économique.
Hier, elle provoquait des actions inconsidérées. De là la décision de notre Comité central d’Ivry, demandant la dissolution des gardes civiques et de tous les groupes armés.
Aujourd’hui, chers camarades, de graves périls nous menacent dans le domaine de la production. On ne le sent pas assez.
Les mêmes gens, les mêmes groupements, qui ont provoqué la défaite poursuivent un plan diabolique de désorganisation et de désagrégation de notre économie nationale. Ils veulent créer le chaos et le désordre. Ils veulent créer une atmosphère de panique et de trouble qui serait propice aux entreprises de la réaction.
Il faut examiner, près d’un an après la Libération, le sombre tableau de notre situation économique. Certains disent : « Mais c’est que nous avons beaucoup plus souffert qu’après la guerre de 1914 1918 ».
Il est vrai que la destruction s’étend sur beaucoup plus de départements, mais elle touche surtout les maisons d’habitation et les transports, qui ont été particulièrement atteints. Notre appareil industriel de base est presque intact.
Vous le savez bien, nos houillères. à l’exception d’une partie de Béthune, de Noeux, de Bruay, et des autres concessions, plus à l’ouest, nos houillères étaient presque entièrement dévastées en 1918, noyées, toutes les installations de surface détruites. Il a fallu des années pour pouvoir revenir à la production d’avant guerre.
Actuellement, à part un outillage usé, nos houillères sont intactes. Nos grandes usines de la sidérurgie, nos hauts fourneaux pourraient travailler à 90 % de leur potentiel d’avant guerre.
Le problème décisif de l’heure, c’est le problème de la production. Vous le savez déjà, chers camarades, c’est ce qui m’a amené à Waziers ; c’est pourquoi le Bureau politique m’a envoyé vous parler, à vous, les mineurs. J’aborde ici une partie importante de mon rapport, la question du charbon.
LE CHARBON
C’est le problème le plus important à l’heure actuelle. Sans charbon, rien ne va, vous le savez bien, ni l’industrie, ni les transports ne peuvent fonctionner et, en premier lieu, sans l’augmentation de notre propre production, pas de reprise économique, pas de relèvement industriel, pas de renaissance nationale.
Déjà avant la guerre, nous devions importer le tiers environ de nos besoins, ce qui grevait lourdement notre balance commerciale, ce qui réduisait les possibilités d’essor industriel. Avant la guerre, notre consommation s’élevait en moyenne de 60 à 70 millions de tonnes. Nous produisions 45 à 50 millions de tonnes. Nous devions importer 20 à 25 millions de tonnes de charbon.
Et voici que la situation s’est aggravée en raison d’abord d’une diminution sensible de la production, et ensuite en raison des difficultés d’importation des autres pays qui ont également à satisfaire des besoins intérieurs et connaissent eux mêmes une crise approfondie et, soit dit en passant, même là où il n’y a pas de nationalisation.
Certains disent que la production charbonnière dans notre région baisse en raison des premières mesures, bien insuffisantes, de nationalisation…
En Belgique, en avril dernier, la production atteignait 1.036.000 tonnes de charbon, 46 % de la production de 1940 où elle était de 2.254.000 tonnes chaque mois.
En Angleterre, en Hollande, crise charbonnière.
Nous devons encore actuellement fournir, sur nos faibles ressources 300.000 tonnes chaque mois pour les besoins de l’armée alliée.
Je voudrais établir un fait pour montrer l’effort des mineurs. En janvier, la production brute s’était élevée à 2.700.000 tonnes contre, en 1938, une production mensuelle de 3.400.000 tonnes, c’est à dire 80 % de la production.
Le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, en janvier, avait donné 1.725.000 tonnes, en mars 1.900.000 tonnes contre une production mensuelle en 1938 de 2.350.000 tonnes, c’est à dire également 80 % de la production d’avant guerre.
En janvier, toujours dans notre bassin, le rendement individuel pour le fond, s’était élevé à 880 kg. En mars, il s’est même élevé à 913 kg. contre 1.156 kg. en 1938, également 80 % du rendement de 1938. Je ne cite pas le rendement des années ultérieures.
Un groupe ici à Douai a donné, dans les semaines du 19 au 22 avril une production qui égalait et parfois dépassait en certains puits celle de 1938, avec un total de 65.000 tonnes et un rendement de 1.155 kg.
Il est vrai qu’il s’est produit un fléchissement à partir d’avril, fléchissement dans la production et fléchissement dans le rendement.
Il y a eu diverses causes à cela : ravitaillement défectueux, manque de vêtements, et en raison d’un mécontentement plus ou moins justifié contre l’insuffisance de l’épuration. Il y a aussi des grèves, elles, très peu justifiées.
Il y a aussi, et n’en tiennent pas compte ceux qui font les campagnes contre les mineurs, toute une série de fêtes, fêtes religieuses, Ascension, lundi de Pentecôte et fêtes de la Victoire. Tout cela entraîne, dans un métier comme le métier des mineurs, une certaine désorganisation.
Ensuite nouveau progrès. La production en juin atteint dans notre bassin 1.650.000 tonnes. La dernière semaine du 25 juin au 1er juillet 383.000 tonnes, le rendement moyen 836 kg. Au groupe d’Hénin-Liétard 891 kg, au groupe de Valenciennes 901 kg.
Mais on est encore loin des chiffres de janvier et de mars. Ici, dans ce groupe de Douai, loin des chiffres d’avril, avec 46.000 tonnes et 865 kg. de rendement, pour l’ouvrier du fond dans la semaine du 25 au 2 juillet, contre 63.000 tonnes et 1.155 kg. pendant la semaine du 19 au 22 avril.
Il faut examiner honnêtement, loyalement les causes de cette situation qui est préjudiciable aux intérêts du pays et proposer des remèdes.
La première des causes, je l’ai dit au Congrès national de notre Parti, c’est la diminution du personnel occupé. En 1929, qui fut l’année de la plus forte production charbonnière, les houillères occupaient 330.000 ouvriers, dont 186.000 pour le fond. En 1945. il ne reste que 200.000 ouvriers au total, dont 140.000 seulement pour le fond, soit 25 %, un quart en moins, pour le bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Une diminution moyenne de 20 à 25 % des ouvriers dans une profession où la production générale dépend du facteur humain expliquerait déjà largement une baisse générale de la production de 20 % et expliquerait ensuite une perte du rendement individuel.
La diminution en ce qui concerne le fond porte surtout sur les ouvriers qualifiés, alors que le personnel occupé à transporter le charbon, galibots, rouleurs, etc… reste sensiblement le même.
La crise des effectifs risque d’ailleurs de s’aggraver avec le départ de nos camarades polonais, départ vers leur pays où ils sont assurés de trouver de meilleures conditions, un pays entièrement renouvelé.
La réaction proteste et protestera, prétendant empêcher les mineurs polonais de regagner leur pays, parce que les conditions économiques et politiques dans lesquelles étaient maintenus les mineurs polonais en faisaient une main-d’œuvre à bon marché, concurrençant la main-d’œuvre française.
Le premier remède, je l’ai dit à notre Congrès national, consiste à revaloriser la condition du mineur. Il faut améliorer ses conditions de salaire et ses conditions de sécurité, d’hygiène, de logement, il faut que le mineur trouve avantage à travailler de son métier.
Il y a quarante ans, il y avait, dans les mines de Marles et dans les mines de Bruay, des mineurs qui venaient depuis au delà de Frévent jusqu’à Doullens ; ils gagnaient 50 sous dans leur village et gagnaient ici 6 fr. 50 à 7 francs ; avec une demi heure de chemin de fer le matin et une l’après-midi ; ils se trouvaient bien plus avantagés que leurs camarades restés au travail des champs.
Il faut donner aux ouvriers mineurs du fond un certain salaire ; encore une fois, il faut qu’ils trouvent avantage à travailler de leur métier et qu’ils puissent engager leurs enfants à continuer à travailler au fond de la mine. Il faut que les mineurs aiment la mine.
D’ailleurs, ce n’est pas vrai que les mineurs n’aiment pas leur métier. Vous savez bien que je suis d’une famille de mineurs. J’ai assisté assez souvent, à la remonte, aux discussions entre mes oncles et le grand père qui était passionné et qui ne pouvait plus aller à la mine.
Chaque soir, il demandait : « Alors comment ça s’est il passé ? Qu’est ce que vous avez fait ? Et moi, j’aurais fait comme ça, et moi j’aurais fait autrement; je ne m’y serais pas pris comme cela, etc.. ». Il suivait au fur et à mesure avec ses fils l’avance des travaux.
Il connaissait tout. Est ce que tous les vieux mineurs ne sont pas ainsi ? Les vieux mineurs ont l’amour de leur métier comme les marins ont l’amour du leur.
Les prix à la tâche. On a accordé la possibilité d’une majoration qui peut aller jusqu’à 60 % et voilà que déjà on nous cite quelques groupes, où les ingénieurs réduisent les prix à la tâche. Je dis qu’il faut relever les prix à la tâche et les maintenir, payer les prix fixés, même et surtout si l’ouvrier gagne de grosses journées.
L’essentiel est d’obtenir du charbon et pour obtenir du charbon, il faut payer les sommes fixées.
Il faut payer les jeunes à partir de vingt et un ans comme des ouvriers. Un vrai mineur, c’est celui qui a commencé jeune, qui a été galibot, à condition qu’on reconnaisse ses mérites. Ce n’est pas bien, ce qui se passe dans telle fosse.
Je prends le n° 7. Des dizaines de jeunes gens de vingt à vingt cinq ans, et même parfois trente ans, sont maintenus comme herscheux [= ouvrier qui fait circuler les wagons], sous prétexte qu’on manque de main-d’œuvre. Il n’y a qu’à mettre à ces travaux des ouvriers du jour qui seraient remplacés avantageusement au jour par des jeunes filles et par des femmes.
Je pose pour vous, mes camarades mineurs, cette question. Il faut peut-être encore changer quelque chose même dans nos mœurs ici dans notre bassin minier en ce qui concerne le travail des jeunes filles et des femmes.
Vous savez qu’il y a une trentaine d’années, nos jeunes filles étaient servantes à Lille et à Paris parce qu’il fallait quand même aider un peu au ménage. Servantes à Lille et à Paris, c’était tout l’avenir. Puis on se mariait, et c’était fini.
Par la suite, entre les deux guerres, en particulier dans les régions d’Hénin-Liétard, de Lens, elles allaient travailler dans les usines du textile de la région lilloise.
Je dis qu’il faut, en même temps qu’on revalorise la condition du mineur, assurer les conditions du travail normal pour les filles et pour les femmes des mineurs.
Je le dis aussi pour ceux qui ont des idées réactionnaires sur ces questions, pour ceux qui sont, par exemple, partisans de la théorie « les femmes au foyer ». Il n’y aura pas d’émancipation de la femme aussi longtemps qu’elle n’aura pas elle même obtenu sa propre émancipation.
Mettre des jeunes filles et des femmes à une quantité de travaux au jour, à la surface, c’est permettre d’envoyer au fond ceux qui devraient s’y trouver.
Maintenant, et pendant une période transitoire, pourquoi ne pas mettre au fond ceux qui ont été volontaires pour le travail en Allemagne ? Comment, ces messieurs, lorsque Hitler leur a dit : « Venez travailler chez moi », y sont allés et ils reviennent maintenant et veulent reprendre leur vie tranquille ? Allez travailler au fond ! Vous y serez maintenant, enfin, utiles au pays.
Et puis, il y a les prisonniers allemands. D’une façon générale on peut et on doit occuper davantage les prisonniers, même en tenant compte que parfois il peut y avoir un rendement inférieur. A condition naturellement que l’on crée les conditions matérielles pour que ces prisonniers puissent produire.
Il ne s’agit pas de donner aux prisonniers le salaire des ouvriers mineurs: non, il s’agit de leur donner les conditions de ravitaillement nécessaire, de leur assurer les conditions de couchage, d’hygiène qui leur permettent tous les matins d’aller travailler et non pas de rester dans les cantonnements.
Il ne faut pas toujours nous amener ici des prisonniers officiers pour créer des camps militaires ; qu’on nous amène des prisonniers qui iront travailler ! Autrement, on ne sera pas long à nous dire: » Mais le rendement a encore baissé ».
Si nous avons 15.000 ou 20.000 prisonniers, cela ne nous fera que 10.000 à 15.000 journées et des demi-journées. On s’en prendra aux ouvriers mineurs du Nord et du Pas-de-Calais.
Et voilà la première raison : baisse du personnel. Remède: donner de meilleurs salaires, faire en sorte que le courant revienne vers les mines, qu’elles soient comme auparavant un aimant, c’est à dire qu’elles attirent ceux qui n’ont pas peur du travail et qui veulent gagner de grosses journées : donner du travail à la surface aux jeunes filles et aux femmes pour libérer la main-d’ouvre.
Mettre, dans les périodes transitoires, des volontaires du travail en Allemagne et occuper le plus grand nombre possible de prisonniers.
La seconde cause de la baisse de la production, du rendement, c’est la déficience physiologique des mineurs. C’est vrai que cinq années d’oppression, cinq années de privations ont amené une fatigue extrême.
C’est vrai que beaucoup de mineurs sont à la limite de leurs forces. Il arrive une heure où la machine humaine se détraque, s’affaisse, et c’est sans doute une des explications. Mais là encore, Martel a absolument raison, faut il ne pas répéter tous les matins aux mineurs : « Vous êtes usés, vous êtes usés ». Il faut apporter le remède efficace.
Il ne faut pas dire dans les rapports : « Les mineurs ont droit à 37 litres de vin par mois » ; il faut dire : « Les mineurs ont reçu 37 litres de vin par mois ». Il ne faut pas dire : « Les mineurs ont droit à 2,750 kg de viande par mois » ; il faut dire : « Le mois dernier les mineurs ont effectivement touché 2,750 kg de viande ».
Les rations ne doivent pas être sur le papier, mais dans la réalité : il faut de la viande, des matières grasses, de la bière, du vin, du café, des vêtements, des chaussures pour les mineurs.
Je puis vous dire, chers camarades, je le sais assez, je connais assez l’opinion dans toute la France, je visite assez les différentes régions de notre pays : il n’est pas un ouvrier dans une autre profession, il n’est pas un paysan, il n’est pas un seul Français qui ne soit prêt à accepter qu’on prenne sur sa propre part de beurre, de viande, de bière, de café et de vin si on lui dit
« Tout cela, c’est afin que les mineurs puissent donner du charbon ».
Une troisième cause, c’est la médiocrité de notre appareillage aussi bien que l’outillage individuel. Nous avons un outillage fatigué, d’un modèle usé. Et ceux qui comparent le rendement individuel du mineur français à celui des mineurs d’autres pays devraient en tenir compte.
Ainsi, il faut faire un gros effort. Il y a eu une progression de la mécanique. En 1914, 1,7 % du charbon en Russie était extrait par les procédés mécaniques ; en 1939, 95 %.
Chez nous, on manque de machines à air comprimé, de marteaux piqueurs, de lampes, de tuyaux. L’introduction d’un outillage perfectionné aurait permis d’économiser la peine des ouvriers en permettant l’augmentation de la production. L’outillage, c’est une grave question, c’est un grave problème. J’y reviendrai d’ailleurs.
En raison du manque de charbon, on travaille au ralenti ; en raison aussi d’un certain sabotage. C’est un cercle vicieux : pas de charbon pour les usines, les usines ne fabriquent pas d’outils pour les mineurs.
Il faut ici, chers camarades, saluer le sacrifice de vos camarades de la métallurgie qui viennent de renoncer à leurs vacances payées pour vous fabriquer des marteaux piqueurs.
Ce sont les mêmes camarades qui, l’hiver dernier, aux Forges et Ateliers de Meudon, manquant de courant électrique dans le jour, avaient demandé et obtenu de leur direction, de travailler la nuit par un froid rigoureux et sans supplément de salaire, pour pouvoir produire pour vous.
Une quatrième cause, absolument certaine quoique sujette à la controverse : c’est une certaine forme de résistance à la production et de sabotage de la part de certaines directions, de quelques employés supérieurs, de quelques ingénieurs qui n’ont pas encore compris que tout de même quelque chose a changé dans notre pays.
Ils demeurent plus ou moins dévoués à leurs anciens maîtres et gardent quand même l’espoir que ces anciens maîtres reviendront et reprendront tout en main.
C’est la conséquence aussi d’une épuration insuffisante, quoique ayant été prolongée indéfiniment. C’est la conséquence d’un système de nationalisation encore imparfait. Il est imparfait en raison, par exemple, de ce versement inadmissible d’une indemnité considérable aux anciens exploitants.
Car si nous admettons le dédommagement des petits actionnaires, nous ne pouvons admettre que l’on dédommage les barons de la mine, accusés de collaboration et qui doivent être frappés de confiscation de leurs biens comme tous les traîtres à la patrie.
Un système imparfait aussi parce que les leviers de commande sont très souvent aux mains de personnes qui ont intérêt à faire échouer ce premier essai timide de la nationalisation. Des faits, chaque minute, chaque délégué mineur nous en apportent.
D’une façon générale, c’est l’abandon parfois de veines à grand rendement, pour l’exploitation de veines plus dures à exploiter.
A la fosse Barrois, l’une des plus importantes d’Aniche, on se prépare à exploiter la veine 21, qui présente deux sillons de charbon de 0 m 35 séparés par un banc de terre de 0 m 50. alors que la veine 22, pour une même ouverture de 1 m 20, n’offre que 10 à 15 cm de terre.
Au puits Saint-René, on laisse un panneau de 5.000 t. Au grand moulin 112, on exploite une veine où 17 ouvriers font 30 balles par poste alors que pendant la guerre, dans la veine Laure, un ouvrier seul faisait 20 à 25 balles.
Quel est, ici comme ailleurs, le prétexte ? On prétend qu’il est nécessaire de revenir à une exploitation normale. Ce serait très bien si nous étions en période normale. Et il est inadmissible qu’on ne tienne compte des règles qu’après le départ forcé des Allemands et lorsqu’il s’agit de travailler pour la France.
Au 7 de l’Escarpelle, à Courcelles, on maintient 10 ouvriers dans une taille de 69 m complètement en cran, au lieu de les déplacer dans la taille au levant de la même veine.
A Thivencelles, on exploite une veine de 90 cm dont 80 cm de terre. De 20 balles remontées au jour, il reste, après le triage, 50 kg de charbon.
Et je pourrais continuer ainsi longtemps, ajouter à cela des méthodes défectueuses.
A la fosse Barrois, le triage commence à 7 h 30, ce qui retarde la coupe, puis gêne l’après-midi pour la coupe à terre qui fonctionne mal. Le matin, les mineurs perdent des heures, d’où baisse de rendement.
A propos de coupe à terre, pourquoi ne pas généraliser les 3 X 8 : deux postes au charbon, le troisième au remblai ?
Dans les services du jour : fours à coke, traction, etc., même gabegie, même sabotage. Des wagons demeurent chargés alors qu’on en manque. Ou bien, ils restent sur des voies de garage, faute d’une réparation minime.
On va me dire que ces faits ne sont pas probants ; il faut en discuter. Les ingénieurs, les agents de maîtrise doivent en discuter avec le comité du puits et porter éventuellement la chose devant les conférences, devant l’assemblée des mineurs, et dire : voilà dans quelles conditions nous nous trouvons, voilà ce que nous pouvons faire. Les mineurs donneront leur avis. Il y a encore des ingénieurs qui ont ce sentiment qu’eux seuls connaissent les conditions d’exploitation.
Ce n’est pas nous qui allons diminuer le moins du monde la valeur de la science et de la technique, mais nous savons aussi qu’un petit grain de pratique ne gêne en rien. Nous savons que les avis des ouvriers peuvent bien souvent influencer d’une façon très favorable les décisions des ingénieurs.
Je pense qu’en définitive la décision reste à l’ingénieur et qu’une décision doit être appliquée sur l’ordre de l’ingénieur, autrement il n’y a pas d’autorité possible, d’exploitation possible.
Il y a d’autres raisons de la crise du charbon sur lesquelles je voudrais m’expliquer aussi ouvertement et aussi franchement.
Ce sont celles qui tiennent à l’effort insuffisant des mineurs eux mêmes, à votre effort à vous.
Aux dernières informations, pour la semaine du 2 au 8 juillet, on indique une légère baisse de la production. Je dois dire que cette baisse provient uniquement de la baisse dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Dans la même période, les camarades de la Loire ont battu leur record et ils dépassent les chiffres d’avant guerre. Ici nous sommes à la traîne dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
C’est un fait bien regrettable que, dans nos bassins tout particulièrement, tous les mineurs ne soient pas encore parvenus à la conscience juste de la responsabilité qui pèse sur eux.
Les mineurs ont des raisons de se plaindre. Il y a des causes de mécontentement, mais ce n’est pas une raison pour ralentir l’effort. Il faut au contraire le développer et briser tous les obstacles. Vous croyez que les camarades de la Loire sont contents quand on leur envoie comme directeur l’ancien directeur épuré des Mines de Dourges ?
Ils ne sont pas contents non plus et vous croyez qu’ils ont dit pour cela : nous faisons la grève ?
Non. Martel a eu raison tout à l’heure de stigmatiser de telles attitudes. Ils n’ont pas cédé au courant public de démagogie et de vaine popularité. Comme disait Staline, nous ne craignons pas les difficultés, nous sommes faits pour surmonter les difficultés et nous les surmonterons.
Les mineurs doivent vaincre la réaction. Si les agents sabotent la production générale et la production du charbon afin d’empêcher la renaissance de l’économie nationale, c’est une raison suffisante pour qu’un ouvrier comprenant son devoir multiplie son effort de production. Il y a pas mal d’exemples de mineurs qui prétendent ne pas forcer à la production, ne pas pousser à la production et pas seulement parce qu’ils ont la crainte de voir baisser les prix à la tâche.
Par exemple, dans un rapport, je vois : « Nous avons des conditions assez normales mais si nous dépassons, on va nous baisser les prix à la tâche ». Il y a aussi le fait que ces camarades eux mêmes parfois ont peur de toucher de grosses quinzaines ; allons, disons le mot ils ne veulent pas paraître des macas [= un très bon ouvrier, dans l’argot des mineurs], n’est ce pas ? Eh bien, ce n’est pas juste. Il y a tout de même un intérêt différent.
Les macas, chers camarades, c’étaient ceux qui forçaient à la production pour le profit du patron au détriment de leurs frères, les ouvriers mineurs. Ils forçaient à la production pour faire baisser les prix à la tâche de leurs autres camarades.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’être un maca, il s’agit de produire afin que nous puissions accomplir, poursuivre, développer l’oeuvre de libération libération, non plus seulement maintenant du joug allemand, mais libération de toutes les entreprises de réaction, de toutes les entreprises fascistes.
Je veux d’ailleurs faire remarquer une chose, chers camarades, il y a des camarades qui disent: « Mais si je travaille davantage, je donne davantage aux actionnaires, puisqu’il reste des actionnaires ». C’est une erreur, chers camarades. Dans les conditions actuelles, mettez vous bien cela dans la tête, si vous avez peu produit, les actionnaires ont leurs 8 francs et si vous produisez beaucoup, ils ont quand même leurs 8 francs.
Je dis cela parce que cela ne doit pas vous arrêter, étant donné que si vous sortez plus de charbon, cela ne signifie pas qu’il y a un franc de plus pour les actionnaires. Par conséquent, même de ce côté, il faut écarter l’argument démagogique de ceux qui disent : « Si je produis beaucoup, c’est pour les actionnaires ». Si vous produisez beaucoup, c’est seulement dans l’intérêt du pays, et c’est dans votre propre intérêt.
Et puis, je veux revenir sur la question des absences. On parle, on donne beaucoup de raisons, de prétextes, à ce propos. Je dois vous dire, chers camarades, que je ne suis pas tout à fait convaincu des raisons qu’on donne pour justifier les absences.
Quand on me dit, par exemple, qu’à Notre-Dame, ou dans certaines fosses de l’ancienne concession, on a payé jusqu’à 27, 28, 30 % d’absences, je dis que c’est un scandale, ce n’est pas possible, cela ne peut pas continuer.
On s’absente trop facilement pour un oui ou pour un non et un mineur qui a le goût de son métier, sait très bien que tant d’absences entraîne une désorganisation complète du travail. Les camarades présents sont les premiers à en souffrir.
L’absence est justifiée ou n’est pas justifiée. Au lieu de produire, on désorganise la production, on fait tort à ses camarades, et pour quelle raison ? Parfois pour un oui ou pour un non, pour une égratignure. Je dis que c’est un scandale.
Je ne peux pas comprendre, par exemple, que des délégués à la Caisse de secours puissent donner des billets de malade sans journée de malade.
« Si tu es malade, tu auras ta journée de malade, tu auras tous les soins. Mais si tu n’es pas malade, tu travailleras, et si tu ne veux pas travailler, tant pis ».
Chers camarades, celui qui a le billet de malade sans journée de malade, il a aussi son ravitaillement ; il a aussi les litres de vin, il a aussi la viande ; il mange la part de ses camarades. Ce n’est pas possible, on ne peut pas continuer comme cela.
Il faut avoir plus de conscience. Je vais vous dire, mes chers camarades, que dans le bassin de la Loire la même question s’est posée pendant l’hiver quand il y a eu tant de grippes, quand il y a eu tant de difficultés alimentaires.
Le syndicat a réuni les délégués des Caisses de secours et leur a dit : « Épluchez les billets de malades et discutez avec les médecins » et on leur a dit : « Ces médecins, pour la plupart, ne sont pas vos amis. Ces médecins, ils donnent facilement les billets. Eux qui ont été longtemps les adversaires de la classe ouvrière, qui sont les ennemis des nationalisations, ils donnent facilement les billets de malade ; ils poussent à la désorganisation ».
Il va y avoir des élections à la Caisse de secours. Le syndicat doit demander que ces questions soient posées largement et dire aux délégués des Caisses de secours que vous allez élire : « Il faut être intransigeant ; c’en est fini avec de telles méthodes, parce que c’est de l’anarchie, un encouragement à la paresse ».
Voici un autre cas. On m’a signalé l’autre jour que dans un puits, le puits de l’Escarpelle, une quinzaine de jeunes gens, des galibots, ont demandé de partir à six heures pour aller au bal. Je dis que c’est inadmissible.
Vous le savez bien, chers camarades, j’ai été jeune aussi. J’ai été aussi au bal et j’ai dansé, mais je n’ai jamais manqué un seul poste, à cause d’une fête ou d’un dimanche, jamais. D’ailleurs, il n’aurait pas fait bon à la maison. Il m’est arrivé de rentrer à la maison à cinq heures, de passer les loques et de partir.
Je ne dis pas que la journée ait été très grosse, mais je n’ai pas manqué. Une fois, je l’ai raconté à mes camarades, j’avais 19 ans ; il m’est arrivé de travailler un lundi de ducasse [= une fête annuelle dans le Nord de la France et en Belgique, avec des processions, une kermesse, etc.] au poste de deux heures.
Je n’ai pas pu changer, je n’ai pas pu obtenir autre chose. J’ai travaillé au poste de deux heures et puis, la journée finie, je me suis lavé et j’ai couru à nouveau danser. Mais j’ai fait mon poste.
Chers camarades, ici je m’adresse aux jeunes et aux jeunes tout particulièrement. Il faut faire un effort. Je l’ai dit non seulement à cette assemblée, mais au Congrès de l’Union de la Jeunesse républicaine, à Paris. il faut surmonter la crise de la moralité qui sévit en général dans notre pays et qui atteint particulièrement notre jeunesse.
J’ai dit aux jeunes : il faut avoir le goût de son ouvrage, parce qu’il faut trouver dans son travail la condition de sa propre élévation et de l’élévation générale ; les paresseux ne seront jamais de bons communistes, de bons révolutionnaires, jamais, jamais.
Les mineurs courageux, ceux qui ne craignent pas la peine, ceux qui connaissent leur métier, ceux là ont toujours été les meilleurs de nos militants ouvriers, ils ont été les pionniers, les organisateurs de nos syndicats, les piliers de notre Parti.
Ici, chers camarades, je le dis en toute responsabilité au nom du Comité central, au nom des décisions du Congrès du Parti, je le dis franchement : il est impossible d’approuver la moindre grève, surtout lorsqu’elle éclate, comme la semaine dernière, aux mines de Béthune, en dehors du syndicat et contre le syndicat.
On a pris des sanctions. Sur quatre porions [= agents de maîtrise], on en a réintégré deux, en les rétrogradant d’ailleurs.
L’un de ces rétrogradés a été placé comme surveillant dans une taille avec des Allemands. Ce n’est pas si mal. On lui reprochait seulement d’avoir poussé au « carton » pendant l’occupation. « Eh bien ! va pousser maintenant les Allemands à faire du carton ». Ce n’est pas si mal, chers camarades.
On peut ne pas être satisfait de cette décision, on peut ne pas être content, mais on n’a pas le droit d’en empêcher l’application. Je le dis tout net : si nous n’appliquons pas les décisions de notre propre syndicat – je suis toujours un syndiqué du syndicat minier du Pas-de-Calais – nous allons à l’anarchie, nous faciliterons les provocations contre les mineurs, contre la classe ouvrière et contre la République.
Eh bien ! quelques camarades s’insurgent, ils déclenchent la grève au n° 2 et dans toute la concession, si bien que nous avons perdu 30.000 tonnes de charbon au moins, en une période où le pays a besoin de la moindre gaillette [= gros morceau de charbon], à l’heure où nous fermons des usines, à l’heure où dans la région parisienne, on arrête des entreprises faute de charbon, et ces ouvriers, dont on arrête les usines, apprennent que dans un des trous essentiels du bassin minier du Pas-de-Calais, on fait grève parce que le nez du porion [= agent de maîtrise] ne revient pas à un délégué.
C’est un scandale. c’est une honte, c’est une faute très grave contre le syndicat et l’intérêt des mineurs.
Des sanctions ont été prises, peut-être pas dans les formes où elles devaient l’être contre le délégué mineur et son suppléant. qui avaient couru les autres puits pour déclencher la grève. Je dis ouvertement que le mal, ce n’est pas la sanction ; le mal, c’est que des communistes et des militants du syndicat des mineurs se soient exposés à de telles sanctions.
Et, sous prétexte que l’on a sanctionné le délégué mineur, on recommence la grève jusqu’à jeudi soir, et on a eu de la peine hier à faire reprendre le travail, bien que le ministre de la Production ait rapporté la sanction prise par le commissaire régional. Ce n’est pas ainsi qu’on travaille pour le pays.
On ne peut pas épurer pendant 107 ans. On ne peut pas, pendant des mois et des mois, avoir des porions [= agents de maîtrise] qui sont payés en restant chez eux et entretenant l’agitation.
Et puis, entre nous, sérieusement parlant, les porions, quand ils n’ont pas été des chiens, se révélant comme de vrais collaborateurs, ne sont pas les plus mauvais ; ce ne sont pas eux les principaux responsables.
Ce ne sont pas même les ingénieurs, c’est encore plus haut qu’il faut frapper. C’est pourquoi nous demandons de véritables nationalisations et la confiscation des biens des traîtres.
Il y a mieux ou pire. Voilà les agents de maîtrise et les employés des mines de Bruay qui décident de faire la grève. Vous voyez d’une part une exigence d’épuration contre les porions, contre les agents de maîtrise et d’autre part la grève pour soutenir les revendications des porions et des agents de maîtrise.
Chers camarades, alors on veut à chaque fois faire la grève, pour épurer ou pour soutenir. On pourrait au fond en définir le seul but : faire la grève pourvu qu’il y ait un prétexte. On fera la grève, cela fait plaisir au porion. Ce n’est pas sérieux.
Je voudrais attirer votre attention sur ce point, sur ces agents de maîtrise et employés qui se sont pris d’un tel zèle pour la grève. Je n’ai pas vu beaucoup de porions faire la grève en 1920, ni en 1922, 1923, ni en 1931, ni même en 1936 et moins encore en 1941.
Comment, je le dis sans acrimonie, voilà des hommes qui, par tradition, étaient des briseurs de grève, allaient travailler sous la protection des gardes mobiles, pendant l’occupation de l’armée allemande, et les voici maintenant qui, tout feu tout flamme, veulent faire la grève et entraîner les autres à la faire ?
Il y a des mineurs qui n’auraient pas assez de bon sens pour comprendre qu’on veut les tirer par le bout du nez et les conduire à tout prix dans une aventure.
Je vous fais juges : vous verrez combien de journaux de Paris parleront des conseils que je viens de vous donner pour la production. Il n’y en aura pas, sauf l’Humanité . Mais faites une grève d’une demi heure, dans la plus petite fosse, à 10 ouvriers, tous les journaux de Paris, avec un grand titre, en parleront.
L’autre tour, on m’a parlé d’une grève possible des mécaniciens d’extraction. J’ai beaucoup de sympathie pour la mécanique d’extraction. C’est vraiment un travail qui comporte une lourde responsabilité, et on trouve chez les mécaniciens d’extraction une grande conscience professionnelle.
Je pense qu’il faut leur assurer les meilleures conditions de salaire et de travail. Mais là encore, pas par la grève. Comment, vous êtes deux et parce qu’à deux vous avez décidé de faire la grève, vous allez empêcher mille ouvriers de travailler ? Ce n’est pas possible, voyons, il faut être plus sérieux.
Ici encore, on emploie les mêmes méthodes. On essaie par tous les moyens, chers camarades, de pousser et de profiter.
Je voudrais vous faire comprendre, je voudrais que ce que nous pensons au Comité central puisse passer dans la tête, dans le cour de chacun de vous ici, militants communistes, secrétaires des organisations, délégués mineurs, délégués les plus responsables ; chez vous d’abord, puis chez tous les mineurs communistes, chez tous les syndiqués, chez tous les mineurs, que produire, produire et encore produire, faire du charbon, c’est aujourd’hui la forme la plus élevée de votre devoir de classe, de votre devoir de Français.
Hier, l’arme, c’était le sabotage, mais aujourd’hui l’arme du mineur, c’est produire pour faire échec au mouvement de réaction, pour manifester sa solidarité de classe envers les ouvriers des autres corporations. Le travail, la production sont subordonnés à l’effort des mineurs.
Pour préserver et pour renforcer l’union de la classe ouvrière avec les travailleurs des classes moyennes, avec les masses paysannes, pour assurer la vie du pays, pour permettre la reconstruction économique, pour permettre la renaissance morale et culturelle de la France, chers camarades, au nom du Comité central, au nom du Parti, au nom de tous les travailleurs, je vous dis : « Toute la France a les yeux fixés sur vous ; toute la France attend des mineurs, et tout particulièrement des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, un nouvel et grand effort ».
Songez que la situation est difficile et demeurera difficile encore longtemps.
Songez que nous allons connaître un hiver qui sera sans doute plus rude que l’hiver précédent, que les usines seront fermées, que les femmes et les enfants auront froid pour le sixième hiver et, dans ces conditions, la moindre défaillance de votre part nourrirait toutes les campagnes des ennemis du pays contre vous, contre toute la masse ouvrière.
Avec le même héroïsme dont vous avez fait preuve sous l’occupation dans la bataille contre l’occupant, il faut vous dépenser pour la production. Je suis sûr que nous gagnerons la bataille de la production comme nous avons gagné la bataille contre l’occupant.
Électrification. – On peut faire passer de 10 à 50 milliards de kilowatts notre production électrique, jusqu’à la fin de 1947, il nous serait possible de disposer de 7 milliards de kilowatts en plus. Dans un autre ordre d’idées, la seule électrification des chemins de fer économisant 10 millions de tonnes de houille, permettrait de rallumer nos hauts fourneaux.
Nous en avons 12 en activité sur 207 . Il y a quelques semaines, deux viennent encore de s’éteindre dans la Sambre. Alors que nous avons du fer, alors que nous pourrions en avoir encore, on nous dit : il nous faut le coke de la Ruhr, le coke de la Sarre.
Mais de 1914 à 1918, quand ces deux bassins se trouvaient aux mains des Allemands, avions nous le coke de la Sarre, le coke de la Ruhr ? On pourrait échanger avec la Belgique du coke contre du fer, on pourrait surtout produire davantage chez nous. Ici aussi il y a un sabotage systématique.
Toute notre industrie mécanique est à réorganiser. Nous avons l’outillage le plus désuet et n’avons que 550.000 machines outils.
Les Anglais et les Américains ont un matériel beaucoup plus perfectionné. Imaginez ce que va être la concurrence si nous ne parvenons pas rapidement à importer quelques dizaines de milliers de machines outils perfectionnées et à en construire nous même.
Où irons nous ? Les patrons ont réussi jusqu’ici à empêcher qu’on introduise de nouvelles machines. Ils craignent la concurrence; ils sont routiniers, et il faut dire aussi à leur décharge que l’Administration des Finances ne les encourage pas ; elle ne veut pas leur dire à quelles conditions ils pourront ensuite s’acquitter.
Et je ne parle pas des actes de sabotage avérés ; refus de 10 camions chez Genève, à Ivry, parce que la peinture n’avait pas la couleur voulue.
Refus de camions chez Paquette, à Bagnolet, parce que les caisses étaient en peuplier, alors qu’elles étaient prévues en sapin.
Dans les chemins de fer, c’est un millier de wagons immobilisés à Sotteville.
A Jarville, 25 wagons de bauxite sont restés à quai d’août 1944 à mars 1945.
A l’origine de tous ces sabotages, on retrouve tout jours les Comités d’organisation.
En résumé, d’abord travailler. Je répète : avoir à l’esprit toujours cette pensée, et pour produire appliquer le programme du Congrès national de la Résistance : liquider Vichy, complètement, les institutions de Vichy, l’esprit de Vichy, les Comités d’organisation de Vichy qui subsistent encore sous l’appellation d’ « Offices professionnels » ; épurer, châtier les traîtres, confisquer leurs biens et procéder aux véritables nationalisations réclamées dans le manifeste du Parti communiste et du Parti socialiste, avec une participation plus grande des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers ; l’administration des entreprises disposant d’une plus large autonomie dans leur exploitation, dans leurs possibilités commerciales et financières.
LE RENOUVELLEMENT DE LA DÉMOCRATIE
N’est il pas vrai, chers camarades, que nous avons des raisons d’être inquiets ? N’est il pas vrai que jusqu’ici notre République n’en a que le nom ? Nous vivons sous un régime provisoire qui se prolonge.
Après les élections municipales, on pouvait croire qu’il y aurait quelques changements, le peuple avait signifié clairement sa volonté. Le peuple tout entier, hommes et femmes, avait voté pour la Résistance, pour la démocratie.
Nous, communistes, nous avons toujours fait confiance aux femmes. Nous avions pensé que, dans l’ordre général, il se pourrait que les femmes votent mieux que les hommes.
Nous ne nous sommes pas trompés. Les résultats du vote en France signifiaient que le peuple demandait qu’on en revînt à la démocratie ; eh bien ! rien n’a changé, et même la situation s’est plutôt aggravée.
Par exemple dans l’armée : au lieu de se hâter d’organiser une véritable armée républicaine par l’amalgame de nos divisions réorganisées en Afrique et de toutes nos Forces françaises de l’Intérieur, nos bataillons innombrables de Francs-Tireurs et Partisans, on chasse les officiers FFI, on les écarte alors qu’on maintient aux postes les plus éminents des pétainistes notoires.
Notre Xe Congrès a réclamé une Assemblée constituante souveraine. On nous propose un double vote :
un référendum d’une part, et d’autre part, un vote pour des hommes dont on ne saura pas ce qu’ils sont au moment où nous voterons : des élus à une Chambre des Députés ou des élus à une Assemblée constituante qui pourrait être, dans un cas, vraiment souveraine et, dans un autre cas, simplement une prolongation de l’actuelle Assemblée consultative dont on demande les conseils pour ne jamais les suivre.
On nous propose de choisir entre la Constitution de 1875 qui est morte et bien morte et qu’on ne ressuscitera pas, et la prolongation des méthodes de pouvoir personnel.
Fait plus grave, chers camarades, le chef du gouvernement engage son autorité, dans un grand discours où il ne craint pas de dire qu’une Assemblée unique, ce serait la dictature. Comment peut on assimiler une assemblée élue par le peuple à une dictature ?
Si le chef du gouvernement a une telle notion de la démocratie, comment voulez vous que nous ne puissions pas dire que c’est là l’expression de la crainte du peuple, la crainte devant les forces nouvelles ; et comment ne serions nous pas d’accord avec nos camarades de L’Aube lorsqu’ils disent que le référendum qu’on nous propose, c’est une tentative pure et simple d’escamotage de la Constituante souveraine ?
Nous sommes d’accord. Le Parti communiste n’accepte pas ces escamotages et les ministres communistes les ont combattus. Nous voulons que les choses soient claires. Les communistes disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent.
Devant ces faits, le CNR. et les États-généraux unanimes décidèrent d’imprimer un bulletin de vote exigeant une Assemblée constituante souveraine et voilà que ce même jour, le 13 juillet, on a donné de nouvelles explications entortillées disant qu’une troisième réponse pourrait être ajoutée. On pourrait répondre oui oui, non non. Imaginez une telle façon de voter.
Tout cela est fait pour diviser les républicains. Le oui-oui, non non, c’est pour appeler à se diviser ceux des républicains qui pensent qu’il ne faudrait qu’une seule Chambre et ceux des républicains qui pensent qu’il faudrait deux Chambres.
L’essentiel pour les républicains, c’est que le gouvernement soit sous le contrôle des élus de la nation. Tous sont unis sur ce point, ainsi qu’en témoigne le vote unanime de la question préalable à la Commission de l’Assemblée consultative.
L’UNION NÉCESSAIRE
Ici également, il importe de déjouer les manœuvres de division, telles celle tentée par cette « majorité » du Mouvement de Libération Nationale qui prétend unir tout en jetant l’exclusive contre les radicaux et contre les communistes.
Et maintenant, elle exclut du M.L.N. les représentants de la « minorité », c’est à dire qu’en fait elle crée la scission.
Cela n’est pas surprenant si l’on songe que M. Frenay, l’ami de Pucheu, siège à la majorité du M.L.N.
L’union de tous les républicains, c’est d’abord l’unité de la classe ouvrière. Il faut dire partout, dans tout le pays, dans les réunions intérieures de notre Parti, il faut dire aux camarades socialistes : il est impossible que nous recommencions comme avant la guerre à nous quereller, à nous chamailler, à nous disputer et à nous battre au profit de la réaction.
N’est il pas vrai qu’il y a vingt cinq années, à Lens, à Hénin et en quelques autres localités, nous ne nous disputions pas seulement, nous nous battions avec nos camarades socialistes ? Il y avait des divergences.
Ce n’était pas seulement des petites querelles de tempérament et de caractère, mais il y avait des divergences sérieuses. La vie a aplani ces divergences. Nous ne pouvons pas revenir à cela.
Je pourrais raconter comment j’ai été jeté en bas d’un mur, à Béthune, à coups de perche par les socialistes. Nous allions à une manifestation. J’y allais pour porter la contradiction à Dumoulin et à quelques autres, tous du même acabit, et puis je repris le train le soir à Béthune.
Sur le quai de la gare de Béthune, un vieux camarade, un réformiste, j’ai toujours conservé cette scène dans mon esprit, est venu vers moi.
C’était un jeune homme alors : il me dit: « Alors tu es content, tu t’en vas toucher tes sous ? » Comprenez, chers camarades, vous riez, moi je ne riais pas, je vous assure.
Vous comprenez que ce militant socialiste avait la conviction honnête et sincère que nous faisions, pour le compte des compagnies, une politique de division de la classe ouvrière.
J’ai discuté avec lui : « Vous dites des bêtises : d’abord vous me connaissez mal ; vous pourriez vous informer, vous pourriez savoir qui je suis, qui est mon père, qui est mon grand père. Vous auriez su que je suis d’une famille de militants syndiqués ».
J’ai commencé à discuter avec lui, mais au point de départ, l’accrochage avait été un peu rude. Cela m’est toujours resté dans l’esprit, et vous savez bien, camarades du Pas-de-Calais, du Nord, vous savez bien ici dans cette région, que j’ai toujours bataillé pour l’unité.
Je savais qu’il y avait, chez les socialistes, des dirigeants qui ne valaient pas cher, mais ce que je savais aussi, c’est qu’il y avait de bons ouvriers que nous devions gagner. Si on recrute des militaires dans le civil, il faut bien que nous allions recruter quelque part ceux qui sont dans notre Parti. Nous sommes 900.000 ; il faut bien qu’ils viennent de quelque part. Nous avons gagné les socialistes.
Les ouvriers socialistes, comme les communistes, veulent l’unité ; ils comprennent quelle force ce serait si nous parvenions à l’unité. Quel avenir lumineux s’ouvrirait pour la classe ouvrière et pour notre pays.
Regardez déjà aux élections municipales, quel succès ? A une Assemblée nationale constituante, si nous étions unis dans un seul parti, je vous assure que nous ne serions pas loin d’être la majorité.
Je ne peux pas comprendre qu’on puisse se refuser à travailler à un tel avenir pour la classe ouvrière.
Notre Parti a élaboré un projet de charte, sur la base des principes du socialisme de Marx et d’Engels, enrichi par Lénine et Staline.
Ensemble, socialistes et communistes, nous discuterons et nous déciderons des principes, des méthodes, des cormes d’organisation du Parti ouvrier français.
Certains objectent le climat. Le climat n’y serait pas. Chers camarades, je vous demande si le climat n’y est pas, après les épreuves de la guerre, après que tant de socialistes se sont battus au coude à coude avec les communistes contre l’ennemi commun !
Quand nous avons tant de héros qui sont tombés côte à côte, quand le sang a été versé en commun, si les conditions ne sont pas réunies, nous n’aurons jamais l’unité.
Ce n’est pas vrai. Ceux qui disent que le climat n’y est pas, ce sont ceux qui sont contre l’unité et qui n’osent pas le dire, qui entortillent tous leurs raisonnements afin de s’opposer à l’unité. En tout cas, que faut il faire ?
Puisqu’on nous dit qu’il faut d’abord préserver l’unité d’action, eh bien ! il faut accepter les propositions que notre camarade Jacques Duclos a formulées à notre Xe Congrès : il faut dire que le Comité directeur du Parti socialiste et le Comité central du Parti communiste tiendront des séances en commun, que leurs bureaux politiques se réuniront en commun ; nous mettrons en commun tous nos efforts.
Nos camarades socialistes écriront dans l’Humanité et nous écrirons dans Le Populaire. Nous offrirons les colonnes de Liberté et nous écrirons dans leurs journaux. Ainsi nous préparerons le meilleur climat s’il faut préparer le climat.
De nombreux camarades socialistes approuvent nos propositions à Paris et en province, dans la Seine, la Somme, les Côtes-du-Nord, les congrès fédéraux du Parti socialiste se prononcent pour l’unité organique.
LE PARTI
Et maintenant, très rapidement, la troisième partie il s’agit des questions intérieures du Parti.
1° Nous avons toujours été fidèles à la cause du peuple. Nous sommes restés constamment à la pointe du combat contre le complot hitlérien, ayant une politique résolument nationale, résolument française.
2° Nous avons toujours défendu avec acharnement les intérêts des travailleurs, les intérêts des malheureux. Nos élus dans les municipalités, dans toutes les assemblées, nos camarades dans les syndicats, dans les grandes organisations, les coopératives, ont travaillé au mieux des intérêts de leurs camarades. Nous avons été le parti de la protection de l’enfance, du soutien de la famille. de la retraite pour les vieux.
3° Nous avons toujours servi avec passion la cause de l’unité, unité de la classe ouvrière, unité entre Français.
4° Nous avons toujours été fidèles à notre idéal communiste, aux principes du marxisme léninisme.
5° Dans la bataille, nous n’avons jamais renoncé et jamais reculé devant tous les sacrifices imposés. Des milliers des nôtres sont tombés : membres du Comité central dont on rappelait tout à l’heure les noms, militants de cette région du Nord : les frères Martel, Hentgès, Froissard, les frères Camphin, nos délégués mineurs comme Noël, et tous les autres.
Nous sommes devenus un grand parti, un parti de gouvernement, un parti qui a des militants dans les hautes administrations, un parti dont la voix est entendue dans tout le pays, qui est écoutée, dont on suit les indications, les conseils.
Noblesse oblige ; nous devons être fidèles à nos morts. Nous devons être dignes de la confiance que nous accorde la classe ouvrière, que nous accorde le peuple.
Il faut éduquer nos ouvriers, leur apprendre l’histoire du Parti, leur apprendre les enseignements de notre parti, leur montrer qu’il faut savoir être fier et intransigeant en matière de principes, leur apprendre que nous avons forgé notre Parti dans une bataille de vingt-cinq années, une bataille intransigeante contre toutes les déviations opportunistes et sectaires.
Vous vous en souvenez, camarades du Nord et du Pas-de-Calais, des batailles que nous avons menées ici même à Douai, il y a de cela une vingtaine d’années, quand nous avons battu les tendances opportunistes, et dans le Pas-de-Calais, quand nous nous sommes battus contre l’élément sectaire et opportuniste. Nous avons développé la lutte contre les sectaires qui voulaient étouffer notre Parti.
Les communistes doivent avoir la possibilité d’émettre librement leurs opinions dans le Parti, discuter de tous les problèmes du Parti. Il va de soi qu’une fois la discussion terminée, la décision prise, tout le monde doit appliquer la décision, majorité comme minorité.
Par exemple, où en serions nous si nous avions permis à Doriot de développer dans le Parti des opinions opportunistes ? Est ce que notre Parti aurait pu accomplir sa tâche à la tête des masses si nous avions laissé gangrener notre Parti ? Luttons donc contre les éléments de provocation qui se sont glissés dans notre Parti.
Dans le domaine de l’organisation, il faut prêter une grande attention au travail des cellules et des sections.
Moins de paperasse et de bavardages inutiles. Il faut prendre des décisions et veiller à leur application; aider les secrétaires de cellule. Peut-être est il nécessaire de décentraliser.
Il y a encore des camarades qui disent que nous manquons de cadres. Si nous manquons de cadres maintenant, qu’aurions nous dit, il y a quinze ans ?
Les camarades qui disent cela sont des camarades qui travaillent mal ; ce sont des camarades qui ne découvrent pas toutes les richesses qui sont autour de nous dans le Parti et dans la classe ouvrière, qui ne voient pas toute cette jeunesse.
Il faut faire confiance aux jeunes, il faut faire confiance aux femmes, il faut faire confiance aux vieux camarades expérimentés. L’enthousiasme des jeunes, l’expérience des vieux, voilà de quoi faire un bon mélange et même un mélange étonnant qui pourrait, dans tout le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, nous conduire à une meilleure production charbonnière si tous nos militants s’y attachent.
Il est vrai aussi que parfois les camarades se considèrent arrivés quand ils sont délégués mineurs, ou maires, adjoints ou directeurs de coopérative, ou secrétaires d’une grande section. Eh bien, non, chers camarades. Il ne s’agit pas de se laisser tourner la tête, il ne s’agit pas d’avoir le vertige du succès.
Plus nous avançons, et plus nous avons de responsabilités, et plus la tâche devient difficile, et plus il faut être attentif.
Les camarades qui ne sont pas attentifs, ceux qui se laissent peu à peu absorber par le train train, qui oublient, qui perdent de vue le combat nécessaire de tous les instants, ceux là commettent des erreurs, commettent des fautes.
Il faut savoir faire notre mea culpa, reconnaître qu’on a commis une faute. Lorsqu’on s’est trompé, il faut le reconnaître.
La grande tâche pour les organisateurs communistes du Pas-de-Calais, c’est d’aller dans toutes les concessions de Béthune, il faut aller à Béthune, il faut réunir toutes les sections communistes, discuter avec chaque camarade, et amener les délégués mineurs à reconnaître qu’ils ont commis une grande erreur, qu’ils doivent comprendre cette erreur et qu’ils ne doivent plus recommencer cette faute.
Chers camarades, je vous le dis : dans notre Parti, il n’en sera pas comme dans d’autres partis, nous avons trop le souci de nos responsabilités pour permettre que chacun fasse ce qui lui plaît. Nous exigerons de chaque camarade le respect des décisions du Xe Congrès du Parti, et le Xe Congrès du Parti a dit : « Il faut produire ».
C’est à la volonté qu’ils mettront pour produire que nous jugerons nos militants dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Ce Congrès a élu, en conclusion de ses travaux, un Comité central. Nous avons réélu 29 camarades ; un est mort, malheureusement. Parmi ces 28 camarades, ici chez nous, nous avons Ramette, nous avons Martel, nous avons Bonte, du Nord.
Nous avons Tournemaine, du Nord, de Somain ; peut-être aussi un petit peu moi et puis nous avons 41 nouveaux camarades, des anciens chefs des FTP, des militants, des ouvriers, de grands intellectuels, et des femmes qui ont donné les preuves de leur capacité, de leur courage, de leur fermeté dans l’action clandestine. Nous avons élu au Comité central.
Lecoeur, le maire de Lens ; Camphin, l’ancien secrétaire du Pas-de-Calais (colonel Baudouin) ; Lallemand, le secrétaire fédéral du Nord ; Grenier, député de Saint Denis, ancien secrétaire de la section d’Halluin ; Jeannette Vermeersch, ouvrière du textile, dirigeante du Mouvement des femmes. Et nous avons élu à la Commission de contrôle notre camarade Calonne, le dirigeant de l’organisation de la grande grève de mai 1941.
Tout le Parti, avec son Comité central, fera l’effort, – n’est il pas vrai, chers camarades ? – pour produire, pour assurer la renaissance économique, politique, culturelle de notre pays.
Nous lutterons pour obtenir une Constituante souveraine et un élargissement de la démocratie.
Nous lutterons pour constituer un grand Parti ouvrier français.
J’ai la conviction, la certitude absolue que les mineurs communistes du Nord et du Pas-de-Calais seront au premier rang dans cette bataille pour faire une France nouvelle, une France libre, forte et heureuse.
=>Retour au dossier sur Le Parti Communiste Français au gouvernement avec la bataille du charbon