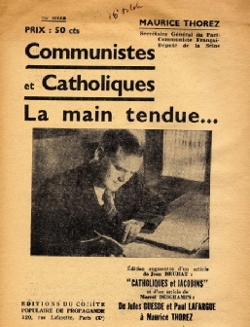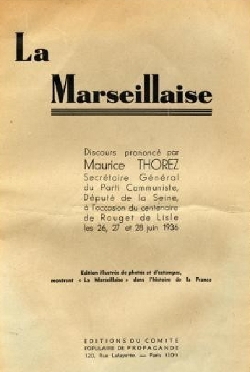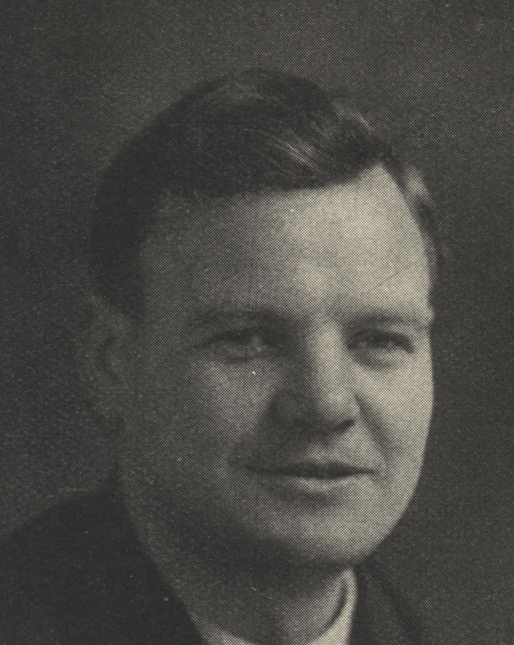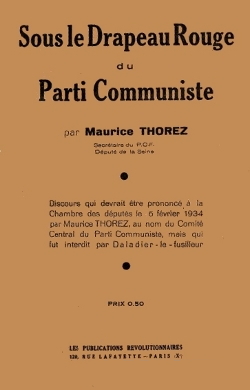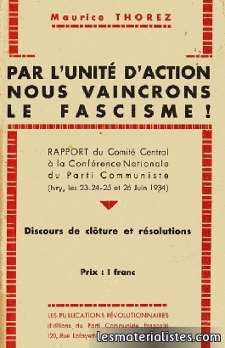La conception même du communisme est nécessairement falsifiée par Maurice Thorez dans un sens économiste.
A ses yeux, le communisme, c’est simplement la « mise en commun ». Cela ne va pas plus loin.
Lors du discours « Pour une jeunesse heureuse » prononcé le 27 mars 1937 aux Jeunesses Communistes de la région parisienne dans une salle du parc d’attractions parisien « Magic City », Maurice Thorez définit ainsi de la manière suivante « communisme » et « communiste » :
« Le communisme – ce pur et noble idéal de justice sociale et de fraternité humaine – c’est désormais la certitude que nous pouvons réaliser et que nous réaliserons le rêve de bonheur qui a hanté l’humanité dans les temps les plus reculés, puisque les progrès de la science, s’appuyant désormais sur la force et sur la conscience de la classe ouvrière, peuvent permettre une meilleure organisation de la société, une organisation de la production qui assure un travail à tous les travailleurs libres et avec le travail la joie, l’amour dans la liberté et dans la paix (…).
Le communiste, c’est celui qui poursuit la réalisation de cet idéal, tout en se préoccupant, dans le présent d’améliorer le sort des travailleurs, le sort des déshérités ; c’est celui qui se dévoue à la cause commune, à la cause de tous, et voilà sans doute la raison essentielle de la grande influence et des effectifs toujours plus nombreux de votre Fédération des Jeunesses Communistes.
Le communisme, ses buts, l’action de ses partisans, de ses militants, répondent pleinement aux aspirations de la jeunesse, à son impérieux besoin de mouvement, à son goût de l’action et aussi à son élan naturel vers le bien et vers le beau, vers ce que vous chantiez tout à l’heure : « Vive la vie, vivent la joie et l’amour » (…).
Le désir de s’instruire est inné dans la jeunesse. La jeunesse est attirée par l’étude de la science ; elle veut aussi étudier le passé, pour que le passé puisse lui servir dans le présent et préparer son avenir.
La jeunesse laborieuse de France doit et peut étudier l’effort séculaire de ses pères, de ses ancêtres, dans leur lutte pour la paix.
La jeunesse laborieuse de France doit et peut étudier la littérature de notre pays. La jeunesse laborieuse de France ne peut prétendre à une connaissance suffisante du marxisme-léninisme, de notre propre doctrine, sans apprendre à connaître les matérialistes du XVIIIe siècle, les grands Encyclopédistes si justement appréciés par les fondateurs du matérialisme historique.
Les jeunes travailleurs, les jeunes révolutionnaires, ont beaucoup à apprendre de l’histoire des grandes révolutions et des grands mouvements sociaux de notre pays, tout particulièrement de l’histoire de la grande Révolution française. »

« La France du Front populaire et sa mission dans le monde »
En 1938 fut publié un document de plus d’une centaine de pages, intitulé pas moins que « La France du Front populaire et sa mission dans le monde ».
Il s’agissait du rapport présenté au IXe congrès du Parti Communiste français, se tenant à Arles du 25 au 29 décembre 1937.
Ce document est une synthèse de la ligne social-chauvine faussant l’interprétation du matérialisme dialectique, accordant à la France en tant que nation une position « historique ».
Revendiquant le mot d’ordre d’« Union de la nation française », lancé au congrès précédent, en janvier 1936, ce nouveau rapport présente justement de la manière suivante le rapport de l’année précédente :
« Le rapport [de 1936] était comme une nouvelle rencontre de la classe ouvrière avec la France, un des plus beaux et des plus riches pays du monde.
Il débutait par le tableau des richesses de la France, de ses ressources immenses, agricoles et industrielles.
Il détaillait les principales productions de la terre de France fécondée par la sueur et le sang de Jacques Bonhomme, l’ancêtre de nos laboureurs.
La production de ses usines géantes, fruits du labeur de nos pères, et des pères de nos pères, jusqu’aux plus lointaines générations. »
On voit le degré de populisme atteint, et Maurice Thorez continue tout au long dans le même esprit : « Sur notre sol fertile lèvent de belles moissons », etc. etc.
Dans ce qui est un véritable manifeste, on trouve également et surtout exposé ce qui est au cœur de l’économie politique du Parti Communiste français : la liquidation du concept de bourgeoisie.
Voici ce que dit Maurice Thorez, faussant les enseignements du matérialisme historique dans un sens petit-bourgeois :
« Nous avons montré, conformément à l’enseignement de Lénine, qu’au sommet de la nouvelle aristocratie, de l’aristocratie de l’argent, se trouvait un tout petit nombre de gros capitalistes, les chefs et les représentants de ces deux cents familles qui dominent l’économie et la politique du pays.
C’est cette oligarchie financière qui condamne le peuple de France à la misère, à la déchéance physique, à la dégradation morale, qui détruit la famille, jette le père à la rue sans souci du pain de ses enfants, qui contraint sa fille à la prostitution, et qui réserve à l’enfant abandonné et malheureux, privé de soins et de tendresse, le bagne d’Eysses ou de Belle-Isle.
C’est l’oligarchie financière qui fait s’épanouir, fleurs vénéneuses du fumier capitaliste, la corruption et le scandale, qui soudoie les chefs fascistes, entretient et arme leurs troupes mercenaires, sème la division et provoque à la guerre civile. »
De fait, il est évident qu’ici Maurice Thorez exprime une conception qui est une falsification complète du matérialisme historique. Il y a ici une oligarchie malveillante, au lieu d’une bourgeoisie en tant que classe décadente.