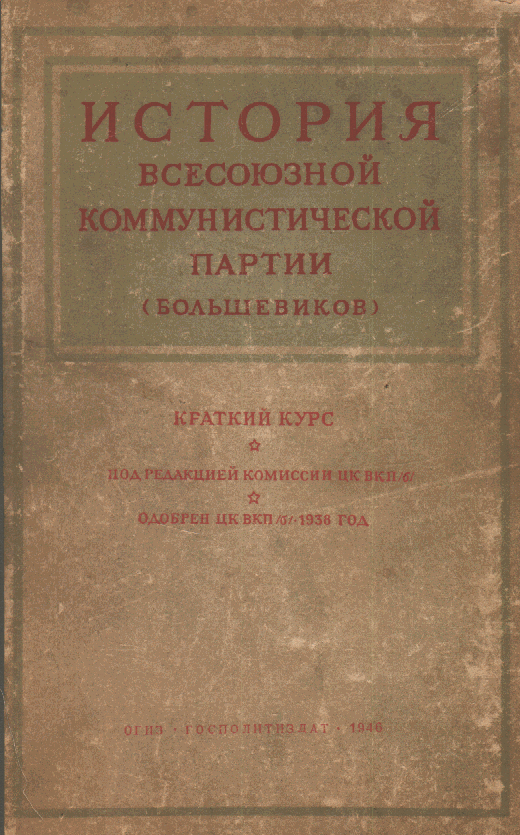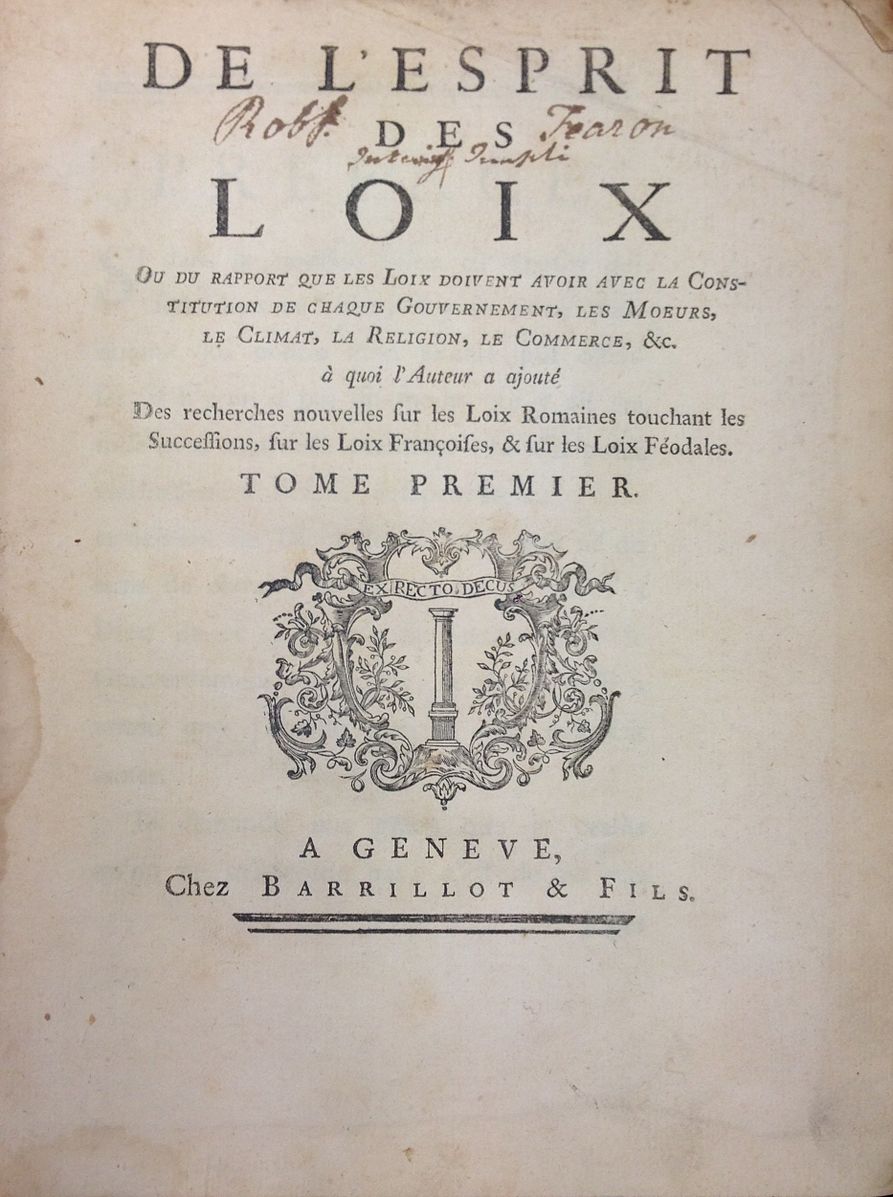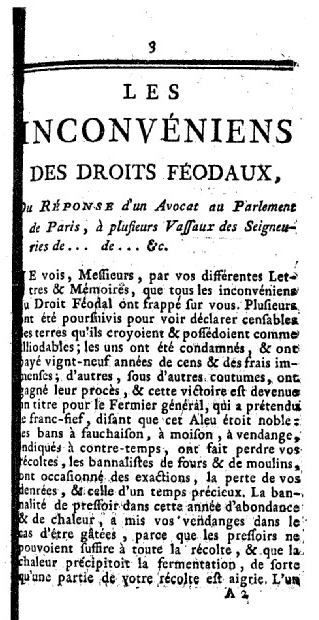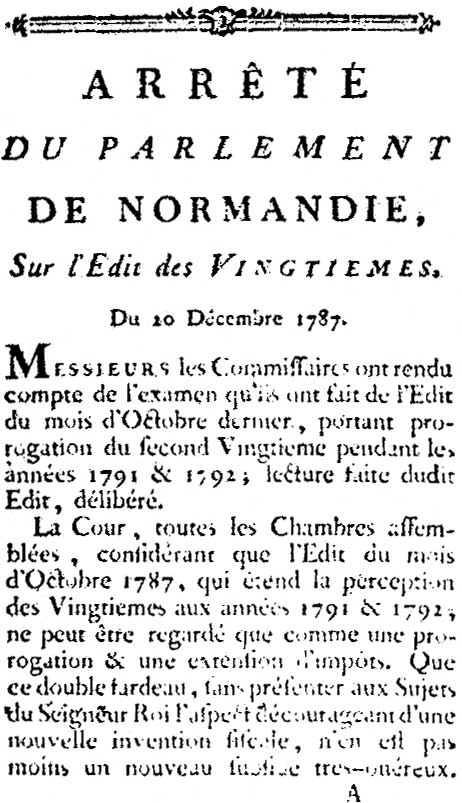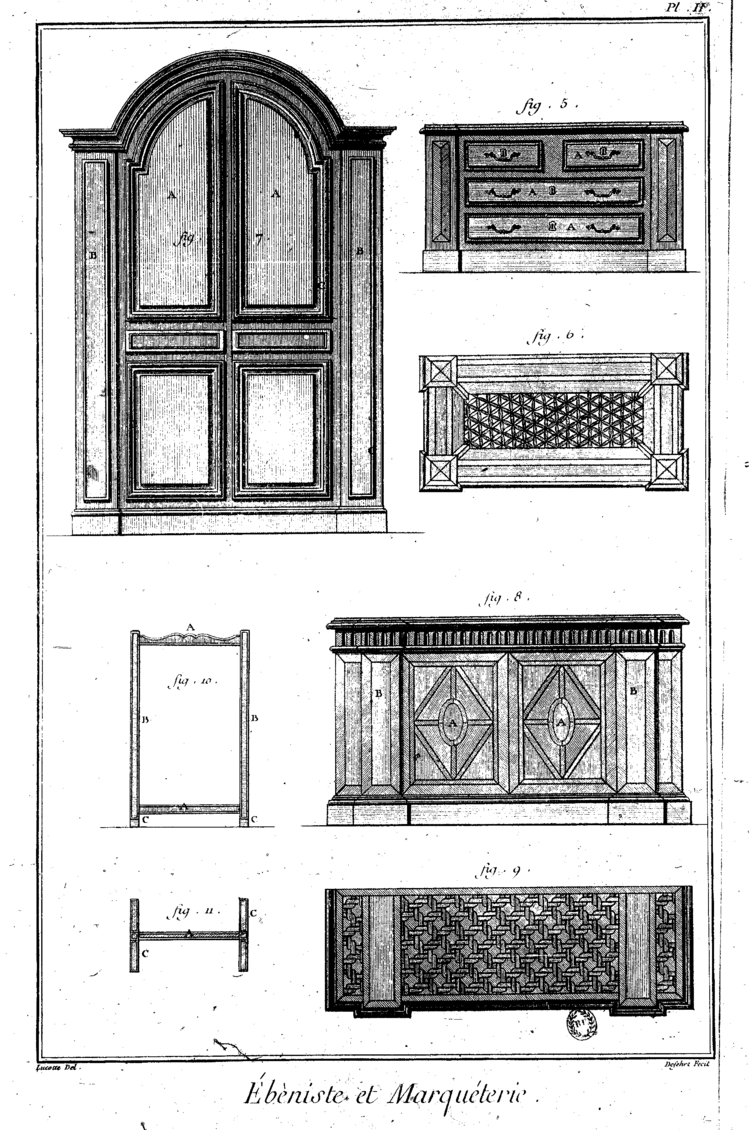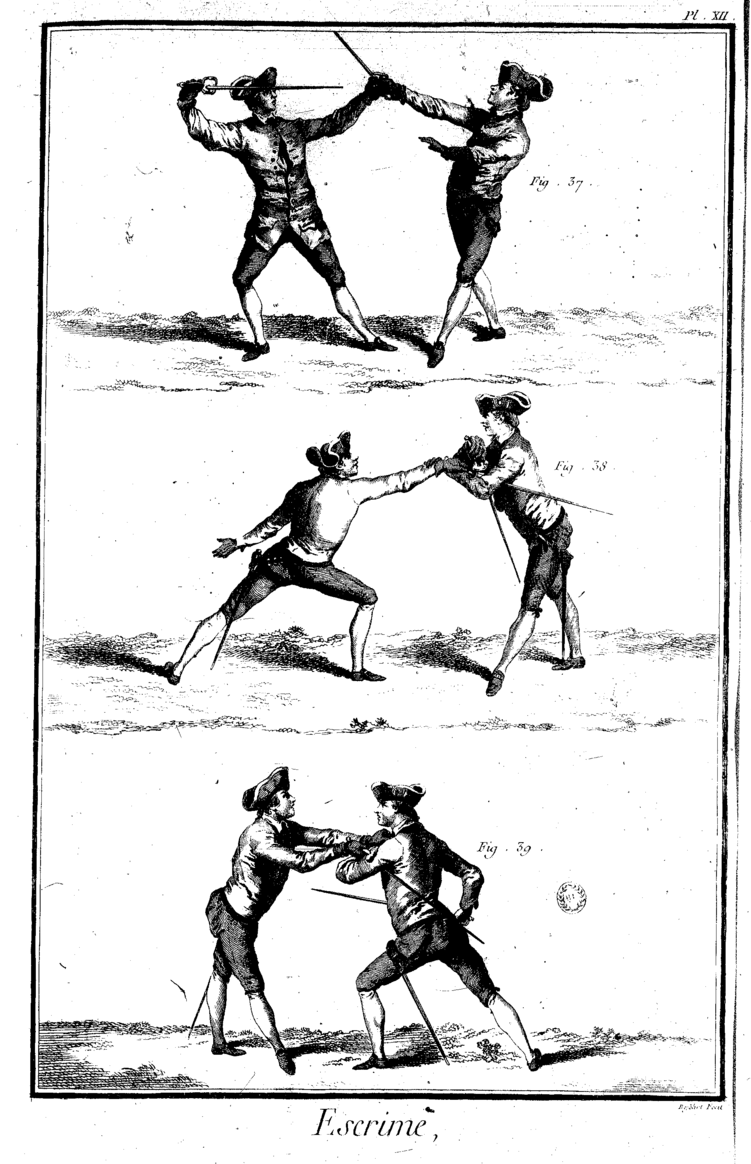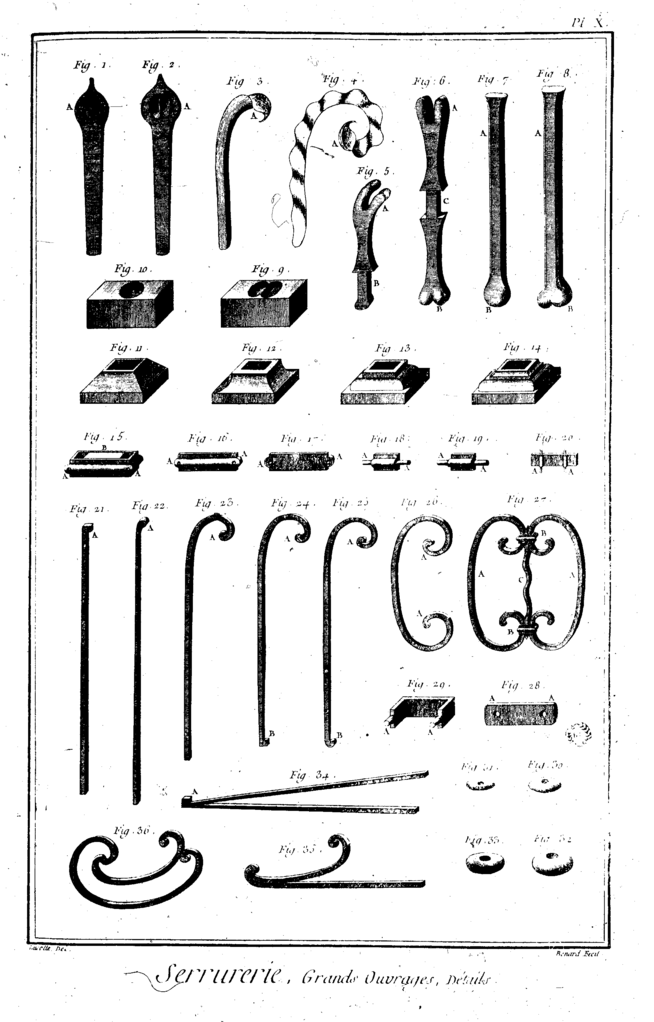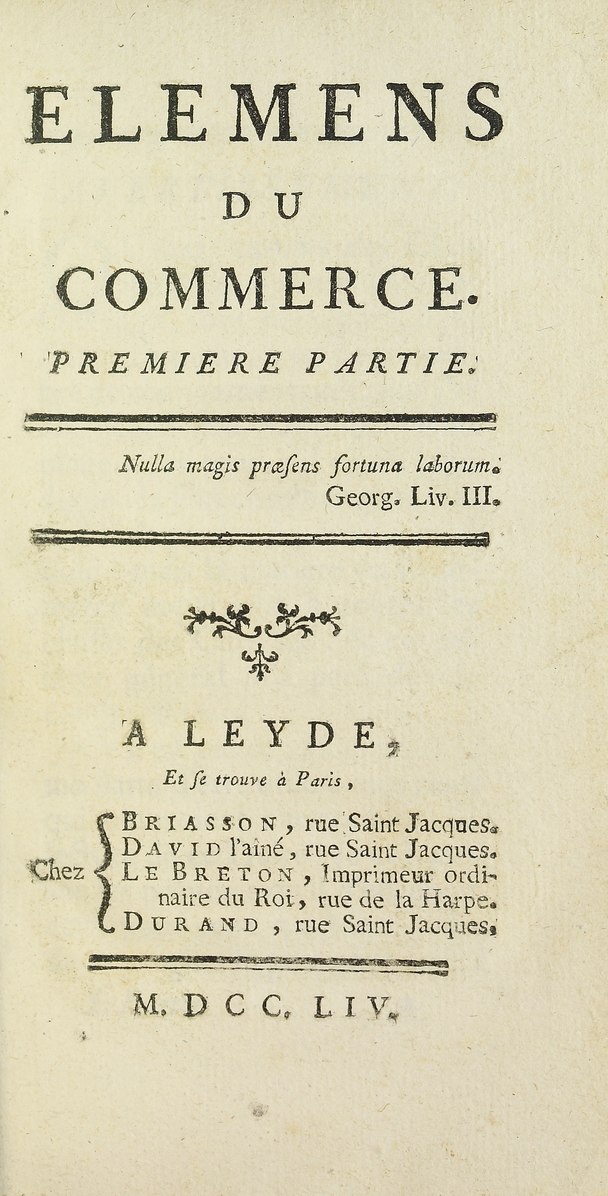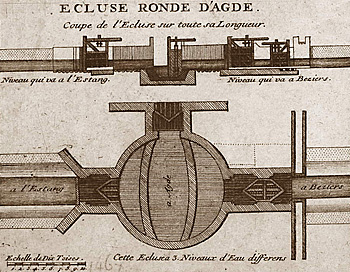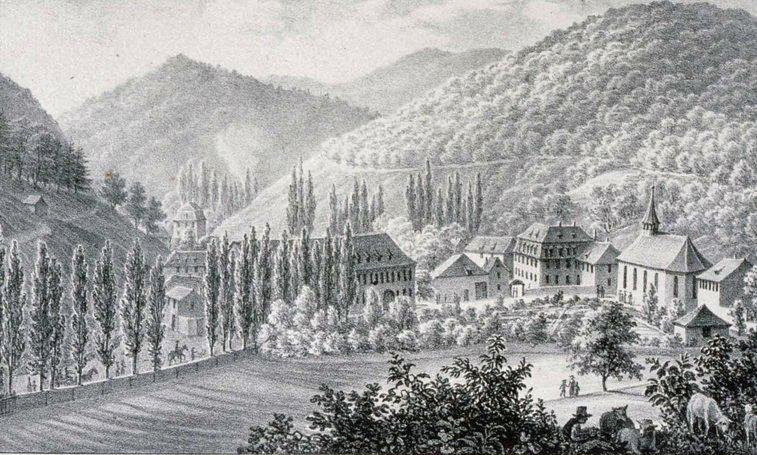Nous voulons ici avertir que les événements en Ukraine portent une charge qualitative entièrement nouvelle, au sens où il ne s’agit pas simplement d’une tension avec des traits bien spécifiques liée à une situation particulière et à un moment particulier. Il ne s’agit pas, en tant que tel, d’un affrontement de deux pays issus de l’URSS, la Russie et l’Ukraine, sur la base de questions d’orientation politiques et économiques extérieure et intérieure.
Il s’agit en effet d’une réalité ayant un caractère nouveau et une dimension générale, reflétant une période historique bien déterminée, car l’heure est à l’accentuation militaire des contradictions inter-impérialistes. La Russie agit ici comme un challenger bousculant l’ordre capitaliste mondial afin de forcer violemment au repartage du monde, afin de parvenir à la mise en place d’un nouvel empire russe.
Il ne s’agit pas de troubles ayant une portée militaire – mais bien d’un effondrement de la « paix » capitaliste.
Nous affirmons cela, parce que notre position communiste marxiste-léniniste-maoïste nous permet de caractériser la crise capitaliste et ce qu’elle implique.
Nous avons compris que le capitalisme était devenu fondamentalement instable avec l’irruption de la pandémie. Dialectiquement, le maintien de son apparente stabilité, au moyen de la multiplication des crédits, se paie par un basculement dans la bataille pour le repartage du monde. La paix intérieure du capitalisme a comme prix la guerre extérieure. Aussi avons-nous justement souligné, depuis pratiquement une année, que la crise ukrainienne allait devenir majeure – une analyse correcte qui est une preuve de la validité de notre analyse du mode de production capitaliste connaissant un processus d’effondrement général.
Il faut ici bien souligner sur ce plan que le monde est totalement sous le choc que la Russie se soit permise d’aligner la majeure partie de ses troupes autour de l’Ukraine et de reconnaître officiellement, le 21 février 2022, les républiques séparatistes de l’Est de l’Ukraine. Les médias, les analystes, les experts, les diplomates… sont tous débordés par cette réalité nouvelle, dont la dimension militaire est ouverte.
Fondamentalement, ce n’est pas que ce soit une initiative militaire unilatérale qui marque les capitalistes, mais qu’il s’agisse là d’un phénomène contribuant massivement au caractère instable des rapports internationaux, une frontière considérée comme infranchissable depuis l’effondrement du bloc social-impérialiste soviétique en 1989 et l’utilisation de la Chine sociale-fasciste dans le dispositif productif international.
Pour employer un terme aux contours trop flous mais parlant, c’est la mondialisation qui se voit ébranlée de manière fondamentale par la crise ukrainienne. L’unification internationale par le marché capitaliste se voit confrontée à une contre-tendance interne : les contradictions inter-impérialistes, et ces dernières prennent de plus en plus le dessus.
Nous le répétons : la stabilité intérieure du capitalisme a provoqué une instabilité extérieure. Le cadre international, pacifié depuis 1989, s’effondre littéralement. La Russie bousculant l’ordre européen au sujet de l’Ukraine reflète, comme exemple et comme point le plus avancé en ce domaine, l’aventurisme impérialiste se systématisant dans le monde.
Le capitalisme impérialiste (de la superpuissance impérialiste américaine, de la Chine, du Japon, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Russie…) et le capitalisme bureaucratique semi-féodal semi-colonial expansionniste (de la Turquie, de l’Iran, du Brésil, de l’Inde…) assument toujours plus de rompre avec la stabilité internationale auparavant reconnue et acceptée comme prioritaire, ou du moins comme constituant le cadre général où agir.
Et comment procèdent les capitalismes en crise, s’alignant sur l’aventurisme ? En faisant en sorte de diviser pour régner. Les haines nationalistes, les passions guerrières, les volontés hégémoniques, les intérêts matériels, les traditions religieuses… Absolument toutes les nuances et différences entre les peuples, entre les gens eux-mêmes, sont utilisées par les grandes puissances pour provoquer la division, pour fomenter des troubles, pour fomenter des mouvements de « révolte » sur une base irrationnelle, des tendances aux séparatismes… afin que cela serve d’appui aux opérations rentrant dans le cadre des visées impériales.
La division entre les peuples russe et ukrainien est artificielle, elle est produite par le jeu des grandes puissances
Ce qui se déroule en Ukraine est exemplaire de cette opération impérialiste de « diviser pour régner ». Les peuples russes et ukrainiens, qui se connaissent si bien depuis des siècles et qui sont si proches culturellement malgré leurs différences nationales, se voient projeter l’un contre l’autre.
Les choses sont montées en épingle de manière disproportionnée, avec un énorme matraquage idéologique, des opérations psychologiques de grande envergure, une propagande exacerbée réécrivant l’Histoire selon les besoins impérialistes.
Deux grandes puissances sont ici responsables de l’horrible situation de l’Ukraine.
La superpuissance impérialiste américaine, hégémonique dans le monde, utilise l’OTAN comme vecteur afin de placer le continent européen sous son contrôle, élargissant pour cela son dispositif à l’Europe de l’Est. L’Ukraine est le dernier pays manquant encore avant la Russie, d’où les milliards déversés par la CIA afin de pousser à une « révolte » pro-occidentale, qui se réalisa en 2014 avec le coup d’État de l’Euromaidan dont une composante importante consista en les mouvements d’extrême-droite Svoboda et Pravdy Sektor.
L’impérialisme russe tente de reformer, non pas tant la superpuissance social-impérialiste soviétique des années 1960-1980, que l’empire russe d’avant Octobre 1917. L’intégration-désintégration de l’Ukraine est ainsi à l’ordre du jour pour la Russie d’aujourd’hui comme à l’époque des Tsars où la nation ukrainienne était niée, la langue ukrainienne interdite, la culture ukrainienne martyrisée, les Ukrainiens considérés comme des « petits-russes » de moindre valeur.
La thèse de la seconde crise générale du capitalisme
est confirmée
Les événements en Ukraine ne sont pas compréhensibles à partir d’un prisme « géopolitique », de considérations économiques, d’analyses militaires. Il va de soi qu’il y a des aspects militaires, politiques, économiques… dans tout cela. Mais ce n’est pas la substance des choses.
Le véritable déclencheur des événements, ce qui a ouvert la boîte de Pandore, c’est la seconde crise générale du capitalisme, déclenchée par la pandémie. Le capitalisme procède en effet par expansion, tout en se heurtant à un moment donné à une limite. Il se confronte alors à un obstacle infranchissable empêchant la continuité de l’accumulation de capital et de travail.
Il doit tout faire pour forcer la continuation de l’expansion. C’est alors la tendance à la guerre qui s’exprime, jusqu’à la guerre impérialiste.
La première crise générale du capitalisme s’est produite dans les années 1910, avec le déclenchement de la guerre mondiale et la révolution russe d’Octobre 1917. L’accumulation capitaliste était alors littéralement torpillée, les sociétés se déchirant politiquement, culturellement, socialement.
Le capitalisme n’avait alors pas encore atteint le degré de maturité permettant une société de consommation, l’encadrement complet des comportements et des mentalités au moyen des institutions (dont les syndicats font partie), d’un travail salariat perpétuellement rationalisé.
La contradiction entre le travail intellectuel et le travail manuel était explosive dans un tel cadre, et le fascisme comme mobilisation de masse pour dévier les protestations et empêcher l’affirmation du besoin de communisme se systématisa, précipitant les pays dans la seconde guerre mondiale.
La seconde crise générale du capitalisme s’est produite au début de l’année 2020, avec l’irruption d’une maladie issue du terrible écocide provoquée par le capitalisme à l’échelle mondiale. La destruction de la Nature a pris une immense proportion, allant jusqu’à une crise dans le cadre de la contradiction entre les villes et les campagnes, aboutissant au dérèglement des rapports entre les espèces et les maladies.
Le capitalisme a pris de plein fouet l’irruption de la pandémie, toute sa production a été bouleversée, ainsi que le rythme fondamental du 24 heures sur 24 de la vie quotidienne avec sa consommation forcenée. La machinerie capitaliste s’est enrayée.
C’est précisément la compréhension de cette seconde crise qui nous a permis, dès le milieu de l’année 2021, d’affirmer que la crise ukrainienne relevait d’une dimension nouvelle, d’une confrontation militaire à une nouvelle échelle, de la guerre impérialiste pour le repartage du monde.
La crise ukrainienne a comme arrière-plan la contradiction entre la superpuissance impérialiste américaine et son challenger chinois
La bataille pour le repartage du monde est concrètement la grande actualité des pays du monde, que ceux-ci soient des pays capitalistes développés (comme la Belgique, la France…) ou des pays semi-féodaux semi-coloniaux (comme la Turquie, le Brésil ou le Mali). Il faut trouver un moyen d’arriver à l’expansion, à tout prix, sinon le régime s’effondre comme un château de cartes de par la pression de la crise.
La situation en Ukraine doit d’autant moins être comprise de manière « géopolitique » que ce qui se joue à l’arrière-plan, c’est la mise en place de la troisième guerre mondiale impérialiste entre la superpuissance impérialiste américaine et son challenger chinois.
Le capitalisme a réussi à se relancer grâce à une expansion aux dépens d’une partie importante des territoires auparavant sous la dépendance du social-impérialisme soviétique, ainsi qu’avec l’utilisation de la Chine comme atelier du monde, puis comme usine du monde.
La fin de cette expansion commencée en 1989 s’est exprimée en 2020 avec la pandémie et elle apporte au monde une nouvelle grande puissance, la Chine, qui vise à l’hégémonie mondiale en remplacement de la superpuissance impérialiste américaine.
La Chine, un pays social-fasciste depuis la restauration du capitalisme en 1976, a profité de l’expansion capitaliste mondiale en exploitant massivement la classe ouvrière chinoise et en s’appuyant sur un régime terroriste. Profitant de sa taille et de sa population, l’impérialisme chinois vise à s’affirmer sur la scène mondiale, aux dépens de la superpuissance impérialiste américaine.
Le conflit entre l’impérialisme russe et l’Ukraine est ainsi, sur le plan de la tendance historique, également un conflit entre la Russie et la superpuissance impérialiste américaine, et revient même à un affrontement entre la Chine et la superpuissance impérialiste américaine.
Le moteur principal de la guerre impérialiste au niveau mondial est l’affrontement sino-américain, qui joue à tous les niveaux, dans tous les affrontements militaires.
L’OTAN est un appareil militaire à visée externe et interne
La Belgique est pays impérialiste de faible importance, la France est un pays impérialiste d’importance significative. Cependant, la Belgique accueille le siège de l’OTAN à Bruxelles et porte en ce sens une très lourde responsabilité, celle d’assurer une stabilité permanente afin de légitimer l’OTAN.
L’OTAN a été en effet le bras armé accompagnant le développement du capitalisme occidental dans les années 1960-1980, ce qui veut dire que ce n’a pas été simplement une structure militaire se définissant par rapport au bloc de l’Est dirigé par le social-impérialisme soviétique. L’OTAN a également été tout un appareil d’affirmation symbolique, de pression psychologique, d’échanges d’informations des services secrets et d’opérations militaires, dans le sens de la contre-insurrection.
L’OTAN est un appareil exerçant une pression pour uniformiser la défense des intérêts économiques et politiques du capitalisme occidental ; il ne faut jamais oublier l’importance que l’OTAN accorde pour chacun de ses membres, aux formes institutionnelles, aux prises de position diplomatiques, à l’organisation des rapports sociaux.
C’est d’ailleurs pour cela que l’Ukraine n’a pas encore pu adhérer à l’OTAN et qu’elle connaît d’intenses modifications internes afin justement d’être en mesure de répondre aux exigences du capitalisme occidental.
D’où les difficultés également de la France, pays exemplaire du capitalisme occidental mais cherchant à disposer souvent d’une indépendance stratégique, dans ses rapports avec l’OTAN.
Cet aspect de la question de la guerre impérialiste est essentiel, car qui dit guerre dit appareil militaire, et on ne peut pas comprendre les modalités de la guerre sans voir comment celle-ci se développe, comment elle se met en place, comment elle cherche à se dérouler.
La Russie est un pays impérialiste
Même si en Belgique et en France l’OTAN reste l’aspect principal de la tendance à la guerre, il ne faut absolument pas pour autant attribuer une valeur positive, à caractère « anti-impérialiste », à la Russie. Ce pays, dont les visées expansionnistes sont indubitables, n’a eu de cesse de développer un immense appareil idéologique pour se présenter sous un jour favorable, comme simple « victime » de l’OTAN.
Des médias comme RT et Sputnik, des agitateurs permanents sur les réseaux sociaux, des hommes politiques soudoyés, et même des organisations d’extrême-gauche ou d’ultra-gauche en mal de légitimité… présentent la Russie comme un pays pacifique, contribuant au progrès mondial dans tous les domaines, jouant le rôle de principal obstacle à la mondialisation capitaliste.
La Russie porterait, malgré sa nature, des traits « soviétiques », un respect des codes de l’honneur, des principes communautaires « socialistes », permettrait la mise en place d’un monde « multipolaire », ne serait pas gangrené par un capitalisme déchaîné, etc.
Tout cela relève de la propagande impérialiste, aussi ne saurait-on sous-estimer le rôle néfaste joué par la Russie dans sa tentative se présenter comme devant être naturellement soutenue si on s’oppose à un capitalisme qui serait « occidental », par opposition à une « Eurasie » qui porterait une identité « socialiste ».
On doit ici considérer qu’il y a une contradiction inter-impérialiste et s’il y a bien toujours un aspect principal, il ne faut jamais perdre de vue le principe de l’autonomie prolétarienne, du maintien des principes idéologiques communistes, de l’auto-suffisance sur le plan de l’organisation.
Il faut avoir dans l’idée qu’on est dans la même configuration qu’avant 1914 et il ne s’agit pas de prendre parti pour un impérialisme contre un autre.
Nous en sommes revenus à la situation d’avant 1914
Il est nécessaire de constater qu’un piège impérialiste s’est refermé sur l’Ukraine, la superpuissance américaine et l’impérialisme russe transformant ce malheureux pays en cible pour leur propre expansionnisme. La première veut élargir sa zone d’influence et de contrôle, en faisant de l’Ukraine son satellite, alors que la Russie aimerait justement que celle-ci intègre son champ de domination « impériale ».
Cela nous ramène à la situation mondiale avant 1914, avec la compétition entre puissances pour se développer aux dépens d’autres pays, au moyen de coups de pression, d’interventions militaires.
La crise militaire en Ukraine le monte bien : les interventions militaires sont désormais considérées comme le facteur décisif, comme l’expression politique la plus nette, la plus tranchante, la plus à même de permettre l’expansion.
La seconde crise générale du capitalisme a apporté un saut qualitatif, où la tendance à la guerre l’emporte sur les autres tendances, de manière ouverte ou indirecte, franche ou insidieuse. Et les capitalistes profitent de toutes les améliorations techniques et technologiques, du caractère plus développé des forces productives.
Le caractère nouveau de la guerre moderne
Nous voulons souligner le fait que, malheureusement, les larges masses n’ont pas une compréhension juste de ce qu’est la guerre moderne. Elles ne saisissent pas ce qu’est un État, donc elles ne voient pas ce qu’est le pouvoir dans son rapport aux classes. Qui plus est, et c’est là essentiel, elles ne voient pas les immenses modifications que connaît la guerre dans ses formes concrètes depuis trente ans.
L’irruption des nouvelles technologies a largement modifié la gestion des conflits, avec une capacité de connaissance en temps réel désormais des acteurs sur place et une distribution immédiate des décisions à ces mêmes acteurs sur le champ de bataille.
Ce saut qualitatif dans la gestion des actions a contribué à un renforcement quantitatif de par une interaction démultipliée des troupes militaires elles-mêmes. C’est le sens de la professionnalisation des armées : la guerre moderne exige un haut niveau de technicité, tant pour maîtriser les innombrables types d’armes que pour être en mesure de gérer ou participer à des opérations désormais coordonnées de manière très approfondie.
La guerre moderne possède en ce sens de très nombreux aspects, qui ne sont pas tant nouveaux que faisant l’acquisition d’une autre magnitude et se combinant bien davantage. Que ce soit par l’espionnage, le sabotage, la guerre psychologique, les piratages informatiques, les opérations consistant en des « coups » bien déterminés… la guerre moderne a obtenu un caractère « hybride » comme le formulent les experts militaires bourgeois.
Les armées modernes intègrent même directement dans leurs activités tant la surveillance que l’utilisation des réseaux sociaux pour leurs opérations. Il y a cette anecdote de Facebook fermant des comptes se prétendant maliens mais en fait liés aux armées française et russe en décembre 2020, cependant dans les faits chaque armée assume entièrement cette dimension d’opération psychologique, de manipulation.
On peut dire que, avec les technologies actuelles, il y a une combinaison encore plus avancée des services secrets avec l’armée et inversement, ce qui renforce la signification des décisions prises au plus haut niveau au sein d’un appareil d’État toujours plus centralisé.
Jamais les États n’ont ainsi été autant coupés du peuple – mais, en même temps, jamais ils n’ont été autant capable de réactivité et de prises d’initiative d’écrasement rapide.
Il n’est pas de retour en arrière possible
Comme l’a affirmé Staline à la suite de Lénine, « pour supprimer l’inévitabilité des guerres, il faut détruire l’impérialisme ». Toute autre conception est une convergence avec le mode de production capitaliste et il faut souligner ici la menace que représentent les courants bourgeois « socialistes » prétendant réorganiser le capitalisme, le réguler, lui mettre des barrières, le refaçonner, lui imposer des règles, etc.
Il y a deux ennemis et non pas un : il faut combattre ceux qui veulent la guerre impérialiste, au nom du nationalisme, de l’expansionnisme, et il faut aussi combattre ceux qui mentent en prétendant pouvoir faire changer le capitalisme.
Aussi vaines que soient ces prétentions à « améliorer » ou « modifier » le capitalisme, elles désorientent, elles font perdre du temps, elles empêchent de voir la gravité de la situation historique.
Le capitalisme aboutit immanquablement à la guerre impérialiste et il n’est pas de retour en arrière possible une fois un tel processus enclenché. Seul le démantèlement des monopoles peut briser les forces menant à la guerre, et quel sens aurait un retour au capitalisme qui remettrait en branle le processus menant à des monopoles ?
Les réformistes répondront ici qu’un « capitalisme organisé » est possible : c’est un mensonge qui masque les intérêts du capitalisme cherchant à sauver son existence. Il y aura aussi les romantiques économiques qui proposeront un retour en arrière à une forme primitive de capitalisme, avec l’artisanat, voire le troc. C’est là incompatible avec les exigences de notre époque.
Les exigences de notre époque
La guerre qu’amène le capitalisme est aussi, dialectiquement, une contre-réponse à la paix planétaire qui est historiquement possible.
Nous avons besoin d’une société mondiale unifiée, d’une humanité unifiant et centralisant toutes ses forces, afin d’élever le niveau de vie des masses mondiales et d’en même temps protéger la planète, en adoptant un mode de vie qui soit naturel et non plus décidé artificiellement par les capitalistes pour développer la consommation.
La guerre imposée par le capitalisme est également un moyen de propager la concurrence, la compétition, le cynisme, l’égoïsme… Alors que sont à l’ordre du jour la compassion, l’empathie, le Socialisme. Au lieu d’avoir une humanité pacifiée et cultivée, se tournant vers la Nature et en particulier les animaux, ayant la tête dans les étoiles pour envisager la colonisation spatiale, le capitalisme cherche à défigurer le monde à coups de divisions, de sectarisme, de particularismes.
C’est là un aspect essentiel. Le capitalisme propage les divisions qui se conjuguent pour former une légitimité au crime à grande échelle. Il faut que les communistes soient en mesure de faire face à une telle entreprise, et cela implique d’être capable d’avoir une lecture approfondie de ce qu’est la société socialiste, le besoin de communisme.
Toute réduction à de l’économisme, à des considérations sans profondeur, sans âme, sans reconnaissance de la dignité du réel… amène la défaite face aux mobilisations provoquées par le capitalisme, qui profitent tant de moyens matériels élevés que d’un irrationalisme particulièrement prononcé.
Il faut impérativement avoir conscience de cette dimension !
Vive la nation ukrainienne, victime du complot militariste réalisé par la superpuissance américaine et l’impérialisme russe !
Guerre à guerre impérialiste, guerre à l’OTAN !
Guerre populaire jusqu’au Communisme !
Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste de Belgique
Parti Communiste de France (marxiste-léniniste-maoïste)
Février 2022
>> Retour à la page des documents du PCF (mlm)