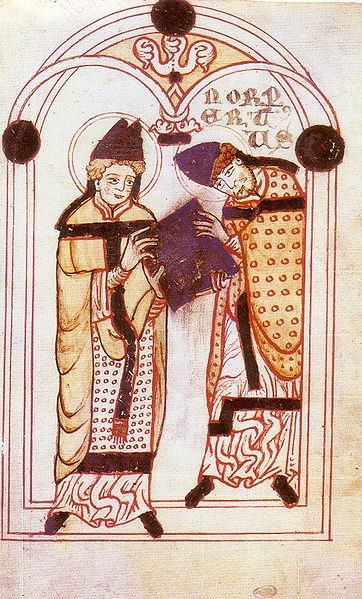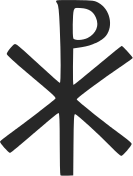Augustin, avec son approche conceptuelle du césaro-papisme et du péché comme base de l’expérience réelle de l’Humanité depuis Adam, avec sa conception idéaliste du rapport entre l’Un et le Multiple, détermina pour plusieurs siècles le christianisme.
Sa fusion du manichéisme et du néo-platonisme, de l’incarnation et de l’Évangile, l’a véritablement porté par ailleurs, étant à la croisée de toute une production d’une très riche intensité.
C’est la base d’une production extrêmement prolixe historiquement, avec ses polémiques, ses conseils techniques, ses nombreux ouvrages idéologiques.
Les titres de ses ouvrages tournés vers la polémique montrent tout de suite de quoi il en retourne, sur le plan de l’agressivité : Des hérésies, Contre les manichéens, Contre les donatistes, Controverse avec les pélagiens, Contre les Juifs, Contre les ariens, Conférences avec le manichéen Fortunat, Contre le manichéen Adimantus, Réfutation de l’épître manichéenne appelée Fondamentale, Contre Fauste le manichéen, Conférences avec le manichéen Félix, Contre un adversaire de la loi et des prophètes, Contre Julien défenseur du pélagianisme, Conférence avec Maximin évêque arien, etc.
Il en va de même pour les ouvrages orientés vers la dimension idéologique – théologique : Du combat chrétien, De la continence, De ce qui est bien dans le mariage, De la sainte virginité, Annotations sur le livre de Job, De la trinité, Explication du sermon sur la montagne, Du symbole, De la vie bienheureuse, De l’immortalité de l’âme, De la patience, De l’utilité du jeune, Des devoirs à rendre aux morts, Traités sur Saint Jean, Traité de la foi, de l’espérance et de la charité, Traité de la musique, Traité du libre-arbitre, etc.

manuscrit en français du début du 15e siècle
Augustin poussera le fanatisme jusqu’au bout, se remettant parfois en cause, afin d’ajuster idéologiquement sa démarche, comme ici dans les Rétractations :
« J’ai loué aussi Platon et les Platoniciens ou les philosophes de l’Académie, et je les ai exaltés plus que ne doivent l’être des impies ; je m’en repens à bon droit ; surtout, quand je songe que c’est contre leurs profondes erreurs qu’il faut partout défendre la doctrine chrétienne. »
On trouve également dans ses œuvres de très nombreux conseils techniques pour diffuser la religion. Les orateurs doivent « instruire, plaire et toucher », il faut toujours viser l’attention des auditeurs.
Augustin explique par conséquent dans sa Méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme :
« Il n’est pas rare de voir un auditeur, qui semblait charmé au début, se lasser d’être attentif ou de se tenir debout ; il n’approuve plus, que dis-je ? il se met à bailler et témoigne involontairement l’envie qu’il a de se retirer.
Dès qu’on s’aperçoit de sa fatigue, on doit le récréer, soit en lui tenant quelques propos d’un enjouement de bon ton, sans sortir du sujet, soit en lui faisant un récit qui frappe son imagination ou touche sa sensibilité.
Qu’on lui parle surtout de lui-même, afin que l’intérêt personnel le tienne en éveil, sans toutefois le blesser par quelque allusion offensante, ni quitter l’accent de tendresse qui peut seul gagner son cœur.
On pourrait encore soulager son attention en lui offrant un siège, ou plutôt, il vaudrait mieux qu’il fût assis dès le commencement, autant que la circonstance le permet.
Je trouve fort sensé l’usage adopté dans certaines églises d’outre-mer, où l’on voit assis l’évêque qui parle et le peuple qui l’écoute : de la sorte, les personnes trop délicates ne sont pas condamnées à relâcher leur attention et à en perdre les fruits, même à se retirer.
C’est déjà un inconvénient qu’un chrétien, quoique incorporé à l’Église, soit contraint de quitter une assemblée nombreuse pour reprendre ses forces; mais n’est-il pas cent fois plus fâcheux qu’un catéchumène, qui doit être initié aux mystères, soit réduit à la nécessité impérieuse de se retirer, pour ne pas tomber de faiblesse?
La timidité l’empêche d’expliquer la raison qui l’oblige à partir; ses forces épuisées ne lui permettent plus de rester debout.
Je parle par expérience: j’ai vu un homme de la campagne me quitter au milieu de l’entretien, et sa conduite m’a révélé le péché que je signale.
Eh! n’y a-t-il pas un orgueil révoltant à ne pas laisser s’asseoir en notre présence des hommes qui sont nos frères, que dis-je ? dont nous – cherchons à nous faire des frères, et qui, à ce titre, doivent attendre de nous une sollicitude plus empressée?
Ne voyons-nous pas qu’une femme était assise en écoutant le Seigneur dont les anges environnent le trône ?
Si l’entretien doit être court ou que le lieu ne permette guère de s’asseoir, je le veux bien, on écoutera debout: c’est qu’alors l’auditoire sera nombreux et qu’il ne s’agira pas d’instruire un catéchumène. Mais il y a péril, je le répète, à laisser debout une ou deux personnes qui viennent nous trouver pour s’initier à la foi chrétienne.
Toutefois, si nous n’avons pas pris cette précaution au début, et que nous apercevions des signes d’ennui chez l’auditeur, il faut lui offrir aussitôt un siège, en le pressant de s’asseoir, et lui adresser quelques paroles pour le récréer, ou même dissiper le malaise qui avait troublé son attention.
Dans l’incertitude où nous sommes des motifs qui l’empêchent d’écouter, tenons-lui, dès qu’il est assis, quelques propos enjoués ou pathétiques; pour l’arracher aux distractions que lui causent les souvenirs du monde.
De la sorte, si nous tombons juste sur les pensées qui le préoccupent, elles disparaîtront pour ainsi dire devant une accusation directe : si nous nous sommes trompés, quelques mots sur ces préoccupations que nous sommes obligés de supposer en lui, par cela seul qu’ils sont inattendus et interrompent la suite de l’entretien, piquent sa curiosité et renouvellent son attention.
Du reste, soyons brefs, puisque nous faisons une digression, de peur que le remède ne soit pire que le mal et n’augmente la lassitude que nous avons dessein de combattre. Ayons soin dès lors d’abréger; faisons entrevoir et pressons la fin de notre entretien. »
Il faut savoir « adapter son langage aux circonstances et aux personnes », comme dit ici, encore dans sa Méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme :
« Figure-toi bien qu’un écrivain qui compose dans son cabinet pour être lu, se place à un tout autre point de vue que l’orateur qui parle devant un auditoire attentif; et pour l’orateur, que de points de vue divers!
Tantôt il donne des instructions en particulier, sans témoins qui contrôlent son langage; tantôt il parle sous les yeux d’une assemblée qui représente les goûts les plus divers.
Parle-t-il en public? tantôt il n’adresse ses instructions qu’à une seule personne, et l’assemblée ne fait que le juger ou rendre témoignage à la vérité de ses paroles; tantôt l’auditoire attend un discours qui s’adresse à tous indistinctement.
Dans ce dernier cas, la méthode doit encore changer selon que le public est pour ainsi dire réuni en famille et n’attend qu’une conférence, ou qu’il est suspendu en silence aux lèvres de l’orateur, parlant du haut d’une tribune. Et même alors, le ton doit varier, si l’auditoire est plus ou moins nombreux, s’il est composé de savants ou d’ignorants, de gens de la ville ou de la campagne, enfin, s’il représente le peuple entier avec ses différentes classes.
En effet, si l’orateur n’est pas capable d’éprouver les émotions les plus diverses, son âme ne saurait se peindre dans son discours ni sa parole exprimer des sentiments assez variés pour répondre aux mille impressions que provoque la sympathie dans une foule nombreuse.
Il n’est ici question que d’initier à la foi des esprits novices : toutefois, je puis t’assurer, d’après mon expérience personnelle, que je ressens une émotion toute différente selon que je vois dans le catéchumène un savant, un ignorant, un étranger, un concitoyen,un riche, un pauvre, un particulier,un magistrat; dignité, famille, âge, sexe, système philosophique, font autant d’impressions sur mon coeur, et, sous l’empire du sentiment que j’éprouve, mon discours commence, se continue et s’achève.
On doit à tous une égale charité; mais ce n’est pas une raison pour appliquer à tous le même remède.
La charité sait enfanter les uns et se rendre faible avec les autres; elle travaille à édifier ceux-ci, elle a peur d’offenser ceux-là; tantôt elle s’abaisse, tantôt elle s’élève, tour à tour indulgente et sévère, jamais ennemie, toujours maternelle.
Quand on n’a point éprouvé ces mouvements de la charité, on croit que notre bonheur est attaché au faible talent qui nous vaut les éloges de la multitude et les douces émotions de la gloire.
Mais que Dieu, en « présence duquel montent les gémissements des captifs » (Psal. LXXVIII, 11.), voie notre humilité et nos peines, et qu’il nous remette tous nos péchés (Psal. XXIV, 18.).
Si ma parole a eu pour toi quelque agrément, si elle t’a inspiré le désir d’apprendre de moi quelques règles pour vivifier tes discours, je te le répète, tu aurais été plus vite initié à ces secrets en me voyant exercer les fonctions de catéchiste qu’en me lisant. »
Augustin souligne qu’il faut bien diviser les phrases lors de leur traduction pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés ou d’erreurs, un même passage peut être interprété de plusieurs manières, tout comme par ailleurs un même terme, etc.
Il pratique toutes les contorsions possibles pour justifier les incohérences : si dans les Écritures il y a des choses sévères, il ne s’agit que de métaphores et il ne s’agit d’ailleurs pas de prendre au pied de la lettre ce qui consisterait en réalité en des images, des figures allégoriques.
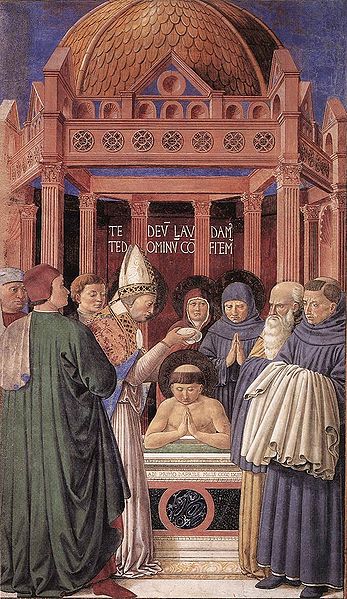
Augustin développe également le principe qu’une même chose peut être comprise différemment, selon la position du lecteur, comme ici dans De la doctrine chrétienne :
« Souvent il arrive que celui qui est ou qui se croit élevé à un degré supérieur dans la vie spirituelle, regarde comme autant de figures les préceptes imposés à ceux qui suivent la voie commune.
Qu’il ait embrassé, par exemple, le célibat, et se soit fait eunuque en vue du royaume des cieux (Matt. XIX, 12.), tout ce que les Livres saints contiennent sur l’obligation d’aimer et de gouverner son épouse, lui paraît devoir être entendu dans le sens figuré et non littéral.
Qu’un autre ait résolu de conserver sa fille vierge, il ne voit qu’une expression métaphorique dans ces paroles : « Marie ta fille et tu auras fait un grand ouvrage » (Eccli. VII, 27.).
Une des considérations qui contribuent à l’intelligence de l’Écriture, c’est donc de savoir qu’il y a des préceptes communs à tous les hommes, et d’autres qui ne s’adressent qu’aux personnes d’une condition particulière.
Il convenait que le remède fût non-seulement appliqué d’une manière générale pour la guérison du corps entier, mais encore approprié à l’infirmité particulière de chacun des membres. Car il faut guérir et perfectionner dans sa condition celui qui ne peut être élevé à une condition supérieure. »
Augustin a donc permis une approche très rigoureuse sur le plan technique, permettant au catholicisme de disposer d’un socle de haut niveau, profitant de la gigantesque culture d’Augustin, rompu à la culture romaine.
Cependant, il fut bien obligé, naturellement, de chercher une voie pour compenser les contradictions innombrables des textes religieux.
Dans De la doctrine chrétienne, il y a notamment le passage suivant qui est très intéressant, car relevant de la tentative impossible de justifier la valeur de commandements de l’Ancien Testament, relevant du mode de production esclavagiste, en contradiction flagrante avec le message du Nouveau Testament.
Il faudrait, selon Augustin, remettre les choses dans leur contexte et comprendre que ce qui a été commandé ou permis dans le passé, dans l’Ancien Testament, correspond à un autre temps, qui serait entièrement différent.
Voici comment il tente de formuler une justification :
« Actions louées dans l’Écriture, maintenant contraires aux bonnes mœurs.
L’ancien Testament tout entier, ou presque tout entier, peut donc s’interpréter, non-seulement dans le sens littéral, mais encore dans le sens figuré.
Cependant pour les faits que le lecteur croira devoir prendre à la lettre, et dont les auteurs sont loués dans l’Écriture; si ces faits sont opposés à ce qui s’observe parmi les fidèles depuis l’établissement de la loi nouvelle, il s’attachera à la figure qu’ils contiennent, pour la comprendre, mais il se gardera de prendre le fait lui-même comme règle de ses mœurs.
Car bien des choses se pratiquaient alors légitimement, qu’on ne pourrait aujourd’hui se permettre sans péché. »
Voici comment, dans De la vraie religion, Augustin cherche à montrer que « l’enseignement de la vraie religion est contenu avec un enchaînement parfait dans l’ancien et le nouveau Testament » :
« Peut-être dira-t-on que les deux Testaments ne peuvent avoir été donnés par le même Dieu, puisque le peuple nouveau n’est point astreint aux mêmes cérémonies qui obligeaient ou qui obligent encore le peuple juif.
Mais est-il impossible que sans violer la justice le même père de famille commande autre chose à des serviteurs qu’il juge bon pour eux-mêmes de traiter plus sévèrement, et autre chose à des serviteurs qu’il daigne adopter pour enfants?
Quant aux préceptes moraux, on peut s’étonner de les voir en quelque sorte moins parfaits dans l’ancienne loi que dans l’Évangile et en conclure qu’ils n’ont pas le même Dieu pour auteur.
Mais est-il moins étonnant de voir un médecin, qui veut soulager ou guérir les malades, faire donner aux plus faibles, par ses serviteurs, des remèdes différents de ceux qu’il donne par lui-même aux tempéraments plus vigoureux?
De même donc que la médecine demeure la même science, et que sans varier dans sa nature elle varie ses remèdes suivant la diversité de nos maladies; ainsi, immuable en elle-même, la divine providence porte secours de différentes manières à sa créature inconstante et fragile; elle commande ou défend, selon nos différentes faiblesses, afin de ramener du vice, le principe de la mort, de retirer de la mort même et de rattacher intimement à sa nature et à son essence divine tout ce qui déchoit, c’est-à-dire tout ce qui incline vers le néant. »

Voici d’autres exemples, tirés de l’Accord des évangélistes, où Augustin s’évertue à justifier pourquoi les évangélistes racontent la même scène parfois très différemment.
Augustin explique que, dans certains cas, c’est pour renforcer la même idée différemment :
« Maintenant la voix du ciel a-t-elle dit: « En qui je me complais, in quo mihi complacui,» ou : « Je mets en vous ma complaisance, in te complacui, » ou enfin : « Il me complaît en vous, in te complacuit mihi ? »
On est libre d’admettre l’une ou l’autre de ce Trois leçons, pourvu que l’on comprenne qu’en rapportant différemment les paroles, les Évangélistes ont rendu la même pensée.
La différence des expressions a même l’avantage de nous faire mieux saisir l’idée, que si tous l’avaient rapportée dans les mêmes termes , et d’écarter le danger d’une fausse interprétation. »
Dans l’exemple suivant, on a droit à un bricolage de très haute mauvaise foi :
« Néanmoins il est des esprits qui ne voient pas comment saint Matthieu et saint Marc disent que le fait arriva six jours après, quand il s’agit de huit jours dans le texte de saint Luc.
Nous ne devons pas leur répondre par le mépris ; mais les instruire en leur faisant connaître la raison de cette différence. En effet, quand on dit qu’une chose arrivera dans tant de jours, quelquefois on ne compte ni le jour présent ni celui où elle doit avoir lieu, mais seulement les jours intermédiaires, les jours pleins et entiers après lesquels elle arrivera.
C’est ce qu’ont fait saint Matthieu et saint Marc. Ils ont exclu et le jour où le Sauveur parlait et celui de l’événement, et n’ayant égard qu’aux jours intermédiaires ils disent : « Six jours après; » tandis que saint Luc en comptant les deux jours exceptés par eux, savoir le premier et le dernier, et en suivant le mode de langage où la partie se prend pour le tout, nous fait lire : « Huit jours après. » »
Augustin est à ce titre incontournable dans la formation chrétienne, afin d’être en mesure de parer aux critiques rationalistes, de justifier ce qui semble incohérent de point de vue rationnel. Inévitablement, cela renforce d’autant plus la dimension mystique, anti-matérialiste.
La nécessité de gommer les contradictions fut un puissant moteur du fanatisme. Il fallait obligatoirement rejeter la raison, afin de maintenir le caractère parfait des textes. La raison est, chez Augustin, entièrement subordonnée aux Écritures, conformément à son approche fanatique.
Comme le le formule dans De la vraie religion, dans le passage où il explique que la méditation des Saintes Écritures sert de remède à la curiosité :
« Renonçons donc et pour toujours à ces niaiseries du théâtre et de la poésie.
Que l’étude et la méditation des Écritures soit l’aliment et le breuvage de notre esprit; la faim et la soif d’une curiosité insensée ne lui avaient donné que la fatigue et l’inquiétude; il cherchait en vain à se rassasier de ses vaines imaginations; ce n’était qu’un festin en peinture.
Sachons nous livrer à ce salutaire exercice, aussi noble que libéral.
Si les merveilles et la beauté des spectacles nous charment , aspirons à voir cette sagesse, qui atteint avec force d’une extrémité à l’autre et qui dispose tout avec douceur (Sag. VIII, 1.). Qu’y a-t-il en effet de plus admirable et de plus beau, que cette puissance invisible qui crée et gouverne le monde visible, qui l’ordonne et l’embellit ? »
Concluons donc avec cette sorte de petite synthèse faite par Augustin, dans De la doctrine chrétienne :
« L’Écriture s’explique mieux par elle-même que la raison.
S’il se présente un sens dont la certitude ne puisse être établie par d’autres témoignages de l’Écriture, il faut alors en montrer l’évidence par de solides raisonnements, bien que, peut-être, ce sentiment n’ait pas été celui de l’auteur en cet endroit.
Mais cette méthode est très-dangereuse.
La voie la plus sûre sera toujours celle de L’Écriture même ; et quand nous y cherchons la vérité cachée sous le voile des expressions métaphoriques, il faut que notre interprétation soit à l’abri de toute controverse, ou que, si elle est contestable, l’incertitude soit résolue par des, témoignages puisés ailleurs dans l’étendue des livres saints. »