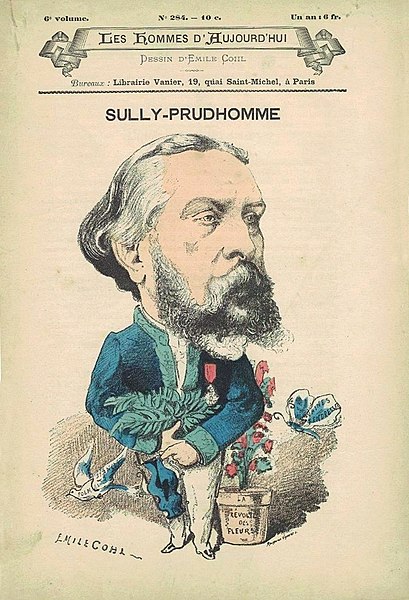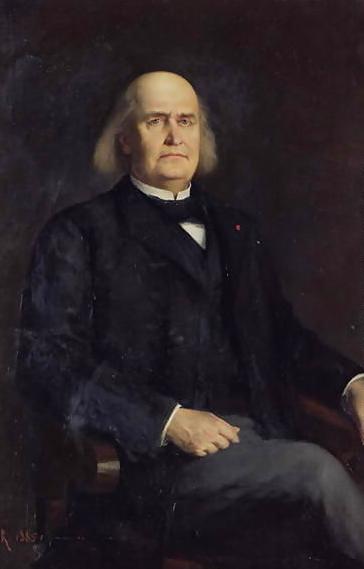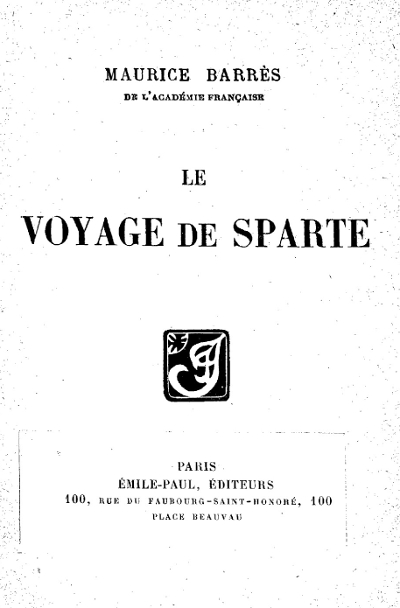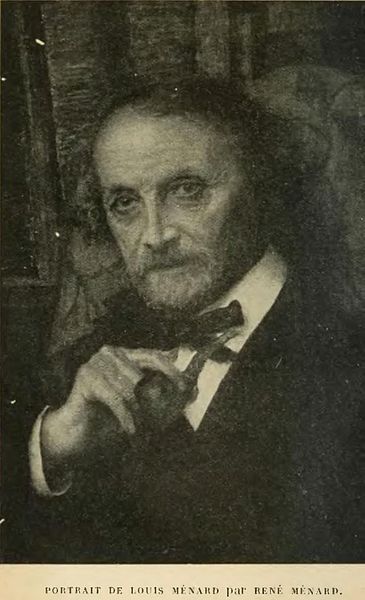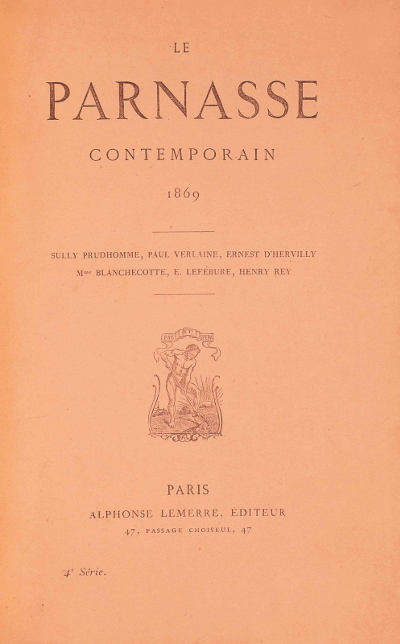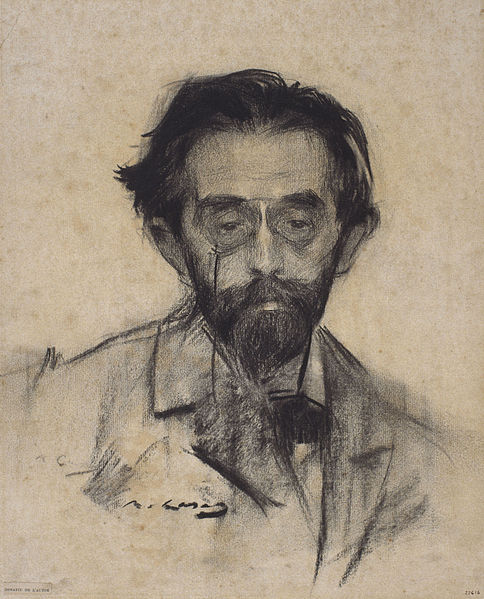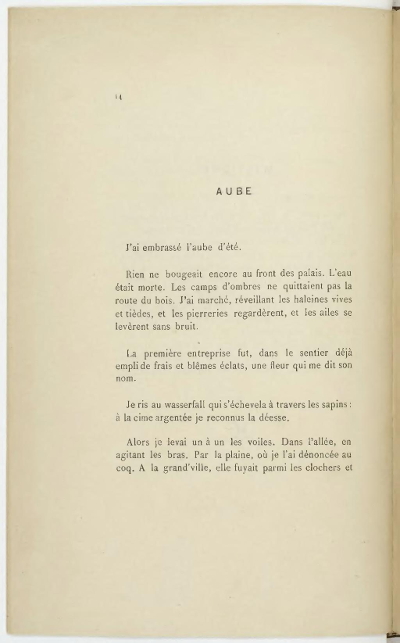Préface de Paul Verlaine
Le livre que nous offrons au public fut
écrit de 1873 à 1875, parmi des voyages tant en Belgique qu’en
Angleterre et dans toute l’Allemagne.
Le mot Illuminations est anglais et
veut dire gravures coloriées, – colored plates : c’est
même le sous-titre que M. Rimbaud avait donné à son manuscrit.
Comme on va voir, celui-ci se compose
de courtes pièces, prose exquise ou vers délicieusement faux
exprès. D’idée principale il n’y en a ou du moins nous n’y en
trouvons pas. De la joie évidente d’être un grand poète, tels
paysages féeriques, d’adorables vagues amours esquissées et la
plus haute ambition (arrivée) de style : tel est le résumé
que nous croyons pouvoir oser donner de l’ouvrage ci-après. Au
lecteur d’admirer en détail.
De très courtes notes biographiques
feront peut-être bien.
M. Arthur Rimbaud est né d’une
famille de bonne bourgeoisie à Charleville (Ardenne) où il fit
d’excellentes études quelque peu révoltées. A seize ans il avait
écrit les plus beaux vers du monde, dont de nombreux extraits furent
par nous donnés naguère dans un libelle intitulé les Poètes
maudits. Il a maintenant dans les trente-deux ans, et voyage en Asie
où il s’occupe de travaux d’art. Comme qui dirait le Faust du
second Faust, ingénieur de génie après avoir été l’immense
poète vivant élève de Méphistophélès et possesseur de cette
blonde Marguerite !
On l’a dit mort plusieurs fois. Nous
ignorons ce détail, mais en serions bien triste. Qu’il le sache au
cas où il n’en serait rien. Car nous fûmes son ami et le restons
de loin.
Deux autres manuscrits en prose et
quelques vers inédits seront publiés en leur temps.
Un nouveau portrait par Forain qui a
connu également M. Rimbaud paraîtra quand il faudra.
Dans un très beau tableau de
Fantin-Latour, Coin de table, à Manchester actuellement,
croyons-nous, il y a un portrait en buste de M. Rimbaud à seize ans.
Les Illuminations sont un peu
postérieures à cette époque.
Paul
Verlaine
Publié
dans La Vogue
1886
Après le déluge
Aussitôt que l’idée du Déluge se
fut rassise,
Un lièvre s’arrêta dans les
sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à
l’arc-en-ciel à travers la toile de l’araignée.
Oh les pierres précieuses qui se
cachaient, — les fleurs qui regardaient déjà.
Dans la grande rue sale les étals se
dressèrent, et l’on tira les barques vers la mer étagée là-haut
comme sur les gravures.
Le sang coula, chez Barbe-Bleue, — aux
abattoirs, — dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit
les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent.
Les castors bâtirent. Les
« mazagrans » fumèrent dans les estaminets.
Dans la grande maison de vitres encore
ruisselante les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses
images.
Une porte claqua, et sur la place du
hameau, l’enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des
coqs des clochers de partout, sous l’éclatante giboulée.
Madame *** établit un piano dans les
Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux
cent mille autels de la cathédrale.
Les caravanes partirent. Et le
Splendide Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du
pôle.
Depuis lors, la Lune entendit les
chacals piaulant par les déserts de thym, — et les églogues
en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette,
bourgeonnante, Eucharis me dit que c’était le printemps.
Sourds, étang, — Écume, roule
sur le pont, et par-dessus les bois ; — draps noirs et
orgues, — éclairs et tonnerre, — montez et roulez ;
— Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges.
Car depuis qu’ils se sont dissipés,
— oh les pierres précieuses s’enfouissant, et les fleurs
ouvertes ! — c’est un ennui ! et la Reine, la
Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais
nous raconter ce qu’elle sait, et que nous ignorons.
Enfance
I
Cette idole, yeux noirs et crin jaune,
sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine et
flamande ; son domaine, azur et verdure insolents, court sur des
plages nommées, par des vagues sans vaisseaux, de noms férocement
grecs, slaves, celtiques.
À la lisière de la forêt — les
fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent, — la fille à
lèvre d’orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui
sourd des prés, nudité qu’ombrent, traversent et habillent les
arcs-en-ciel, la flore, la mer.
Dames qui tournoient sur les terrasses
voisines de la mer ; enfantes et géantes, superbes noires dans
la mousse vert-de-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et
des jardinets dégelés — jeunes mères et grandes sœurs aux
regards pleins de pèlerinages, sultanes, princesses de démarche et
de costume [,] tyranniques petites étrangères et personnes
doucement malheureuses.
Quel ennui, l’heure du « cher
corps » et « cher cœur ».
II
C’est elle, la petite morte, derrière
les rosiers. — La jeune maman trépassée descend le perron
— La calèche du cousin crie sur le sable — Le petit
frère — (il est aux Indes !) là, devant le couchant,
sur le pré d’œillets. — Les vieux qu’on a enterrés tout
droits dans le rempart aux giroflées.
L’essaim des feuilles d’or entoure
la maison du général. Ils sont dans le midi. — On suit la
route rouge pour arriver à l’auberge vide. Le château est à
vendre ; les persiennes sont détachées. — Le curé aura
emporté la clef de l’église. — Autour du parc, les loges
des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu’on ne
voit que les cimes bruissantes. D’ailleurs il n’y a rien à voir
là-dedans.
Les prés remontent aux hameaux sans
coqs, sans enclumes. L’écluse est levée. Ô les calvaires et les
moulins du désert, les îles et les meules.
Des fleurs magiques bourdonnaient. Les
talus le berçaient. Des bêtes d’une élégance fabuleuse
circulaient. Les nuées s’amassaient sur la haute mer faite d’une
éternité de chaudes larmes.
III
Au bois il y a un oiseau, son chant
vous arrête et vous fait rougir.
Il y a une horloge qui ne sonne pas.
Il y a une fondrière avec un nid de
bêtes blanches.
Il y a une cathédrale qui descend et
un lac qui monte.
Il y a une petite voiture abandonnée
dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée.
Il y a une troupe de petits comédiens
en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.
Il y a enfin, quand l’on a faim et
soif, quelqu’un qui vous chasse.
IV
Je suis le saint, en prière sur la
terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la
mer de Palestine.
Je suis le savant au fauteuil sombre.
Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la
bibliothèque.
Je suis le piéton de la grand’route
par les bois nains ; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je
vois longtemps la mélancolique lessive d’or du couchant.
Je serais bien l’enfant abandonné
sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant l’allée
dont le front touche le ciel.
Les sentiers sont âpres. Les
monticules se couvrent de genêts. L’air est immobile. Que les
oiseaux et les sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin
du monde, en avançant.
V
Qu’on me loue enfin ce tombeau,
blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief — très
loin sous terre.
Je m’accoude à la table, la lampe
éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces
livres sans intérêt.
À une distance énorme au-dessus de
mon salon souterrain, les maisons s’implantent, les brumes
s’assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit
sans fin !
Moins haut, sont des égouts. Aux
côtés, rien que l’épaisseur du globe. Peut-être les gouffres
d’azur, des puits de feu. C’est peut-être sur ces plans que se
rencontrent lunes et comètes, mers et fables.
Aux heures d’amertume je m’imagine
des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi
une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?
Conte
Un Prince était vexé de ne s’être
employé jamais qu’à la perfection des générosités vulgaires.
Il prévoyait d’étonnantes révolutions de l’amour, et
soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance
agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l’heure
du désir et de la satisfaction essentiels. Que ce fût ou non une
aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez
large pouvoir humain.
Toutes les femmes qui l’avaient connu
furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté ! Sous
le sabre, elles le bénirent. Il n’en commanda point de nouvelles.
— Les femmes réapparurent.
Il tua tous ceux qui le suivaient,
après la chasse ou les libations. — Tous le suivaient.
Il s’amusa à égorger les bêtes de
luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les
taillait en pièces. — La foule, les toits d’or, les belles
bêtes existaient encore.
Peut-on s’extasier dans la
destruction, se rajeunir par la cruauté ! Le peuple ne murmura
pas. Personne n’offrit le concours de ses vues.
Un soir il galopait fièrement. Un
Génie apparut, d’une beauté ineffable, inavouable même. De sa
physionomie et de son maintien ressortait la promesse d’un amour
multiple et complexe ! d’un bonheur indicible, insupportable
même ! Le Prince et le Génie s’anéantirent probablement
dans la santé essentielle. Comment n’auraient-ils pas pu en
mourir ? Ensemble donc ils moururent.
Mais ce Prince décéda, dans son
palais, à un âge ordinaire. Le prince était le Génie. Le Génie
était le Prince.
La musique savante manque à notre
désir.
Parade
Des drôles très solides. Plusieurs
ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés de mettre en
œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos
consciences. Quels hommes mûrs ! Des yeux hébétés à la
façon de la nuit d’été, rouges et noirs, tricolores, d’acier
piqué d’étoiles d’or ; des faciès déformés, plombés,
blêmis, incendiés ; des enrouements folâtres ! La
démarche cruelle des oripeaux ! — Il y a quelques
jeunes, — comment regarderaient-ils Chérubin ? — pourvus
de voix effrayantes et de quelques ressources dangereuses. On les
envoie prendre du dos en ville, affublés d’un luxe
dégoûtant.
Ô le plus violent Paradis de la
grimace enragée ! Pas de comparaison avec vos Fakirs et les
autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés avec
le goût du mauvais rêve ils jouent des complaintes, des tragédies
de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l’histoire ou les
religions ne l’ont jamais été. Chinois, Hottentots, bohémiens,
niais, hyènes, Molochs, vieilles démences, démons sinistres, ils
mêlent les tours populaires, maternels, avec les poses et les
tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et
des chansons « bonnes filles ». Maîtres jongleurs, ils
transforment le lieu et les personnes, et usent de la comédie
magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s’élargissent,
les larmes et des filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur
terreur dure une minute, ou des mois entiers.
J’ai seul la clef de cette parade
sauvage.
Antique
Gracieux fils de Pan ! Autour de
ton front couronné de fleurettes et de baies tes yeux, des boules
précieuses, remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent.
Tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des
tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat dans ce
ventre où dort le double sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant
doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de
gauche.
Being beauteous
Devant une neige un Être de Beauté de
haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique
sourde font monter, s’élargir et trembler comme un spectre ce
corps adoré ; des blessures écarlates et noires éclatent dans
les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent,
dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. Et les
frissons s’élèvent et grondent et la saveur forcenée de ces
effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques
musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de
beauté, — elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont
revêtus d’un nouveau corps amoureux.
XXX
Ô la face cendrée, l’écusson de
crin, les bras de cristal ! le canon sur lequel je dois
m’abattre à travers la mêlée des arbres et de l’air léger !
Vies
I
Ô les énormes avenues du pays saint,
les terrasses du temple ! Qu’a-t-on fait du brahmane qui
m’expliqua les Proverbes ? D’alors, de là-bas, je vois
encore même les vieilles ! Je me souviens des heures d’argent
et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule,
et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. — Un
envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée — Exilé
ici j’ai eu une scène où jouer les chefs-d’œuvre dramatiques
de toutes les littératures. Je vous indiquerais les richesses
inouïes. J’observe l’histoire des trésors que vous trouvâtes.
Je vois la suite ! Ma sagesse est aussi dédaignée que le
chaos. Qu’est mon néant, auprès de la stupeur qui vous attend ?
II
Je suis un inventeur bien autrement
méritant que tous ceux qui m’ont précédé ; un musicien
même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. À
présent, gentilhomme d’une campagne aigre au ciel sobre, j’essaie
de m’émouvoir au souvenir de l’enfance mendiante, de
l’apprentissage ou de l’arrivée en sabots, des polémiques, des
cinq ou six veuvages, et quelques noces où ma forte tête m’empêcha
de monter au diapason des camarades. Je ne regrette pas ma vieille
part de gaîté divine : l’air sobre de cette aigre campagne
alimente fort activement mon atroce scepticisme. Mais comme ce
scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d’ailleurs
je suis dévoué à un trouble nouveau, — j’attends de
devenir un très méchant fou.
III
Dans un grenier où je fus enfermé à
douze ans j’ai connu le monde, j’ai illustré la comédie
humaine. Dans un cellier j’ai appris l’histoire. À quelque fête
de nuit dans une cité du Nord, j’ai rencontré toutes les femmes
des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris on m’a
enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée
par l’Orient entier j’ai accompli mon immense œuvre et passé
mon illustre retraite. J’ai brassé mon sang. Mon devoir m’est
remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement
d’outre-tombe, et pas de commissions.
Départ
Assez vu. La vision s’est rencontrée
à tous les airs.
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir,
et au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie. — Ô
Rumeurs et Visions !
Départ dans l’affection et le bruit
neufs !
Royauté
Un beau matin, chez un peuple fort
doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique.
« Mes amis, je veux qu’elle soit reine ! » « Je
veux être reine ! » Elle riait et tremblait. Il parlait
aux amis de révélation, d’épreuve terminée. Ils se pâmaient
l’un contre l’autre.
En effet ils furent rois toute une
matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons,
et toute l’après-midi, où ils s’avancèrent du côté des
jardins de palmes.
À une raison
Un coup de ton doigt sur le tambour
décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie.
Un pas de toi, c’est la levée des
nouveaux hommes et leur en-marche.
Ta tête se détourne : le nouvel
amour ! Ta tête se retourne, — le nouvel amour !
« Change nos lots, crible les
fléaux, à commencer par le temps », te chantent ces enfants.
« Élève n’importe où la substance de nos fortunes et de
nos vœux » on t’en prie.
Arrivée de toujours, qui t’en iras
partout.
Matinée d’ivresse
Ô mon Bien ! Ô mon
Beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! Chevalet
féerique ! Hourra pour l’œuvre inouïe et pour le corps
merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les
rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans
toutes nos veines même quand, la fanfare tournant, nous serons rendu
à l’ancienne inharmonie. Ô maintenant, nous si digne de ces
tortures ! rassemblons fervemment cette promesse surhumaine
faite à notre corps et à notre âme créés : cette promesse,
cette démence ! L’élégance, la science, la violence !
On nous a promis d’enterrer dans l’ombre l’arbre du bien et du
mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous
amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts
et cela finit, — ne pouvant nous saisir sur-le-champ de cette
éternité, — cela finit par une débandade de parfums.
Rire des enfants, discrétion des
esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets
d’ici, sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela
commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des
anges de flamme et de glace.
Petite veille d’ivresse, sainte !
quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié. Nous
t’affirmons, méthode ! Nous n’oublions pas que tu as
glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous
savons donner notre vie tout entière tous les jours.
Voici le temps des Assassins.
Phrases
Quand le monde sera réduit en un seul
bois noir pour nos quatre yeux étonnés, — en une plage pour
deux enfants fidèles, — en une maison musicale pour notre
claire sympathie, — je vous trouverai.
Qu’il n’y ait ici-bas qu’un
vieillard seul, calme et beau, entouré d’un « luxe inouï »,
— et je suis à vos genoux.
Que j’aie réalisé tous vos
souvenirs, — que je sois celle qui sait vous garrotter, — je
vous étoufferai.
Quand nous sommes très forts, — qui
recule ? très gais, qui tombe de ridicule ? Quand nous
sommes très méchants, que ferait-on de nous.
Parez-vous, dansez, riez, — je
ne pourrai jamais envoyer l’Amour par la fenêtre.
— Ma camarade, mendiante, enfant
monstre ! comme ça t’est égal, ces malheureuses et ces
manœuvres, et mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix
impossible, ta voix ! unique flatteur de ce vil désespoir.
(Fragments du feuillet 12)
Une matinée couverte, en juillet. Un
goût de cendres vole dans l’air ; — une odeur de bois
suant dans l’âtre, — les fleurs rouies, — le saccage
des promenades, — la bruine des canaux par les champs
— pourquoi pas déjà les joujoux et l’encens ?
J’ai tendu des cordes de clocher à
clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des
chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse.
Le haut étang fume continuellement.
Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc ? Quelles
violettes frondaisons vont descendre ?
Pendant que les fonds publics
s’écoulent en fêtes de fraternité, il sonne une cloche de feu
rose dans les nuages.
Avivant un agréable goût d’encre de
Chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. — Je
baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et, tourné du
côté de l’ombre, je vous vois, mes filles ! mes reines !
Ouvriers
Ô cette chaude matinée de février.
Le Sud inopportun vint relever nos souvenirs d’indigents absurdes,
notre jeune misère.
Henrika avait une jupe de coton à
carreau blanc et brun, qui a dû être portée au siècle dernier, un
bonnet à rubans, et un foulard de soie. C’était bien plus triste
qu’un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était
couvert, et ce vent du Sud excitait toutes les vilaines odeurs des
jardins ravagés et des prés desséchés.
Cela ne devait pas fatiguer ma femme au
même point que moi. Dans une flache laissée par l’inondation du
mois précédent à un sentier assez haut elle me fit remarquer de
très petits poissons.
La ville, avec sa fumée et ses bruits
de métiers, nous suivait très loin dans les chemins. Ô l’autre
monde, l’habitation bénie par le ciel et les ombrages ! Le
sud me rappelait les misérables incidents de mon enfance, mes
désespoirs d’été, l’horrible quantité de force et de science
que le sort a toujours éloignée de moi. Non ! nous ne
passerons pas l’été dans cet avare pays où nous ne serons jamais
que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus
une chère image.
Les Ponts
Des ciels gris de cristal. Un bizarre
dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d’autres
descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se
renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous
tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes
s’abaissent et s’amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont
encore chargés de masures. D’autres soutiennent des mâts, des
signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent, et
filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge,
peut-être d’autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce
des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants
d’hymnes publics ? L’eau est grise et bleue, large comme un
bras de mer. — Un rayon blanc, tombant du haut du ciel,
anéantit cette comédie.
Ville
Je suis un éphémère et point trop
mécontent citoyen d’une métropole crue moderne parce que tout
goût connu a été éludé dans les ameublements et l’extérieur
des maisons aussi bien que dans le plan de la ville. Ici vous ne
signaleriez les traces d’aucun monument de superstition. La morale
et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin !
Ces millions de gens qui n’ont pas besoin de se connaître amènent
si pareillement l’éducation, le métier et la vieillesse, que ce
cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu’une
statistique folle trouve pour les peuples du continent. Aussi comme,
de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers
l’épaisse et éternelle fumée de charbon, — notre ombre
des bois, notre nuit d’été ! — des Érinnyes
nouvelles, devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur
puisque tout ici ressemble à ceci, — la Mort sans pleurs,
notre active fille et servante, et un Amour désespéré, et un joli
Crime piaulant dans la boue de la rue.
Ornières
À droite l’aube d’été éveille
les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les
talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides
ornières de la route humide. Défilé de féeries. En effet :
des chars chargés d’animaux de bois doré, de mâts et de toiles
bariolées, au grand galop de vingt chevaux de cirque tachetés, et
les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes ;
— vingt véhicules, bossés, pavoisés et fleuris comme des
carrosses anciens ou de contes, pleins d’enfants attifés pour une
pastorale suburbaine ; — Même des cercueils sous leur
dais de nuit dressant les panaches d’ébène, filant au trot des
grandes juments bleues et noires.
Villes (Ce sont des villes !)
Ce sont des villes ! C’est un
peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de
rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des
rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de
colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les
feux. Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière
les chalets. La chasse des carillons crie dans les gorges. Des
corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et
des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les
plates-formes au milieu des gouffres les Rolands sonnent leur
bravoure. Sur les passerelles de l’abîme et les toits des auberges
l’ardeur du ciel pavoise les mâts. L’écroulement des apothéoses
rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques
évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes
crêtes une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus,
chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des
conques précieuses, — la mer s’assombrit parfois avec des
éclats mortels. Sur les versants des moissons de fleurs grandes
comme nos armes et nos coupes, mugissent. Des cortèges de Mabs en
robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds
dans la cascade et les ronces, les cerfs tettent Diane. Les
Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus
entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de
beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os
sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans
se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s’effondre. Les
sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit. Et une heure je suis
descendu dans le mouvement d’un boulevard de Bagdad où des
compagnies ont chanté la joie du travail nouveau, sous une brise
épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des
monts où l’on a dû se retrouver.
Quels bons bras, quelle belle heure me
rendront cette région d’où viennent mes sommeils et mes moindres
mouvements ?
Vagabonds
Pitoyable frère ! Que d’atroces
veillées je lui dus ! « Je ne me saisissais pas
fervemment de cette entreprise. Je m’étais joué de son infirmité.
Par ma faute nous retournerions en exil, en esclavage. » Il me
supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait
des raisons inquiétantes.
Je répondais en ricanant à ce
satanique docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je créais,
par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les
fantômes du futur luxe nocturne.
Après cette distraction vaguement
hygiénique, je m’étendais sur une paillasse. Et, presque chaque
nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche
pourrie, les yeux arrachés, — tel qu’il se rêvait !
— et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin
idiot.
J’avais en effet, en toute sincérité
d’esprit, pris l’engagement de le rendre à son état primitif de
fils du Soleil, — et nous errions, nourris du vin des cavernes
et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la
formule.
Villes (L’acropole officielle)
L’acropole officielle outre les
conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. Impossible
d’exprimer le jour mat produit par le ciel immuablement gris,
l’éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du sol. On
a reproduit dans un goût d’énormité singulier toutes les
merveilles classiques de l’architecture. J’assiste à des
expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes
qu’Hampton-Court. Quelle peinture ! Un Nabuchodonosor
norwégien a fait construire les escaliers des ministères ; les
subalternes que j’ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas
et j’ai tremblé à l’aspect des gardiens de colosses et
officiers de constructions. Par le groupement des bâtiments en
squares, cours et terrasses fermées, on évince les cochers. Les
parcs représentent la nature primitive travaillée par un art
superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables : un bras
de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais
chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une
poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme
est une armature d’acier artistique de quinze mille pieds de
diamètre environ.
Sur quelques points des passerelles de
cuivre, des plates-formes, des escaliers qui contournent les halles
et les piliers, j’ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville !
C’est le prodige dont je n’ai pu me rendre compte : quels
sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l’acropole ?
Pour l’étranger de notre temps la reconnaissance est impossible.
Le quartier commerçant est un circus d’un seul style, avec
galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques. Mais la neige de la
chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les
promeneurs d’un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une
diligence de diamants.
Sur quelques points des passerelles de
cuivre, des plates-formes, des escaliers qui contournent les halles
et les piliers, j’ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville !
C’est le prodige dont je n’ai pu me rendre compte : quels
sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l’acropole ?
Pour l’étranger de notre temps la reconnaissance est impossible.
Le quartier commerçant est un circus d’un seul style, avec
galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques. Mais la neige de la
chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les
promeneurs d’un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une
diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge : on
sert des boissons polaires dont le prix varie de huit cents à huit
mille roupies. À l’idée de chercher des théâtres sur ce circus,
je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez
sombres. Je pense qu’il y a une police, mais la loi doit être
tellement étrange, que je renonce à me faire une idée des
aventuriers d’ici.
Le faubourg aussi élégant qu’une
belle rue de Paris est favorisé d’un air de lumière. L’élément
démocratique compte quelque cents âmes. Là encore les maisons ne
se suivent pas ; le faubourg se perd bizarrement dans la
campagne, le « Comté » qui remplit l’occident éternel
des forêts et des plantations prodigieuses où les gentilshommes
sauvages chassent leurs chroniques sous la lumière qu’on a créée.
Veillées
I
C’est le repos éclairé, ni fièvre
ni langueur, sur le lit ou sur le pré.
C’est l’ami ni ardent ni faible.
L’ami.
C’est l’aimée ni tourmentante ni
tourmentée. L’aimée.
L’air et le monde point cherchés. La
vie.
— Était-ce donc ceci ?
— Et le rêve fraîchit.
II
L’éclairage revient à l’arbre de
bâtisse. Des deux extrémités de la salle, décors quelconques, des
élévations harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur
est une succession psychologique de coupes de frises, de bandes
atmosphériques et d’accidences géologiques. — Rêve
intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les
caractères parmi toutes les apparences.
III
Les lampes et les tapis de la veillée
font le bruit des vagues, la nuit, le long de la coque et autour du
steerage.
La mer de la veillée, telle que les
seins d’Amélie.
Les tapisseries, jusqu’à mi-hauteur,
des taillis de dentelle, teinte d’émeraude, où se jettent les
tourterelles de la veillée.
La plaque du foyer noir, de réels
soleils des grèves : ah ! puits des magies ; seule
vue d’aurore, cette fois.
Mystique
Sur la pente du talus les anges
tournent leurs robes de laine dans les herbages d’acier et
d’émeraude.
Des prés de flammes bondissent
jusqu’au sommet du mamelon. À gauche le terreau de l’arête est
piétiné par tous les homicides et toutes les batailles, et tous les
bruits désastreux filent leur courbe. Derrière l’arête de droite
la ligne des orients, des progrès.
Et tandis que la bande en haut du
tableau est formée de la rumeur tournante et bondissante des conques
des mers et des nuits humaines,
La douceur fleurie des étoiles et du
ciel et du reste descend en face du talus, comme un panier, — contre
notre face, et fait l’abîme fleurant et bleu là-dessous.
Aube
J’ai embrassé l’aube d’été.
Rien ne bougeait encore au front des
palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne quittaient pas
la route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et
tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent
sans bruit.
La première entreprise fut, dans le
sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me
dit son nom.
Je ris au wasserfall blond qui
s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je
reconnus la déesse.
Alors je levai un à un les voiles.
Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai
dénoncée au coq. À la grand’ville elle fuyait parmi les clochers
et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre,
je la chassais.
En haut de la route, près d’un bois
de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai
senti un peu son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au
bas du bois.
Au réveil il était midi.
Fleurs
D’un gradin d’or, — parmi
les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les
disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, — je
vois la digitale s’ouvrir sur un tapis de filigranes d’argent,
d’yeux et de chevelures.
Des pièces d’or jaune semées sur
l’agate, des piliers d’acajou supportant un dôme d’émeraudes,
des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la
rose d’eau.
Tels qu’un dieu aux énormes yeux
bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux
terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses.
Nocturne vulgaire
Un souffle ouvre des brèches
operadiques dans les cloisons, — brouille le pivotement des
toits rongés, — disperse les limites des foyers, — éclipse
les croisées. — Le long de la vigne, m’étant appuyé du
pied à une gargouille, — je suis descendu dans ce carrosse
dont l’époque est assez indiquée par les glaces convexes, les
panneaux bombés et les sophas contournés — Corbillard de mon
sommeil, isolé, maison de berger de ma niaiserie, le véhicule vire
sur le gazon de la grande route effacée ; et dans un défaut en
haut de la glace de droite tournoient les blêmes figures lunaires,
feuilles, seins ;
— Un vert et un bleu très
foncés envahissent l’image. Dételage aux environs d’une tache
de gravier.
— Ici, va-t-on siffler pour
l’orage, et les Sodomes, — et les Solymes, — et les
bêtes féroces et les armées,
— (Postillon et bêtes de songe
reprendront-ils sous les plus suffocantes futaies, pour m’enfoncer
jusqu’aux yeux dans la source de soie).
— Et nous envoyer, fouettés à
travers les eaux clapotantes et les boissons répandues, rouler sur
l’aboi des dogues…
— Un souffle disperse les
limites du foyer.
Marine
Les chars d’argent et de cuivre —
Les proues d’acier et d’argent —
Battent l’écume, —
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux
Filent circulairement vers l’est,
Vers les piliers de la forêt, —
Vers les fûts de la jetée,
Dont l’angle est heurté par des
tourbillons de lumière.
Fête d’hiver
La cascade sonne derrière les huttes
d’opéra-comique. Des girandoles prolongent, dans les vergers et
les allées voisins du Méandre, — les verts et les rouges du
couchant. Nymphes d’Horace coiffées au Premier Empire, — Rondes
Sibériennes, Chinoises de Boucher.
Angoisse
Se peut-il qu’Elle me fasse pardonner
les ambitions continuellement écrasées, — qu’une fin aisée
répare les âges d’indigence, — qu’un jour de succès
nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale,
(Ô palmes ! diamant — Amour,
force ! — plus haut que toutes joies et gloires !
— de toutes façons, partout, — Démon, dieu,
— Jeunesse de cet être-ci ; moi !)
Que des accidents de féerie
scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris
comme restitution progressive de la franchise première ?…
Mais la Vampire qui nous rend gentils
commande que nous nous amusions avec ce qu’elle nous laisse, ou
qu’autrement nous soyons plus drôles.
Rouler aux blessures, par l’air
lassant et la mer ; aux supplices, par le silence des eaux et de
l’air meurtriers ; aux tortures qui rient, dans leur silence
atrocement houleux.
Métropolitain
Du détroit d’indigo aux mers
d’Ossian, sur le sable rose et orange qu’a lavé le ciel vineux
viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal habités
incontinent par de jeunes familles pauvres qui s’alimentent chez
les fruitiers. Rien de riche. — La ville !
Du désert de bitume fuient droit en
déroute avec les nappes de brumes échelonnées en bandes affreuses
au ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la plus
sinistre fumée noire que puisse faire l’Océan en deuil, les
casques, les roues, les barques, les croupes. — La bataille !
Lève la tête : ce pont de bois,
arqué ; les derniers potagers de Samarie ; ces masques
enluminés sous la lanterne fouettée par la nuit froide ;
l’ondine niaise à la robe bruyante, au bas de la rivière ;
les crânes lumineux dans les plants de pois — et les autres
fantasmagories —la campagne.
Des routes bordées de grilles et de
murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu’on
appellerait cœurs et sœurs, Damas damnant de longueur,
— possessions de féeriques aristocraties ultra-Rhénanes,
Japonaises, Guaranies, propres encore à recevoir la musique des
anciens — et il y a des auberges qui pour toujours n’ouvrent
déjà plus — il y a des princesses, et si tu n’es pas trop
accablé, l’étude des astres — Le ciel.
Le matin où avec Elle, vous vous
débattîtes parmi les éclats de neige, les lèvres vertes, les
glaces, les drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums
pourpres du soleil des pôles, — ta force.
Barbare
Bien après les jours et les saisons,
et les êtres et les pays,
Le pavillon en viande saignante sur la
soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles n’existent
pas.)
Remis des vieilles fanfares d’héroïsme
— qui nous attaquent encore le cœur et la tête — loin
des anciens assassins —
Oh ! Le pavillon en viande
saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles
n’existent pas)
Douceurs !
Les brasiers pleuvant aux rafales de
givre, — Douceurs ! — les feux à la pluie du vent
de diamants jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé
pour nous. — Ô monde ! —
(Loin des vieilles retraites et des
vieilles flammes, qu’on entend, qu’on sent,)
Les brasiers et les écumes. La
musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres.
Ô Douceurs, ô monde, ô musique !
Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les yeux, flottant.
Et les larmes blanches, bouillantes, — ô douceurs ! — et
la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes
arctiques.
Le pavillon…
Solde
À vendre ce que les juifs n’ont pas
vendu, ce que noblesse ni crime n’ont goûté, ce qu’ignorent
l’amour maudit et la probité infernale des masses : ce que le
temps ni la science n’ont pas à reconnaître ;
Les Voix reconstituées ; l’éveil
fraternel de toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs
applications instantanées ; l’occasion, unique, de dégager
nos sens !
À vendre les Corps sans prix, hors de
toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance !
Les richesses jaillissant à chaque démarche ! Solde de
diamants sans contrôle !
À vendre l’anarchie pour les
masses ; la satisfaction irrépressible pour les amateurs
supérieurs ; la mort atroce pour les fidèles et les amants !
À vendre les habitations et les
migrations, sports, féeries et conforts parfaits, et le bruit, le
mouvement et l’avenir qu’ils font !
À vendre les applications de calcul et
les sauts d’harmonie inouïs. Les trouvailles et les termes non
soupçonnés, possession immédiate,
Élan insensé et infini aux splendeurs
invisibles, aux délices insensibles, — et ses secrets
affolants pour chaque vice — et sa gaîté effrayante pour la
foule —
À vendre les Corps, les voix,
l’immense opulence inquestionable, ce qu’on ne vendra jamais. Les
vendeurs ne sont pas à bout de solde ! Les voyageurs n’ont
pas à rendre leur commission de si tôt !
Fairy
Pour Hélène se conjurèrent les sèves
ornamentales dans les ombres vierges et les clartés impassibles dans
le silence astral. L’ardeur de l’été fut confiée à des
oiseaux muets et l’indolence requise à une barque de deuils sans
prix par des anses d’amours morts et de parfums affaissés.
— Après le moment de l’air
des bûcheronnes à la rumeur du torrent sous la ruine des bois, de
la sonnerie des bestiaux à l’écho des vals, et des cris des
steppes. —
Pour l’enfance d’Hélène
frissonnèrent les fourrures et les ombres, — et le sein des
pauvres, et les légendes du ciel.
Et ses yeux et sa danse supérieurs
encore aux éclats précieux, aux influences froides, au plaisir du
décor et de l’heure uniques.
Guerre
Enfant, certains ciels ont affiné mon
optique : tous les caractères nuancèrent ma physionomie. Les
Phénomènes s’émurent. — À présent, l’inflexion
éternelle des moments et l’infini des mathématiques me chassent
par ce monde où je subis tous les succès civils, respecté de
l’enfance étrange et des affections énormes. — Je songe à
une Guerre, de droit ou de force, de logique bien imprévue.
C’est aussi simple qu’une phrase
musicale.
Jeunesse
I
Dimanche
Les calculs de côté, l’inévitable
descente du ciel, et la visite des souvenirs et la séance des
rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit.
— Un cheval détale sur le turf
suburbain, et le long des cultures et des boisements, percé par la
peste carbonique. Une misérable femme de drame, quelque part dans le
monde, soupire après des abandons improbables. Les desperadoes
languissent après l’orage, l’ivresse et les blessures. De petits
enfants étouffent des malédictions le long des rivières. —
Reprenons l’étude au bruit de
l’œuvre dévorante qui se rassemble et remonte dans les masses.
II
Sonnet
Homme de constitution ordinaire,
la chair n’était-elle pas un fruit pendu dans le verger, — ô
journées enfantes ! — le corps un trésor à prodiguer ;
— ô aimer, le péril ou la force de Psyché ? La terre
avait des versants fertiles en princes et en artistes, et la
descendance et la race vous poussaient aux crimes et aux deuils :
le monde votre fortune et votre péril. Mais à présent, ce labeur
comblé, toi, tes calculs, — toi, tes impatiences — ne
sont plus que votre danse et votre voix, non fixées et point
forcées, quoique d’un double événement d’invention et de
succès une raison, — en l’humanité fraternelle et discrète
par l’univers sans images ; — la force et le droit
réfléchissent la danse et la voix à présent seulement appréciées.
III
Vingt ans
Les voix instructives exilées…
L’ingénuité physique amèrement rassise… — Adagio — Ah !
l’égoïsme infini de l’adolescence, l’optimisme studieux :
que le monde était plein de fleurs cet été ! Les airs et les
formes mourant… — Un chœur, pour calmer l’impuissance et
l’absence ! Un chœur de verres, de mélodies nocturnes… En
effet les nerfs vont vite chasser.
IV
Tu en es encore à la tentation
d’Antoine. L’ébat du zèle écourté, les tics d’orgueil
puéril, l’affaissement et l’effroi.
Mais tu te mettras à ce travail :
toutes les possibilités harmoniques et architecturales s’émouvront
autour de ton siège. Des êtres parfaits, imprévus, s’offriront à
tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la
curiosité d’anciennes foules et de luxes oisifs. Ta mémoire et
tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion créatrice.
Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En
tout cas, rien des apparences actuelles.
Promontoire
L’aube d’or et la soirée
frissonnante trouvent notre brick en large en face de cette villa et
de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que
l’Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou
que l’Arabie ! Des fanums qu’éclaire la rentrée des
théories, d’immenses vues de la défense des côtes modernes ;
des dunes illustrées de chaudes fleurs et de bacchanales ; de
grands canaux de Carthage et des Embankments d’une Venise louche ;
de molles éruptions d’Etnas et des crevasses de fleurs et d’eaux
des glaciers ; des lavoirs entourés de peupliers d’Allemagne ;
des talus de parcs singuliers penchant des têtes d’Arbre du
Japon ; les façades circulaires des « Royal » ou
des « Grand » de Scarbro’ ou de Brooklyn ; et
leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions de
cet Hôtel, choisies dans l’histoire des plus élégantes et des
plus colossales constructions de l’Italie, de l’Amérique et de
l’Asie, dont les fenêtres et les terrasses à présent pleines
d’éclairages, de boissons et de brises riches, sont ouvertes à
l’esprit des voyageurs et des nobles — qui permettent, aux
heures du jour, à toutes les tarentelles des côtes, — et
même aux ritournelles des vallées illustres de l’art, de décorer
merveilleusement les façades du Palais-Promontoire.
Scènes
L’ancienne Comédie poursuit ses
accords et divise ses Idylles :
Des boulevards de tréteaux.
Un long pier en bois d’un bout à
l’autre d’un champ rocailleux où la foule barbare évolue sous
les arbres dépouillés.
Dans des corridors de gaze noire
suivant le pas des promeneurs aux lanternes et aux feuilles.
Des oiseaux des mystères s’abattent
sur un ponton de maçonnerie mû par l’archipel couvert des
embarcations des spectateurs.
Des scènes lyriques accompagnées de
flûte et de tambour s’inclinent dans des réduits ménagés sous
les plafonds, autour des salons de clubs modernes ou des salles de
l’Orient ancien.
La féerie manœuvre au sommet d’un
amphithéâtre couronné par les taillis, — Ou s’agite et
module pour les Béotiens, dans l’ombre des futaies mouvantes sur
l’arête des cultures.
L’opéra-comique se divise sur une
scène à l’arête d’intersection de dix cloisons dressées de la
galerie aux feux.
Soir historique
En quelque soir, par exemple, que se
trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la
main d’un maître anime le clavecin des prés ; on joue aux
cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des
mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils d’harmonie, et
les chromatismes légendaires, sur le couchant.
Il frissonne au passage des chasses et
des hordes. La comédie goutte sur les tréteaux de gazon. Et
l’embarras des pauvres et des faibles sur ces plans stupides !
À sa vision esclave, — l’Allemagne
s’échafaude vers des lunes ; les déserts tartares
s’éclairent — les révoltes anciennes grouillent dans le
centre du Céleste Empire ; par les escaliers et les fauteuils
de rois — un petit monde blême et plat, Afrique et Occidents,
va s’édifier. Puis un ballet de mers et de nuits connues, une
chimie sans valeur, et des mélodies impossibles.
La même magie bourgeoise à tous les
points où la malle nous déposera ! Le plus élémentaire
physicien sent qu’il n’est plus possible de se soumettre à cette
atmosphère personnelle, brume de remords physiques, dont la
constatation est déjà une affliction.
Non ! — Le moment de
l’étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la
planète emportée, et des exterminations conséquentes, certitudes
si peu malignement indiquées dans la Bible et par les Nornes et
qu’il sera donné à l’être sérieux de surveiller. — Cependant
ce ne sera point un effet de légende !
Bottom
La réalité étant trop épineuse pour
mon grand caractère, — je me trouvai néanmoins chez ma dame,
en gros oiseau gris bleu s’essorant vers les moulures du plafond et
traînant l’aile dans les ombres de la soirée.
Je fus, au pied du baldaquin supportant
ses bijoux adorés et ses chefs-d’œuvre physiques, un gros ours
aux gencives violettes et au poil chenu de chagrin, les yeux aux
cristaux et aux argents des consoles.
Tout se fit ombre et aquarium ardent.
Au matin, — aube de juin
batailleuse, — je courus aux champs, âne, claironnant et
brandissant mon grief, jusqu’à ce que les Sabines de la banlieue
vinrent se jeter à mon poitrail.
H
Toutes les monstruosités violent les
gestes atroces d’Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique,
sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d’une
enfance elle a été, à des époques nombreuses, l’ardente hygiène
des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des
êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action — Ô
terrible frisson des amours novices, sur le sol sanglant et par
l’hydrogène clarteux ! trouvez Hortense.
Mouvement
Le mouvement de lacet sur la berge des
chutes du fleuve,
Le gouffre à l’étambot
La célérité de la rampe,
L’énorme passade du courant
Mènent par les lumières inouïes
Et la nouveauté chimique
Les voyageurs entourés des trombes du
val
Et du strom.
Ce sont les conquérants du monde
Cherchant la fortune chimique
personnelle ;
Le sport et le confort voyagent avec
eux ;
Ils emmènent l’éducation
Des races, des classes et des bêtes,
sur ce Vaisseau.
Repos et vertige
À la lumière diluvienne,
Aux terribles soirs d’étude.
Car de la causerie parmi les appareils,
— le sang, les fleurs, le feu, les bijoux —
Des comptes agités à ce bord fuyard,
— On voit, roulant comme une
digue au-delà de la route hydraulique motrice,
Monstrueux, s’éclairant sans fin,
— leur stock d’études ; —
Eux chassés dans l’extase harmonique
Et l’héroïsme de la découverte.
Aux accidents atmosphériques les plus
surprenants
Un couple de jeunesse s’isole sur
l’arche,
— Est-ce ancienne sauvagerie
qu’on pardonne ?
Et chante et se poste.
Dévotion
À ma sœur Louise Vanaen de
Voringhem : — Sa cornette bleue tournée à la mer du
Nord. — Pour les naufragés.
À ma sœur Léonie Aubois d’Ashby.
Baou — l’herbe d’été bourdonnante et puante. — Pour
la fièvre des mères et des enfants.
À Lulu, — démon — qui a
conservé un goût pour les oratoires du temps des Amies et de son
éducation incomplète. Pour les hommes ! À madame ***.
À l’adolescent que je fus. À ce
saint vieillard, ermitage ou mission.
À l’esprit des pauvres. Et à un
très haut clergé.
Aussi bien à tout culte en telle place
de culte mémoriale et parmi tels événements qu’il faille se
rendre, suivant les aspirations du moment ou bien notre propre vice
sérieux.
Ce soir à Circeto des hautes glaces,
grasse comme le poisson, et enluminée comme les dix mois de la nuit
rouge, — (son cœur ambre et spunck), — pour ma seule
prière muette comme ces régions de nuit et précédant des
bravoures plus violentes que ce chaos polaire.
À tout prix et avec tous les airs,
même dans des voyages métaphysiques. — Mais plus alors.
Démocratie
« Le drapeau va au paysage
immonde, et notre patois étouffe le tambour.
« Aux centres nous alimenterons
la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes
logiques.
« Aux pays poivrés et
détrempés ! — au service des plus monstrueuses
exploitations industrielles ou militaires.
« Au revoir ici, n’importe où.
Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ;
ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison
pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »
Génie
Il est l’affection et le présent
puisqu’il a fait la maison ouverte à l’hiver écumeux et à la
rumeur de l’été, lui qui a purifié les boissons et les aliments,
lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des
stations. Il est l’affection et l’avenir, la force et l’amour
que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer
dans le ciel de tempête et les drapeaux d’extase.
Il est l’amour, mesure parfaite et
réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l’éternité :
machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l’épouvante
de sa concession et de la nôtre : ô jouissance de notre santé,
élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui
qui nous aime pour sa vie infinie…
Et nous nous le rappelons et il voyage…
Et si l’Adoration s’en va, sonne, sa promesse sonne :
« Arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages
et ces âges. C’est cette époque-ci qui a sombré ! »
Il ne s’en ira pas, il ne redescendra
pas d’un ciel, il n’accomplira pas la rédemption des colères de
femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce péché : car
c’est fait, lui étant, et étant aimé.
Ô ses souffles, ses têtes, ses
courses ; la terrible célérité de la perfection des formes et
de l’action.
Ô fécondité de l’esprit et
immensité de l’univers !
Son corps ! Le dégagement rêvé,
le brisement de la grâce croisée de violence nouvelle !
Sa vue, sa vue ! tous les
agenouillages anciens et les peines relevés à sa suite.
Son jour ! l’abolition de toutes
souffrances sonores et mouvantes dans la musique plus intense.
Son pas ! les migrations plus
énormes que les anciennes invasions.
Ô Lui et nous ! l’orgueil plus
bienveillant que les charités perdues.
Ô monde ! et le chant clair des
malheurs nouveaux !
Il nous a connus tous et nous a tous
aimés. Sachons, cette nuit d’hiver, de cap en cap, du pôle
tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en
regards, forces et sentiments las, le héler et le voir, et le
renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige,
suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.
>Sommaire du dossier des Illuminations d’Arthur Rimbaud