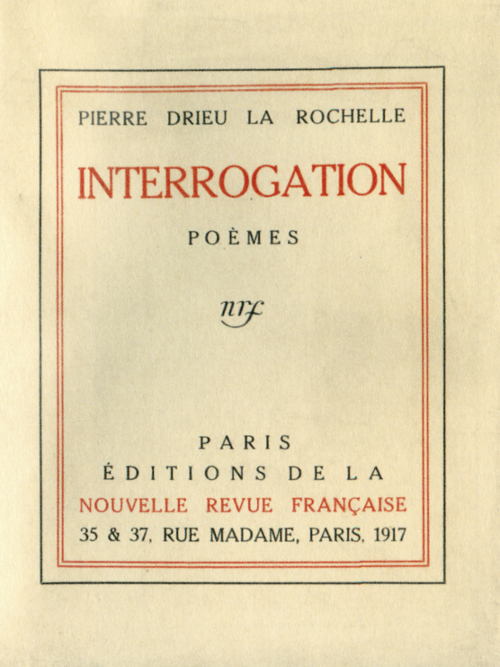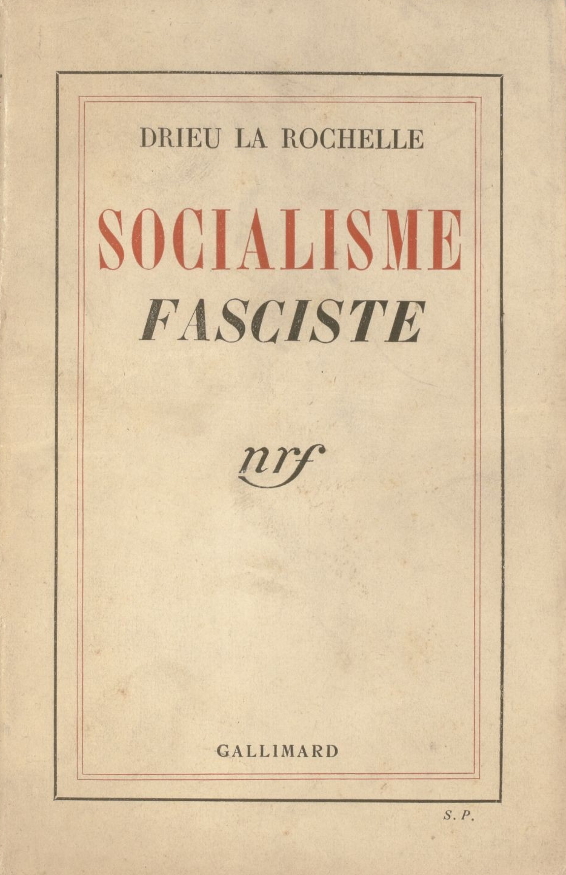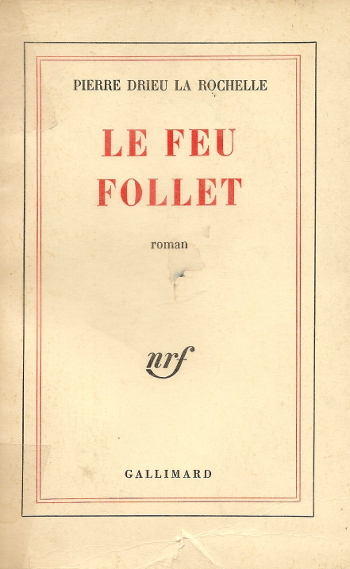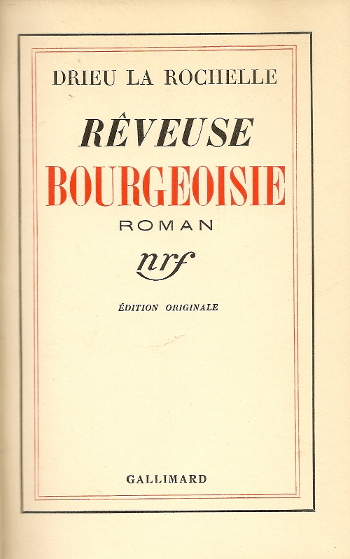L’essai Le jeune européen est une tentative de formulation romantique d’un dépassement de sa situation personnelle historique pour aboutir, à travers l’ultra-subjectivisme, à la production d’un idéalisme « pur ».
Comment Pierre Drieu La Rochelle se présente-t-il ? Il dit de lui :
« Toute une époque est une aventure. Je suis un aventurier. Bonne époque pour moi que mon époque, notre chère époque. Je connaissais déjà les courses d’auto, la cocaïne, l’alpinisme.
Je trouvais dans cette Champagne désolée, abstraite, le sport d’abîme que je flairais depuis longtemps.
Patrouilles, guerre de mines, camaraderie bestiale et farouche, gloire sordide. »
Ce fut la base d’une expérience présentée sous un angle mystique :
« Pendant trois mois d’abjection physique, dans la dysenterie, parmi ces armées de paysans, d’employés et d’ouvriers, encadrées d’intellectuels délirants, jetées les unes contre les autres, par de vieux chefs de gare désorientés, dans des massacres obscurs, je connus un transport inouï.
Je fus l’ermite des charniers. »
Par conséquent, il y a une forme de transcendance, qu’il s’agit de revivre afin de pouvoir ne serait-ce que vivre :
« Il faut avoir tué de sa main pour comprendre la vie. La seule vie dont les hommes sont capables, je vous le redis, c’est l’effusion du sang : meurtres et coïts. Tout le reste n’est que fin de course, décadence. »
Or, le développement du capitalisme, en tant que développement des forces productives, d’une vie facile se développant malgré et même contre l’expérience de la première guerre mondiale, pose une approche radicalement différente, que Pierre Drieu La Rochelle vit extrêmement mal :
« Tandis que les Américains canonnaient la Nature, les Européens, les uns sur les autres, encore trompés par de vieilles coutumes, se canonnaient entre eux.
Mais vienne la paix et il ne s’agirait plus que de boîtes de conserve et d’autos à bon marché. »
On voit le grand problème : Pierre Drieu La Rochelle reconnaît l’aliénation amené par le développement du capitalisme, mais il lui oppose non pas l’avenir, mais le passé.
Il est à la fois scandalisé que sa propre expérience soit aussi rapidement placée à l’arrière-plan de l’histoire, et choquée de la rapidité du développement en cours.
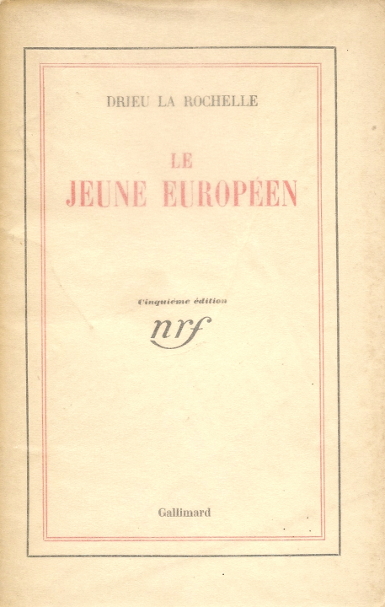
Le thème de la nature est vu, mais incompris, cantonné principalement à la question du corps, celui de l’homme, et pourtant on devine tout à fait comment, à travers la critique romantique petite-bourgeoise de Pierre Drieu La Rochelle, il y a la dénonciation romantique d’un monde rempli de futilités, voire une véritable critique de l’aliénation, comme dans le long passage suivant :
« L’éclairage : sauf dans quelques intérieurs étroits, l’homme pas encore su maîtriser la force nouvelle de l’électricité, dont il se blesse par mille éclats, par infatuation.
Il ne sait pas la capter, la calmer, la rendre chaude et douce ou alors il l’amortit, il la met sous le boisseau, et ce sont des pénombres funèbres (…).
Ces idiots aveugles, incapables de se tenir à la hauteur de leurs propres inventions, n’ont pas encore remarqué que l’électricité tuait les nuances et que seules des couleurs crues, profondément massées, pouvaient faire front contre ces charges de clarté blanche.
De même, le vêtement n’est pas traité à l’échelle neuve : des détails vétilleux embrouillent la tache des costumes, entravent l’arabesque des corps.
Il faudrait faire alterner des partis-pris : tantôt, sur un fond uni, faire ressortir le corps humain à force de lumière, comme le font photographes et cinégraphes, et tirer de cette seule matière tout son trésor de suggestion linéaire quand c’est une ombre plate sur un fond clair, ou de plasticité quand son volume est pétri par l’ombre : tantôt fondre ce corps dans le décor, ne l’utiliser plus que comme un élément entre autres, comme un véhicule pour charrier des couleurs, un mobile pour déplacer des lignes dans un tableau qui capte tout le tourbillon de la nature, comme font les Ballets Russes. »
« Que de femmes, cette époque est femme, abîme de jouissance, anxieuse et énervée. »
D’où une révolte romantique contre la banalité de la vie quotidienne, contre le sordide d’une vie quotidienne vide de sens.
« Apparemment, on peut se retourner encore dans le monde par un débrouillage individue ; l’un est très fier d’avoir inventé un nouveau système de boutons de manchettes ; l’autre d’avoir réuni la fabrication des fromages et l’industrie touristique dans le Lot-et-Garonne.
Mais ils ne prennent pas garde que leur initiative émerge à peine un instant du courant de plus en plus monotone de la production moderne, et qu’en réalité, depuis le président de la banque jusqu’au dernier comptable, ils sont tous employés, salariés, dans les mêmes bureaux, mobilisés de force au service d’un vaste communisme obscur, confortable, ennuyeux, laid.
Il n’y a pas de bonté, mais un grand adoucissement des mœurs. Les riches ne voient pas les pauvres, ne conçoivent pas les pauvres. Mais peu à peu, riches et pauvres abandonnent leur état particulier pour se rencontrer et se fondre dans un état intermédiaire.
Il manque les ouvriers à ce tableau. Ils sont dans leurs faubourgs, au cinéma, et se gorgent de films qui, pour quelques sous, les introduisent dans les salons des riches.
Il suffit de voir les hommes devant les bêtes pour constater leur unanimité. Voici justement sur la scène des otaries.
J’entends les hommes le lendemain : Dis-donc, Félix, on ne s’est pas embêté, hier soir, hein ! Nous en avons eu pour notre argent.
Et qu’est-ce qu’on s’était mis à dîner. Il faut raconter cela à Léon. Garçon ! trois Chambéry-fraise. On a été avec Madame Félix et la gosse au Casino. Dis-donc, c’est bien le moins, hein ! Il y a assez longtemps qu’on turbine.
Un peuple, mon vieux, bondé. Des gens chic. Y avait des tas de gonzesses à poil. Pas mal. Mais quand l’Américain a amené les otaries…. Ah ! les vaches ! C’est le moment qu’on a commencé à jouir. On se sentait vivre. Non Sont-elles moches !
Tu dirais des gonzesses qui ont le derrière pris dans un édredon et qui courent après l’autobus. Ah ! C’est pas permis d’être bâti comme ça. C’est tout désossé, ça tortille sa viande comme une amoureuse. Ça se pousse, ça tangue, ça mugit comme un veau, ça essaye de se mettre en colère. »
Félix, Léon et Ernest boivent d’autres Chambéry-fraise.
« Nous sommes les hommes, c’est nous les rois. Le soir, on nous voit assis, avec nos lardons, au music-hall. Tout est en ordre sur la terre. Nos femmes sont en peaux de bêtes et couronnées d’oiseaux morts.
Nous avons roulé l’éléphant, soufflé au lion ses chasses. Le cheval n’est qu’un abruti et le chien fut pris par ses bons sentiments. Nous avons vaincu toutes les bestioles. C’est la gloire. Nos petits drapeaux ornent les Pôles.
Nous avons traîné les otaries dans les cirques comme des reines liées par les genoux. Tu en fais, un œil. Hourra! Que la grosse caisse crève ! Tant pis, si les cymbales attrapent des ampoules ! Hourra pour la coterie ! Sifflons avec la puissance de la vapeur : on va écraser les étoiles. C’est une fameuse rigolade. »
Otaries, sirènes, glissez dans l’eau et la nageuse sera sans grâce. »
Cette révolte contre l’unanimité aseptisée est romantique dans ses exigences, mais elle est malheureusement incapable de lire les contradictions existantes, et donc le potentiel pour un avenir justement radieux. Il ne reste plus que le passé à idéaliser, où se réfugier, tel un au-delà servant de refuge existentiel.