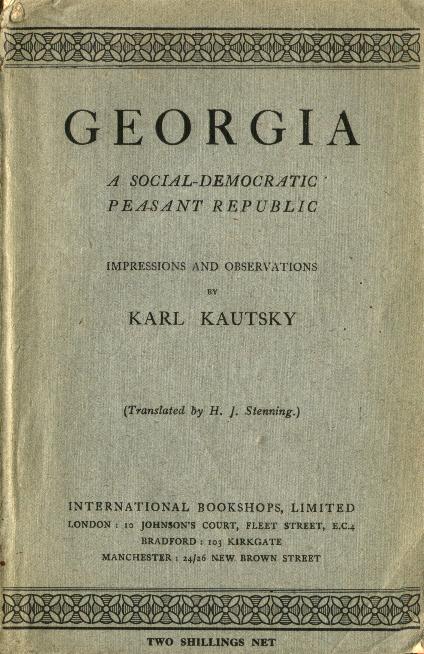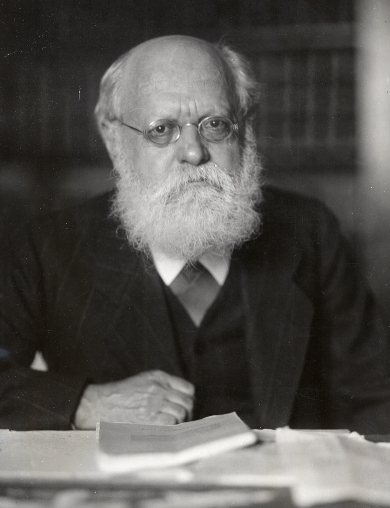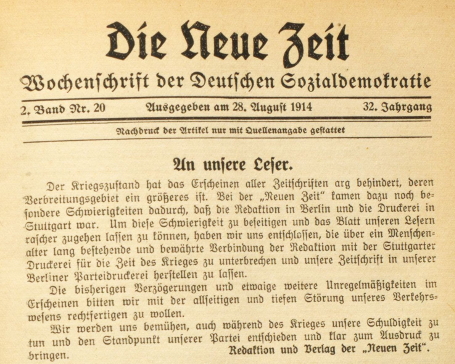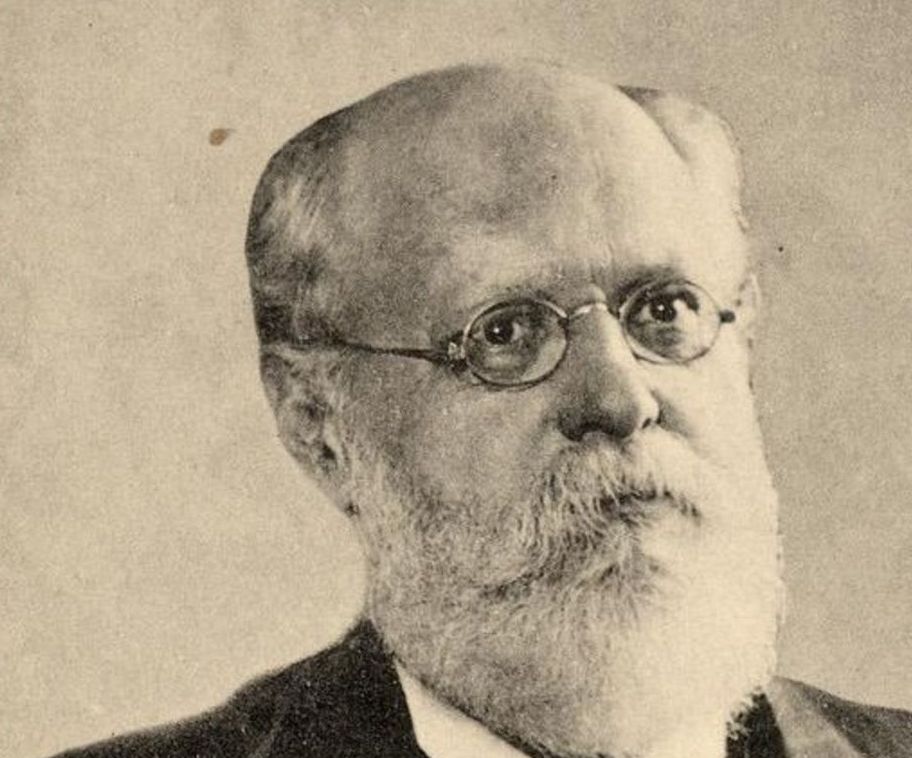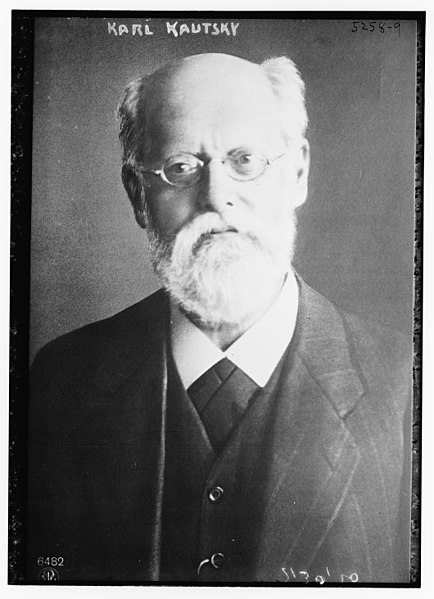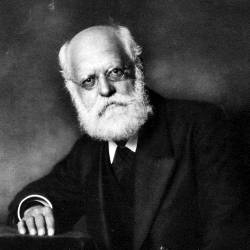Avant-propos
à la réédition de 1933
Cet
écrit fut publié pour la première fois en 1908, pour le
vingt-cinquième anniversaire de la mort de notre maître. Depuis il
s’écoula vingt-cinq nouvelles années qui ont apporté la
monstrueuse guerre mondiale et de formidables révolutions en Europe
et en Asie. Mais la méthode de Marx, tout ce que Marx apporta à
l’humanité pensante luttant pour des formes de vie supérieure, ne
fut pas renversée en cette époque de bouleversements, mais au
contraire affermie. En ces jours, où tout est ébranlé, où les
classes bourgeoises et les partis doutent jusqu’à d’eux-mêmes,
le marxisme nous donne la seule base certaine sur laquelle nous
pourrons construire et nous construirons l’édifice d’un état
social meilleur.
Pour
cette raison, je puis rééditer le présent écrit sans changement,
à quelques données près. L’œuvre historique de Marx n’a rien
perdu de son importance dans ce dernier quart de siècle. Elle domine
plus que jamais notre époque.
Kautsky
Vienne,
février 1933.
Introduction
Il
y eut cinquante ans, le 14 mars 1908, que mourut Karl Marx, et il y a
déjà un siècle que parut le Manifeste
Communiste
où sa doctrine fut exposée, dans ses grandes lignes, pour la
première fois.
Ce
sont là des époques déjà bien lointaines pour nous qui sommes
d’un temps où la vie est si trépidante et où les conceptions
scientifiques et esthétiques changent plus souvent que la mode.
Cependant Karl Marx vit encore d’une vie intense parmi nous. Il
domine plus que jamais la pensée contemporaine, malgré toutes les
crises de marxisme et malgré toutes les objections et les
réfutations des représentants officiels de la science bourgeoise.
Il
aurait été complètement incompréhensible que son influence fût
aussi extraordinaire si Marx n’avait réussi à découvrir les
assises encore ignorées de la société capitaliste. Après de
telles découvertes, il ne reste plus de connaissances sociologiques
d’importance primordiale à acquérir qui soient telles qu’elles
dépassent Marx, aussi longtemps que la forme actuelle de la société
se maintiendra. On peut dire aussi que, pendant toute cette période,
sa méthode sera plus fructueuse que n’importe quelle autre.
L’influence
puissante et durable de Marx sur la pensée moderne aurait été
encore incompréhensible s’il n’avait su dépasser par la pensée
le mode de production capitaliste. Il en révéla les tendances qui
mènent à une forme supérieure de société et dont les buts, bien
que fort éloignés, se rapprochent continuellement, devenant de plus
en plus tangibles au cours de l’évolution. Au fur et à mesure que
l’on constate ces faits, on comprend davantage la grandeur de
l’homme qui les a prophétisés.
C’est
la fusion si rare de la profondeur scientifique avec l’audace
révolutionnaire, qui le fait vivre avec bien plus d’intensité un
demi-siècle après sa mort que lorsqu’il était parmi les vivants.
Si
nous voulons définir le caractère de la contribution historique de
cet homme prodigieux, le mieux sera peut-être de dire qu’elle est
une synthèse de domaines différents et souvent même
contradictoires : nous y trouvons avant tout la synthèse des
sciences naturelles et des sciences psychologiques, la synthèse de
la pensée anglaise, française et allemande, celle du mouvement
ouvrier et du socialisme et celle enfin de la théorie et de la
pratique. C’est parce qu’il a réussi non seulement à connaître
ces domaines du savoir avec une universalité sans pareille, mais
encore à posséder ces connaissances d’une manière magistrale
qu’il lui fut possible de fournir la formidable contribution
historique qui marque de son sceau les derniers lustres du
dix-neuvième et les deux premiers du vingtième.
1.
La synthèse des sciences naturelles et des sciences psychologiques
La
production théorique de Karl Marx est à la base de toute son
activité. Nous devons donc la considérer en tout premier lieu. Mais
précisément sa vulgarisation présente de particulières
difficultés. Il nous sera possible, espérons-le, de les surmonter
bien que nous soyons obligés de nous limiter. En tout cas, les
points que nous traiterons seront aisément compréhensibles. Le
lecteur ne devra donc pas se laisser décourager à la lecture des
premières pages, les suivantes étant plus faciles.
Les
sciences sont réparties en deux grands domaines : celui des
sciences naturelles, qui cherchent à définir les lois des
mouvements des corps inanimés et animés, et celui des sciences
psychologiques ou sciences de l’esprit nommés, en somme,
improprement ainsi : parce que, dans la mesure où l’esprit
apparaît comme manifestation d’un corps particulier, il est du
domaine des sciences naturelles. La psychologie, c’est-à-dire la
science de l’âme, utilise les méthodes des sciences naturelles et
on ne s’est jamais avisé d’employer les sciences psychologiques
à la guérison des maladies mentales. Les sciences naturelles ont un
droit incontesté sur ce domaine.
Ce
qu’on appelle les sciences psychologiques, ce sont en réalité les
sciences sociales ; elles traitent des rapports de l’homme
avec son semblable. Seules les activités et les manifestations
psychologiques de l’homme qui y entrent en ligne de compte sont
l’objet propre des sciences psychologiques.
Parmi
celles-ci, on peut, de nouveau, distinguer deux groupes : les
unes, qui étudient la société humaine comme telle et en se basant
sur des observations numériques.
A
ce groupe appartient l’économie politique, autrement dit la
science des lois de la société économique sous le régime de la
production matérielle ; l’ethnologie, c’est-à-dire l’étude
des conditions sociales des différents peuples ; enfin, la
préhistoire, ou la science des conditions sociales de la période
dont il ne nous a pas été transmis de documents écrits.
L’autre
groupe des sciences psychologiques comprend celles qui jusqu’à
présent s’occupent surtout de l’individu et qui traitent de sa
place et de son activité dans la société : l’histoire, le
droit, l’éthique ou morale.
Le
deuxième groupe des sciences psychologiques est extrêmement ancien
et a exercé de tout temps la plus grande influence sur la pensée
humaine. Le premier groupe, par contre, à l’époque de la
formation de Marx, était récent, n’étant parvenu que depuis peu
aux méthodes scientifiques. Il était du domaine des spécialistes
et n’avait pas encore d’influence sur les idées générales,
alors que celles-ci étaient imprégnées des sciences naturelles et
psychologiques du deuxième groupe.
Entre
ces deux dernières catégories de sciences, il y avait un abîme,
que révélaient les conceptions générales opposées engendrées
par chacune d’elles.
Les
sciences naturelles avaient permis de découvrir dans la nature tant
de relations nécessaires et conformes à des lois, ou en d’autres
termes on y avait si souvent constaté que de mêmes causes
engendraient de mêmes effets qu’elles étaient toutes pénétrées
de l’hypothèse d’une conformité causale générale dans la
nature et qu’elles avaient complètement banni l’idée de forces
mystérieuses y agissant d’une manière arbitraire. L’homme
moderne n’essaie plus d’influencer en sa faveur de telles
puissances par des prières et des sacrifices, mais au contraire il
tend à connaître les relations causales dans la nature afin d’en
tirer ce dont il a besoin pour sa conservation ou son agrément.
Il
en va tout autrement des sciences psychologiques. Celles-ci étaient
encore dominées par l’idée de la liberté de la volonté humaine,
volonté ne dépendant donc d’aucune nécessité causale. – Les
juristes et les moralistes étaient enclins à rester fidèles à
cette idée, pour ne pas sentir le sol se dérober sous leurs pieds.
Si l’homme est un produit des circonstances, et son action est sa
volonté de causes qui ne dépendent pas de son bon plaisir, que
deviennent alors le péché et le châtiment, le bien et le mal, la
sentence juridique et le jugement moral ?
Ce
n’était là, certes, qu’un mobile, un considérant et non un
argument de la raison pratique. Celle-ci était surtout fournie par
la science historique, qui, en réalité, ne reposait que sur
l’ensemble des documents écrits des époques antérieures où les
faits d’individus isolés, notamment des souverains, étaient
consignés souvent par eux-mêmes. Il semblait impossible de trouver
une nécessité causale quelconque dans ces faits isolés. En vain
des esprits formés à l’école des sciences naturelles tentèrent
de trouver une telle nécessité. Ils s’insurgent certes contre
cette conception que la conformité générale aux lois de la nature
n’était pas valable en ce qui concerne l’action de l’homme.
L’expérience leur apportait suffisamment de matériaux pour
prouver que l’esprit ne faisait pas exception dans la nature, et
qu’aux mêmes causes l’esprit répondait toujours par les mêmes
effets. Toutefois, si l’on parvint à établir incontestablement la
relation causale pour les actes psychologiques simples que l’homme
a en commun avec les animaux, pour ses actes compliqués, pour les
idées sociales et les idéals, les naturalistes ne purent la
découvrir. Ils purent sans doute affirmer que l’esprit humain fait
partie de la nature et qu’il est régi par des lois nécessaires,
mais ils ne parvinrent pas à le prouver pour tous les domaines d’une
manière suffisante. Leur monisme matérialiste reste incomplet et ne
put avoir raison de l’idéalisme et du dualisme.
C’est
alors que Marx vint. Il vit que l’Histoire est le résultat des
luttes des classes ; il vit également que, dans l’Histoire,
les idées agissantes des hommes, leur succès et leurs insuccès
sont le résultat des luttes des classes. Mais il vit plus encore.
Les oppositions et les luttes des classes, on les avait déjà
constatées avant lui dans l’Histoire, mais elles étaient apparues
surtout comme étant l’œuvre de la bêtise et de la méchanceté
d’une part, de sentiments élevés et du progrès des idées
d’autre part. Marx, le premier, découvrit leur relation nécessaire
avec les rapports économiques, dont les lois peuvent être connues,
comme il le démontra clairement. Mais les rapports économiques
eux-mêmes reposent à leur tour, en dernière instance, sur le
caractère et le degré de domination de l’homme sur la nature qui
résulte de la connaissance des lois de celle-ci. Si distincte que
puisse paraître la société du restant de la nature, ici comme là,
nous trouvons l’évolution dialectique, c’est-à-dire le
mouvement causé par une lutte d’oppositions surgissant
spontanément et continuellement du milieu même.
L’évolution
sociale fut ainsi située dans le cadre de l’évolution naturelle ;
l’esprit humain, même dans ses manifestations les plus élevées
et les plus compliquées, dans ses manifestations sociales, était
expliqué comme étant une portion de la nature ; la conformité
causale de son activité démontrée dans tous les domaines et la
dernière base de l’idéalisme et du dualisme philosophiques
anéantie.
De
cette manière, Marx n’a pas seulement transformé complètement la
science historique, mais il a aussi comblé l’abîme entre les
sciences naturelles et les sciences psychologiques. En même temps,
il fondait l’unité du savoir humain et par là même rendait la
philosophie superflue dans la mesure où elle cherchait à remplacer
précisément cette unité. La philosophie, en effet, n’était
qu’une sagesse située au-dessus des sciences et qui n’en était
pas déduite ; elle constituait une certaine unité de pensée
sur l’évolution du monde.
La
conception de l’Histoire de Marx représente un formidable progrès
scientifique. La pensée et la connaissance humaines y auraient dû
puiser abondamment – mais chose singulière, la science bourgeoise
s’en détourna complètement et ce n’est seulement qu’en
opposition à cette dernière, ce n’est qu’en tant que science
particulière.
On
s’est moqué de l’opposition entre la science bourgeoise et la
science prolétarienne, comme s’il pouvait y avoir une chimie ou
des mathématiques bourgeoises et une chimie ou des mathématiques
prolétariennes ! Mais les railleurs prouvent uniquement qu’ils
ne savent pas de quoi il s’agit.
La
découverte de la conception matérialiste de l’Histoire supposait
deux conditions préalables. D’abord un développement suffisant de
la science, et en second lieu un point de vue révolutionnaire.
La
conformité aux lois de l’évolution historique ne pouvait être
découverte que lorsque les nouvelles sciences psychologiques dont
nous avons parlé plus haut, l’économie politique, l’ethnologie
et la préhistoire eurent atteint un certain niveau. Seules ces
sciences, dont l’essence excluait de prime abord l’individu et
qui de prime abord se fondaient sur des observations numériques,
permettaient de trouver les lois fondamentales de l’évolution
sociale et d’étudier les courants qui mènent les individus et en
premier lieu ceux qui n’admettent que la façon traditionnelle
d’écrire l’Histoire.
Ces
nouvelles sciences psychologiques ne se développèrent qu’avec le
mode de production capitaliste et avec la circulation économique
mondiale qui s’y rattache. Elles ne purent avoir de résultat
important que lorsque le capital devint prépondérant, mais lorsque
par là même la bourgeoisie avait cessé d’être une classe
révolutionnaire.
Seule,
cependant, une pareille classe pouvait accepter la doctrine de la
lutte de classe. Une classe qui veut le pouvoir, doit vouloir la
lutte qui y mène et elle en comprend facilement la nécessité. Par
contre, une classe au pouvoir considérera pareille lutte comme
inopportune et elle se détournera de toute doctrine qui en démontre
la nécessité.
Cette
classe s’élèvera d’autant plus contre la doctrine de la lutte
de classe que cette doctrine d’évolution sociale propose comme
conclusion fatale de la lutte des classes contemporaine
l’annihilation des maîtres actuels.
La
théorie d’après laquelle les hommes sont les produits des
rapports sociaux, à un point tel que les membres d’une société
de forme déterminée se distinguent des hommes vivant dans des
sociétés d’autres formes, n’est pas plus acceptables pour une
société conservatrice, parce que le changement de société
apparaîtrait comme étant le seul moyen de changer les hommes. Aussi
longtemps que la bourgeoisie fut révolutionnaire, elle prôna la
conception suivant laquelle les hommes étaient les produits de la
société ; mais malheureusement alors, les sciences devant
permettre l’étude des forces motrices de l’évolution historique
n’avaient pas encore suffisamment progressé. Les matérialistes
français du XVIII° siècle ne connaissaient pas la lutte des
classes et ne portaient pas attention au progrès technique.
Ainsi
s’ils savaient que, pour changer les hommes, il fallait changer la
société, ils ne voyaient pas d’où proviendraient les forces
nécessaires à cet effet. Ils les voyaient surtout dans la
toute-puissance d’individus extraordinaires et avant tout
d’éducateurs. Le matérialisme bourgeois ne put aller plus loin.
Dès
que la bourgeoisie devint conservatrice, l’idée que les
inconvénients propres à notre temps étaient dus aux rapports
sociaux, qui devaient par conséquent être changés, lui parut
rapidement insupportable. Dans la mesure où elles s’inspirent des
méthodes des sciences naturelles, elle essaie maintenant de prouver
que les hommes sont naturellement ce qu’ils sont, qu’ils doivent
être tels et que vouloir changer la société ne signifie rien
d’autre que vouloir perturber l’ordre naturel. On doit être
exclusivement formé selon la discipline des sciences naturelles et
être resté insensible aux rapports sociaux de notre temps pour
affirmer la perpétuation nécessaire de ces derniers. La plus grande
partie de la bourgeoisie n’en a plus le courage ; elle essaie
de se consoler en contestant le matérialisme et en reconnaissant le
libre-arbitre. Ce n’est pas la société qui fait les hommes,
affirme-t-elle, mais au contraire les hommes qui font la société
selon leur volonté. La société est imparfaite, parce que les
hommes le sont. Nous devons améliorer la société non pas par des
transformations sociales, mais en élevant les individus, en leur
insufflant une moralité supérieure. Les hommes meilleurs produiront
une société meilleure. Aussi l’éthique et la reconnaissance du
libre-arbitre sont-elles devenues les doctrines favorites de la
bourgeoisie actuelle. Ces doctrines doivent révéler la bonne
volonté de la bourgeoisie, porter remède aux défauts sociaux, ne
pas pousser à un changement social quelconque, mais au contraire s’y
opposer.
Les
connaissances qui peuvent être acquises sur la base de l’unité
scientifique fondée par Marx sont inaccessibles à celui qui se
tient sur le plan de la société bourgeoise. Seule celui qui prend
une position critique vis-à-vis de la société bourgeoise ou,
autrement dit, seul celui qui se place sur le terrain du prolétariat
peut arriver à la compréhension de ces connaissances. Dans cette
mesure on peut distinguer la science prolétarienne de la science
bourgeoise.
Naturellement,
l’opposition entre la science prolétarienne et la science
bourgeoise s’exprime le plus fortement dans les sciences
psychologiques, tandis que l’opposition entre la science féodale
ou catholique et la science bourgeoise se montre de la manière la
plus frappante dans les sciences naturelles. Mais la pensée humaine
tend toujours vers l’unité, les différents domaines scientifiques
s’influencent toujours réciproquement et pour cette raison nos
conceptions sociales agissent en retour sur notre conception générale
du monde. Ainsi, l’opposition entre la science bourgeoise et la
science prolétarienne s’impose finalement aussi dans les sciences
naturelles.
On
peut déjà observer cette influence dans la philosophie grecque. Un
exemple entre autres, qui se trouve en relation étroite avec notre
étude, se révèle dans la science moderne. J’ai déjà indiqué
ci-avant que la bourgeoisie, aussi longtemps qu’elle était
révolutionnaire, admettait également que l’évolution naturelle
s’accomplît catastrophiquement. Depuis qu’elle est devenue
conservatrice, elle ne veut plus entendre parler de catastrophes dans
la nature. L’évolution s’accomplit maintenant, d’après elle,
d’une manière plus lente et exclusivement par la voie de
changements imperceptibles.
Les
catastrophes lui paraissent anormales, monstrueuses et de plus
uniquement propres à troubler l’évolution naturelle. Et malgré
la théorie darwiniste de la lutte pour l’existence, la science
bourgeoise s’efforce autant qu’elle le peut d’identifier
l’évolution avec un mouvement tout pacifique.
Pour
Marx, par contre, la lutte des classes n’était qu’une forme de
la loi générale de l’évolution de la nature, qui n’a
aucunement un caractère pacifique. L’évolution est pour lui,
comme nous l’avons déjà remarqué, « dialectique »,
c’est-à-dire le produit d’une lutte d’éléments opposés qui
surgissent nécessairement. Tout conflit de ces éléments
irréconciliables doit finalement conduire à l’écrasement d’un
des deux protagonistes et par conséquent à une catastrophe.
Celle-ci peut se préparer très lentement, la force d’un
antagoniste peut croître imperceptiblement, mais finalement
l’effondrement d’un des antagonistes sera inévitable, par suite
de la lutte et de l’accroissement en force de l’autre. Tous les
jours, à chaque pas nous rencontrons de petites catastrophes dans la
nature comme dans la société. Chaque mort est une catastrophe. Tout
être et toute chose doivent succomber devant la prépondérance d’un
antagoniste. Ce n’est pas seulement vrai pour les plantes et les
animaux, mais aussi pour des sociétés entières et pour des empires
comme pour des corps célestes.
Pour
ces derniers également, la marche du processus général de
l’évolution prépare à certains moments des catastrophes par une
croissance graduelle des contradictions. Pas de mouvement, pas
d’évolution sans catastrophes de temps à autre. Elles
représentent un stade nécessaire de l’évolution, qui est
impossible sans révolutions intermittentes. Cette conception dépasse
la conception bourgeoise révolutionnaire qui admettait que
l’évolution s’accomplissait uniquement par catastrophes, aussi
bien que la conception bourgeoise conservatrice qui voit dans la
catastrophe une perturbation, un ralentissement et non point le
passage nécessaire d’une évolution souvent lente et imperceptible
à une autre.
Nous
trouvons une autre opposition entre la science bourgeoise et la
science prolétarienne ou, si l’on préfère, conservatrice et
révolutionnaire, dans la critique de la connaissance.
Une
classe révolutionnaire, qui se sent de taille à conquérir la
société, est aussi encline à ne pas admettre de limite à ses
conquêtes scientifiques et à s’estimer capable de résoudre tous
les problèmes de son temps. Une classe conservatrice, par contre,
craint instinctivement tout progrès non seulement dans le domaine
politique et social, mais aussi sur le terrain scientifique, parce
qu’elle sent que toute science profonde ne peut plus lui être
d’une grande utilité, mais au contraire peut infiniment lui nuire.
Elle est encline à renier sa confiance dans la science.
La
naïve assurance qui animait les penseurs révolutionnaires du XVIII°
siècle, comme s’ils avaient en poche la solution de toutes les
énigmes du monde, comme s’ils parlaient au nom de la Raison
absolue, ne peut plus être partagée aujourd’hui par le
révolutionnaire le plus audacieux.
De
nos jours, personne ne niera ce que savait certes plus d’un penseur
du XVIII° siècle et même de l’Antiquité : que tout notre
savoir est relatif, qu’il représente un rapport de l’homme, du
« moi » avec le reste du monde et qu’il nous montre
uniquement ce rapport et non pas le monde lui-même. Toute
connaissance est, par conséquent, relative, conditionnée et limitée
et il n’y a pas de vérités absolues et éternelles.
Cela
signifie simplement qu’il n’y a pas de termes à notre
connaissance, que le processus de la connaissance est illimité,
infini, et qu’il est vraiment
fou de proposer une connaissance quelconque comme conclusion
définitive de la vérité. Il ne l’est pas moins de considérer
une proposition quelconque comme la limite extrême de la sagesse que
nous ne pourrons jamais dépasser.
Bien
mieux, nous savons que l’humanité a toujours réussi à dépasser
toute limite de son savoir, limite qu’elle savait pouvoir franchir
tôt ou tard pour rencontrer d’ailleurs plus loin de nouvelles
frontières qu’elle ne soupçonnait pas auparavant.
Nous
ne devons pas craindre de tout d’aborder un problème quelconque,
que nous sommes en état d’élucider.
Nous
ne devons pas, découragés, laisser tomber les bras pour murmurer
résignés : Ignorabimus
(nous ignorerons), nous n’en saurons jamais rien. Ce découragement
cependant caractérise la pensée bourgeoise moderne. Au lieu de
tendre de toutes ses forces à élargir et à approfondir notre
savoir, elle s’applique de son mieux à en fixer les limites et à
discréditer la certitude de la connaissance scientifique.
Aussi
longtemps que la bourgeoisie était révolutionnaire, elle passait
outre à de pareils problèmes.
Aussi
Marx n’épargna jamais ses efforts pour réfuter la philosophie
bourgeoise actuelle.
2.
Marx et Engels
Ce
fut son point de vue révolutionnaire prolétarien qui permit à
Marx de fonder l’unité des sciences. Mais lorsque nous parlons de
Marx, nous ne devons jamais oublier que cette œuvre fut accomplie
en même temps par Frédéric Engels, un penseur de valeur égale et
que, sans la collaboration étroite de ces deux hommes, la nouvelle
conception matérialiste de l’Histoire et la nouvelle conception
historique ou dialectique du monde n’auraient pu d’un seul coup
se présenter d’une manière à la fois si achevée et si
générale.
Engels
arriva par une autre voie que Marx à cette conception. Marx était
le fils d’un homme de loi et se destina d’abord à la carrière
judiciaire, puis, plus tard, à la carrière universitaire. Il
étudia le droit, la philosophie et l’Histoire et ne s’attacha
aux études économiques que lorsqu’il ressentit amèrement
qu’elles lui manquaient.
A
Paris, il étudia l’économie, l’histoire de la Révolution et
le socialisme, et le grand penseur Saint-Simon semble avoir eu sur
lui une énorme influence. Ces études le menèrent à l’idée que
ce ne sont ni la loi ni l’État qui font la société, mais au
contraire que la société qui naît du processus économique fait
la loi et l’État selon ses besoins.
Engels,
par contre, était le fils d’un industriel. Il reçut les premiers
fondements de son savoir, non pas au gymnase, mais à l’école
moyenne, où il apprit à penser selon les méthodes des sciences
naturelles. Il entra ensuite dans le commerce et exerça l’économie
pratiquement et théoriquement à Manchester, au centre du
capitalisme anglais où son père possédait une fabrique.
Venant
de l’Allemagne, où il s’était familiarisé avec la philosophie
hégélienne, il sut approfondir la science économique qu’il
trouva à son arrivée en Angleterre. Son attention fut surtout
attirée par l’histoire économique. Nulle part ailleurs, vers les
années 40 du XIX° siècle, la lutte de classe prolétarienne
n’était si développée, sa liaison avec l’évolution
capitaliste si évidente, qu’en Angleterre.
Ainsi
Engels arriva en même temps que Marx, mais par un autre chemin, au
seuil de la même conception matérialiste de l’Histoire. Si l’un
y est arrivé par le chemin des anciennes sciences psychologiques,
c’est-à-dire le droit, l’éthique, l’histoire économique,
l’ethnologie et par les sciences naturelles, c’est dans la
Révolution, dans le socialisme qu’ils se rencontrèrent. C’est
la concordance de leurs idées qui les rapprocha immédiatement
lorsqu’ils entrèrent en relations personnelles en 1844, à Paris.
L’identité des idées fit bientôt place à une communion
complète et à une collaboration où il est impossible de dire ce
que chacun a apporté. Certainement Marx était le plus éminent des
deux et personne ne l’a reconnu avec moins d’envie et même plus
joyeusement qu’Engels lui-même. Leur manière de penser s’appela
d’ailleurs marxiste, du nom même de Marx. Mais Marx n’aurait pu
produire ce qu’il a produit sans Engels, de qui il apprit dans une
mesure formidable – d’ailleurs l’inverse est vrai également.
Chacun d’eux s’éleva par sa collaboration avec l’autre et
arriva ainsi à un élargissement de ses vues et à une universalité
qu’il n’aurait pu conquérir lui seul. Marx serait venu sans
Engels, comme Engels sans Marx, à la conception matérialiste de
l’Histoire, mais leur évolution aurait été plus lente parce que
les erreurs auraient été plus nombreuses. Marx était le penseur
le plus profond et Engels le plus audacieux. Chez Marx la force
d’abstraction était plus développée, c’est-à-dire le don de
découvrir ce qui est général dans la confusion des phénomènes
particuliers ; chez Engels, c’était l’esprit de
combinaison qui prédominait, c’est-à-dire la capacité de
reconstituer, à l’aide d’observations particulières,
l’ensemble d’un phénomène.
Chez
Marx, la capacité de critique et d’auto-critique était plus
vigoureuse ; elle mettait un frein à l’audace de sa pensée
et l’incitait à avancer prudemment en éprouvant continuellement
le sol, tandis qu’Engels, l’esprit tout rempli de la joie fière
que lui donnaient ses vues grandioses, s’enthousiasmait vite et
planait au-dessus des plus grandes difficultés.
Parmi
les nombreuses suggestions que Marx reçut d’Engels, il en est une
particulièrement importante.
Marx
s’éleva formidablement parce qu’il domina la façon de penser
allemande et qu’il l’enrichit de pensée française. Engels,
d’autre part, le familiarisa avec la pensée anglaise.
Dès
lors sa pensée prit tout son essor. Rien de plus erroné que de
considérer le marxisme comme purement allemand. Il fut, dès son
début, international.
3.
Les synthèses de la pensée allemande, de la pensée française et
de la pensée anglaise
Trois
nations représentaient, au XIXe siècle, la civilisation moderne.
Seul celui qui s’était assimilé l’esprit de toutes les trios,
et qui était ainsi armé de toutes les acquisitions de son siècle,
pouvait produire l’immense travail que fournit Marx.
La
synthèse de la pensée de ces trois nations, où chacune d’elles
a perdu son aspect unilatéral, constitue le point de départ de la
contribution historique de Marx et de Engels.
Le
capitalisme, comme nous l’avons mentionné plus haut, était, dans
la deuxième moitié du XIXe siècle, beaucoup plus développé en
Angleterre que dans n’importe quel pays. Ce développement était
dû avant tout à la situation géographique de cette puissance,
situation qui lui permit de tirer des avantages appréciables de la
politique coloniale de conquête et de pillage à laquelle
s’épuisèrent les États européens limitrophes de l’océan
Atlantique.
Grâce
à sa situation insulaire, elle n’avait pas besoin d’entretenir
une forte armée permanente, elle pouvait consacrer tous ses moyens
à sa flotte et conquérir, sans épuisement, la maîtrise des mers.
De plus, sa richesse en charbon et en fer lui permettait de
consacrer les richesses acquises par la politique coloniale au
développement d’une grande industrie capitaliste qui à son tour,
par la domination des mers, conquérait le marché mondial. Avant le
développement des chemins de fer, la marche ne pouvait s’ouvrir
pour les marchandises de grande consommation que par les voies
maritimes.
Pour
cette raison, il fut possible d’étudier en Angleterre plutôt
qu’ailleurs non seulement le capitalisme et ses tendances, mais
aussi, comme nous l’avons indiqué, la lutte prolétarienne de
classe que ses tendances provoquèrent. Nulle part non plus, la
science du mode de production capitaliste, l’économie politique,
n’était aussi prospère. Il en était de même, grâce au
commerce mondial, de l’histoire économique et de l’ethnologie.
Mieux que n’importe où ailleurs, on pouvait apprendre en
Angleterre ce que serait l’époque à venir. On pouvait connaître
aussi, grâce aux nouvelles sciences psychologiques, les lois de
l’évolution sociale qui régissent toutes les époques, et ainsi
constituer l’unité des sciences naturelles et psychologiques.
Mais
l’Angleterre n’offrait à cette fin que le matériel, et non la
méthode d’investigation.
C’est
précisément parce que le capitalisme s’est développé plus tôt
en Angleterre qu’ailleurs que la bourgeoisie y est arrivée à la
direction de la Société avant que la féodalité n’eût abdiqué
complètement dans le domaine politique, économique et spirituel et
que la bourgeoisie y a conquis une complète indépendance. La
politique coloniale elle-même, qui stimulait le capitalisme, donna
aussi aux seigneurs féodaux de nouvelles forces.
De
plus, pour des raisons déjà mentionnées, l’armée permanente en
Angleterre n’atteignit pas un grand développement, ce qui empêcha
l’établissement d’un fort pouvoir politique centralisé.
La
bureaucratie demeura faible et l’administration autonome des
classes régnantes resta puissante à côté d’elle. Les luttes de
classe ne se concentrèrent donc pas, mais au contraire
s’éparpillèrent. Il en résulta un esprit de compromis entre le
passé et le présent qui pénétra toute la vie et toute la pensée.
Les penseurs et les champions des classes nouvelles ne se dressèrent
pas formellement contre le christianisme, l’aristocratie et la
monarchie ; leurs partis ne rédigèrent pas de grands
programmes. Ils ne tentèrent pas de penser leurs idées jusqu’au
bout, ils préférèrent lutter pour telles mesures isolées
suggérées par l’actualité plutôt que pour des programmes
d’ensemble. L’étroitesse d’esprit et le conservatisme, la
surévaluation du travail de détail en politique comme en science,
l’abstention de toute velléité d’acquisition d’un large
horizon pénétrèrent toutes les classes.
En
France, la situation était toute différente. Ce pays était
économiquement plus arriéré, ses industries capitalistes étaient
avant tout des industries de luxe, la petite bourgeoisie était
prédominante. Mais le ton était donné par la petite bourgeoisie
de Paris.
Jusqu’à
l’introduction des chemins de fer, de grandes villes d’au moins
un demi-million d’habitants, comme Paris, n’étaient pas
nombreuses et jouaient un rôle tout différent de celui qui leur
est dévolu actuellement.
Avant
l’établissement des chemins de fer qui permirent les transports
de grandes masses d’hommes, les armées ne pouvaient qu’être de
peu d’importance : elles étaient dispersées dans le pays,
impossible à rassembler rapidement et leur armement ne mettait pas
les masses populaires en un tel état d’infériorité
qu’actuellement. Aussi, longtemps avant la Révolution, les
Parisiens se distinguèrent par leur opiniâtreté à arracher par
des soulèvements armés répétés des concessions au gouvernement.
Avant
l’introduction de l’obligation scolaire, de l’amélioration
des postes par l’utilisation du chemin de fer et du télégraphe,
et de la diffusion des journaux quotidiens dans les campagnes, la
supériorité et par conséquent l’influence intellectuelle de la
population des grandes villes sur l’ensemble du pays étaient
extraordinairement grandes.
Le
compagnonnage représentait pour la masse des gens sans instruction
la seule possibilité de se former au point de vue politique et
esthétique, voire scientifique. Combien plus grande était cette
possibilité pour la grande ville que dans les petites villes de
province et les villages ! Tous ceux qui avaient de l’esprit
en France partaient pour Paris. Tout ce qui se faisait à Paris
était l’œuvre d’un esprit supérieur.
C’est
cette population spirituelle, pétillante et courageuse, qui vit
l’effondrement total du pouvoir de l’État et des classes
régnantes.
Les
mêmes causes qui, en France, contrecarraient l’évolution
économique poussaient à la ruine de la féodalité et de l’État.
D’abord la politique coloniale coûta à ce dernier un sacrifice
formidable, brisant sa puissance militaire et financière et
activant la ruine de nombreux paysans et plus encore des
aristocrates. L’État, la noblesse et l’Église, qui avaient
fait banqueroute politiquement et moralement et – sauf l’Église
– financièrement, surent néanmoins exercer à l’extrême leur
oppression, grâce à l’abolition des organisations populaires et
à la puissance du gouvernement. Ce dernier disposait, en effet, de
l’armée permanente et d’une administration importante qu’il
avait centralisée entre ses mains. Cette situation entraîna
finalement cette catastrophe colossale que nous connaissons sous le
nom de grande Révolution française. Pendant cette période, les
petits bourgeois et les prolétaires de Paris dominèrent la France
et firent front à l’Europe.
Précédemment
déjà, l’opposition aiguë et toujours croissante des besoins de
la masse du peuple conduite par la bourgeoisie libérale et des
besoins des nobles et du clergé protégé par les pouvoirs de
l’État mena à la critique la plus radicale des idées
antérieures. La guerre fut déclarée à toute autorité
traditionnelle. Le matérialisme et l’athéisme, simples marottes
d’une noblesse déchue en Angleterre et rapidement disparues du
reste après la victoire de la bourgeoisie, représentaient au
contraire en France le mode de penser des réformateurs les plus
audacieux et des classes nouvelles. Si en Angleterre les causes
économiques des antagonistes et des luttes de furent manifestes, en
France révolutionnaire, par contre, on put le plus clairement voir
que toute lutte de classe est une lutte pour le pouvoir politique.
On peut constater en France aussi que la tâche d’un grand parti
politique ne se résout pas à l’application de quelques réformes,
mais qu’elle doit être la conquête du pouvoir politique, et que,
d’autre part, cette conquête par une classe opprimée entraîne
toujours une modification du mécanisme social.
Si
en Angleterre, dans la première moitié du XIX° siècle, c’était
la science économique qui était la plus avancée, en France
c’était la pensée politique ; si l’Angleterre était
régie par l’esprit de compromis, la France l’était par celui
du radicalisme ; si en Angleterre le travail de détail de la
lente construction organique prédominait, en France c’était
celui que nécessite l’ardeur révolutionnaire.
La
pensée audacieuse et radicale pour qui rien n’était sacré, qui
poursuivait toute idée jusqu’au bout sans égards et sans
inquiétude pour les conséquences, précéda l’action audacieuse
et radicale. Mais si brillants et si séduisants que furent les
résultats de cette pensée et de cette action, les défauts de ces
avantages se développèrent également. Plein d’impatience, on ne
prit pas le temps de se préparer à atteindre les buts les plus
extrêmes. Plein de ferveur à conquérir d’un élan
révolutionnaire la forteresse de l’État, on négligea le travail
préliminaire d’investissement. Et cette poussée pour arriver aux
plus hautes vérités entraîna rapidement à des conclusions
hâtives et mit à la place de la recherche patiente le goût des
idées spirituelles et improvisées. La tendance à vouloir enfermer
dans quelques formules et quelques grands mots la plénitude infinie
de la vie se fit jour.
Au
prosaïsme britannique s’opposa l’ivresse phraséologie
gauloise.
La
situation en Allemagne était encore différente.
Le
capitalisme y était encore moins développé qu’en France, parce
que l’Allemagne était presque complètement coupée de l’océan
Atlantique, la grande route des échanges du commerce mondial de
l’Europe, et parce qu’elle ne se remettait, de ce fait, que
lentement des horribles dévastations de la guerre de Trente ans.
Bien plus encore que la France, l’Allemagne était un pays
petit-bourgeois, et de plus un pays sans fort pouvoir politique
central. Divisée en un grand nombre de petits États, elle n’avait
pas de grande capitale et la vie des petites villes et des petits
États rendait sa peu nombreuse petite bourgeoisie faible et lâche.
L’effondrement final de la féodalité ne fut pas le fait d’un
soulèvement intérieur, mais d’une invasion de l’extérieur. Ce
ne sont pas les bourgeois allemands, mais au contraire les soldats
français qui balayèrent la féodalité des parties les plus
importantes de l’Allemagne.
Certes,
les grands succès de la bourgeoisie ascendante en Allemagne et en
France stimulèrent aussi la bourgeoisie allemande, mais le désir
d’action de ses éléments les plus énergiques et les plus
intelligents ne put se réaliser dans aucun des domaines qu’avait
conquis la bourgeoisie de l’Europe occidentale. Ils ne pouvaient
ni fonder ni diriger de grandes entreprises commerciales et
industrielles, ni intervenir dans les parlements et dans une presse
toute puissante sur les destins de l’État, ni commander des
flottes et des armées. La réalité était pour cette bourgeoisie
désespérante et il ne lui restait plus que l’évasion dans la
pensée pure et la transfiguration de la réalité par l’art, où
elle se jeta à corps perdu et où elle créa de grandes choses.
Ici,
le peuple allemand surpassa la France et l’Angleterre. Tandis que
celles-ci produisaient Fox, Pitt et Burke, un Mirabeau, un Danton,
un Robespierre, un Nelson et un Napoléon, l’Allemagne donna un
Schiller, un Goethe, Kant, Fichte et Hegel.
La
pensée était l’occupation la plus élevée des grands Allemands,
l’idée se présentait à eux comme maîtresse du monde, la
révolution de la pensée comme moyen de révolutionner le monde.
Plus la réalité était étroite et misérable, plus la pensée
essayait de s’élever au-dessus d’elle, de dépasser ses limites
et de saisir tout l’infini.
Tandis
que les Anglais concevaient les meilleures méthodes pour
perfectionner leurs flottes et leur industrie, les Français pour
assurer la victoire de leurs armées et de leurs insurrections, les
Allemands imaginèrent les meilleures méthodes pour l’avancement
de la pensée et de la recherche intellectuelle.
Mais
ces résultats, comme ceux de la France et de l’Angleterre,
n’étaient pas sans désavantage pour la théorie comme pour la
pratique. L’éloignement de la réalité produisit une ignorance
du monde et une surévaluation de l’importance des idées,
auxquelles on attribua une vie et une force en soi, indépendantes
de la tête des hommes qui les créaient et qui avaient à les
réaliser. On se contentait d’avoir des théories justes et on
négligeait de lutter pour conquérir la puissance nécessaire afin
de les appliquer. Si profonde que fut la philosophie allemande, si
méthodique que devint la science allemande, si enthousiaste que fut
l’idéalisme allemand, si majestueuses que furent les œuvres
qu’ils accomplirent, ils ne cachaient pas moins une indicible
impuissance à agir et un renoncement absolu à toute lutte pour le
pouvoir.
L’idéal
allemand fut bien plus sublime que l’idéal français ou même que
l’idéal anglais, mais on ne fit pas un pas pour s’en approcher.
On déclarait d’avance l’idéal était inaccessible.
Les
Allemands, longtemps, ne surent se débarrasser de l’idéalisme
inactif, comme les anglais du conservatisme et les Français de la
phraséologie extrémiste.
Le
développement de la grande industrie a finalement fait disparaître
cet idéalisme pour le remplacer par un esprit belliqueux.
Auparavant, il avait trouvé un réactif dans l’influence de
l’esprit français après la Révolution.
L’Allemagne
lui est redevable de quelques-uns de ses plus grands esprits.
Souvenons-nous que Henri Heine et Ferdinand Lassalle unissent la
pensée française révolutionnaire à la méthode philosophique
allemande.
Mais
le résultat fut plus important encore lorsque cette union se
compléta de la science économique anglaise. C’est cette synthèse
que nous devons aux travaux d’Engels et de Marx.
Ils
reconnurent que l’économie et la politique, le travail de détail
de l’organisation et l’ardeur révolutionnaire se
conditionnaient l’un l’autre ; que le travail de détail
est stérile sans le but essentiel qui en est à la fois le
stimulant et la raison ; que ce but est imprécis sans le
travail de détail préalable, qui seul donne la capacité de lutte
nécessaire pour l’atteindre. Ils reconnurent également qu’un
tel objectif ne peut naître du simple besoin révolutionnaire ;
qu’il doit être dégagé des illusions et de l’enivrement, par
l’application consciencieuse des méthodes de recherche
scientifique, et qu’il doit être à l’unisson de l’ensemble
du savoir de l’humanité. Ils reconnurent de plus que l’économie
est le fondement de l’évolution sociale, et qu’elle comprend
les lois qui régissent nécessairement cette évolution.
L’Angleterre
leur donna la plus grande partie de la documentation économique
qu’ils utilisèrent et la philosophie allemande la meilleure
méthode pour en déduire l’objectif de l’évolution sociale
contemporaine ; la Révolution française leur démontra de la
manière la plus claire la nécessité de conquérir la puissance et
notamment le pouvoir politique pour arriver au but.
C’est
ainsi qu’ils créèrent le socialisme scientifique moderne par la
fusion de tout ce que la pensée anglaise, la pensée française et
la pensée allemande avaient de grand et de fertile.
4.
L’union du mouvement ouvrier et du socialisme
La
conception matérialiste de l’Histoire marque une date mémorable.
Avec elle commence une nouvelle ère de la science malgré toutes
les contestations des savants bourgeois. Elle marque une date non
seulement dans la lutte pour l’évolution sociale, mais dans la
politique au meilleur sens du mot. Elle réalisa, en effet, l’union
du mouvement ouvrier et du socialisme, créant ainsi les conditions
les plus favorables à la lutte de classe prolétarienne.
Le
mouvement ouvrier et le socialisme ne sont nullement identiques de
nature. Le mouvement ouvrier surgit nécessairement en opposition au
capitalisme industriel, partout où celle-ci apparaît, expropriant
les masses travailleuses et les asservissant, tout en les
rassemblant et les unissant malgré lui dans les grandes entreprises
et dans les villes industrielles. La forme originaire du mouvement
ouvrier est purement économique : la lutte pour les salaires
et le temps de travail qui, d’abord, s’exprime par des
explosions de désespoir et des émeutes sans préparation, pour
passer ensuite rapidement aux formes supérieures des organisations
syndicales. De plus, la lutte politique apparaît rapidement. La
bourgeoisie elle-même, dans sa lutte contre la féodalité, a
besoin de l’aide prolétarienne qu’elle appelle à la rescousse.
Ainsi les travailleurs apprennent bientôt à apprécier
l’importance de la liberté et de la puissance politique pour
leurs buts propres. Notamment, le suffrage universel sera très tôt
en France et en Angleterre l’objet d’une aspiration politique
des prolétaires et il amènera, déjà dans les années trente, en
Angleterre, la formation d’un parti prolétarien, celui des
chartistes.
Le
socialisme prend naissance plus tôt encore. Certes il est, tout
comme le mouvement ouvrier, un produit du capitalisme : tous
deux procèdent de la nécessité d’agir contre la misère à
laquelle l’exploitation capitaliste condamne les classes
laborieuses. Alors que la défense du prolétariat s’organise
partout d’elle-même dans le mouvement ouvrier, là où une
importante population ouvrière se rassemble, le socialisme suppose
une connaissance approfondie de la société moderne. Tout
socialisme repose sur l’idée que dans la société bourgeoise il
n’est pas possible de mettre fin à la misère provenant du
capitalisme. Cette misère provient en effet de la propriété
privée des moyens de production et ne peut disparaître qu’avec
elle. En cela, les différents systèmes socialistes sont d’accord ;
ils ne diffèrent que dans la voie que chacun veut suivre pour
arriver à la suppression de la propriété privée et dans les
conceptions que chacun a de la nouvelle propriété sociale qui doit
la remplacer.
Si
naïfs que pouvaient être parfois les espérances et les projets
des socialistes, les conceptions sur lesquelles ils se fondaient
impliquaient une science sociale, qui était encore complètement
inaccessible au prolétariat dans les premières décennies du XIX°
siècle. Certes, ne pouvait arriver aux conceptions socialistes
qu’un homme qui aurait considéré la société bourgeoise du
point de vue du prolétariat, encore fallait-il que cet homme
possédât les méthodes scientifiques qui, à cette époque bien
plus que maintenant, n’étaient accessibles qu’aux milieux
bourgeois.
Le
mouvement ouvrier procède naturellement et évidemment de la
production capitaliste, partout où celle-ci atteint un certain
niveau. Le socialisme, par conséquent, eut dans son évolution
comme prémices non seulement le capitalisme, mais encore un
concours de circonstances qui se présentèrent rarement.
Le
socialisme apparut d’abord dans les milieux bourgeois. En
Angleterre, le socialisme, très récemment encore, était propagé
surtout par des éléments bourgeois. Ce fait apparaît comme une
contradiction à la théorie marxiste de la lutte des classes, mais
cela ne serait vrai que si la classe bourgeoise s’était
identifiée avec le socialisme, ou que si Marx avait déclaré
impossible que des individus non-prolétaires pour des raisons
particulières pussent adopter le point de vue du prolétariat.
Marx
a toujours affirmé que la seule force capable de faire triompher le
socialisme, c’est la classe ouvrière. En d’autres termes, le
prolétariat ne peut se libérer que par ses propres forces ;
ce qui ne veut nullement dire que seuls des prolétaires puissent
montrer le chemin du socialisme.
Il
n’est plus nécessaire de prouver aujourd’hui que le socialisme
n’est rien, s’il n’est pas porté par un mouvement ouvrier
puissant. Le contraire n’apparaît pas aussi clairement,
c’est-à-dire que le mouvement ouvrier ne peut développer toutes
ses forces que s’il a compris le socialisme et l’a adopté.
Le
socialisme n’est pas le produit d’une éthique indépendante du
temps et de l’espace et des différences de classe. Il n’est,
essentiellement, rien d’autre que la science de la société, en
partant du point de vue du prolétariat. La science ne sert pas
seulement à satisfaire le besoin de savoir, de connaître l’inconnu
et le mystérieux, mais elle a aussi un but économique :
épargner les forces. Elle permet à l’homme de se retrouver plus
facilement parmi les choses de la réalité, d’éviter toute
dépense inutile de forces et ainsi, à tout moment, d’obtenir le
rendement maximum possible.
À
son origine, la science sert directement et consciemment les buts
d’économie de forces. Plus elle se développe et s’éloigne de
son point de départ, plus il y a d’intermédiaires entre son
activité de recherche et son effet pratique ; mais leur
connexion ne peut en être ainsi que voilée et non pas supprimée.
Le
socialisme, la science prolétarienne de la société sert aussi à
rendre possible l’application rationnelle des forces du
prolétariat : il y réussit d’autant mieux qu’il est
lui-même plus parfait et que la connaissance de la réalité, qu’il
implique, est plus profonde.
La
théorie socialiste n’est nullement un jeu oiseux de savants de
cabinet, mais au contraire, une affaire très pratique pour le
prolétariat en lutte.
Son
arme principale, c’est le groupement de la masse en organisations
puissantes, autonomes et libres de toute influence bourgeoise. On ne
peut arriver à ce résultat sans une théorie socialiste, qui seule
est à même de discerner l’intérêt prolétarien commun aux
diverses couches prolétariennes et de séparer celles-ci du monde
bourgeois.
Un
mouvement ouvrier, spontané et dépourvu de toute théorie se
dressant dans les classes travailleuses contre le capitalisme
croissant, est incapable d’accomplir ce travail.
Considérons,
par exemple, les syndicats. Ce sont des unions professionnelles, qui
cherchent à défendre les intérêts immédiats de leurs membres.
Mais combien divergents sont les intérêts de chacune de ces
professions prises séparément : des gens de mer et des
houillers, des cochers et des typographes ! Sans théorie
socialiste, ils ne peuvent connaître leurs intérêts communs et
les différentes couches de prolétaires se considèrent
mutuellement comme étrangères, voire comme ennemies.
Comme
le syndicat ne représente que les intérêts immédiats de ses
membres, il ne se trouve pas directement en rapport avec l’ensemble
du monde bourgeois, mais d’abord avec les capitalistes de sa
profession seulement. Il y a, à côté de ces capitalistes, toute
un série d’éléments bourgeois qui tirent directement ou
indirectement leurs ressources de l’exploitation des prolétaires
et par là sont intéressés au maintien de l’ordre social
bourgeois. Ils s’opposeront à tout essai de mettre fin à
l’exploitation des prolétaires, mais ils n’ont nullement
intérêt à ce que précisément les rapports de travail de l’une
ou l’autre profession soient particulièrement défavorables. Il
peut être parfaitement indifférent à un gros propriétaire
foncier, à un banquier, à un propriétaire de journal ou à un
avocat, du moment qu’ils ne possèdent pas de titres de filatures,
que le filateur de Manchester gagne 2 ou 2 ½ schillings par jour ou
qu’il travaille 10 ou 12 heures par jour.
Ces
éléments bourgeois peuvent très bien avoir intérêt à faire
certaines concessions aux syndicats pour obtenir d’eux, en retour,
des services d’ordre politique. Il arriva ainsi que des syndicats,
qui n’étaient pas guidés par la théorie socialiste se mirent au
services de causes qui n’étaient rien moins que prolétariennes.
Mais
de pires choses étaient possibles et arrivèrent. Toutes les
couches prolétariennes ne sont pas capables de s’élever au
niveau de l’organisation syndicale. Une différence se crée dans
le prolétariat entre travailleurs organisés et non-organisés.
Quand les premiers sont pénétrés de la pensée socialiste, ils
forment la partie la plus combative du prolétariat. Quand cette
pensée leur manque, les organisés ne deviennent que trop
facilement des aristocrates, qui non seulement perdent toute
sympathie pour les ouvriers inorganisés mais souvent même entrent
en opposition avec eux, leur rendent l’organisation plus
difficile, pour en monopoliser les avantages. Les travailleurs
inorganisés sont cependant incapables de toute lutte et de toute
ascension sans le concours des organisés. Sans leur appui, ils
s’enfoncent d’autant plus dans la misère que les autres
s’élèvent.
Ainsi
le mouvement syndical peut même amener, malgré l’accroissement
de la puissance de certaines couches, un affaiblissement direct de
l’ensemble du prolétariat lorsque le mouvement syndical n’est
pas pénétré de l’esprit socialiste.
L’organisation
politique du prolétariat également ne peut exercer toute sa force
sans cet esprit. Ceci est clairement démontré par le premier parti
ouvrier, le Chartisme, fondé en 1835, en Angleterre. Certes
celui-ci comprenait des éléments progressistes et clairvoyants ;
cependant, dans son ensemble, il ne suivait pas un programme
socialiste déterminé, mais seulement des objectifs isolés,
pratiques et accessibles. Avant tout, le suffrage universel, qui ne
doit certainement pas être un but en soi, mais un moyen d’atteindre
le but. Ce but ne consistait pour l’ensemble des Chartistes, qu’en
revendications économiques immédiates isolées, et avant tout la
journée de travail normale de dix heures. Il en résulta un premier
désavantage : le parti ne fut pas purement un parti de classe,
le suffrage universel intéressant aussi les petits-bourgeois.
Il
dut paraître avantageux à plus d’un que la petite bourgeoisie en
tant que telle se ralliât au parti ouvrier. Par-là, celui-ci fut
plus nombreux, mais non plus fort. Le prolétariat a ses propres
intérêts et ses propres méthodes de combat qui se distinguent de
celles de toutes les autres classes. Il restreint son action par
l’union avec les autres, et ne peut, par là même, exercer toute
sa force. Certes les petits-bourgeois et les paysans sont bien reçus
chez nous socialistes, lorsqu’ils veulent se joindre à nous, mais
seulement lorsqu’ils se placent sur une base prolétarienne, et
qu’ils se considèrent comme des prolétaires. Notre programme
socialiste est là pour garantir que seuls de tels éléments de la
petite bourgeoisie et de la petite paysannerie viennent à nous.
Pareil programme manquait aux Chartistes et ainsi de nombreux
éléments petits-bourgeois se joignirent à leur lutte pour le
droit électoral, éléments qui possédaient aussi peu de
compréhension que d’inclination pour les méthodes de lutte et
les intérêts prolétariens.
Comme
conséquence fatale, de vives luttes intérieures eurent lieu dans
le Chartisme même et l’affaiblirent beaucoup.
La
défaite de la Révolution de 1848 mit ensuite fin pour une dizaine
d’années à tout mouvement ouvrier politique. Lorsque le
prolétariat européen s’agita à nouveau, la lutte pour le
suffrage universel reprit parmi la classe ouvrière anglaise. On
pouvait s’attendre à une résurrection du Chartisme. Mais alors
la bourgeoisie anglaise fit un coup de maître. Elle divisa le
prolétariat anglais, accorda le droit de vote aux travailleurs
organisés, les détacha du restant du prolétariat et prévint
par-là la résurrection du Chartisme.
Comme
celui-ci ne possédait pas de programme d’ensemble dépassant la
revendication du droit de vote, dès qu’on eut répondu à cette
revendication de manière telle que la partie combative de la classe
ouvrière fut satisfaite, la base du Chartisme devait disparaître.
Ce n’est qu’à la fin du siècle que, suivant de très loin les
travailleurs du continent européen, les Anglais fondèrent un
nouveau parti ouvrier autonome. Mais pendant longtemps ils n’ont
pas saisi la signification pratique du socialisme pour le
développement complet de la puissance du prolétariat et ont refusé
d’accepter pour leur parti un programme parce que celui-ci ne
pouvait être qu’un programme socialiste ! Ils attendirent
que la logique des faits les y contraignît.
Actuellement
et sous tous les rapports, les conditions de l’union si nécessaire
du mouvement ouvrier et du socialisme sont accomplies. Elles
manquaient dans les premiers lustres du XIX° siècle.
Les
travailleurs furent à cette époque abattus par le premier assaut
du capitalisme. Quant à étudier d’une manière approfondie les
problèmes sociaux, il leur en manquait les moyens.
Les
socialistes bourgeois ne virent, pour cette raison, de la misère
que le capitalisme répand, qu’un seul aspect, l’oppression, et
non l’autre, excitant qui aiguillonnait le prolétariat vers
l’ascension révolutionnaire. Ils croyaient qu’il n’y avait
qu’un facteur qui permit de réaliser la libération du
prolétariat : la bonne volonté de la bourgeoisie. Ils
appréciaient la bourgeoisie d’après leur propre valeur,
croyaient trouver parmi elle suffisamment de compagnons d’idées
pour être en état d’appliquer des mesures socialistes. Leur
propagande socialiste trouva d’ailleurs au commencement beaucoup
d’écho parmi les philanthropes bourgeois. Les bourgeois ne sont
pas, en effet, en général inhumains ; la misère les émeut
et, du moment qu’ils n’en tirent pas profit, ils voudraient
volontiers la supprimer. Aussi sensibles qu’ils sont envers le
prolétaire souffrant, aussi durs sont-ils envers le prolétaire
militant. Ils sentent que celui-ci ébranle la base de leurs moyens
d’existence. Le prolétariat qui mendie jouit de leur sympathie,
celui qui revendique les met dans un état de sauvage hostilité.
Ainsi les socialistes bourgeois trouvèrent-ils peu à leur goût
que le mouvement ouvrier menaçât de leur enlever le facteur sur
lequel ils comptaient le plus : la sympathie de la bourgeoisie
bien-pensante pour les prolétaires.
Ils
virent d’autant plus le mouvement ouvrier un élément fâcheux
que leur confiance dans le prolétariat, qui en ce temps
représentait encore en général une masse d’un niveau
extrêmement bas, était minime et qu’ils constataient plus
clairement l’insuffisance et la naïveté du mouvement ouvrier.
Ils
arrivèrent souvent à se dresser directement contre le mouvement
ouvrier, par exemple, en montrant combien les syndicats seraient
superflus puisqu’ils ne voulaient qu’augmenter les salaires, au
lieu de combattre le salariat lui-même qui est la cause de tout le
mal.
Peu
à peu cependant, un revirement se préparait. Vers 1840, le
mouvement ouvrier avait suffisamment évolué pour produire une
série d’esprits des mieux doués qui s’assimilèrent le
socialisme et qui virent en lui la science prolétarienne de la
société. Ces travailleurs savaient déjà, de leur propre
expérience, qu’ils n’avaient pas à compter sur la
philanthropie de la bourgeoisie. Ils comprirent que le prolétariat
devait se libérer lui-même. De plus, des socialistes bourgeois
aussi vinrent à cette idée qu’on ne pouvait se fier à la
générosité de la bourgeoisie. Certes, ils n’avaient pas
confiance dans le prolétariat. Son mouvement ne leur paraissait que
comme une force destructive menaçant toute civilisation. Ils
crurent que seule l’intelligence bourgeoise pouvait construire une
société socialiste, ils ne virent plus la force motrice nécessaire
à cette fin dans la compassion
envers le prolétariat, mais dans la peur
d’un prolétariat agressif. Ils en saisirent la puissance
impression ante et comprirent que le mouvement ouvrier provient
nécessairement du mode de production capitaliste et qu’il croîtra
toujours pendant ce mode de production. Ils espérèrent que la peur
du mouvement ouvrier croissant inciterait la bourgeoisie
intelligente à écarter le danger par des mesures socialistes.
C’était un progrès important, bien que l’union du socialisme
et du mouvement ouvrier ne pouvait procéder d’une telle
conception. Il manquait en effet, aux ouvriers socialistes, malgré
tout le génie de certains d’entre eux, le vaste savoir nécessaire
pour fonder une théorie du socialisme dans laquelle le socialisme
serait organiquement allié au mouvement ouvrier.
Les
ouvriers socialistes ne purent que reprendre le vieux socialisme
bourgeois, c’est-à-dire l’utopisme et l’adapter à leurs
besoins.
Ceux
qui allèrent le plus loin dans ce sens furent certains socialistes
prolétariens qui procédaient du Chartisme ou de la Révolution
française. Ces derniers notamment acquirent une grande importance
pour l’histoire du socialisme. La grande Révolution avait
clairement tiré la signification que la conquête du pouvoir de
l’État peut avoir pour la libération d’une classe.
Dans
cette révolution, grâce à des circonstances particulières, une
puissante organisation politique, le Club des Jacobins, était
arrivé à dominer Paris et par là toute la France, par l’action
terroriste de petits-bourgeois mêlés, en une forte proportion, à
des éléments prolétaires. Et même pendant la Révolution, Babeuf
avait déjà tiré la conséquence de celle-ci dans un sens purement
prolétarien et cherché, par une conjuration, à conquérir le
pouvoir d’État pour une organisation communiste.
Le
souvenir de ces événements ne s’était pas effacé chez les
ouvriers français. La conquête du pouvoir, pour les socialistes
prolétariens constitua rapidement le moyen par lequel ils voulaient
gagner la puissance nécessaire à la réalisation du socialisme.
Mais considérant la faiblesse et l’immaturité du prolétariat,
ils ne pouvaient concevoir d’autre chemin pour la conquête du
pouvoir que le « putsch » d’un certain nombre de
conjurés qui devaient libérer la Révolution. Parmi les
représentants de ces idées, Blanqui est le plus connu. En
Allemagne, Weitling représenta des conceptions semblables.
D’autres
socialistes procédèrent aussi de la Révolution française. Mais
le « putsch » ou la tentative révolutionnaire leur
sembla un moyen peu approprié pour renverser la domination du
capital. Comme la tendance mentionnée plus haut, celui-ci comptait
peu sur la puissance du mouvement ouvrier. Elle se tirait d’affaire,
en négligeant de voir à quel point la petite bourgeoisie repose
sur la même base de propriété privée des moyens de production
que le capital et en croyant que les prolétaires pourraient régler
leur compte aux capitalistes sans opposition de la petite
bourgeoisie, ou « du Peuple », et même avec son aide.
On
n’avait besoin que de la République et du suffrage universel pour
obliger l’État à prendre des mesures socialistes.
Cette
conception de beaucoup de républicains, dont le plus remarquable
fut Louis Blanc, trouva en Allemagne une contrepartie dans la
conception monarchiste de la royauté sociale, qu’entretenaient
quelques professeurs et autres idéologues comme Robertus.
Ce
socialisme d’État monarchiste ne fut qu’une mode, quelquefois
démagogique. Il n’a jamais acquis une signification pratique
sérieuse. Il n’en est pas de même pour les tendances
représentées par Blanqui et Louis Blanc. Elles dominèrent Paris
pendant les journées de la Révolution de février 1848.
Ces
tendances trouvèrent dans la personne de Proudhon un critique
puissant. Proudhon doutait du prolétariat comme de l’État et de
la Révolution. Il admettait bien que le prolétariat doit se
libérer lui-même ; mais il vit aussi que, si la classe
ouvrière voulait lutter pour sa libération, elle devait
entreprendre le combat pour conquérir le pouvoir, parce que même
la simple lutte économique dépend de l’État. Comme Proudhon
tenait la conquête du pouvoir comme étant sans chance de succès,
il conseilla au prolétariat de s’abstenir, dans ses efforts
d’émancipation, de toute lutte et de n’essayer que les moyens
d’organisation pacifique, comme par exemple les banques d’échange,
les caisses d’assurances et autres institutions. Pour les
syndicats, il avait aussi peu de compréhension que pour la
politique.
Ainsi
le mouvement ouvrier et le socialisme et tous les essais de créer
un rapport plus étroit entre eux, pendant la dizaine d’années où
Marx et Engels fixaient leur point de vue et leurs méthodes,
formaient un chaos de tendances aussi diverses que multiples, qui
avaient chacune découvert une petite part du vrai, mais dont aucune
ne pouvait le saisir complètement et qui toutes devaient tôt ou
tard finir dans l’insuccès.
Ce
qui ne fut pas permis à ces tendances réussit au matérialisme
historique qui, en plus de sa grande signification pour la science,
acquit une non moins grande importance sociale. Il devait faciliter
la révolution de l’une comme de l’autre.
Comme
les socialistes de leur temps, Marx et Engels constatèrent que le
mouvement ouvrier paraît insuffisant lorsqu’on l’oppose au
socialisme et qu’on demande : quel est le moyen le plus
approprié, le mouvement ouvrier (syndicat, lutte pour le droit de
vote, etc.) ou le socialisme pour procurer au prolétaire des moyens
certains d’existence et la suppression de toute exploitation ?
Mais ils constatèrent aussi que cette question était tout à fait
mal posée. Socialisme, moyens certains d’existence du
prolétariat, suppression de toute exploitation sont identiques. La
question est simplement celle-ci : comment le prolétariat
arrive-t-il au socialisme ? Et ici la doctrine de la lutte de
classe répond : par le mouvement ouvrier.
Certes,
celui-ci n’est pas en état de procurer immédiatement au
prolétariat une existence certaine et la suppression de toute
exploitation, mais il n’est pas seulement le moyen indispensable
d’empêcher la chute dans la misère des prolétaires isolés,
mais encore de procurer à l’ensemble de la classe des
travailleurs une force toujours plus grande, une force
intellectuelle, économique et politique qui croît toujours, même
si, en même temps, l’exploitation du prolétariat augmente. On ne
doit pas apprécier le mouvement ouvrier d’après son importance
dans la limitation de l’exploitation, mais au contraire, d’après
son importance au point de vue de l’accroissement de la puissance
du prolétariat. Ce n’est pas de la conjuration de Blanqui, ni du
socialisme d’État de Louis Blanc et de Robertus, ni des
organisations pacifiques de Proudhon, mais de la lutte de classe,
qui peut durer des dizaines d’années et même des générations,
que naît la force qui peut et doit prendre possession de l’État
sous la forme de la République démocratique et y introduire le
socialisme.
Mener
la lutte de classe économique et politique, s’occuper de la
manière la plus zélée du travail de détail, mais avec la pensée
de l’exécuter avec de larges vues socialistes, grouper en un tout
formidable, unifié et harmonieux se développant irrésistiblement
chaque jour les organisations et les activités du prolétariat, ce
sont là, d’après Marx et Engels, les tâches de tous ceux,
prolétaires ou non, qui se placent au point de vue du prolétariat
qu’ils veulent libérer.
L’accroissement
de la puissance du prolétariat repose lui-même en dernière
instance sur le remplacement des modes de production précapitalistes
et petits-bourgeois par le mode de production capitaliste qui
augmente le nombre des prolétaires, les concentre, les rend plus
indispensables pour l’ensemble de la société et crée en même
temps, à cause du capital toujours plus concentré, les prémices
de l’organisation sociale de la production qui ne doit plus être
recherchée arbitrairement par les utopistes, mais au contraire doit
procéder de la réalité capitaliste.
Par
cette conception, Marx et Engels ont créé le fondement sur lequel
s’élève la démocratie socialiste, le fondement sur lequel se
place le prolétariat militant du monde entier et d’où est partie
sa marche triomphante.
Cette
contribution ne fut pas possible aussi longtemps que le socialisme
ne possédait pas sa science indépendante de celle de la
bourgeoisie. Les socialistes avant Marx et Engels étaient certes,
pour la plupart, initiés à la science de l’économie politique,
mais ils le reprenaient, sans esprit critique, sous la forme dans
laquelle elle avait été créé par les penseurs bourgeois et ils
ne se distinguaient d’eux que par les conclusions en faveur du
prolétariat qu’ils en tiraient.
Marx,
le premier, a entrepris d’une manière complètement indépendante
l’étude du mode de production capitaliste et montré combien on
peut le concevoir plus clairement et plus profondément lorsqu’on
le considère d’un point de vue prolétarien au lieu d’un point
de vue bourgeois, parce que le point de vue prolétarien dépasse ce
mode de production au lieu d’y être inclus. A Marx, seulement,
qui considère le capitalisme comme une forme sociale qui évolue,
il fut permis de saisir complètement son caractère historique
propre.
Ce
travail formidable est contenu dans Le
Capital
de Marx, paru en 1867. Auparavant, il avait déjà exposé, avec
Engels, son nouveau point de vue socialiste dans le Manifeste
Communiste
de 1848.
Ainsi
le combat d’émancipation prolétarien reçut un fondement
scientifique d’une grandeur et d’une solidité qu’aucune
classe révolutionnaire ne posséda avant lui. Mais certes, il n’y
eut aucune classe à qui échut une tâche aussi gigantesque que
celle qui échoit au prolétariat moderne qui doit remboîter le
monde entier que le capitalisme a fait sortir de ses joints. Le
prolétariat n’est heureusement par un Hamlet qui accueille cette
tâche par des lamentations. De la grandeur de celle-ci, il tire sa
confiance.
5.
Synthèse de la théorie et de la pratique
Nous
avons examiné les travaux principaux de Marx et de son
collaborateur Engels. Mais l’exposé de leur production serait
incomplet si nous ne parlions pas de la synthèse de la théorie et
de la pratique qui constitue un de ses aspects principaux.
Pour
la pensée bourgeoise, ceci est une faiblesse de leur œuvre
scientifique, devant laquelle, peut-être avec malveillance et
incompréhension même, la science bourgeoise doit s’incliner.
S’ils n’avaient été que ces théoriciens et des savants de
cabinet, qui se seraient contentés d’exposer leurs théories en
une langue incompréhensible pour le commun des mortels dans des
in-folio inaccessibles, cela aurait encore pu passer. Mais le fait
que leur science est née de la lutte et doit à son tour servir la
lutte, la lutte contre l’ordre existant, cela a dû oblitérer
leur impartialité et leur enlever leur honnêteté.
Cette
misérable façon de considérer les choses ne permet de voir en un
lutteur qu’un avocat, à qui sa science ne sert à rien d’autre
qu’à lui fournir des arguments contre la partie adverse.
Personne
n’a un plus grand besoin de vérité que le lutteur engagé dans
une lutte terrible avec la perspective de ne résister que s’il
connaît clairement sa situation et ses moyens d’action.
Les
juges qui interprètent les lois de l’État peuvent être induits
en erreur par les stratagèmes d’un avocassier habile. Il n’en
est pas de même de la nécessité des lois naturelles que l’on
peut connaître mais non duper ou corrompre.
Le
lutteur qui se trouve dans cette situation puisera dans l’ardeur
de la lutte un désir plus grand d’entière vérité. Et aussi le
désir, non pas de conserver pour soi la vérité acquise, mais de
la communiquer à ses compagnons de lutte.
Ainsi
Engels écrivait entre 1845 et 1848, époque où lui et Marx
acquirent leurs nouveaux résultats scientifiques, qu’ils
n’avaient nullement l’intention « de
chuchoter ces résultats dans de gros livres exclusivement réservés
au monde savant ».
Ils se mirent au contraire immédiatement en relation avec des
organisations prolétariennes pour y faire de la propagande pour
leurs conceptions et la tactique qui y correspond. Ils réussirent
ainsi à gagner à leurs principes l’internationale « Union
des Communistes », une des plus importantes parmi les
associations prolétariennes révolutionnaires de l’époque,
principes qui trouvèrent leur expression peu de semaines avant la
révolution de février 1848 dans le Manifeste
Communiste
qui devait servir de « fil conducteur » au mouvement
prolétarien de tous les pays.
La
révolution appela Marx et Engels de Bruxelles, où ils
séjournaient, d’abord à Paris, ensuite en Allemagne, où ils se
consacrèrent un certain temps à la pratique révolutionnaire.
La
chute de la révolution les contraignit, fort à contrecœur, à
partir de 1850, à se consacrer entièrement à la théorie. Mais
lorsqu’au commencement des années 1860, le mouvement ouvrier
reprit vie, Marx – Engels fut d’abord empêché pour des raisons
personnelles – se remit immédiatement de toutes ses forces au
travail pratique du mouvement.
Il
entra dans l’Association Internationale des Travailleurs, fondée
en 1864 et qui devait devenir rapidement un épouvantail pour toute
l’Europe bourgeoise.
Le
ridicule esprit policier avec lequel même la démocratie bourgeoise
soupçonne tout mouvement prolétarien, représente l’Internationale
comme une monstrueuse société de conspiration qui s’était donné
pour unique tâche l’organisation de troubles et de tentatives
révolutionnaires. En réalité elle poursuivait ouvertement ses
objectifs : la concentration de toutes les forces
prolétariennes en une activité commune, mais propre, libérée de
toute politique ou pensée bourgeoise, en vue de l’expropriation
du capital et de la conquête de tous les instruments politiques et
économiques des classes possédantes par le prolétariat. Le pas le
plus important et le plus décisif dans cette voie, c’est la
conquête de la puissance politique, mais l’émancipation
économique des classes travailleuses est le bit final, « auquel
tout mouvement politique comme simple moyen doit se subordonner ».
Comme
moyen le plus approprié à l’accroissement de la puissance
prolétarienne Marx considère l’organisation.
« Les
prolétaires possèdent un élément du succès »,
dit-il, dans l’Adresse Inaugurale, « le
nombre. Mais le nombre n’a un grand poids que lorsqu’il est
groupé en une organisation et conduit à un but précis ».
Sans
but, pas d’organisation. Le but commun seul peut unir les
différents individus en une organisation commune. D’un autre
côté, la diversité des buts est une cause de division comme la
communauté du but amène l’union.
Précisément
à cause de l’importance de l’organisation pour le prolétariat,
tout dépend du genre de but qu’on lui assigne. Ce but est de plus
grande signification pratique. Rien de moins pratique que cette
façon de voir qui semble d’un si grand réalisme politique :
le mouvement est tout, le but n’est rien. Est-ce l’organisation
n’est donc rien et le mouvement inorganisé tout ?
Déjà
avant Marx des socialistes assignèrent des buts au prolétariat.
Mais ceux-ci provoquèrent le sectarisme, et divisèrent les
prolétaires parce que chacun de ces socialistes mettait l’accent
sur la manière spéciale qu’il avait trouvée de résoudre le
problème social. Autant de solutions, autant de sectes.
Marx
ne donna pas de solution particulière. Il s’opposa à toutes les
mises en demeure d’être « positif » et d’exposer en
détail les mesures à prendre, par lesquelles on émanciperait le
prolétariat. Il ne proposa à l’Internationale que ce but général
de l’organisation, que tout prolétaire pouvait adopter : la
libération économique de sa classe ; et le chemin qu’il
montrait pour y arriver était celui que l’instinct de classe du
prolétaire indiquait : la lutte de classe politique et
économique.
Avant
tout ce fut la forme syndicaliste de l’organisation que Marx
propagea dans l’Internationale ; elle apparut comme la forme
d’organisation qui pouvait le plus rapidement possible réunir de
grandes masses d’une manière durable. Dans les syndicats, il vit
également les cadres du parti ouvrier. Sa pénétration de l’esprit
de la lutte des classes et sa compréhension des conditions, grâce
auxquelles l’expropriation de la classe capitaliste et la
libération du prolétariat étaient possibles, n’agirent pas
moins activement que le développement de l’organisation syndicale
elle-même.
Il
eut de fortes oppositions à vaincre, précisément chez les
travailleurs les plus avancés, qui étaient encore pénétrés de
l’esprit des anciens socialistes et qui appréciaient peu les
syndicats, parce que ceux-ci ne touchaient pas au salariat. Ils leur
parurent comme une déviation de la bonne méthode, qu’ils
voyaient dans la fondation d’organisations dans lesquelles le
salariat était directement vaincu, comme dans les coopératives de
production. Si, malgré tout, l’organisation syndicale fit de
rapides progrès sur le continent européen à partir de la deuxième
moitié des années 60, elle le doit avant tout à l’Internationale
et à l’influence que Marx exerça sur elle et par elle.
Les
syndicats n’étaient pas pour Marx un but en soi, mais seulement
le moyen de mener la lutte de classe contre l’ordre capitaliste.
Il s’opposa de la manière la plus énergique aux chefs de
syndicats qui essayèrent de détourner les syndicats de ce but –
que ce fût pour des raisons étroitement personnelles ou pour des
considérations purement syndicales, notamment contre les
fonctionnaires syndicaux qui commencèrent à tricher avec les
libéraux.
En
général, aussi indulgent et tolérant que Marx était envers les
masses prolétariennes, aussi sévère était-il pour ceux qui se
présentaient comme leurs chefs. Ceci fut surtout vrai pour les
théoriciens.
Dans
l’organisation prolétarienne était bienvenu, pour Marx, tout
prolétaire qui se présentait avec l’intention honnête de
participer à la lutte de classe quelles que fussent les conceptions
que le nouvel adhérent prônait, les motifs d’action théoriques
qui le menaient, ou les arguments qu’il employait ; qu’il
fût athée ou chrétien, proudhonien, blanquiste, weitlingien ou
lassalien, qu’il comprît la théorie de la valeur ou qu’il la
tînt pour superfétatoire. Naturellement, il ne lui était pas
indifférent d’avoir affaire avec des ouvriers aux conceptions
claires ou pleins de confusion. Il considérait comme un devoir
important de les éclairer, mais il aurait tenu pour erroné de
repousser des travailleurs parce qu’ils pensaient d’une manière
confuse, et de les écarter de l’organisation. Il mettait toute sa
confiance dans la puissance des contradictions de classes et dans la
logique de la lutte de classe qui devait mener chaque prolétaire
dans la bonne voie du moment qu’il avait adhéré à une
organisation qui servait une véritable lutte de classe
prolétarienne.
Mais
il se comportait d’une manière différente vis-à-vis des gens
qui vinrent au prolétariat comme professeurs et qui répandaient
des conceptions propres à troubler la force et l’unité de cette
lutte de classe. Vis-à-vis de tels éléments, il ne connaissait
pas d’indulgence. Il s’opposa à eux en critique impitoyable,
leurs intentions eussent-elles été les meilleures ; leur
activité lui semblait en tout cas répréhensible – même
lorsqu’il y avait des résultats et qu’elle ne s’exprimait pas
en un pur gaspillage de forces.
Grâce
à cela Marx fut toujours un des hommes les plus haïs ; haï
non seulement de la bourgeoisie qui craignait en lui l’ennemi le
plus dangereux, mais aussi de tous les sectaires, inventeurs,
confusionnistes cultivés et autres éléments semblables dans le
camp socialiste qui s’emportaient d’autant plus passionnément
contre son « intolérance », son « autoritarisme »,
son « dogmatisme » et son « inquisition »
qu’ils ressentaient douloureusement sa critique.
Avec
ses conceptions, nous, marxistes, avons aussi repris cette position
et nous en sommes fiers. Ce n’est que celui qui se sent le plus
faible qui se plaint de « l’intolérance » d’une
critique purement idéologique. Personne n’est plus durement, plus
méchamment critiqué que Marx. Mais jusqu’ici il n’est encore
jamais arrivé à un marxiste de chanter une complainte sur
l’intolérance de nos adversaires d’idées. Pour cela, notre
affaire est trop certaine.
Par
contre, le découragement, qui parfois se manifeste dans les masses
prolétariennes à la suite de querelles d’idées entre le
marxisme et ses critiques, ne nous laisse pas indifférents. Ce
découragement exprime un besoin tout à fait justifié : celui
de l’unité du combat de classe et du groupement de tous les
éléments prolétariens en une grande masse distincte, celui
d’éviter des divisions qui pourraient affaiblir le prolétariat.
Les
travailleurs connaissent très bien la force qu’ils puisent dans
leur unité, ils l’apprécient plus que la clarté théorique et
ils maudissent les discussions théoriques, lorsqu’elles menacent
d’aller jusqu’à la division. Et cela avec raison, parce que le
besoin de clarté théorique produirait le contraire de ce qu’il
devrait donner s’il affaiblit la lutte de classe prolétarienne au
lieu de la renforcer.
Un
marxiste qui pousserait une divergence théorique jusqu’à la
division d’une organisation de combat prolétarienne n’agirait
pas d’une manière marxiste, c’est-à-dire dans le sens de la
doctrine marxiste de la lutte de classe pour laquelle chaque pas en
avant est plus important qu’une douzaine de programmes.
Marx
et Engels ont exposé dans le Manifeste
Communiste,
au chapitre intitulé : « Prolétaires et Communistes »,
leur conception relative à la position que les marxistes devaient
occuper dans les organisations prolétariennes. Les communistes
étaient à peu près ce que nous appelons aujourd’hui les
marxistes.
Dans
ce chapitre, on peut lire ceci :
« Quelle
est la position des communistes vis-à-vis des prolétaires pris en
masse ?
Les
communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres
partis ouvriers.
Ils
n’ont point d’intérêts qui les séparent du prolétariat.
Ils
ne proclament pas de principes sectaires sur lesquels ils voudraient
modeler le mouvement ouvrier.
Les
communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur
deux points :
- Dans
les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en
avant et font valoir les intérêts communs du prolétariat.
- Dans
les différentes phases évaluatives de la lutte entre prolétaires
et bourgeois, ils représentent toujours et partout les intérêts
du mouvement générale.
Pratiquement,
les communistes sont donc la fraction la plus résolue, la plus
avancée de chaque pays, la section qui anime toutes les autres;
théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage
d’une intelligence nette des conditions de la marche et des fins
générales du mouvement prolétarien.
Le
but immédiat des communistes est le même que celui de toutes les
fractions du prolétariat : organisation des prolétaires en classe,
destruction de la suprématie bourgeoise, conquête du pouvoir
politique par le prolétariat.
Les
propositions théoriques des communistes ne reposent nullement sur
des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel
réformateur du monde.
Elles
ne sont que l’expression, en termes généraux, des conditions
réelles d’une lutte de classes existante, d’un mouvement historique
évoluant sous nos yeux. »
Depuis
quatre-vingt-cinq ans [en 1933] que ceci fut écrit, plus d’une
situation a changé, de sorte que ces phrases ne peuvent plus être
appliquées à la lettre. En 1848, il n’y avait pas encore de
grands partis ouvriers unitaires ayant des programmes généraux
socialistes, et à côté de la théorie marxiste, il s’en
trouvait d’autres, bien plus répandues.
Aujourd’hui
il n’y a plus, chez le prolétaire militant, uni dans des partis
de masse, qu’une seule théorie socialiste vivante : la
théorie marxiste. Tous les membres des partis ouvriers ne sont pas
marxistes, et encore moins ont-ils une solide formation marxiste.
Mais parmi eux, ceux qui n’admettent pas la théorie marxiste
n’ont point du tout de théorie propre. Ou bien ils contestent
l’utilité d’une théorie ou d’un programme quelconque, ou
bien ils brassent les bribes de la pensée pré-marxiste. Ce qui
suffit pour les buts habituels d’agitation populaire, mais ce qui
est insuffisant lorsqu’il s’agit de discerner dans la réalité
des phénomènes nouveaux et inattendus. Précisément à cause de
cette souplesse et de cette inconsistance dans cette position on ne
peut faire un édifice qui défie toutes les tempêtes.
Le
marxisme ne doit plus aujourd’hui se dresser contre d’autres
conceptions socialistes. Ses critiques ne lui opposent pas d’autres
idées, mais émettent seulement des doutes sur la nécessité d’une
théorie en général ou du moins d’une théorie conséquente. On
ne lui oppose plus dans le mouvement ouvrier que des expressions
telles que « dogmatisme », « orthodoxie » et
autres et non plus de nouveaux systèmes.
Ce
n’est là pour nous, marxistes, qu’une raison de plus de ne pas
vouloir enfermer le mouvement ouvrier dans une secte marxiste
particulière qui se séparerait des autres couches du prolétariat
militant. Comme Marx nous considérons, comme étant notre tâche,
d’unir l’ensemble du prolétariat en un organisme de lutte. À
l’intérieur de cet organisme, ce sera toujours notre but de
rester « la partie la plus active et la plus avancée »
qui « ait sur le reste du prolétariat l’avantage d’une
intelligence nette des conditions, de la marche et des fins
générales du mouvement prolétarien », c’est-à-dire que
nous nous efforçons de fournir le maximum dans l’action pratique
et dans l’étude théorique, qu’il est possible de fournir dans
des circonstances données. Nous ne voulons avoir une situation
spéciale de l’organisation générale du prolétariat groupé en
parti de classe que par la supériorité de notre travail que nous
assure la supériorité de notre point de vue marxiste.
Le
prolétariat, d’ailleurs, partout où il n’est pas pénétré de
marxisme, est contraint par la force des choses à en prendre le
chemin.
Il
est très rare qu’un marxiste ou un groupe marxiste ait fait appel
à la scission pour des divergences théoriques. Quand il y eut des
divisions, ce furent toujours des divisions pour des raisons
pratiques et non théoriques ; c’étaient toujours des
divergences tactiques ou d’organisation qui les amenèrent et la
théorie ne fut que le bouc émissaire chargé de tous les péchés
commis en la circonstance.
Marx
n’a pas seulement montré théoriquement la voie par laquelle le
prolétariat doit atteindre au plus vite son haut objectif, il a été
aussi pratiquement de l’avant dans cette voie. Par son activité
dans l’Internationale, il devint un guide pour toute notre
activité pratique.
[Aujourd’hui
encore l’opposition si profonde entre communistes et
social-démocrates n’est pas théorique, mais pratique. Pour cette
raison, nous n’en parlerons, ici, pas plus longtemps. Cette
opposition est une opposition tactique et d’organisation, et non
pas l’opposition du marxisme et de l’anti-marxisme, mais au
contraire celle de la démocratie et de la dictature. À ce sujet,
nous pouvons, nous social-démocrates, pleinement nous en référer
à Marx, qui intervint dans les questions du parti et des syndicats
en faveur de la démocratie la plus complété et dans celle de
l’État en faveur de la république démocratique. (Paragraphe
rajouté en 1933.)]
Non
seulement comme penseur, mais encore comme modèle, nous avons ici à
commémorer Marx ou mieux, ce qui est plus dans son esprit, à
l’étudier. Nous ne tirerons pas un profit moindre de l’histoire
de son activité personnelle que de ses études théoriques.
Il
ne fut pas seulement un modèle par son activité, par son
intelligence supérieure, mais aussi par son audace, sa persévérance
qui se mariaient avec la plus grande bonté, l’abnégation et la
sérénité inébranlable.
Pour
connaître son audace, il faut lire son procès qui se déroula à
Cologne, le 9 février 1849, à cause de son appel à la résistance
armée où il expose la nécessité d’une nouvelle révolution. Le
soin vigilant qu’il montra, alors qu’il vivait lui-même dans la
plus grande misère, pour ses compagnons, à qui il pensait toujours
avant de penser à lui-même, notamment après l’effondrement de
la révolution de 1848, comme après la chute de la Commune de Paris
de 1871, témoigne de sa bonté et de son abnégation. Toute sa vie
fut une chaîne ininterrompue d’épreuves, auxquelles seul un
homme dont la persévérance et l’énergie dépassaient de
beaucoup la mesure commune pour résister.
Dès
le début de son activité à la Rheinische
Zeitung,
en 1842, il fut pourchassé de pays en pays, jusqu’au moment où
la Révolution de 1848 lui fit espérer la victoire. Par la défaite
de la révolution, il se vit rejeté de nouveau dans la misère
politique et personnelle, qui semblait d’autant plus sans espoir
qu’en exil il était boycotté d’un côté par la démocratie
bourgeoise, de l’autre par une partie des communistes mêmes qui
le combattaient parce qu’il n’était, d’après eux, pas
suffisamment révolutionnaire et que, de ses partisans, un grand
nombre étaient enfermés pour de nombreuses années dans les
forteresses prussiennes. Finalement vint une éclaircie,
l’Internationale ; mais après peu d’années, elle disparut
aussi à la suite de la chute de la Commune de Paris, et elle fut
dissoute dans la confusion. Certes, l’Internationale avait
accompli sa tâche de la manière la plus brillante, mais
précisément à cause de cela les mouvements révolutionnaires des
différents pays étaient devenus autonomes. Plus elle grandissait,
plus l’Internationale avait besoin d’une forme d’organisation
plus élastique, qui laissât plus de place aux différentes
organisations nationales. Cependant, au même moment, les dirigeants
des syndicats anglais qui voulaient marcher avec les libéraux se
sentirent mal à l’aise à cause des tendances de la lutte de
classe, alors que dans les pays latins l’anarchisme bakouninien
se rebellait contre la participation des travailleurs à la
politique : phénomènes qui poussèrent précisément alors le
Conseil général de l’Internationale à l’application la plus
rigoureuse de ses attributions centralisatrices, alors que le
fédéralisme était plus nécessaire que jamais dans
l’organisation.
Le
fier navire conduit par Marx échoua sur cet écueil.
Ce
fut une amère désillusion pour Marx. Certes, la brillante
ascension de la social-démocratie allemande et le renforcement du
mouvement révolutionnaire en Russie vinrent alors.
Cependant
la loi sur les socialistes mit bientôt fin à cette ascension
brillante, et le terrorisme russe atteignit son point culminant en
1881. À partir de ce moment, il alla en déclinant.
Ainsi
l’activité politique de Marx fut une chaîne ininterrompue
d’insuccès et de désillusions, tout comme son activité
scientifique. L’œuvre de sa vie, le Capital,
de laquelle il avait espéré beaucoup, resta apparemment inaperçue
et sans action. Même dans son propre parti, son œuvre ne fut que
peu comprise jusqu’au commencement des années quatre-vingts.
Marx
mourut juste au seuil du temps où les semailles qu’il avait
prodiguées dans les périodes les plus arides devaient se lever. Il
mourut au moment où le mouvement prolétarien s’étendit à toute
l’Europe et se pénétra de l’esprit de Marx, se plaçant sur
les fondements qu’il avait établis, ce qui donna une période
d’essor victorieux au prolétariat.
Si
décourageante qu’aurait été cette situation pour beaucoup
d’hommes, elle n’enleva jamais à Marx son égalité d’humeur
ni ses convictions. Il dépassa si fortement son milieu et vit si
loin au-delà de celui-ci qu’il put apercevoir la terre promise
que la grande masse de ses contemporains ne soupçonnaient même
pas. Ce fut la grandeur de son œuvre scientifique, ce fut la
profondeur de sa théorie, où il puisa le meilleur de sa force de
caractère, où son énergie et ses convictions prirent racine, qui
le mirent à l’abri de toute défaillance et de cette inégalité
de sentiments qui fait passer de la jubilation d’aujourd‘hui au
sombre pessimisme de demain.
Nous devons puiser également à cette source afin d’être certains que nous serons à la hauteur de notre tâche. Alors nous pourrons espérer atteindre notre but plus tôt qu’il ne l’aurait été autrement. La bannière de la délivrance du prolétariat et de l’humanité entière que Marx a déployée, qu’il brandit plus d’une génération avant nous, jamais abattu, jamais découragé par des attaques toujours renouvelées, cette bannière, les combattants qu’il a formés le planteront sur les ruines de la forteresse capitaliste.
>Sommaire du dossier