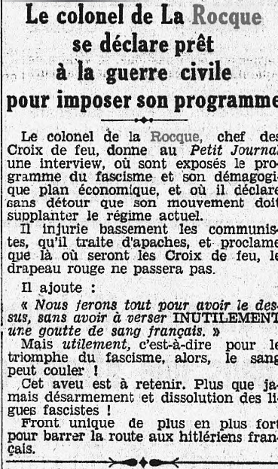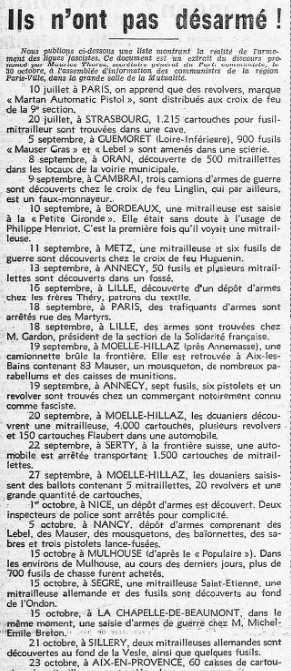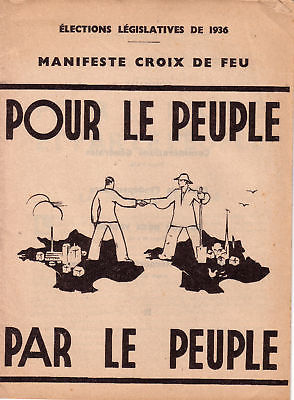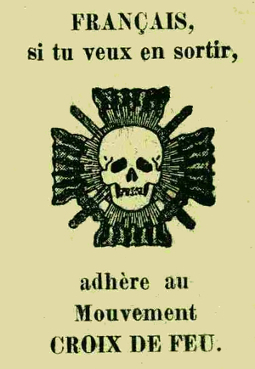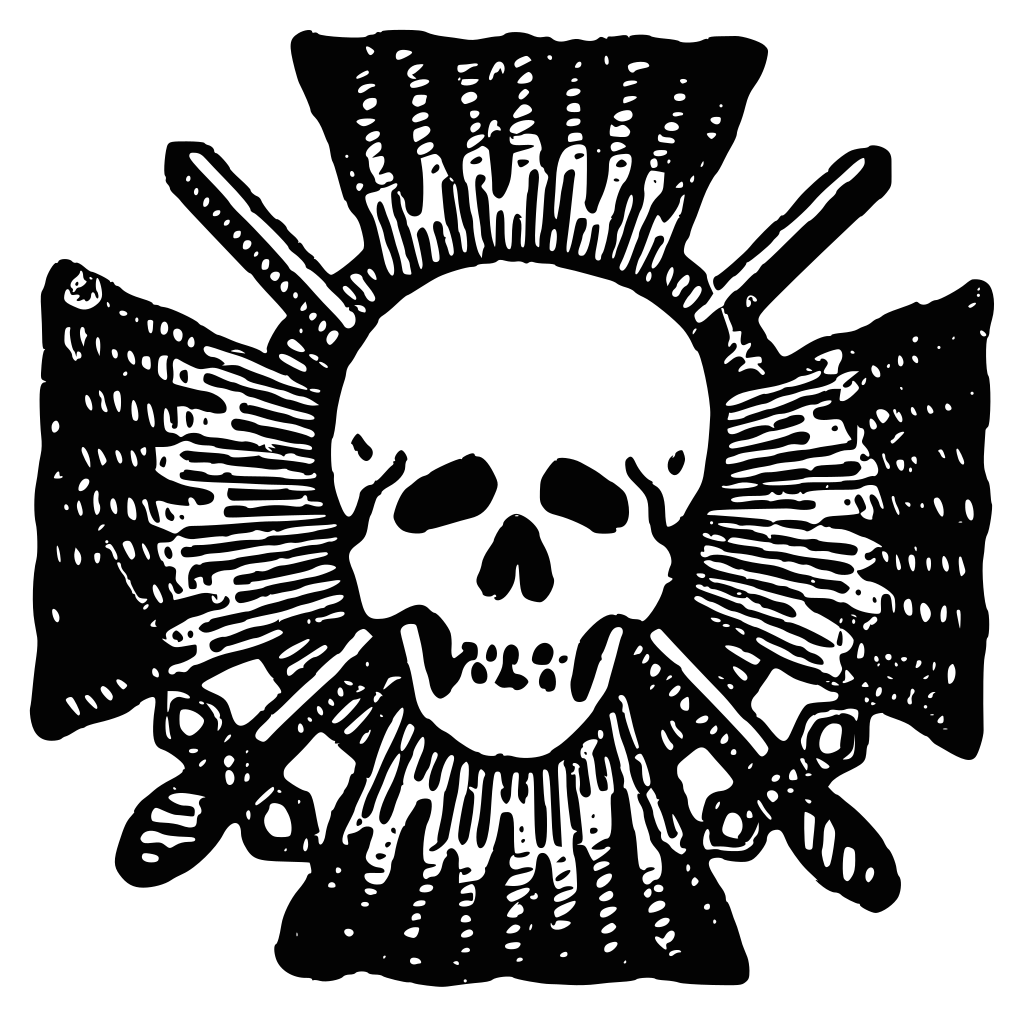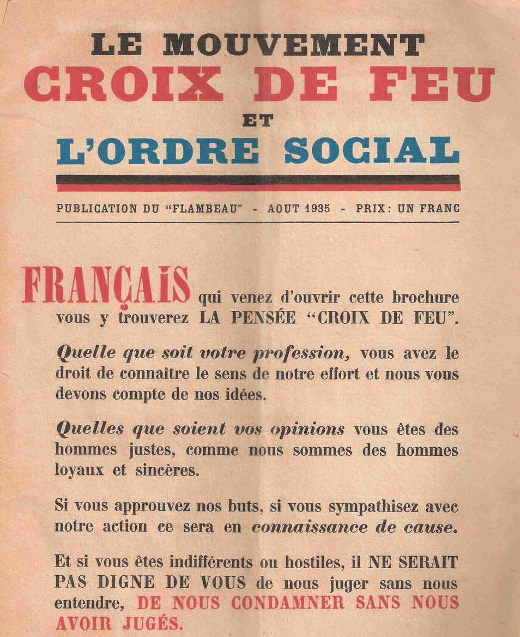Rédigé en octobre 1916 et publié en décembre 1916 dans le n° 2 du « Recueil du Social‑Démocrate ».
Existe-t-il un lien entre l’impérialisme et la victoire ignoble,
monstrueuse, que l’opportunisme (sous les espèces du
social-chauvinisme) a remportée sur le mouvement ouvrier européen ?
Telle est la question fondamentale du socialisme contemporain. Et
maintenant que nous avons parfaitement établi dans notre littérature
du parti :
-
le caractère impérialiste de notre époque et de la
guerre actuelle ;
-
l’indissoluble liaison historique entre le
social-chauvinisme et l’opportunisme, ainsi que l’identité de leur
contenu politique et idéologique, nous pouvons et nous devons
passer à l’examen de cette question fondamentale.
Il nous faut commencer par donner la définition la plus précise
et la plus complète possible de l’impérialisme. L’impérialisme est
un stade historique particulier du capitalisme. Cette particularité
est de trois ordres : l’impérialisme est
-
le capitalisme monopoliste ;
-
le capitalisme parasitaire ou pourrissant ;
-
le capitalisme agonisant.
La substitution du monopole à la libre concurrence est le trait
économique capital, l’essence de l’impérialisme. Le
monopolisme se manifeste sous cinq formes principales :
-
les cartels, les syndicats patronaux, et les trusts ;
la concentration de la production a atteint un degré tel qu’elle a
engendré ces groupements monopolistes de capitalistes ;
-
la situation de monopole des grosses banques : trois a
cinq banques gigantesques régentent toute la vie économique de
l’Amérique, de la France, de l’Allemagne ;
-
l’accaparement des sources de matières premières par
les trusts et l’oligarchie financière (le capital financier est le
capital industriel monopolisé, fusionné avec le capital
bancaire) ;
-
le partage (économique) du monde par les cartels
internationaux a commencé. Ces cartels internationaux,
détenteurs du marché mondial tout entier qu’ils se
partagent « à l’amiable » — tant que la guerre ne l’a
pas repartagé — on en compte déjà plus de cent !
L’exportation des capitaux, phénomène particulièrement
caractéristique, à la différence de l’exportation des
marchandises à l’époque du capitalisme non monopoliste, est en
relation étroite avec le partage économique et
politico-territorial du monde ;
-
le partage territorial du monde (colonies) est terminé.
L’impérialisme, stade suprême du capitalisme d’Amérique et
d’Europe, et ensuite d’Asie, a fini de se constituer vers 1898-1914.
Les guerres hispano-américaine (1898), anglo-boer (1899-1902),
russo-japonaise (1904-1905) et la crise économique de 1900 en
Europe, tels sont les principaux jalons historiques de la nouvelle
époque de l’histoire mondiale.
Que l’impérialisme soit un capitalisme parasitaire ou pourrissant, c’est ce qui apparaît avant tout dans la tendance à la putréfaction qui distingue tout monopole sous le régime de la propriété privée des moyens de production.
La différence entre la bourgeoisie impérialiste démocratique républicaine, d’une part, et réactionnaire monarchiste, d’autre part, s’efface précisément du fait que l’une et l’autre pourrissent sur pied (ce qui n’exclut pas du tout le développement étonnamment rapide du capitalisme dans différentes branches d’industrie, dans différents pays, en différentes périodes).
En second lieu, la putréfaction du capitalisme se manifeste par la formation d’une vaste couche de rentiers, de capitalistes vivant de la « tonte des coupons ». Dans quatre pays impérialistes avancés : l’Angleterre, l’Amérique du Nord, la France et l’Allemagne, le capital en titres est de 100 à 150 milliards de francs, ce qui représente un revenu annuel d’au moins 5 à 8 milliards par pays. En troisième lieu, l’exportation des capitaux est du parasitisme au carré. En quatrième lieu, « le capital financier vise à l’hégémonie, et non à la liberté ».
La réaction politique sur toute la ligne est le propre de l’impérialisme. Vénalité, corruption dans des proportions gigantesques, panamas de tous genres. En cinquième lieu, l’exploitation des nations opprimées, indissolublement liée aux annexions, et surtout l’exploitation des colonies par une poignée de « grandes » puissances, transforme de plus en plus le monde « civilisé » en un parasite sur le corps des peuples non civilisés, qui comptent des centaines de millions d’hommes.
Le prolétaire de Rome vivait aux dépens de la société. La société actuelle vit aux dépens du prolétaire contemporain. Marx a particulièrement souligné cette profonde remarque de Sismondi. L’impérialisme change un peu les choses. Une couche privilégiée du prolétariat des puissances impérialistes vit en partie aux dépens des centaines de millions d’hommes des peuples non civilisés.
On comprend pourquoi l’impérialisme est un capitalisme agonisant,
qui marque la transition vers le socialisme : le monopole qui
surgit du capitalisme, c’est déjà l’agonie du
capitalisme, le début de sa transition vers le socialisme. La
socialisation prodigieuse du travail par l’impérialisme (ce que les
apologistes, les économistes bourgeois, appellent
l’« interpénétration ») a la même signification.
En définissant ainsi l’impérialisme, nous entrons en contradiction complète avec K. Kautsky, qui se refuse à voir dans l’impérialisme une « phase du capitalisme », et le définit comme la politique « préférée » du capital financier, comme une tendance des pays « industriels » à annexer les pays [1] « agraires ».
Du point de vue théorique, cette définition de Kautsky est absolument fausse. La particularité de l’impérialisme, c’est justement la domination du capital non pas industriel, mais financier, la tendance à s’annexer non pas les seuls pays agraires, mais toutes sortes de pays. Kautsky dissocie la politique de l’impérialisme de son économie ; il dissocie le monopolisme en politique du monopolisme dans l’économie, afin de frayer la voie à son réformisme bourgeois : le « désarmement », l’« ultra-impérialisme » et autres sottises du même acabit.
Le sens et le but de cette théorie falsifiée sont uniquement d’estomper les contradictions les plus profondes de l’impérialisme et de justifier ainsi la théorie de l’« unité » avec les apologistes de l’impérialisme, les social-chauvins et opportunistes avoués.
Nous avons déjà suffisamment insisté sur cette rupture de Kautsky avec le marxisme, et dans Le Social-Démocrate, et dans Le Communiste. Nos kautskistes de Russie, les « okistes » avec Axelrod et Spectator en tête, sans en excepter Martov et, dans une notable mesure, Trotski, ont préféré passer sous silence la question du kautskisme en tant que tendance.
N’osant pas défendre ce que Kautsky a écrit pendant la guerre, ils se sont contentés d’exalter purement et simplement Kautsky (Axelrod dans sa brochure allemande que le Comité d’organisation a promis de publier en russe) ou d’invoquer des lettres privées de Kautsky (Spectator), dans lesquelles il assure appartenir à l’opposition et essaie jésuitiquement de faire considérer ses déclarations chauvines comme nulles et non avenues.
Notons que dans sa « conception » de l’impérialisme, qui revient à farder ce dernier, Kautsky marque un recul non seulement par rapport au Capital financier de Hilferding (quel que soit le zèle que mette aujourd’hui Hilferding lui-même à défendre Kautsky et l’ « unité » avec les social-chauvins !), mais aussi par rapport au social-libéral J. A. Hobson.
Cet économiste anglais, qui n’a pas la moindre prétention au titre de marxiste, définit avec beaucoup plus de profondeur l’impérialisme et en dévoile les contradictions dans son ouvrage de 1902 [2]. Voici ce que disait cet auteur (chez qui l’on retrouve presque toutes les platitudes pacifistes et « conciliatrices » de Kautsky) sur la question particulièrement importante du caractère parasitaire de l’impérialisme :
Des circonstances de deux ordres affaiblissaient, selon Hobson, la
puissance des anciens Empires :
-
le « parasitisme économique » et
-
le recrutement d’une armée parmi les peuples dépendants.
« La première circonstance est la coutume du parasitisme
économique, en vertu de laquelle l’Etat dominant utilise ses
provinces, ses colonies et les pays dépendants pour enrichir sa
classe gouvernante et corrompre ses classes inférieures, afin
qu’elles se tiennent tranquilles. »
En ce qui concerne la seconde circonstance, Hobson écrit :
« L’un des symptômes les plus singuliers de la cécité de
l’impérialisme »
(dans la bouche du social-libéral Hobson, ce refrain sur la
« cécité » des impérialistes est moins déplacé que
chez le « marxiste » Kautsky),
« c’est l’insouciance avec laquelle la Grande-Bretagne, la
France et les autres nations impérialistes s’engagent dans cette
voie. La Grande-Bretagne est allée plus loin que toutes les autres.
La plupart des batailles par lesquelles nous avons conquis notre
Empire des Indes ont été livrées par nos troupes indigènes :
dans l’Inde, comme plus récemment aussi en Egypte, de grandes armées
permanentes sont placées sous le commandement des Britanniques ;
presque toutes nos guerres de conquête en Afrique, sa partie Sud
exceptée, ont été faites pour notre compte par les indigènes.»
La perspective du partage de la Chine provoque chez Hobson
l’appréciation économique que voici :
« Une grande partie de l’Europe occidentale pourrait alors prendre l’apparence et le caractère qu’ont maintenant certaines parties des pays qui la composent — le Sud de l’Angleterre, la Riviera, les régions d’Italie et de Suisse les plus fréquentées des touristes et peuplées de gens riches — à savoir : de petits groupes de riches aristocrates recevant des dividendes et des pensions du lointain Orient, avec un groupe un peu plus nombreux d’employés professionnels et de commerçants et un nombre plus important de domestiques et d’ouvriers occupés dans les transports et dans l’industrie travaillant à la finition des produits manufacturés.
Quant aux principales branches d’industrie, elles disparaîtraient, et la grande masse des produits alimentaires et semi-ouvrés affluerait d’Asie et d’Afrique comme un tribut.»
« Telles sont les possibilités que nous offre une plus
large alliance des Etats d’Occident, une fédération européenne des
grandes puissances : loin de faire avancer la civilisation
universelle, elle pourrait signifier un immense danger de parasitisme
occidental aboutissant à constituer un groupe à part de nations
industrielles avancées, dont les classes supérieures recevraient un
énorme tribut de l’Asie et de l’Afrique et entretiendraient, à
l’aide de ce tribut, de grandes masses domestiquées d’employés et
de serviteurs, non plus occupés à produire en grandes quantités
des produits agricoles et industriels, mais rendant des services
privés ou accomplissant, sous le contrôle de la nouvelle
aristocratie financière, des travaux industriels de second ordre.
Que ceux qui sont prêts à tourner le dos à cette théorie »
(il aurait fallu dire : à cette perspective)
« comme ne méritant pas d’être examinée, méditent sur
les conditions économiques et sociales des régions de l’Angleterre
méridionale actuelle, qui en sont déjà arrivées à cette
situation. Qu’ils réfléchissent à l’extension considérable que
pourrait prendre ce système si la Chine était soumise au contrôle
économique de semblables groupes de financiers, de « placeurs
de capitaux » (les rentiers), de leurs fonctionnaires
politiques et de leurs employés de commerce et d’industrie, qui
drainent les profits du plus grand réservoir potentiel que le monde
ait jamais connu afin de les consommer en Europe. Certes, la
situation est trop complexe et le jeu des forces mondiales trop
difficile à escompter pour qu’une prévision — celle-ci ou toute
autre — de l’avenir dans une seule direction puisse être
considérée comme la plus probable. Mais les influences qui
régissent à l’heure actuelle l’impérialisme de l’Europe
occidentale s’orientent dans cette direction, et si elles ne
rencontrent pas de résistance, si elles ne sont pas détournées
d’un autre côté, c’est dans ce sens qu’elles orienteront
l’achèvement de ce processus. »
Le social-libéral Hobson ne voit pas que cette « résistance » ne peut être opposée que par le prolétariat révolutionnaire, et seulement sous la forme d’une révolution sociale. Il n’est pas social-libéral pour rien !
Mais il a fort bien abordé, dès 1902, la question du rôle et de la portée des « Etats-Unis d’Europe » (avis au kautskiste Trotski !), comme aussi de tout ce que cherchent à voiler les kautskistes hypocrites des différents pays, à savoir le fait que les opportunistes (les social-chauvins) font cause commune avec la bourgeoisie impérialiste justement dans le sens de la création d’une Europe impérialiste sur le dos de l’Asie et de l’Afrique ; le fait que les opportunistes apparaissent objectivement comme une partie de la petite bourgeoisie et de certaines couches de la classe ouvrière, soudoyée avec les fonds du surprofit des impérialistes et convertie en chiens de garde du capitalisme, en corrupteurs du mouvement ouvrier.
Nous avons maintes fois signalé, non seulement dans des articles, mais aussi dans des résolutions de notre Parti, cette liaison économique extrêmement profonde de la bourgeoisie impérialiste, très précisément, avec l’opportunisme qui a triomphé aujourd’hui (est-ce pour longtemps ?) du mouvement ouvrier.
Nous en avons inféré, notamment, que la scission avec le social-chauvinisme était inévitable. Nos kautskistes ont préféré éluder la question ! Martov, par exemple, avance depuis un bon moment dans ses conférences un sophisme qui, dans les Izvestia du secrétariat à l’étranger du Comité d’organisation (n° 4 du 10 avril 1916), est énoncé en ces termes :
(…) « La cause de la social-démocratie révolutionnaire
serait très mauvaise, voire désespérée, si les groupes d’ouvriers
qui, par leur développement intellectuel, se sont le plus rapprochés
de l’« intelliguentsia » et sont les plus qualifiés,
abandonnaient fatalement cette dernière pour rejoindre
l’opportunisme »…
An moyen du vocable absurde « fatalement » et d’un certain « escamotage », on élude le fait que certains contingents d’ouvriers ont rallié l’opportunisme et la bourgeoisie impérialiste !
Or éluder ce fait, c’est tout ce que veulent les sophistes du Comité d’organisation ! Ils se retranchent derrière cet « optimisme officiel », dont font aujourd’hui parade et le kautskiste Hilferding et beaucoup d’autres individus : les conditions objectives, prétendent-ils, se portent garantes de l’unité du prolétariat et de la victoire de la tendance révolutionnaire ! Nous sommes, disent-ils, « optimistes » en ce qui concerne le prolétariat !
Mais en réalité tous ces kautskistes, Hilferding, les okistes,
Martov et Cie sont des optimistes… en ce qui
concerne l’opportunisme. Tout est là !
Le prolétariat est un produit du capitalisme, du capitalisme mondial et pas seulement européen, pas seulement impérialiste. A l’échelle mondiale, que ce soit cinquante ans plus tôt ou cinquante ans plus tard, à cette échelle, c’est une question de détail, il est bien évident que le « prolétariat » « sera » uni, et qu’en son sein la social-démocratie révolutionnaire vaincra « inéluctablement ».
Il ne s’agit pas de cela, messieurs les kautskistes, il s’agit du fait que maintenant, dans les pays impérialistes d’Europe, vous rampez à plat ventre devant les opportunistes, qui sont étrangers au prolétariat en tant que classe, qui sont les serviteurs, les agents de la bourgeoisie, les véhicules de son influence ; et s’il ne s’affranchit pas d’eux, le mouvement ouvrier restera un mouvement ouvrier bourgeois.
Votre propagande en faveur de l’« unité » avec les opportunistes, avec les Legien et les David, les Plékhanov ou les Tchkhenkéli, les Potressov, etc., revient objectivement à favoriser l’asservissement des ouvriers par la bourgeoisie impérialiste, à l’aide de ses meilleurs agents au sein du mouvement ouvrier. La victoire de la social-démocratie révolutionnaire à l’échelle mondiale est absolument inévitable, mais elle se poursuit et se poursuivra, elle se fait et se fera uniquement contre vous ; elle sera une victoire sur vous.
Les deux tendances, disons même les deux partis dans le
mouvement ouvrier contemporain, qui se sont si manifestement séparés
dans le monde entier en 1914-1916, ont été observées de près
par Engels et Marx en Angleterre pendant plusieurs dizaines
d’années, de 1858 à 1892 environ.
Ni Marx, ni Engels n’ont vécu jusqu’à l’époque impérialiste du
capitalisme mondial, dont le début ne remonte pas au-delà de
1898-1900. Mais l’Angleterre, dès le milieu du XIX° siècle, avait
ceci de particulier qu’au moins deux traits distinctifs
fondamentaux de l’impérialisme s’y trouvaient réunis :
– d’immenses colonies et
– des profits de monopoles (en raison de sa situation de
monopole sur le marché mondial).
Sous ces deux rapports, l’Angleterre faisait alors exception
parmi les pays capitalistes. Et Engels et Marx, analysant cette
exception, ont montré, d’une façon parfaitement claire et précise
sa liaison avec la victoire (momentanée) de l’opportunisme dans le
mouvement ouvrier anglais.
Dans sa lettre à Marx du 7 octobre 1858, Engels écrivait :
« En réalité, le prolétariat anglais s’embourgeoise de
plus en plus, et il semble bien que cette nation bourgeoise entre
toutes veuille en arriver à avoir, à côté de sa bourgeoise, une
aristocratie bourgeoise et un prolétariat bourgeois. Évidemment, de
la part d’une nation qui exploite le monde entier, c’est jusqu’à un
certain point logique. »
Dans sa lettre à Sorge du 21 septembre 1872, Engels
fait savoir que Hales a provoqué au Conseil fédéral de
l’Internationale un grand esclandre et a fait voter un blâme à Marx
pour avoir dit que « les chefs ouvriers anglais s’étaient
vendus ». Marx écrit à Sorge le 4 août 1874 :
« En ce qui concerne les ouvriers des villes (en
Angleterre), il y a lieu de regretter que toute la bande des chefs ne
soit pas entrée au Parlement. C’eût été le plus sûr moyen de se
débarrasser de cette racaille. »
Dans sa lettre à Marx du 11 août 1881, Engels parle des « pires
trade-unions anglaises, qui se laissent diriger par des hommes que la
bourgeoisie a achetés ou tout au moins payés ». Dans
sa lettre à Kautsky du 12 septembre 1882, Engels écrivait :
« Vous me demandez ce que les ouvriers anglais pensent de la
politique coloniale. Exactement ce qu’ils pensent de la politique en
général. Ici, point de parti ouvrier, il n’y a que des
conservateurs et des radicaux libéraux ; quant aux ouvriers,
ils jouissent en toute tranquillité avec eux du monopole colonial de
l’Angleterre et de son monopole sur le marché mondial. »
Le 7 décembre 1889, Engels écrit à Sorge :
« … Ce qu’il y a de plus répugnant ici (en Angleterre),
c’est la « respectabilité » (respectability)
bourgeoise, qui pénètre jusque dans la chair des ouvriers… même
Tom Mann, que je considère comme le meilleur de tous, confie
très volontiers qu’il déjeunera avec le lord-maire. Lorsqu’on fait
la comparaison avec les Français, on voit ce que c’est que la
révolution.»
Dans une lettre du 19 avril 1890 :
« le mouvement (de la classe ouvrière en Angleterre)
progresse sous la surface, il gagne des couches de plus en plus
larges, et surtout parmi la masse inférieure (souligné par Engels)
jusque-là immobile. Le jour n’est pas loin où cette masse se
retrouvera elle-même, où elle aura compris que c’est elle,
précisément, qui est cette masse colossale en mouvement ».
Le 4 mars 1891 :
« l’échec de l’union des dockers qui s’est désagrégée ;
les « vieilles » trade-unions conservatrices, riches et
partant poltronnes, restent seules sur le champ de bataille »…
Le 14 septembre 1891 : au congrès des trade-unions à
Newcastle, ont été vaincus les vieux unionistes, adversaires
de la journée de huit heures, « et les journaux
bourgeois avouent la défaite du parti ouvrier
bourgeois »(souligné partout par Engels)…
Que ces pensées d’Engels, reprises pendant des dizaines d’années,
aient aussi été formulées par lui publiquement, dans la presse,
c’est ce que prouve sa préface à la deuxième édition
(1892) de La situation des classes laborieuses en Angleterre. Il
y traite de « l’aristocratie de la classe ouvrière »,
de la « minorité privilégiée des ouvriers »,
qu’il oppose à la « grande masse des ouvriers ».
« La petite minorité privilégiée et protégée »
de la classe ouvrière bénéficiait seule des « avantages
durables » de la situation privilégiée de l’Angleterre
en 1848-1868 ;
« la grande masse, en mettant les choses au mieux, ne
bénéficiait que d’améliorations de courte durée »…
« Avec l’effondrement du monopole industriel de
l’Angleterre, la classe ouvrière anglaise perdra sa situation
privilégiée … »
Les membres des « nouvelles » unions, des syndicats
d’ouvriers non spécialisés,
« ont un avantage inappréciable : leur mentalité est
un terrain encore vierge, parfaitement libre du legs des
« respectables » préjugés bourgeois, qui désorientent
les esprits des « vieux unionistes » mieux placés »
… Les « prétendus représentants ouvriers », en
Angleterre, sont des gens « à qui ou pardonne leur
appartenance à la classe ouvrière, parce qu’ils sont eux-mêmes
prêts à noyer cette qualité dans l’océan de leur libéralisme »…
C’est à dessein que nous avons reproduit des extraits assez
abondants des déclarations on ne peut plus explicites de Marx et
d’Engels, afin que les lecteurs puissent les étudier dans
leur ensemble. Et il est indispensable de les étudier, il vaut
la peine d’y réfléchir attentivement. Car là est le nœud de la
tactique imposée au mouvement ouvrier par les conditions objectives
de l’époque impérialiste.
Là encore Kautsky a déjà essayé de « troubler l’eau » et de substituer au marxisme une conciliation mielleuse avec les opportunistes.
Dans une polémique avec les social-impérialistes déclarés et naïfs (dans le genre de Lensch) qui justifient la guerre du côté de l’Allemagne comme une destruction du monopole de l’Angleterre, Kautsky « rectifie » cette contre-vérité évidente au moyen d’une autre contre-vérité, non moins évidente. Il remplace la contre-vérité cynique par une contre-vérité doucereuse ! Le monopole industriel de l’Angleterre, dit-il, est depuis longtemps brisé, depuis longtemps détruit, il n’est ni nécessaire ni possible de le détruire.
En quoi cet argument est-il faux ?
En ce que, premièrement, il passe sous silence le monopole colonial de l’Angleterre. Or, comme nous l’avons vu, Engels a soulevé cette question d’une façon parfaitement claire dès 1882, c’est-à-dire il y a 34 ans ! Si le monopole industriel de l’Angleterre est détruit, le monopole colonial non seulement demeure, mais a entraîné de graves complications, car tout le globe terrestre est déjà partagé !
A la faveur de son mensonge mielleux, Kautsky fait passer subrepticement sa petite idée pacifiste bourgeoise et petite-bourgeoise opportuniste selon laquelle il n’y aurait « aucune raison de faire la guerre ».
Au contraire, non seulement les capitalistes ont maintenant une raison de faire la guerre, mais il leur est impossible de ne pas la faire s’ils veulent sauvegarder le capitalisme ; car, sans procéder à un repartage des colonies par la violence, les nouveaux pays impérialistes ne peuvent obtenir les privilèges dont jouissent les puissances impérialistes plus vieilles (et moins fortes).
Deuxièmement. Pourquoi le monopole de l’Angleterre explique-t-il la victoire (momentanée) de l’opportunisme dans ce pays ? Parce que le monopole fournit un surprofit, c’est-à-dire un excédent de profit par rapport au profit capitaliste normal, ordinaire dans le monde entier.
Les capitalistes peuvent sacrifier une parcelle (et même assez grande !) de ce surprofit pour corrompre leurs ouvriers, créer quelque chose comme une alliance (rappelez-vous les fameuses « alliances » des trade-unions anglaises avec leurs patrons, décrites par les Webb), une alliance des ouvriers d’une nation donnée avec leurs capitalistes contre les autres pays. Le monopole industriel de l’Angleterre a été détruit dès la fin du XIX° siècle. Cela est incontestable. Mais comment cette destruction s’est-elle opérée ? Aurait-elle entraîné la disparition de tout monopole ?
S’il en était ainsi, la « théorie » de la conciliation (avec l’opportunisme) de Kautsky recevrait une certaine justification. Mais ce n’est justement pas le cas. L’impérialisme est le capitalisme monopoliste. Chaque cartel, trust, syndicat patronal, chaque banque géante, est un monopole. Le surprofit n’a pas disparu, il subsiste.
L’exploitation par un seul pays privilégié, financièrement riche, de tous les autres pays demeure et se renforce. Une poignée de pays riches — ils ne sont que quatre en tout, si l’on veut parler de la richesse « moderne », indépendante et véritablement prodigieuse : l’Angleterre, la France, les Etats-Unis et l’Allemagne — ont développé les monopoles dans d’immenses proportions, reçoivent un surprofit se chiffrant par centaines de millions sinon par milliards, « chevauchent sur l’échine » de centaines et de centaines de millions d’habitants des autres pays, et luttent entre eux pour le partage d’un butin particulièrement abondant, particulièrement gras et de tout repos.
Là est justement l’essence économique et politique de
l’impérialisme, dont Kautsky cherche à estomper les très profondes
contradictions, au lieu de les dévoiler.
La bourgeoisie d’une « grande » puissance impérialiste peut, économiquement, soudoyer les couches supérieures de « ses » ouvriers en sacrifiant à cette fin quelque cent ou deux cent millions de francs par an, car son surprofit s’élève probablement à près d’un milliard.
Et la question de savoir comment cette petite aumône est partagée entre ouvriers-ministres, « ouvriers-députés » (rappelez-vous l’excellente analyse donnée de cette notion par Engels), ouvriers-membres des comités des industries de guerre, ouvriers-fonctionnaires, ouvriers organisés en associations étroitement corporatives, employés, etc., etc., c’est là une question secondaire.
De 1848 à 1868, et aussi partiellement plus tard, l’Angleterre
était seule à bénéficier du monopole ; c’est
pourquoi l’opportunisme a pu y triompher des dizaines d’années
durant ; il n’y avait pas d’autres pays possédant de riches
colonies ou disposant d’un monopole industriel.
Le dernier tiers du XIX° siècle a marqué le passage à une nouvelle époque, celle de l’impérialisme. Le capital financier bénéficie d’une situation de monopole non pas dans une seule, mais dans plusieurs grandes puissances, très peu nombreuses. (Au Japon et, en Russie, le monopole de la force militaire, l’immensité du territoire ou des commodités particulières de spoliation des allogènes, de la Chine, etc., suppléent en partie, remplacent en partie le monopole du capital financier contemporain, moderne.)
Il résulte de cette différence que le monopole de l’Angleterre a pu demeurer incontesté pendant des dizaines d’années. Le monopole du capital financier actuel est furieusement disputé ; l’époque des guerres impérialistes a commencé.
Autrefois l’on pouvait soudoyer, corrompre pour des dizaines d’années la classe ouvrière de tout un pays. Aujourd’hui, ce serait invraisemblable, voire impossible ; par contre, chaque « grande » puissance impérialiste peut soudoyer et soudoie des couches moins nombreuses (que dans l’Angleterre des années 1848 à 1868) de l’« aristocratie ouvrière ». Autrefois, un « parti ouvrier bourgeois », selon l’expression remarquablement profonde d’Engels, ne pouvait se constituer que dans un seul pays, attendu qu’il était seul à détenir le monopole, mais en revanche pour longtemps.
Aujourd’hui, « le parti ouvrier bourgeois » est inévitable et typique pour tous les pays impérialistes ; mais, étant donné leur lutte acharnée pour le partage du butin, il est improbable qu’un tel parti puisse triompher pour longtemps dans plusieurs pays. Car les trusts, l’oligarchie financière, la vie chère, etc., en permettant de corrompre de petits groupes de l’aristocratie ouvrière, écrasent, oppriment, étouffent et martyrisent de plus en plus la masse du prolétariat et du semi-prolétariat.
D’une part, la tendance de la bourgeoisie et des opportunistes à transformer une poignée de très riches nations privilégiées en parasites « à perpétuité » vivant sur le corps du reste de l’humanité, à « s’endormir sur les lauriers » de l’exploitation des Noirs, des Indiens, etc., en les maintenant dans la soumission à l’aide du militarisme moderne pourvu d’un excellent matériel d’extermination.
D’autre part, la tendance des masses, opprimées plus que par le passé et subissant toutes les affres des guerres impérialistes, à secouer ce joug, à jeter bas la bourgeoisie. C’est dans la lutte entre ces deux tendances que se déroulera désormais inéluctablement l’histoire du mouvement ouvrier. Car la première tendance n’est pas fortuite : elle est économiquement « fondée ».
La bourgeoisie a déjà engendré et formé à son service des « partis ouvriers bourgeois » de social-chauvins dans tous les pays. Il n’y à aucune différence essentielle entre un parti régulièrement constitué comme, par exemple, celui de Bissolati en Italie, parti parfaitement social-impérialiste, et, disons, le pseudo-parti à demi constitué des Potressov, Gvozdev, Boulkine, Tchkhéidzé. Skobelev et Cie. Ce qui importe, c’est que, du point de vue économique, le rattachement de l’aristocratie ouvrière à la bourgeoisie est parvenu à sa maturité et s’est achevé ; quant à la forme politique, ce fait économique, ce changement des rapports de classe s’en trouvera une sans trop de « difficulté ».
Sur la base économique indiquée, les institutions politiques du capitalisme moderne — la presse, le Parlement, les syndicats, les congrès, etc. — ont créé à l’intention des ouvriers et des employés réformistes et patriotes, respectueux et bien sages, des privilèges et des aumônes politiques correspondant aux privilèges et aux aumônes économiques.
Les sinécures lucratives et de tout repos dans un ministère ou au comité des industries de guerre, au Parlement et dans diverses commissions, dans les rédactions de « solides » journaux légaux ou dans les directions de syndicats ouvriers non moins solides et « d’obédience bourgeoise », voilà ce dont use la bourgeoisie impérialiste pour attirer et récompenser les représentants et les partisans des « partis ouvriers bourgeois ».
Le mécanisme de la démocratie politique joue dans le même sens. Il n’est pas question, au siècle où nous sommes, de se passer d’élections ; on ne saurait se passer des masses ; or, à l’époque de l’imprimerie et du parlementarisme, on ne peut entraîner les masses derrière soi sans un système largement ramifié, méthodiquement organisé et solidement outillé de flatteries, de mensonges, d’escroqueries, de jongleries avec des mots populaires à la mode, sans promettre à droite et à gauche toutes sortes de réformes et de bienfaits aux ouvriers, pourvu qu’ils renoncent à la lutte révolutionnaire pour la subversion de la bourgeoisie.
Je qualifierais ce système de Lloydgeorgisme, du nom d’un des représentants les plus éminents et les plus experts de ce système dans le pays classique du « parti ouvrier bourgeois », le ministre. anglais Lloyd George. Brasseur d’affaires bourgeois de premier ordre et vieux flibustier de la politique, orateur populaire, habile à prononcer n’importe quel discours, même rrrévolutionnaire, devant un auditoire ouvrier, et capable de faire accorder de coquettes aumônes aux ouvriers obéissants sous l’aspect de réformes sociales (assurances, etc.), Lloyd George sert à merveille la bourgeoisie [3] ; et il la sert justement parmi les ouvriers, il propage son influence justement au sein du prolétariat, là où il est le plus nécessaire et le plus difficile de s’assurer une emprise morale sur les masses.
Et y a-t-il une grande différence entre Lloyd George et les Scheidemann, les Legien, les Henderson et les Hyndman, les Plékhanov, les Renaudel et consorts ? Parmi ces derniers, nous objectera-t-on, il en est qui reviendront au socialisme révolutionnaire de Marx.
C’est possible, mais c’est là une différence de degré insignifiante si l’on considère la question sur le plan politique, c’est-à-dire à une échelle de masse. Certains personnages parmi les chefs social-chauvins actuels peuvent revenir au prolétariat. Mais le courant social-chauvin ou (ce qui est la même chose) opportuniste ne peut ni disparaître, ni « revenir » au prolétariat révolutionnaire. Là où le marxisme est populaire parmi les ouvriers, ce courant politique, ce « parti ouvrier bourgeois », invoquera avec véhémence le nom de Marx.
On ne peut le leur interdire, comme on ne peut interdire à une firme commerciale de faire usage de n’importe quelle étiquette, de n’importe quelle enseigne ou publicité. On a toujours vu, au cours de l’histoire, qu’après la mort de chefs révolutionnaires populaires parmi les classes opprimées, les ennemis de ces chefs tentaient d’exploiter leur nom pour duper ces classes.
C’est un fait que les « partis ouvriers bourgeois », en tant que phénomène politique, se sont déjà constitués dans tous les pays capitalistes avancés, et que sans une lutte décisive et implacable, sur toute la ligne, contre ces partis ou, ce qui revient au même, contre ces groupes, ces tendances, etc., il ne saurait être question ni de lutte contre l’impérialisme, ni de marxisme, ni de mouvement ouvrier socialiste. La fraction Tchkhéidzé, Naché Diélo, Golos Trouda en Russie et les « okistes » à l’étranger, ne sont rien de plus qu’une variété d’un de ces partis.
Nous n’avons pas la moindre raison de croire que ces partis puissent disparaître avant la révolution sociale. Au contraire, plus cette révolution se rapprochera, plus puissamment elle s’embrasera, plus brusques et plus vigoureux seront les tournants et les bonds de son développement, et plus grand sera, dans le mouvement ouvrier, le rôle joué par la poussée du flot révolutionnaire de masse contre le flot opportuniste petitbourgeois. Le kautskisme ne représente aucun courant indépendant ; il n’a de racines ni dans les masses, ni dans la couche privilégiée passée à la bourgeoisie.
Mais le kautskisme est dangereux en ce sens qu’utilisànt l’idéologie du passé, il s’efforce de concilier le prolétariat avec le « parti ouvrier bourgeois », de sauvegarder l’unité du prolétariat avec ce parti et d’accroître ainsi le prestige de ce dernier. Les masses ne suivent plus les social-chauvins déclarés ; Lloyd George a été sifflé en Angleterre dans des réunions ouvrières ; Hyndman a quitté le parti ; les Renaudel et les Scheidemann, les Potressov et les Gvozdev sont protégés par la police. Rien n’est plus dangereux que la défense déguisée des social-chauvins par les kautskistes.
L’un des sophismes kautskistes les plus répandus consiste à se référer aux « masses ». Nous ne voulons pas, prétendent-ils, nous détacher des masses et des organisations de masse ! Mais réfléchissez à la façon dont Engels pose la question. Les « organisations de masse » des trade-unions anglaises étaient au XIX° siècle du côté du parti ouvrier bourgeois.
Marx et Engels ne recherchaient pas pour autant une conciliation avec ce dernier, mais le dénonçaient. Ils n’oubliaient pas, premièrement, que les organisations des trade-unions englobent directement une minorité du prolétariat. Dans l’Angleterre d’alors comme dans l’Allemagne d’aujourd’hui, les organisations ne rassemblent pas plus de 1/5 du prolétariat.
On ne saurait penser sérieusement qu’il soit possible, en régime capitaliste, de faire entrer dans les organisations la majorité des prolétaires. Deuxièmement, et c’est là l’essentiel, il ne s’agit pas tellement du nombre des adhérents à l’organisation que de la signification réelle, objective, de sa politique : cette politique représente-t-elle les masses, sert-elle les masses, c’est-à-dire vise-t-elle à les affranchir du capitalisme, ou bien représente-t-elle les intérêts de la minorité, sa conciliation avec le capitalisme ? C’est précisément cette dernière conclusion qui était vraie pour l’Angleterre du XIX° siècle, et qui est vraie maintenant pour l’Allemagne, etc.
Engels distingue entre le « parti ouvrier bourgeois »
des vieilles trade-unions, la minorité privilégiée, et
la « masse inférieure », la majorité véritable ;
il en appelle à cette majorité qui n’est pas contaminée
par la « respectabilité bourgeoise ». Là est le fond de
la tactique marxiste !
Nous ne pouvons — et personne ne peut — prévoir quelle est au juste la partie du prolétariat qui suit et suivra les social-chauvins et les opportunistes. Seule la lutte le montrera, seule la révolution socialiste, en décidera finalement.
Mais ce que nous savons pertinemment, c’est que les « défenseurs de la patrie » dans la guerre, impérialiste ne représentent qu’une minorité. Et notre devoir, par conséquent, si nous voulons rester des socialistes, est d’aller plus bas et plus profond, vers les masses véritables : là est toute la signification de la lutte contre l’opportunisme et tout le contenu de cette lutte.
En montrant que les opportunistes et les social-chauvins trahissent en fait lés intérêts de la masse, défendant les privilèges momentanés d’une minorité d’ouvriers, propagent les idées et l’influence bourgeoises et sont en fait les alliés et les agents de la bourgeoisie, nous apprenons aux masses à discerner leurs véritables intérêts politiques et à lutter pour le socialisme et la révolution à travers les longues et douloureuses péripéties des guerres impérialistes et des armistices impérialistes.
Expliquer aux masses que la scission avec l’opportunisme est
inévitable et nécessaire, les éduquer pour la révolution par une
lutte implacable contre ce dernier, mettre à profit l’expérience de
la guerre pour dévoiler toutes les ignominies de la politique
ouvrière nationale libérale au lieu de les camoufler : telle
est la seule ligne marxiste dans le mouvement ouvrier mondial.
Dans notre prochain article, nous essaierons de résumer les
principaux caractères distinctifs de cette ligne, en l’opposant au
kautskisme.
Notes
[1] « L’impérialisme est un produit du capitalisme
industriel hautement évolué. Il consiste dans la tendance de toute
nation capitaliste industrielle à se soumettre et à s’adjoindre des
régions agraires toujours plus nombreuses sans égard aux nations
qui les habitent » (Kautsky, dans la Neue Zeit du
11.IX.1914).
[2] J. A. Hobson ; Imperialism, London 1902.
[3] Récemment, dans une revue anglaise, j’ai trouvé l’article d’un tory, adversaire politique de Lloyd George : « Lloyd George vu par un tory. » La guerre a ouvert les yeux à cet adversaire et lui a montré quel parfait commis de la bourgeoisie est ce Lloyd George ! Les tories ont fait la paix avec lui !
=>Revenir aux œuvres de Lénine