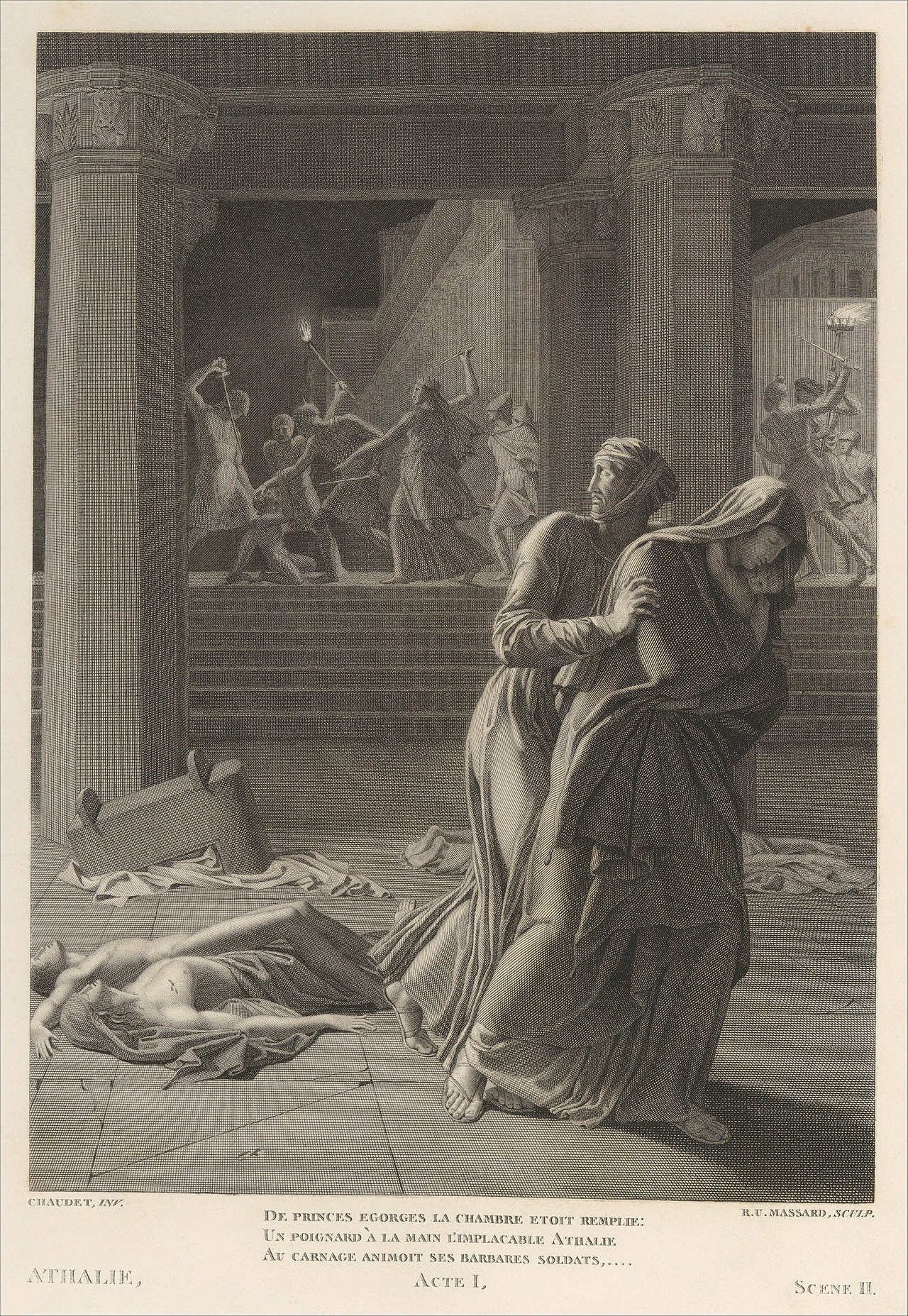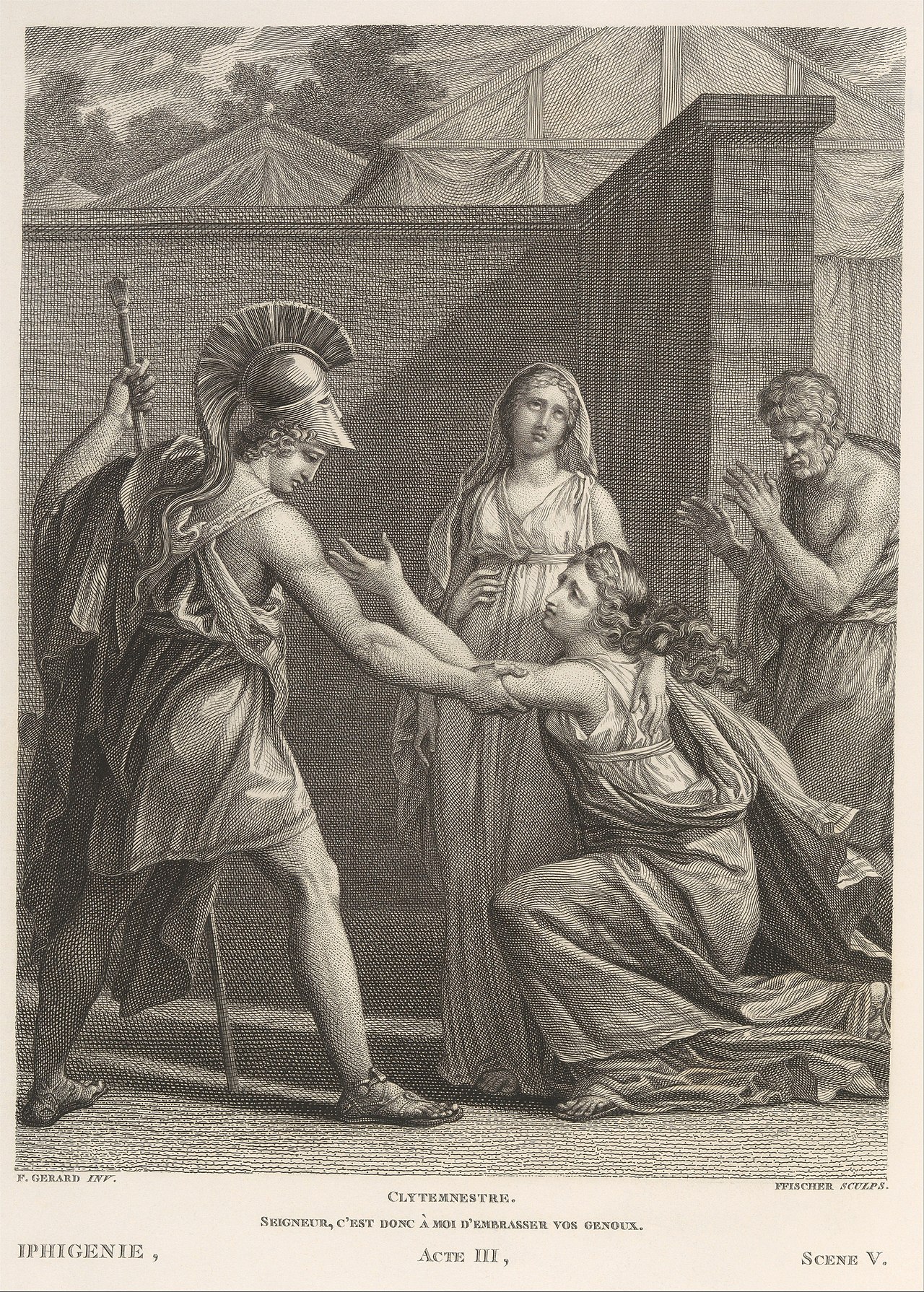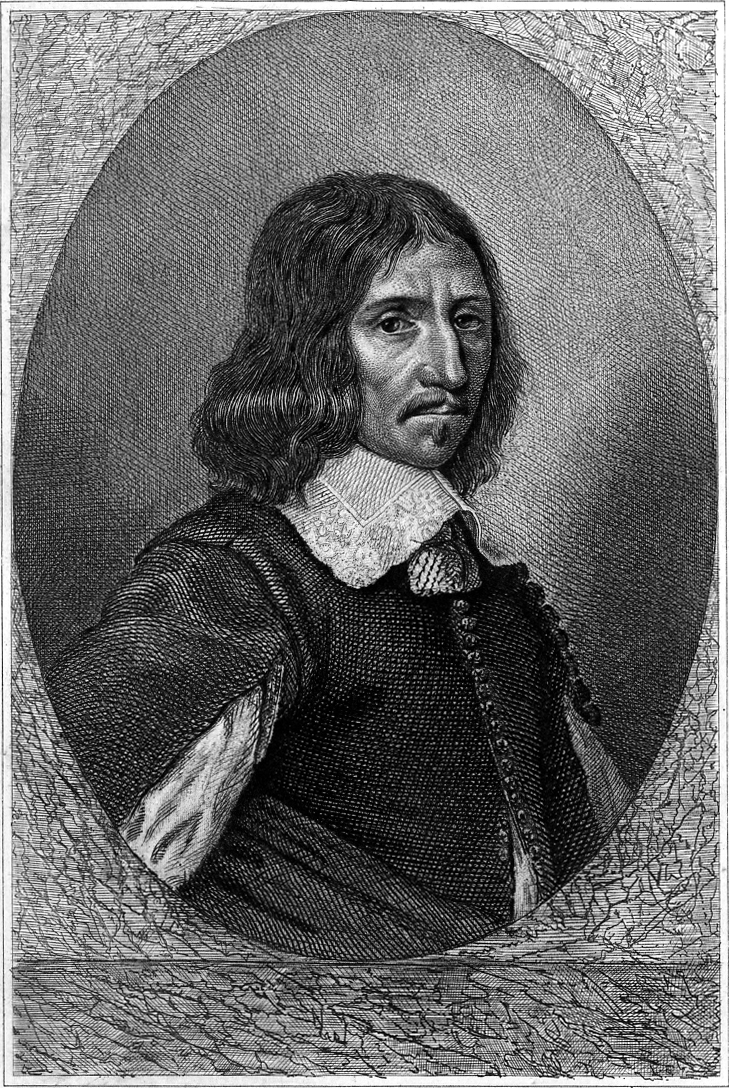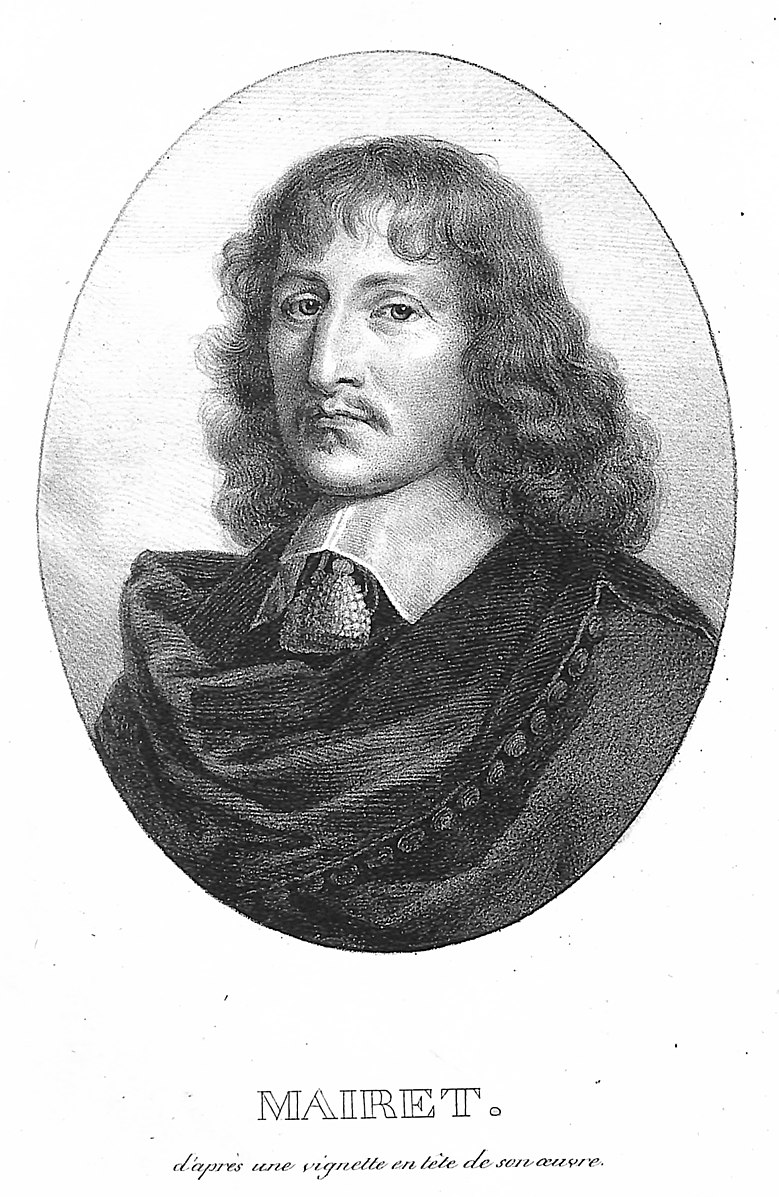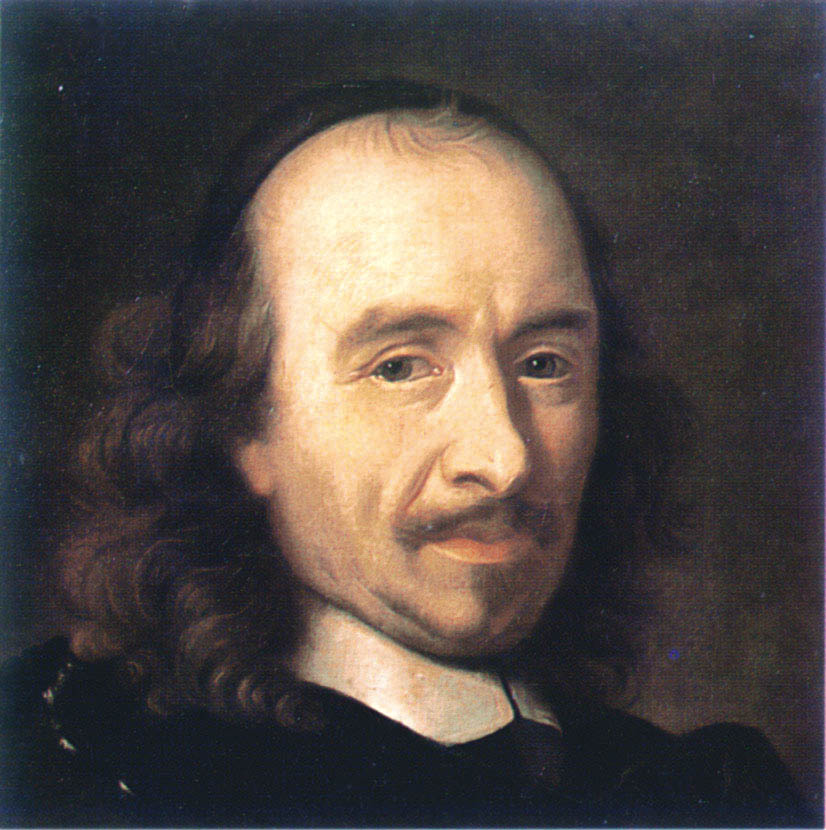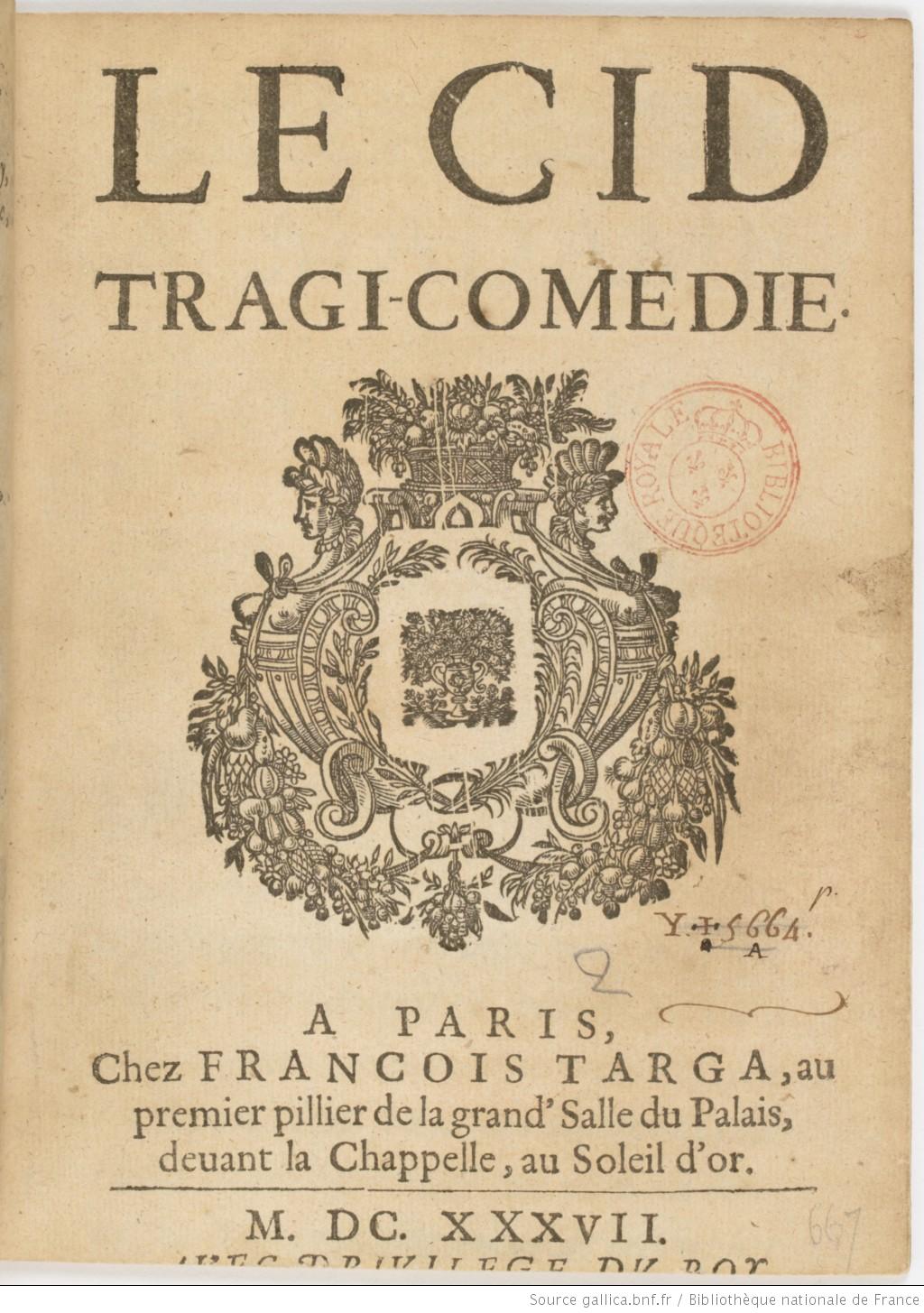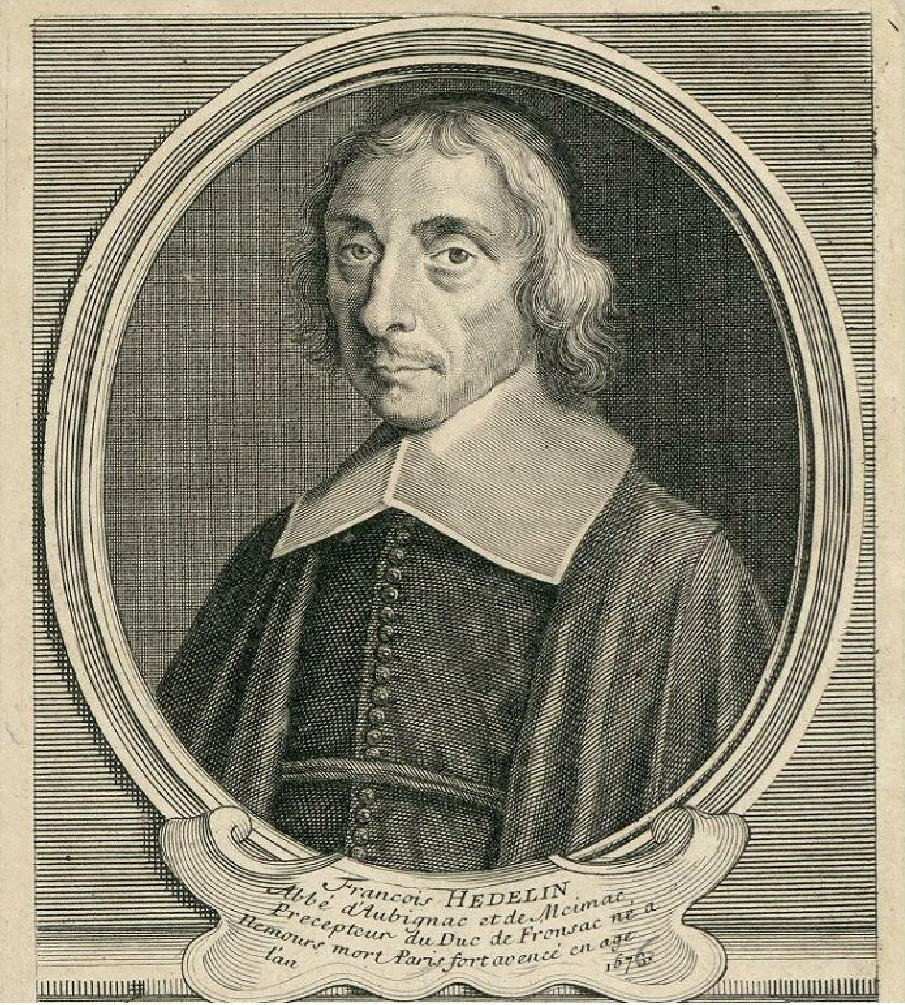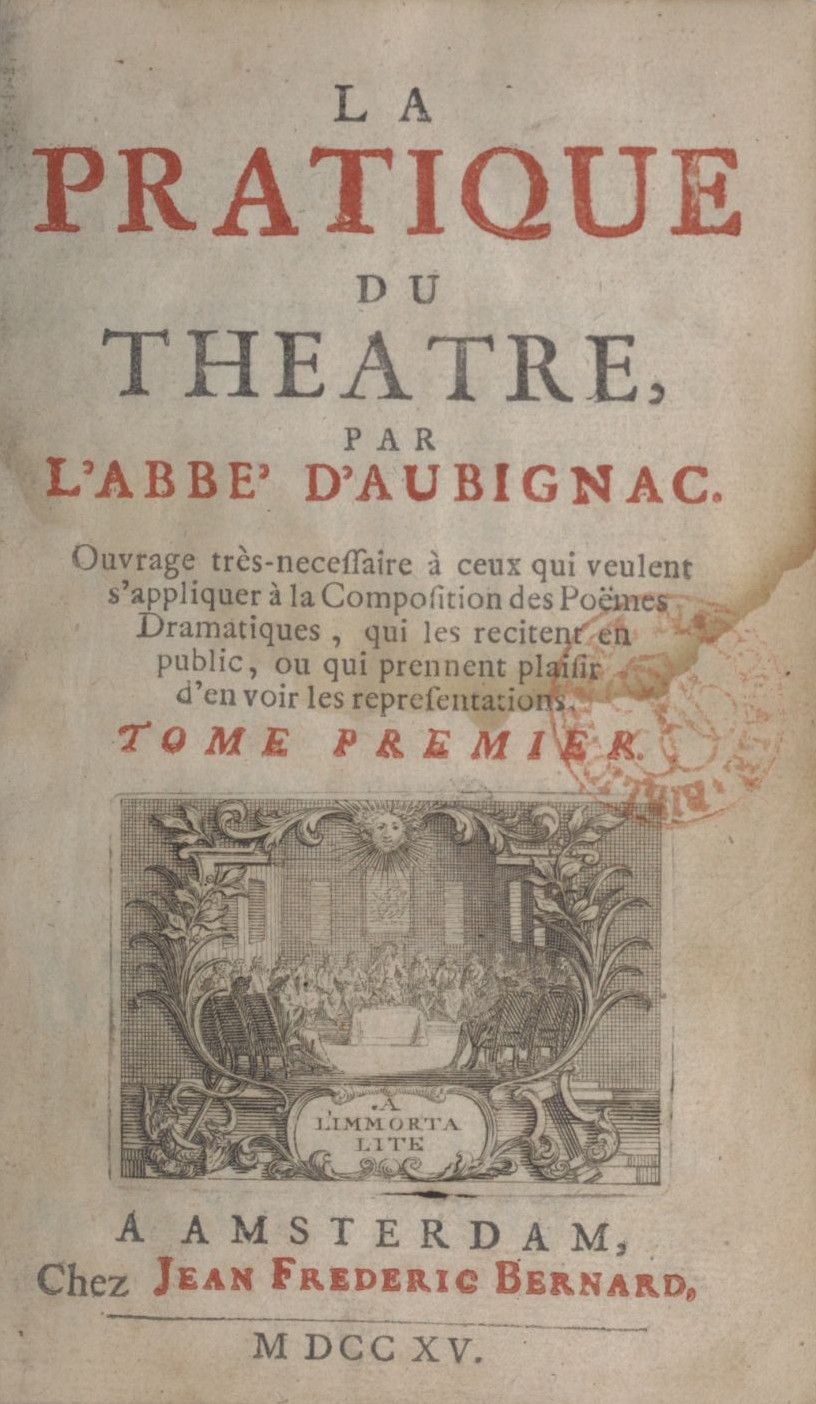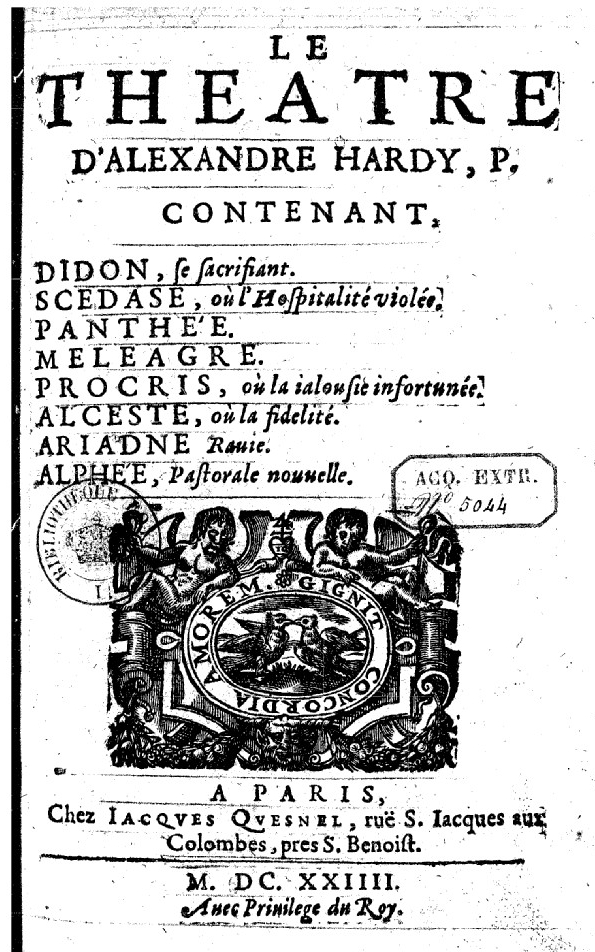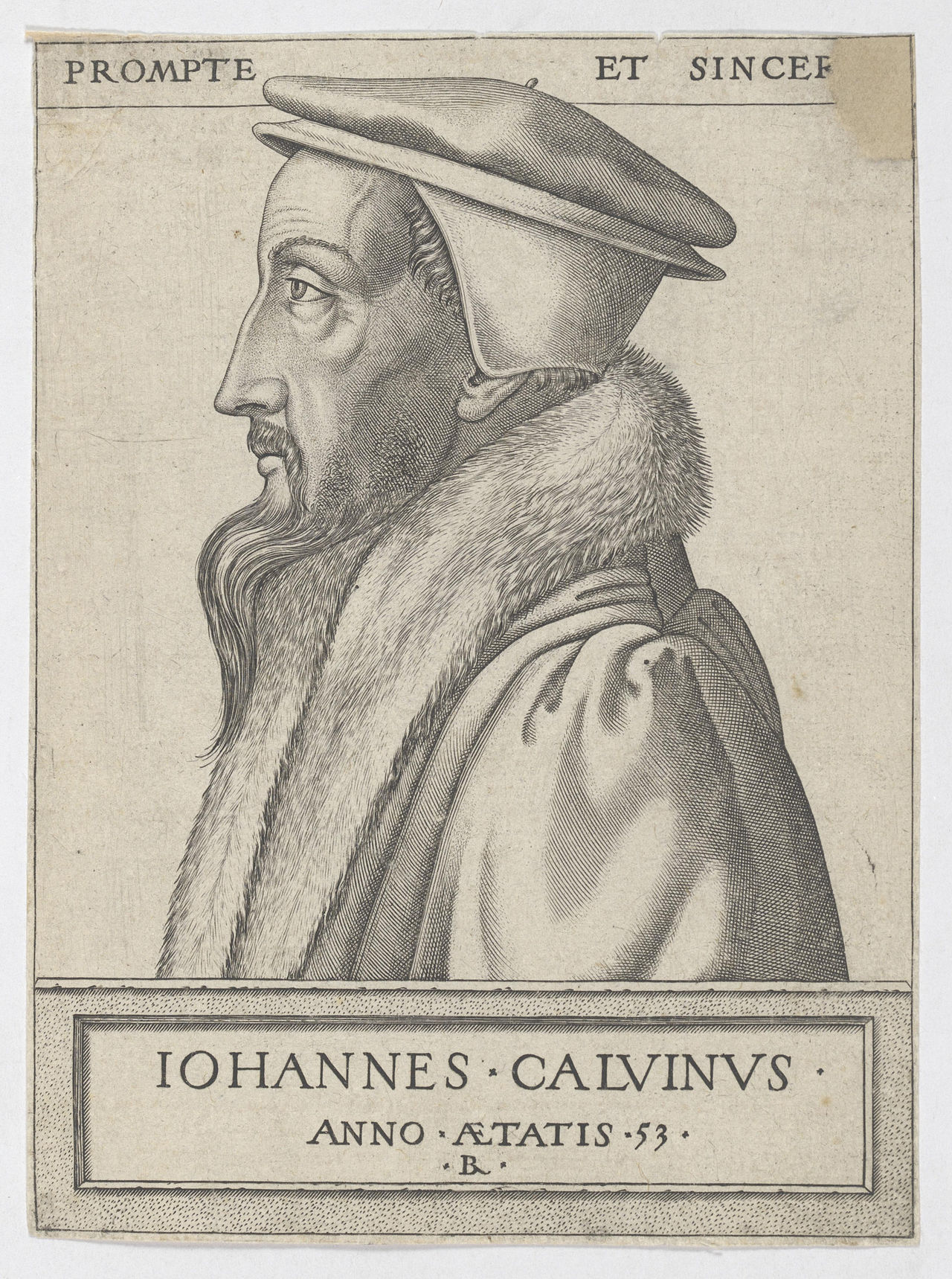Prologue
Puis que la terre (ô Roy, des Rois la crainte),
Qui ne refuse estre à tes loix estrainte,
De la grandeur de ton sainct nom s’estonne,
Qu’elle a gravé dans sa double colonne ;
Puis que la mer, qui te fait son Neptune, (5)
Bruit en ses flots ton heureuse fortune,
Et que le ciel riant à ta victoire
Se voit mirer au parfait de ta gloire,
Pourroyent vers toi les Muses telles estre,
De n’adorer et leur pere et leur maistre ? (10)
Pourroyent les tiens nous celer tes loüanges,
Qu’on oit tonner par les peuples estranges ?
Nul ne sçaurait tellement envers toy
Se rendre ingrat, qu’il ne chante son Roy.
Les bons esprits que ton père forma, (15)
Qui les neuf Sœurs en France ranima,
Du pere et fils se pourroient ils bien taire,
Quand à tous deux telle chose a peu plaire,
Lors que le temps nous aura presenté
Ce qui sera digne d’estre chanté (20)
D’un si grand Prince, ains d’un Dieu dont la place
Se voit au Ciel ja monstrer son espace ?
Et si ce temps qui toute chose enfante,
Nous eust offert ta gloire triomphante,
Pour assez tost de nous estre chantee (25)
Et maintenant à tes yeux presentee,
Tu n’orrois point de nos bouches sinon
Du grand HENRY le triomphe et le nom,
Mais pour autant que ta gloire entendue
En peu de temps ne peut estre rendue, (30)
Que dis-je en peu ? mais en cent mille annees
Ne seroyent pas tes louanges bornees,
Nous t’apportons (ô bien petit hommage)
Ce bien peu d’œuvre ouvré de ton langage,
Mais tel pourtant que ce langage tien (35)
N’avoit jamais dérobbé ce grand bien
Des autheurs vieux : c’est une Tragedie,
Qui d’une voix et plaintive et hardie
Te presente un Romain, Marc-Antoine,
Et Cleopatre, Egyptienne Roine : (40)
Laquelle apres qu’Antoine son ami
Estant desja vaincu par l’ennemi,
Se fust tué, ja se sentant captive,
Et qu’on vouloit la porter toute vive
En triomphe avecques ses deux femmes, (45)
S’occit. Ici les desirs et les flammes
Des deux amans ; d’Octavian aussi
L’orgueil, l’audace et le journel souci
De son trophee emprains tu sonderas,
Et plus qu’à luy le tien egaleras : (50)
Veu qu’il faudra que ses successeurs mesmes
Cedent pour toy aux volontez supremes,
Qui ja le monde à ta couronne voüent,
Et le commis de tous les Dieux t’avoüent.
Recoy donc (SIRE) et d’un visage humain (55)
Prens ce devoir de ceux qui sous ta main
Tant les esprits que les corps entretiennent,
Et devant toy agenouiller se viennent,
En attendant que mieux nous te chantions,
Et qu’à tes yeux sainctement presentions (60)
Ce que ja chante à toy, le fils des Dieux,
La terre toute, et la mer, et les Cieux.
Acte I
L’OMBRE D’ANTOINE
Dans le val tenebreux, où les nuicts eternelles
Font eternelle peine aux ombres criminelles,
Cedant à mon destin je suis volé n’aguere,
Ja ja fait compagnon de la troupe legere,
Moy (dy-je) Marc Antoine horreur de la grand’ Romme, (5)
Mais en ma triste fin cent fois miserable homme.
Car un ardent amour, bourreau de mes mouëlles,
Me devorant sans fin sous ses flames cruelles,
Avoit esté commis par quelque destinee
Des Dieux jaloux de moy, à fin que terminee (10)
Fust en peine et malheur ma pitoyable vie,
D’heur, de joye et de biens paravant assouvie.
O moy des lors chetif, que mon œil trop folastre
S’égara dans les yeux de ceste Cleopatre !
Depuis ce seul moment je senti bien ma playe, (15)
Descendre par l’œil traistre en l’ame encore gaye,
Ne songeant point alors quelle poison extreme
J’avois ce jour receu au plus creux de moymesme :
Mais helas ! en mon dam, las ! en mon dam et perte
Ceste playe cachee en fin fut découverte, (20)
Me rendant odieux, foulant ma renommee
D’avoir enragément ma Cleopatre aimee :
Et forcené aprés comme si cent furies
Exerçans dedans moy toutes bourrelleries,
Embrouillans mon cerveau, empestrant mes entrailles, (25)
M’eussent fait le gibier des mordantes tenailles :
Dedans moy condamné, faisans sans fin renaistre
Mes tourmens journaliers, ainsi qu’on vois repaistre
Sur le Caucase froid la poitrine empietee,
Et sans fin renaissante, à son vieil Promethee. (30)
Car combien qu’elle fust Royne et race royale,
Comme tout aveuglé sous cette ardeur fatale,
Je luy fis les presens qui chacun estonnerent,
Et qui ja contre moy ma Romme eguillonnerent :
Mesme le fier Cesar, ne taschant qu’à deffaire (35)
Celuy qui à Cesar compagnon ne peult plaire,
S’embrassant pour un crime indigne d’un Antoine,
Qui tramoit le malheur encouru pour ma Roine,
Et qui encor au val des durables tenebres
Me va renouvellant mille plaintes funebres, (40)
Eschauffant les serpens des sœurs echevelees,
Qui ont au plus chetif mes peines egalees :
C’est que ja ja charmé, enseveli des flames,
Ma femme Octavienne, honneur des autres Dames,
Et mes mollets enfans je vins chasser arriere, (45)
Nourrissant en mon sein ma serpente meurdriere,
Qui m’entortillonnant, trompant l’ame ravie,
Versa dans ma poitrine un venin de ma vie,
Me transformant ainsi sous ses poisons infuses,
Qu’on seroit du regard de cent mille Meduses. (50)
Or pour punir ce crime horriblement infame
D’avoir banni les miens, et rejetté ma femme,
Les Dieux ont à mon chef la vengeance avancee,
Et dessus moy l’horreur de leurs bras élancee,
Dans la saincte equité, bien qu’elle soit tardive,(55)
Ayant les pieds de laine, elle n’est point oisive,
Ainsi dessus les humains d’heure en heure regarde,
Et d’une main de fer son trait enflammé darde.
Car tost apres Cesar jure contre ma teste,
Et mon piteux exil de ce monde m’appreste. (60)
Me voila ja croyant ma Roine, ains ma ruine,
Me voila bataillant en la plaine marine,
Lors que plus fort j’estois sur la solide terre,
Me voila ja fuyant oublieux de la guerre,
Pour suivre Cleopatre, en faisant l’heur des armes (65)
Ceder à ce malheur des amoureux alarmes.
Me voila dans sa ville ou j’yvrongne et putace,
Me paissant des plaisirs, pendant que Cesar trace
Son chemin devers nous, pendant qu’il a l’armee
Que sus terre j’avois, d’une gueule affamee, (70)
Ainsi que le Lyon vagabond à la queste,
Me voulant devorer, et pendant qu’il s’appreste
Son camp devant la ville, où bientost il refuse
De me faire un parti, tant que malheureux j’use
Du malheureux remede, et poussant mon espee (75)
Au travers des boyaux en mon sang l’ay trempee,
Me donnant guarison par l’outrageuse playe.
Mais avant que mourir, avant que du tout j’aye
Sangloté mes esprits, las, las ! quel si dur homme
Eust peu voir sans pleurer un tel honneur de Romme, (80)
Un tel dominateur, un Empereur Antoine,
Que ja frappé à mort sa miserable Roine,
De deux femmes aidee, angoisseusement palle
Tiroit par la fenestre en sa chambre royale !
Cesar mesme n’eust peu regarder Cleopatre (85)
Couper sur moi son poil, se deschirer et battre,
Et moi la consoler avecques ma parole,
Ma pauvre ame soufflant qui tout soudain s’en vole,
Pour aux sombres enfers endurer plus de rage
Que celui qui a soif au milieu du breuvage, (90)
Ou que celuy qui roüe une peine eternelle,
Ou que les palles Sœurs, dont la dextre cruelle
Egorgea les maris, ou que celuy qui vire
Sa pierre, sans porter son faix où il aspire.
Encore en mon tourment tout seul je ne puis estre : (95)
Avant que ce Soleil qui vient ore de naistre,
Ayant tracé son jour chez sa tante se plonge,
Cleopatre mourra : je me suis ore en songe
A ses yeux presenté, luy commandant de faire
L’honneur à mon sepuchre et apres se deffaire, (100)
Plutost qu’estre dans Romme en triomphe portee,
L’ayant par le desir de la mort confortee,
L’appellant avec moi, qui ja ja la demande
Pour venir endurer en nostre palle bande,
Or se faisant compagne en ma peine et tristesse, : (105)
Qui s’est faite long temps compagne en ma liesse.
CLEOPATRE, ERAS, CHARMIUM.
CLEOPATRE.
Que gaignez-vous, helas ! en la parole vaine ?
ERAS.
Que gaignez-vous, helas ! de vous estre inhumaine ?
CLEOPATRE.
Mais pourquoy perdez-vous vos peines ocieuses ?
CHARMIUM.
Mais pourquoy perdez-vous tant de larmes piteuses ? (110)
CLEOPATRE.
Qu’est-ce qui adviendroit plus horrible à la veuë ?
ERAS.
Qu’est-ce qui pourroit voir une tant depourveuë ?
CLEOPATRE.
Permettez mes sanglots mesme aux fiers Dieux se prendre.
CHARMIUM.
Permettez à nous deux de constante vous rendre.
CLEOPATRE.
Il ne faut que ma mort pour bannir ma complainte. (115)
ERAS.
Il ne faut point mourir avant sa vie esteinte.
CLEOPATRE.
Antoine ja m’appelle, Antoine il me faut suivre.
CHARMIUM.
Antoine ne veut pas que vous viviez sans vivre.
CLEOPATRE.
O vision estrange ! ô pitoyable songe !
ERAS.
O pitoyable Roine, ô quel tourment te ronge ? (120)
CLEOPATRE.
O Dieux ! à quel malheur m’avez-vous allechee ?
CHARMIUM.
O Dieux ! ne sera point votre plainte estanchee ?
CLEOPATRE.
Mais (ô Dieux) à quel bien, si ce jour je devie !
ERAS.
Mais ne plaignez donc point et suivez vostre envie.
CLEOPATRE.
Ha ! pourrois-je donc bien, moy la plus malheureuse (125)
Que puisse regarder la voûte radieuse,
Pourrois-je bien tenir la bride à mes complaintes,
Quand sans fin mon malheur redouble ses attaintes,
Quand je remasche en moy que je suis la meurdriere,
Par mes trompeurs apasts, d’un qui sous sa main fiere (130)
Faisoit croûler la terre ? Ha ! Dieux, pourrais-je traire
Hors de mon cœur le tort qu’alors je luy peu faire,
Qu’il me donnat Syrie, et Cypres, et Phenice,
La Judee embasmee, Arabie et Cilice,
Encourant par cela de son peuple la haine ? (135)
Ha ! pourrois-je oublier ma gloire et pompe vaine
Qui l’apastoit ainsi au mal, qui nous talonne
Et malheureusement les malheureux guerdonne,
Que la troupe des eaux en l’apast est trompee ?
Ha ! l’orgueil, et les ris, la perle destrempee, (140)
La delicate vie effeminant ses forces,
Estoyent de nos malheurs les subtiles amorces !
Quoy ? pourrois-je oublier que par la roide secousse
Pour moy seule il souffrit des Parthes la repousse,
Qu’ils eust bien subjuguez et rendus à sa Romme, (145)
Si les songears amours n’occupoient tout un homme,
Et s’il n’est eu desir d’abandonner sa guerre
Pour revenir soudain hyverner en ma terre ?
Ou pourrois-je oublier pour ma plus grand’gloire
Il traîna en triomphe et loyer de victoire, (150)
Dedans Alexandrie un puissant Artavade,
Roy des Armeniens, veu que telle bravade
N’appartenoit sinon qu’à sa ville orgueilleuse,
Qui se rendit alors d’avantage haineuse ?
Pourrois-je oublier mille et mille et mille choses, (155)
En qui l’amour pour moy a ses paupieres closes,
En cela mesmement que pour ceste amour mienne
On luy veit delaisser l’Octavienne sienne ?
En cela que pour moy il voulut faire guerre
Par la fatale mer, estant plus fort par terre ? (160)
En cela qu’il suivit ma nef au vent donnee,
Ayant en son besoin sa troupe abandonnee ?
En cela qu’il prenoit doucement mes amorces,
Alors que son Cesar prenoit toutes ses forces ?
En cela que feignant estre preste à m’occire, (165)
Ce pitoyable mot soudain je luy feis dire :
« O Ciel faudra-t-il donc que, Cleopatre morte,
Antoine vive encor ? Sus, sus, Page, conforte
Mes douleurs par ma mort. » Et lors, voyant son page
Soy mesme se tuer : » Tu donnes desmoignage, (170)
O Eunuque (dit-il), comme il faut que je meure ! «
Et, vomissant un cri, il s’enferra sur l’heure.
Ha ! Dames ! a, a ! faut-il que ce malheur je taise ?
Ho ! oh ! retenez-moy, je… je…
CHARMIUM.
Mais quel mal-aise (175)
Pourroit estre plus grand ?
ERAS.
Soulagez votre peine,
Efforcez vos esprits.
CLEOPATRE.
Las, las !
CHARMIUM.
Tenez la resne
Au dueil empoisonnant.
CLEOPATRE.
A ! grand Ciel, que j’endure !
Encore l’avoir veu ceste nuict en figure !
Hé !
ERAS.
Hé ! rien que la mort ne ferme au deuil la porte.
CLEOPATRE.
Hé ! hé ! Antoine estoit…
CHARMIUM.
Mais comment ?
CLEOPATRE.
En la sorte…
ERAS.
En quelle sorte donc ?
CLEOPATRE.
Comme alors que sa playe…
CHARMIUM.
Mais levez-vous un peu, que gesner on essaye
Ce qui gesne la voix.
ERAS.
O plaisir, que tu meines
Un horrible troupeau de deplaisirs et peines !
CLEOPATRE.
Comme alors que sa playe avoit ce corps tractable
Ensanglanté par tout.
CHARMIUM.
O songe espouvantable !
Mais que demandoit-il ?
CLEOPATRE.
Qu’à sa tumbe je face
L’honneur qui luy est deu.
CHARMIUM.
Quoy encor ?
CLEOPATRE.
Que je trace
Par ma mort un chemin pour rencontrer son ombre.
Me racontant encor…
CHARMIUM.
La basse porte sombre
Est à l’aller ouverte, et au retour fermee.
CLEOPATRE.
Une eternelle nuict doit de ceux estre aimee,
Qui souffrent en ce jour une peine eternelle.
Ostez-vous le desir de s’efforcer à celle
Qui libre veut mourir pour ne vivre captive ?
ERAS.
Sera donc celle là de la Parque craintive
Qui, au deffaut de mort, verra mourir sa gloire ?
CLEOPATRE.
Non, non, mourons, mourons, arrachons la victoire,
Encore que soyons par Cesar surmontees.
ERAS.
Pourrions nous bien estre en triomphe portees ?
CLEOPATRE.
Que plus tost ceste terre au fond de ses entrailles
M’engloutisse à present ; que toutes les tenailles
De ces bourrelles Soeurs, horreur de l’onde basse,
M’arrachent les boyaux ; que la teste on me casse
D’un foudre inusité, ainsi que je me conseille,
Et que la peur de mort entre dans mon oreille !
CHŒUR DE FEMMES ALEXANDRINES.
Quand l’Aurore vermeille
Se voit au lict laisser
Son Titon qui sommeille,
Et l’ami caresser :
On voit à l’heure mesme
Ce pays coloré,
Sous le flambeau supréme
Du Dieu au char doré :
Et semble que la face
De ce Dieu variant,
De ceste ville face
L’honneur de l’Orient,
Et qu’il se mire en elle
Plus tost qu’en autre part,
La prisant comme celle
Dont plus d’honneur depart,
De pompes et delices
Attrayans doucement,
Sous leur gayes blandices,
L’humain entendement.
Car veit on jamais ville
En plaisir, en honneur,
En banquets plus fertile,
Si durable estoir l’heur ?
Mais ainsi que la force
Du celeste flambeau
Tirer à soy s’efforce
Le plus leger de l’eau ;
Ainsi que l’aimant tire
Son acier, et les sons
De la marine Lyre
Attiroyent les poissons ;
Tout ainsi nos delices,
La mignardise et l’heur,
Allechemens des vices,
Tirent notre malheur,
Pourquoy, fatale Troye,
Honneur des siecles vieux,
Fus tu donnee en proye
Sous le destin des Dieux ?
Pourquoi n’eus tu, Medee,
Ton Jason ? et pourquoy,
Ariadne, guidee
Fus tu sous telle foy ?
Des delices le vice
A ce vous conduisoit :
Puis après sa malice
Soymesme destruisoit.
Tant n’estoit variable
Un Prothee en son temps,
Et tant n’est point muable
La course de nos vents.
Tant de fois ne se change
Thetis, et tant de fois
L’inconstant ne se range
Sous ses diverses loix,
Que nostre heur, en peu d’heure
En malheur retourné,
Sans que rien nous demeure,
Proye au vent est donné.
La rose journalière,
Quand du divin flambeau
Nous darde la lumière
Le ravisseur taureau,
Fait naistre en sa naissance
Son premier dernier jour :
Du bien la jouissance
Et ainsi sans sejour.
Le fruict vengeur du pere
S’est bien esvertué
De tuer sa vipere,
Pour estre apres tué.
Joye, qui dueil enfante,
Se meurdrist ; puis la mort
Par la joye plaisante
Fait au dueil mesme tort.
Le bien qui est durable,
C’est un monstre du Ciel,
Quand son vueil favorable
Change le fiel en miel.
Si la saincte ordonnance
Des immuables Dieux
Forcluse d’inconstance
Seule incogneuë à eux,
En ce bas hemisphere
Veut son homme garder,
Lors le sort improspere
Ne le peut retarder
Que, maugré sa menace,
Ne vienne tenir rang,
Maugré le fer qui brasse
La poudre avec le sang.
On doit seurement dire
L’homme qu’on doit priser,
Quand le Ciel vient l’eslire
Pour le favoriser,
Ne devoir jamais craindre
L’Ocean furieux,
Lors que mieux semble atteindre
Le marche-pied des Dieux ;
Plongé dans la marine,
Il doit vaincre en la fin,
Et s’attend à l’espine
De l’attendant Daulphin.
La guerre impitoyable,
Moissonnant les humains,
Craint l’heur espouventable
De ses celestes mains.
Tous les arts de Medee,
Le venin, la poison,
Les bestes dont gardee
Fut la riche toison,
Ny par le bois estrange
Le lyon outrageux, (320)
Qui sous sa patte range
Tous les plus courageux,
Ny la loy qu’on revere,
Non tant comme on la craint,
Ny le bourreau severe,
Qui l’homme blesme estraint,
Ny les feux qui saccagent
Le haut pin molestans,
Sa fortune n’outragent,
Rendans les dieux constans, (330)
Mais ainsi qu’autre chose
Contraint sous son effort,
Tient sous sa force enclose
La force de la mort ;
Et, maugré ceste bande (335)
Tousjours en bas filant,
Tant que le Ciel commande,
En bas n’est devallant ;
Et quand il y devalle,
Sans aucun mal souffrir, (340)
D’un sommeil qu’il avalle,
A mieux il va s’offrir.
Mais si la destinée,
Arbitre d’un chacun,
A sa chance tournee (345)
Contre l’heur de quelqu’un,
Le sceptre, sous qui ploye
Tout un peuple submis,
Est force qu’il foudroye
Ses mutins ennemis. (350)
La volage richesse,
Appuy de l’heur mondain,
L’honneur et la hautesse
Refuyant tout soudain,
Bref, fortune obstinee, (355)
Ny le temps tout fauchant,
Sa rude destinee
Ne vont point empeschant.
Des hauts Dieux la puissance
Tesmoigne assez ici, (360)
Que nostre heureuse chance
Se precipite ainsi.
Quel estoit Marc Antoine ?
Et quel estoit l’honneur
De nostre brave Roine, (365)
Digne d’un tel donneur ?
Des deux l’un miserable,
Cedant à son destin,
D’une mort pitoyable
Vint avancer sa fin : (370)
L’autre encore craintive
Taschant s’évertuer,
Veut, pour n’estre captive,
Librement se tuer.
Ceste terre honnorable, (375)
Ce pays fortuné,
Helas ! voit peu durable
Son heur importuné.
Telle est la destinee
Des immuables Cieux, (380)
Telle nous est donnee
La defaveur de Dieux.
ACTE II
OCTAVIEN, AGRIPPE, PROCULEE.
OCTAVIEN
En la rondeur du Ciel environnee
A nul, je croy, telle faveur donnee
Des Dieux fauteurs ne peut estre qu’à moy : (385)
Car outre encor que je suis maistre et Roy
De tant de biens, qu’il semble qu’en la terre
Le Ciel qui tout sous son empire enserre
M’ait tout exprés de sa voûte transmis
Pour estre ici son general commis, (390)
Oustre l’espoir de l’arriere memoire
Qui aux neveux rechantera ma gloire,
D’avoir Antoine, Antoine, dis-je, horreur
De tout ce monde, accablé la fureur,
Outre l’honneur que ma Romme m’appreste (395)
Pour le guerdon de l’heureuse conqueste,
Il me semble ja que le Ciel vienne tendre
Ses bras courbez pour en soy me reprendre,
Et que la boule entre ses ronds enclose
Pour un Cesar ne soit que peu de chose ; (400)
Or’ je desire, or’ je desire mieux,
C’est de me joindre au sainct nombre des Dieux.
Jamais la terre en tout advantureuse
N’a sa personne entierement heureuse :
Mais le malheur par l’heur est acquité, (405)
Et l’heur se paye par l’infelicité.
AGRIPPE.
Mais de quel lieu ces mots ?
OCTAVIEN.
Qui eust peu croire
Qu’apres l’honneur d’une telle victoire,
Le dueil, le pleur, le souci, la complainte, (410)
Mesme à Cesar eust donné telle atteinte ?
Mais je me voy souvent en lieu secret
Pour Marc Antoine estre en plainte et regret,
Qui aux honneurs receus en notre terre
Et compagnon m’avoit esté en guerre, (415)
Mon allié, mon beaufrere, mon sang,
Et qui tenoit ici le mesme rang
Avec Cesar. Nonobstant par rancune
De la muable et traistresse fortune,
On veit son corps en sa playe moüillé (420)
Avoir ce lieu piteusement soüillé,
Ha ! cher ami !
PROCULEE.
L’orgueil et la bravade
Ont fait Antoine ainsi qu’un Ancelade,
Qui, se voulant encore prendre aux Dieux,
D’un trait horrible et non lancé des Cieux, (425)
Mais de ta main à la vengeance adextre,
Sentit combien peut d’un grand Dieu la dextre.
Que plaignez-vous, si l’orgueil justement
A l’orgueilleux donne son payement ?
AGRIPPE.
L’orgueil est tel, qui d’un malheur guerdonne
La malheureuse et superbe personne.
Mesmes ainsi que d’un onde le branle,
Lors que le Nord dedans la mer l’ébranle,
Ne cesse point de courir et glisser,
Virevolter, rouler, et se dresser,
Tant qu’à la fin dépiteux il arrive,
Bruyant sa mort, à l’ecumeuse rive :
Ainsi ceux la, que l’orgueil trompe ici,
Ne cessent point de se dresser ainsi,
Courir, tourner, tant qu’ils soyent agitez
Contre les bords de leur felicitez.
C’estoit assez que l’orgueil pour Antoine
Precipiter avec sa pauvre Roine,
Si les amours lascifs et les delices
N’eussent aidé à rouër leurs supplices,
Tant qu’on ne sçait comment ces dereiglez
D’un noir bandeau ses sont tant aveuglez
Qu’ils n’ont sçeu voir et cent et cent augures,
Prognostiqueurs de miseres futures.
Ne veit on par Pisaure l’ancienne
Prognostiquer la perte Antonienne,
Qui des soldats Antoniens armee
Fust engloutie et dans terre abysmee ?
Ne veit on pas dedans Albe une image
Suer long temps ? Ne veit on pas l’orage
Qui de Patras la ville environnoit,
Alors qu’Antoine en Patras sejournoit,
Alors que le feu qui par l’air s’eclata
Heraclion en pieces escarta ?
Ne veit on pas, alors que dans Athenes
En un theatre on luy monstroit les peines ?
Ou pour neant les serpens-piés se mirent,
Quand aux rochers les rochers il joignirent,
Du Dieu Bacchus l’image en bas poussee
Des vents qui l’ont comm’ à l’envi cassee,
Veu que Bacchus un conducteur estoit,
Pour qui Antoine un mesme nom portoit ?
Ne veit on pas d’une flame fatale
Rompre l’image et d’Eumene et d’Atale,
A Marc Antoine en ce lieu dediees ?
Puis maintes voix fatalement criees,
Tant de gesiers, et tant d’autres merveilles,
Tant de corbeaux, et senestres corneilles ?
Tant de sommets rompus et mis en poudre,
Que monstroyent ils que ta future foudre ?
Qui ce rocher devoit ainsi combattre ?
Qu’admonnestoit la nef de Cleopatre,
Et qui d’Antoine avoit le nom par elle,
Où l’hirondelle exila l’hirondelle,
Et toutesfois, en sillant leur lumiere,
N’y voyoyent point ce qui suivoit derriere ?
Vante toi donc, les ayant pourchassez
Comme vengeur des grands Dieux offensez ;
Esjouy toy en leur sang et te baigne,
De leurs enfans fais rougir la campagne,
Racle leur nom, efface leur memoire ;
Poursuy, poursuy jusqu’au bout ta victoire.
OCTAVIEN.
Ne veux je donc ma victoire poursuivre,
Et mon trophee au monde faire vivre ?
Plustost, plustost le fleuve impetueux
Ne se rengorge au grand sein fluctueux !
C’est le souci qui avecq la complainte,
Que je faisais de l’autre vie esteinte,
Me ronge aussi ; mais plus gand tesmoignage
De mes honneurs s’obstinans contre l’aage,
Ne s’est point veu, sinon que ceste Dame,
Qui consuma Marc Antoine en sa flame,
Fut dans ma ville en triomphe menee.
PROCULEE.
Mais pourroit-elle à Romme estre traisnee,
Veu qu’elle n’a sans fin autre desir
Que par sa mort sa liberté choisir ?
Sçavez-vous pas, lors que nous echellasme
Et que par ruse en sa court nous allasmes ?
Que tout soudain qu’en la court on me veit,
En s’écriant une des femmes dit :
« O pauvre Roine ! es-tu donc prise vive ?
Vis tu encor pour trespasser captive ? «
Et qu’elle ainsi, sous telle voix ravie,
Vouloit trancher le fil de sa vie,
Du cimeterre à son costé pendu,
Si saisissant je n’eusse deffendu
Son estomach ja desja menassé
Du bras meurdrier à l’encontre haussé ?
Sçavez-vous pas que depuis ce jour mesme
Elle est tombee en maladie extreme,
Et qu’elle a feint de ne pouvoir manger,
Pour par la faim à la fin se renger ?
Pensez-vous pas qu’outre telle finesse
Elle ne trouve à la mort quelque addresse ?
AGRIPPE.
Il vaudroit mieux dessus elle veiller,
Sonder, courir, espier, travailler,
Que du berger la veue gardienne
Ne s’arrestoit sus son Inachienne.
Que nous nuira, si nous la confortons,
Si doucement sa foiblesse portons ?
Par tels moyens s’envolera l’envie
De faire change à sa mort de sa vie :
Ainsi sa vie heureusement traitee
Ne pourra voir sa quenouille arrestee :
Ainsi, ainsi jusqu’à Romme elle ira ;
Ainsi, ainsi ton souci finira.
Et quand aux plains, veux tu plaindre celuy
Qui de tout temps te brassa tout ennuy,
Qui n’estoit né, sans ta dextre divine,
Que pour la tienne et la nostre ruine ?
Te souvient il que, pour dresser ta guerre,
Tu fus hay de toute nostre terre,
Qui se piquoit mutinant contre toy
Et refusoit se courber sous ta loy,
Lors que tu prins pour guerroyer Antoine
Des hommes francs le quart du patrimoine,
Des serviteurs la huictiesme partie
De leur vaillant, tant que ja divertie
Presque s’estoit l’Italie troublee ?
Mais quelle estoit sa peine redoublee,
Dont il taschoit embrasser les Rommains,
Pour ce Lepide exilé par tes mains ?
Te souvient-il de ceste horrible armee
Que contre nous il avait animee ?
Tant de Rois donc qui voulurent le suivre,
Y venoyent ils pour nous y faire vivre ?
Pensoyent-ils bien nous foudryez exprés,
Pour deplorer nostre ruine aprés ?
Le Roy Bocchus, le Roy Cilicien,
Archelaus, Roy Capadocien,
Et Philadelphe et Adalle de Thrace,
Et Mithridate usoyent ils de menace
Moindre sus nous, que de porter en joye
Nostre despoüille et leur guerriere proye,
Pour à leurs Dieux joyeusement les pendre
Et maint et maint sacrifice leur rendre ?
Voila les pleurs que doit un adversaire
Apres la mort de son ennemy faire.
OCTAVIEN.
O gent Agrippe, ou pour te nommer mieux,
Fidelle Achate, estoit donc de mes yeux
Digne le pleur ? Celuy dont s’effemine
Qui ja du tout l’effeminé ruine ?
Non, non, les plains cederont aux rigueurs,
Baignons en sang les armes et les cœurs,
Et souhaitons à l’ennemi cent vies,
Qui luy seroient plus durement ravies ;
Quant à la Roine, appaiser la faudra
Si doucement que sa main se tiendra
De forbannir l’ame seditieuse
Outre les eaux de la rive oublieuse.
Je vois desor en cela m’efforcer,
Et son desir de mort effacer :
Souvent l’effort est forcé par la ruse.
Pendant, Agrippe, aux affaires t’amuse,
Et toy, loyal messager Proculee,
Sonde partout ce que la fame aislee
Fait s’acouster dedans Alexandrie
Qu’elle circuit, et tantost bruit et crie,
Tantost plus bas marmote son murmure,
N’estant jamais loin de telle aventure.
PROCULEE.
Si bien par tout mon devoir se fera
Que mon Cesar de moy se vantera.
O ! S’il me faut ores un peu dresser
L’esprit plus haut et seul en moy penser,
Cent et cent fois miserable est celuy
Qui en ce monde a mis aucun appuy :
Et tant s’en faut qu’il ne fasche de vivre
A ceux qu’on voit par fortune poursuivre,
Que moy, qui suis du sort assez contant,
Je suis fasché de me voir vivre tant.
Où es tu, Mort, si la prosperité
N’est sous les cieux qu’une infelicité ?
Voyons les grands, et ceux qui de leur teste
Semblent desja deffier la tempeste :
Quel heur ont ils pour une fresle gloire ?
Mille serpens rongears en leur memoire,
Mille soucis meslez d’effroyement,
Sans fin desir, jamais contentement :
Dés que le Ciel son foudre pirouëtte,
Il semble ja que sur eux il se jette :
Dés lors que Mars pres de leur terre tonne,
Il semble ja leur ravir la couronne ;
Dés que l peste en leur regne tracasse,
Il semble ja que leur chef on menasse ;
Bref, à la mort ils ne peuvent penser,
Sans souspirer, blesmir, et s’offenser,
Voyant qu’il faut par mort quitter leur gloire,
Et bien souvent enterrer la memoire,
Où celuy-la, qui solitairement
En peu de biens cherche contentement,
Ne pallit pas si la fatale Parque
Le fait penser à la derniere barque,
Ne pallit pas, non, si le Ciel et l’onde
Se rebrouilloyent au vieil Chaos du monde.
Telle est, telle est la mediocrité
Où gist le but de la felicité :
Mais qui me fait en ces discours me plaire,
Quand il convient exploiter mon affaire ?
Trop tost, trop tost se fera mon message,
Et toujours tard un homme se fait sage.
LE CHŒUR.
Strophe.
De la terre humble et basse,
Esclave de ces cieux,
Le peu puissant espace
N’a rien plus vicieux
Que l’orgueil, qu’on voit estre
Hay du Ciel, son maistre.
Antistrophe.
Orgueil, qui met en poudre
Le rocher trop hautain,
Orgueil pour qui le foudre
Arma des Dieux la main,
Et qui vient pour salaire
Luymesme se deffaire.
Strophe.
A qui ne sont cogneuës
Les races du Soleil,
Qui affrontoyent aux nuës
Un superbe appareil,
Et montagnes portees
L’une sus l’autre entees ?
Antistrophe.
La tombante tempeste,
Adversaire à l’orgueil,
Escarbouilla leur teste,
Qui tropuva son recueil
Apres la mort amere
Au ventre de sa mere.
Strophe.
Qui ne cognoist le sage
Qui trop audacieux,
Pilla du feu l’usage
Au chariot des ieux,
Cherchant par arrogance
Sa propre repentance ?
Antistrophe.
Qu’on le voise voir ore
Sur le mont Scythien,
Où son vautour devore
Son gesier ancien ;
Que sa poitrine on voye
Estre eternelle proye.
Strophe.
Qui ne cognoist Icare,
Le nommeur d’une mer,
Et du Dieu de Pathare
L’enfant, qui enflammer
Vint sous son char le monde,
Tant qu’il tombast en l’onde ?
Antistrophe.
De ceux là les ruines
Tesmoignent la fureur
Des sainctes mains divines,
Qui doivent faire horreur
A l’orgueil, digne d’estre
Puni de telle dextre.
Strophe.
A t’on pas veu la vague
Au giron fluctueux,
Alors qu’Aquilon vague
Se fait tempestueux,
Presque dresser ses crestes
Jusqu’au lieu des tempestes ?
Antistrophe.
Qu’on voye de l’audace
Phebus se courroussant,
Esclarcissant la trace
Qui sont char va froissant,
Dessous ses fleches blondes
Presque abysmer les ondes.
Strophe.
A t’on pas veu d’un arbre
Le couppeau chevelu,
Ou la maison de marbre
Qui semble avoir voulu
Dépriser trop hautaine
L’autre maison prochaine.
Antistrophe.
Qu’on voye un feu celeste
Ceste cime arrachant,
Et par mine moleste
Le palais tresbuchant,
La plante au chef punie,
L’autre au pied demunie
Strophe.
Mais Dieux (ô Dieux) qu’il vienne
Voir la plainte et le dueil
De ceste Roine mienne,
Rabaissant son orgueil,
Roine, qui pour son vice
Reçoit plus grand supplice.
Antistrophe.
Il verra la Deesse
A genoux se jetter,
Et l’esclave Maistresse,
Las, son mal regretter !
Sa voix à demi morte
Requiert qu’on la supporte.
Strophe.
Elle, qui orgueilleuse
Le nom d’Isis portoit,
Qui de blancheur pompeuse
Richement se vestoit,
Comme Isis l’ancienne,
Deesse Egyptienne,
Antistrophe.
Ore presque en chemise
Qu’elle va dechirant,
Pleurant aux pieds s’est mise
De son Cesar, tirant
De l’estomach debile
Sa requeste inutile.
Strophe.
Quel cœur, quelle pensee,
Quelle rigueur pourroit
N’estre point offensee,
Quand ainsi lon verroit
Le retour miserable
De la chance muable ?
Antistrophe.
Cesar, en quelle sorte,
La voyant sans vertu,
La voyant demi-morte,
Maintenant soutiens-tu
Las assauts, que te donne
La pitié, qui t’estonne ?
Strophe.
Tu vois qu’une grand’Roine,
Celle là qui guidoit
Ton compagnon Antoine,
Et par tout commandoit,
Heureuse se vient dire,
Si tu voulois l’occire.
Antistrophe.
Las, helas ! Cleopatre,
Las, helas ! quel malheur
Vient tes plaisirs abbattre,
Les changeant en douleur ?
Las, las, helas, (ô Dame),
Peux tu souffrir ton ame ?
Strophe.
Pourquoy, pourquoy, fortune,
O fortune aux yeux clos,
Es tu tant importune ?
Pourquoy n’a point repos
Du temps le vol estrange,
Qui ses faits brouille et change.
Antistrophe.
Qui en volant sacage
Les chasteaux sourcilleux,
Qui les princes outrage,
Qui les plus orgueilleux,
Roüant sa faulx superbe,
Fauche ainsi comme l’herbe ?
Strophe.
A nul il ne pardonne,
Il se fait et deffait,
Luy mesmes il s’estonne,
Il se flatte en son fait,
Puis il blasme sa peine,
Et contre elle forcene.
Antistrophe.
Vertu seule à l’encontre
Fait l’acier reboucher ;
Outre telle rencontre
Le temps peult tout faucher ;
L’orgueil qui nous amorce
Donne à sa faulx sa force.
ACTE III.
OCTAVIEN, CLEOPATRE, LE CHŒUR, SELEUQUE.
OCTAVIEN.
Voulez-vous donc votre fait excuser ?
Mais dequoy sert à ces mots s’amuser ?
N’est-il pas clair que vous tachiez de faire
Par tous moyens Cesar vostre adversaire,
Et que vous seule attirant vostre ami,
Me l’avez fait capital ennemi,
Brassant sans fin une horrible tempeste,
Dont vous pensiez écerveler ma teste ?
Qu’en dites-vous ?
CLEOPATRE.
O quels piteux alarmes !
Las, que dirois-je ! hé, ja pour moy mes larmes
Parlent assez, qui non pas la justice,
Mais de pitié cherchent le benefice.
Pourtant, Cesar, s’il est à moy possible
De tirer hors d’une ame tant passible
Ceste voix rauque à mes souspirs meslee,
Escoute encor l’esclave desolee,
Las ! qui ne met tant d’espoir aux paroles
Qu’en ta pitié, dont ja tu me consoles.
Songe, Cesar, combien peult la puissance
D’un traistre amour, mesme en sa jouyssance,
Il pense encor que mon foible courage
N’eust pas souffert sans l’amoureuse rage,
Entre vous deux ces batailles tonantes,
Dessus mon chef à la fin retournantes.
Mais mon amour me forçoit de permettre
Ces fiers debats, et toute aide promettre,
Veu qu’il fallait rompre paix et combattre,
Ou separer Antoine et Cleopatre.
Separer, las ! ce mot me fait faillir,
Ce mot le fait par la Parque assaillir.
A a ! a a ! Cesar, a a !
OCTAVIEN.
Si je n’estois ore
Assez bening, vous pourriez feindre encore
Plus de douleurs, pour plus bening me rendre :
Mais quoyu, ne veux-je à mon merci vous prendre ?
CLEOPATRE.
Feindre, helas, ô !
OCTAVIEN.
Ou tellement se plaindre
N’est que mourir, ou bien ce n’est que feindre.
LE CHŒUR.
La douleur
Qu’un malheur
Nous rassemble,
Tel ennuy
A celuy
Pas ne semble,
Qui exempt
Ne la sent ;
Mais la plainte
Mieux bondit,
Quand on dit
Que c’est feinte.
CLEOPATRE.
Si la douleur en ce cœur prisonniere
Ne surmontoit ceste plainte derniere,
Tu n’aurois pas ta pauvre esclave ainsi :
Mais je ne peux égaler au souci,
Qui petillant m’écorche le dedans,
Mes pleurs, mes plaints et mes soupirs ardens.
T’esbahis tu, si ce mot separer
A fait mes forces se retirer ?
Separer (Dieux !), separer je l’ay veu,
Et si je n’ay point à ces debats pourveu
Mieux il te fust (ô captive ravie)
Te separer mesme durant sa vie !
J’eusse la guerre et sa mort empeschee
Et à mon heur quelque atteinte laschee,
Veu que j’eusse eu le moyen et l’espace
D’esperer voir secrettement sa face :
Mais, mais cent fois, cent, cent fois malheureuse,
J’ay ja souffert ceste guerre odieuse :
J’ay, j’ay perdu par ceste estrange guerre,
J’ay perdu tout, et mes biens et ma terre :
Et si ay veu ma vie et mon support,
Mon heur, mon tout, se donner à la mort,
Que tout sanglant, ja tout froid et tout blesme,
Je rechauffois des larmes de moymesme,
Me separant des moymesme à demi
Voyant par mort separer mon ami.
Ha, Dieux ! grands Dieux ! Ha, grands Dieux !
OCTAVIEN.
Qu’est-ce ci ?
Quoy ? la constance estre hors de souci ?
CLEOPATRE.
Constante suis ; separer je me sens,
Mais séparer on ne me peult long temps :
La palle mort m’en fera la raison,
Bien tost Pluton m’ouvrira sa maison,
Où mesme encor l’éguillon, qui me touche,
Feroit rejoindre et ma bouche et sa bouche.
S’on me tuoit, le dueil qui creveroit
Parmi le coup plus de bien me feroit,
Que je n’auroit de mal à voir sortir
Mon sang pourpré et mon ame partir.
Mais vous m’ostez l’occasion de mort,
Et pour mourir me deffaut mon effort,
Qui s’allentit d’heure en heure dans moy,
Tant qu’il faudra vivre maugré l’esmoy ;
Vivre il me faut, ne crains que je me tue :
Pour me tuer trop peu je m’esvertue.
Mais puis qu’il faut que j’allonge ma vie,
Et que de vivre en moy revient l’envie,
Au moins, Cesar, voy la pauvre foiblette,
Qui à tes pieds et de rechef se jette ;
Au moins, Cesar, des gouttes de mes yeux
Amolli toy, pour me pardonner mieux :
De ceste humeur la pierre on cave bien,
Et sus ton cœur ne pourront elles rien ?
Ne t’ont donc peu les lettre esmouvoir
Qu’à tes deux yeux j’avois tantost fait voir,
Lettres je dy de ton pere receues,
Certain tesmoin de nos amours conceuës ?
N’ay-je donc peu destourner ton courage,
Te descouvrant et maint et maint image
De ce tien pere, à celle-la loyal,
Qui de son fils recevra tout son mal ?
Celuy souvent trop tost borne sa gloire,
Qui jusqu’au bout se vange en sa victoire.
Prens donc pitié ; tes glaives triomphans
D’Antoine et moy pardonnent aux enfans.
Pourrois-tu voir les horreurs maternelles,
S’on meurdrissoit ceux que ces deux mammelles,
Qu’ores tu vois maigres et déchirees
Et qui seroient de cent coups empirees,
Ont allaicté ? Oserois-tu mesmement
Des deux costez le dur gemissement ?
Non, non Cesar, contente toy du pere,
Laisse durer les enfans et la mere
En ce malheur, où les Dieux nous ont mis,
Mais fusmes nous jamais tes ennemis
Tant acharnez que n’eussions pardonné,
Si le trophee à nous se fust donné ?
Quant est de moy, en mes fautes commises,
Antoine estoit chef de mes entreprises,
Las, qui venoit à tel malheur m’induire ;
Eussé-je peu mon Antoine esconduire ?
OCTAVIEN.
Tel bien souvent son fait pense amender,
Qu’on voit d’un gouffre en un gouffre guider :
Vous excusant, bien que vostre advantage,
Vous y mettiez, vous nuisez davantage,
En me rendant par l’excuse irrité,
Qui ne suis point qu’ami de verité.
Et si convient qu’en ce lieu je m’amuse
A repousser ceste inutile excuse ;
Pourriez-vous bien de ce vous garentir
Qui fit ma sœur hors d’Athenes sortir,
Lors que, craignant qu’Antoine, son espoux,
Plus se donnast à sa femme qu’à vous,
Vous le paissiez de ruse et de finesses,
De mille et mille et dix mille caresses ?
Tantost au lict exprés emmaigrissiez,
Tantost par feinte exprés vous pallissiez ?
Tantost vostre œil vostre face baignoit,
Dés qu’un ject d’arc de luy vous esloignoit,
Entretenant la feinte et sorcelage,
Ou par coustume, ou par quelque breuvage ;
Mesme attiltrant vos mais et flatteurs
Pour du venin d’Antoine estre fauteurs,
Qui l’abusoiyent sous les plaintes frivoles,
Faisant ceder son proffit aux paroles.
Quoy ? disoient-ils, estes vous l’homicide
D’un pauvre esprit, qui vous prend pour sa guide ?
Faut-il qu’en vous la Noblesse s’offense,
Dont la rigueur à celle la ne pense,
Qui fait de vous le but de ses pensees ?
O ! que son mal envers vous addressees !
Octavienne a le nom de l’espouse,
Et ceste ci, dont la flame jalouse
Empesche assez la viste renommee,
Sera l’amie en son pays nommee,
Ceste divine, à qui rendent hommage
Tant de pays joints à son heritage.
Tant peurent donc vos mines et addresses,
Et de ceux la les plaintes flatteresses,
Qu’Octavienne, et sa femme et ma sœur,
Fut dechassee, et dechassa votre heur.
Vous taisez-vous, avez-vous plus desir,
Pour m’appaiser, d’autre excuse choisir ?
Que diriez-vous du tort fait aux Rommains,
Qui s’enfuyoient secrettement des mains
De vostre Antoine, alors que vostre rage
Leur redoubloit l’outrage sus l’outrage ?
Que diriez-vous de ce beau testament,
Qu’Antoine avoit remis secrettement
Dedans les mains des pucelles Vestales ?
Ces maux estoyent les conduites fatales
De vos malheurs : et ore peu rusee,
Vous voudriez bien encore estre excusee.
Contentez-vous, Cleopatre, et pensez
Que c’est assez de pardon, et assez
D’entretenir le fuseau de vos vies,
Qui ne seront à vos enfans ravies.
CLEOPATRE.
Ore, Cesar, chetive je m’accuse,
En m’excusant de ma premiere excuse,
Recognoissant que ta seule pitié
Peut donner bride à ton inimitié,
Qui ja pour moi tellement se commande.
Que ne veux-tu de moy faire offrande
Aux Dieux ombreux, ny des enfans aussi
Que j’ai tourné en ces entrailles ci.
De ce peu donc mon pouvoir est resté
Je rens, je rens grace à ta majesté,
Et pour donner à Cesar tesmoignage,
Que je suis sienne et le suis de courage,
Je veux, Cesar, te deceler tout l’or,
L’argent, les biens, que je tiens en thresor.
LE CHŒUR.
Quand la servitude,
Le col enschesnant,
Dessous le joug rude
Va l’homme gesnant,
Sans que l’on menasse
D’un sourcil plié,
Sans qu’effort on face
Au pauvre lié,
Assez il confesse,
Assez se contraint,
Assez il se presse,
Par la crainte estraint.
Telle est la nature
Des serfs déconfits ;
Tant de mal n’endure
De Japet le fils.
OCTAVIEN.
L’ample thresor, l’ancienne richesse
Que vous nommez, tesmoigne la hautesse
De vostre race ; et n’estoit le bon heur
D’estre du tout en la terre le seigneur,
Je me plaindrois qu’il faudra que soudain
Ces biens royaux changent ainsi de main.
SELEUQUE.
Comment, Cesar, si l’humble petitesse
Ose addresser sa voix à ta hautesse,
Comment peux-tu ce thresor estimer,
Que ma Princesse a voulu te nommer ?
Cuides tu bien, si accuser je l’ose,
Que son thresor tienne si peu de chose ?
La moindre Roine à ta loy flechissante
Est en thresor autant riche et puissante,
Qui autant peu ma Cleopatre égale,
Que par les champs une case rurale
Au fier chasteau ne peult estre esgalee,
Ou bien la motte à la roche gelee.
Celle sous qui tout l’Égypte flechit,
Et qui du Nil l’eau fertile franchit,
A qui le Juif et le Phenicien,
L’Arabian et le Cilicien,
Avant ton foudre ore tombé sur nous,
Souloyent courber les hommagers genoux,
Qui aux thresors d’Antoine commandoit,
Qui tout en ce monde en pompes excedoit,
Ne pourroit elle avoir que ce thresor ?
Croy, Cesar, croy qu’elle a de tout son or
Et d’autres biens tout le meilleur caché.
CLEOPATRE.
A ! faux meurdrier ! a ! faux traitre ! arraché
Sera le poil de ta teste cruelle.
Que pleust aux Dieux que ce fust ta cervelle !
Tiens, traistre, tien.
SELEUQUE.
O Dieux !
CLEOPATRE.
O chose detestable !
Un serf, un serf !
OCTAVIEN.
Mais chose émerveillable
D’un cœur terrible !
CLEOPATRE.
Et quoy, m’accuses tu ?
Me pensois tu veufve de ma vertu
Comme d’Antoine ? a a ! traistre.
SELEUQUE.
Retiens la,
Puissant Cesar, retiens la doncq.
CLEOPATRE.
Voila
Tous mes biensfaits. Hou ! le dueil qui m’efforce
Donne à mon cœur langoureux telle force,
Que je pourrois, ce me semble, froisser
Du poing tes os, et tes flancs crevasser
A coups de pied.
OCTAVIEN.
O quel grinsant courage !
Mais rien n’est plus furieux que la rage
D’un cœur de femme. Et bien, quoy, Cleopatre ?
Estes vous point ja saoule de le battre !
Fuy t’en, ami, fuy t’en.
CLEOPATRE.
Mais quoy, mais quoy ?
Mon Empereur, est-il un tel esmoy
Au monde encore que ce paillard me donne ?
Sa lacheté ton esprit mesme estonne,
Comme je croy, quand moy, Roine d’ici,
De mon vassal suis accusee ainsi,
Que toy, Cesar, as daigné visiter,
Et par ta voix à repos inciter,
Hé ! si j’avois retenu des joyaux,
Et quelque part de mes habits royaux,
L’aurois-je fait pour moy, las, malheureuse !
Moy, qui de moy ne suis plus curieuse ?
Mais telle estoit ceste esperance mienne
Qu’à ta Livie et ton Octavienne
De ces joyaux le present je feroy,
Et leur pitié ainsi pourchasseroy
Pour (n’estant point de mes presens ingrates)
Envers Cesar estres mes advocates.
OCTAVIEN.
Ne craignez point, je veux que ce thresor
Demeure vostre : encouragez-vous or’,
Vivez ainsi en la captivité
Comm’au plus haut de la prosperité.
Adieu : songez qu’on ne peut recevoir
Des maux, sinon quand on pense en avoir.
Je m’en retourne.
CLEOPATRE.
Ainsi vous soit ami
Tout le Destin, comm’il m’est ennemi.
LE CHŒUR.
Où courez-vous, Seleuque, où courez-vous ?
SELEUQUE.
Je cours fuyant l’envenimé courroux.
LE CHŒUR.
Mais quel courroux ? Hé, Dieu ! si nous en sommes !
SELEUQUE.
Je ne fuy pas Cesar, ni ses hommes.
LE CHŒUR.
Qu’y a t’il donc que peut plus la fortune ?
SELEUQUE.
Il n’y a rien, sinon l’offense d’une…
LE CHŒUR.
Auroit on bien nostre Roine blessee ?
SELEUQUE.
Non, non, mais j’ai nostre Roine offensee.
LE CHŒUR.
Quel malheur donc a causé ton offense ?
SELEUQUE.
Que sert ma faute, ou bien mon innocence ?
LE CHŒUR.
Mais dy le nous, dy, il ne nuira rien.
SELEUQUE.
Dit, il n’apporte à la ville aucun bien.
LE CHŒUR.
Mais tant y a que tu as gaigné l’huis.
SELEUQUE.
Mais tant y a que ja puni j’en suis
LE CHŒUR.
Estant puni, en es-tu du tout quitte ?
SELEUQUE.
Estant puni, plus fort je me dépite,
Et ja dans moy je sens une furie,
Me menassant que telle fascherie
Poindra sans fin mon ame furieuse,
Lors que la Roine, et triste et courageuse,
Devant Cesar aux cheveux m’a tiré,
Et de son poing mon visage empiré :
Si elle m’eust fait mort en terre gesir,
Elle eust preveu à mon present desir,
Veu que la mort n’eust point esté tant dure
Que l’eternelle et mordante pointure,
Qui ja desja jusques au fond me blesse
D’avoir blessé ma Roine et ma maistresse.
LE CHŒUR.
O quel heur à la personne
Le ciel gouverneur ordonne,
Qui, contente de son sort,
Par convoitise ne sort
Hors de l’heureuse franchise,
Et n’a sa gorge submise
Au joug et trop dur lien
De ce pourchas terrien,
Mais bien les antres sauvages,
Les beaux tapis des herbages,
Les rejettans arbrisseaux,
Les murmures des ruisseaux,
Et la gorge babillarde
De Philomele jasarde,
Et l’attente du Printemps
Sont ses biens et passetemps.
Sans que l’ame haute volante,
De plus grand desir bruslante,
Suive les pompeux arrois,
Et puis, offensant ses Rois,
Ait pour maigre recompense
Le feu, le glaive, ou potance,
Ou plustost mille remors,
Conferez a mille morts.
Si l’inconstante fortune
Au matin est opportune,
Elle est importune au soir.
Le temps ne se peut rassoir ;
A la fortune il accorde,
Portant à celuy la corde
Qu’il avoit paravant mis
Au rang des meilleurs amis.
Quoy que soit, soit mort ou peine
Que le soleil nous rameine
En nous ramenant son jour,
Soit qu’elle face sejour,
Ou bien que par la mort griesve
Elle se face plus briesve :
Celuy qui ard de desir
S’est tousjours senti saisir.
Arius de ceste ville,
Que ceste ardeur inutile
N’avoit jamais retenu,
Ce Philosophe chenu,
Qui deprisoit toute pompe
Dont ceste ville se trompe,
Durant nostre grand’douleur
A receu le bien et l’heur.
Cesar, faisant son entree,
A la sagesse monstree,
L’heur et la felicité,
La raison, la verité,
Qu’avoit en soy ce bon maistre,
Le faisant mesme à sa dextre
Costoyer, pour estre à nous
Comme un miracle entre tous.
Seleuque, qui de la Roine
Recevoit le patrimoine
En partie, et qui dressoit
Le gouvernement, reçoit,
Et outre ceste fortune
Qui nous est à tous commune,
Plus griesve infelicité
Que nostre captivité.
Mais or’ ce dernier courage
De ma Roine est un presage,
S’il faut changer de propos,
Que la meurdriere Atropos
Ne souffrira pas qu’on porte
A Romme ma Roine forte,
Qui veut des ses propres mains
S’arracher des fiers Rommains.
Celle dont la confiance
A pris soudain la vengeance
Du serf, et dont la fureur
N’a point craint son Empereur,
Croyez que plustost l’espee
En son sang sera trempee,
Que pour un peu moins souffrir
A son deshonneur s’offrir.
SELEUQUE.
O sainct propos, ô verité certaine !
Pareille aux dez est nostre chance humaine.
== ACTE IV ==
CLEOPATRE, CHARMIUM, ERAS, LE CHŒUR.
CLEOPATRE.
Penseroit doncq Cesar estre du tout vainqueur ?
Penseroit doncq Cesar abastardir ce cœur,
Veu que des tiges vieux ceste vigueur j’herite
De ne pouvoir ceder qu’à la Parque dépite ?
La Parque, et non Cesar, aura sus moy le pris,
La Parque, et non Cesar, soulage mes esprits,
La Parque, et non Cesar, triomphera de moy,
La Parque, et non Cesar, finira mon esmoy,
Et si j’ay ce jourdhuy usé de quelque feinte,
Afin que ma portee en son sang ne fust teinte,
Quoy ! Cesar pensoit-il quece que dit j’avois
Peust bien aller ensemble et de cœur et de voix ?
Cesar, Cesar, Cesar, il te seroit facile
De subjuguer ce cœur aux liens indocile ;
Mais la pitié, que j’ay du sang de mes enfans,
Rendoit sus mon vouloir mes propos triomphans,
Non la pitié que j’ay si par moy, miserable,
Est rompu le filet, à moy, ja trop durable.
Courage, donc, courage (ô compagnes fatales)
Jadis serves à moy, mais en la mort égales,
Vous avez recogneu Cleopatre princesse,
Or ! ne recoignessez que la Parque maistresse.
CHARMIUM.
Encore que les maux par ma Roine endurez,
Encore que les cieux contre nous conjurez,
Encore que la terre envers nous courroucee,
Encore que la Fortune envers nous insensee ?
Encore que d’Antoine une mort miserable,
Encore que la pompe à Cesar desirable,
Encore que l’arrest, que nous fismes ensemble
Qu’il faut qu’un mesme jour aux enfers nous assemble,
Eguillonnast assez mon esprit courageux
D’estre contre soymesme un vainqueur outrageux,
Ce remede de mort, contrepoison de dueil,
S’est tantost presenté d’avantage à mon œil :
Car ce bon Dolabelle, ami de nostre affaire,
Combien que pour Cesar il soit nostre adversaire,
T’a fait sçavoir (ô Roine), apres que l’Empereur
Est parti d’avec toy, et apres ta fureur
Tant equitablement à Seleuque monstree,
Que dans trois jours prefix ceste douce contree
Il nous faudra laisser, pour à Romme menees
Donner un beau spectacle à leurs effeminees.
ERAS.
Ha ! mort, ô douce mort, mort, seule guarison
Des esprits oppressez d’une estrange prison,
Pourquoy souffres tu tant à tes droits faire tort ?
T’avons nous fait offense, ô douce et douce mort ?
Pourquoy n’approches-tu, ô Parque trop tardive ?
Pourquoy veux-tu souffrir ceste bande captive,
Qui n’aura pas plustost le don de liberté,
Que cest esprit ne soit par ton dard écarté ?
Haste doncq, haste toy, vanter tu te pourras
Que mesme sus Cesar une despouille auras :
Ne permets point, alors que Phebus qui nous luit
En devallant sera chez son oncle conduit,
Que ta sœur pitoyable, helas ! à nous cruelle,
Tire encore le fil dont elle nous bourrelle :
Ne permets que des peurs la pallissante bande
Empesche ce jourdhuy de te faire une offrande.
L’occasion est seure, et nul à ce courage
Ce jour nuire ne peult, qu’on ne te face hommage.
Cesar cuide pour vray que ja nous soyons prestes
D’aller, et de donner tesmoignage des questes.
CLEOPATRE.
Mourons donc, cheres soeurs, ayons plustost ce coeur
De servir à Pluton qu’à Cesar, mon vainqueur :
Mais, avant de mourir, faire il nous conviendra
Les obseques d’Antoine, et puis mourir faudra.
Je l’ay tantost mandé à Cesar, qui veult bien
Que Monseigneur j’honore, helas ! et l’ami mien.
Abaisse toy donc, ciel, et avant que je meure,
Viens voir le dernier dueil qu’il faut faire à ceste heure ;
Peut estre tu seras marry de m’estre tel,
Te faschant de mon dueil estrangement mortel.
Allons donc, cheres sœurs ; de pleurs, de cris, de larmes,
Venons nous affoiblir, à fin qu’en ses alarmes
Nostre voisine mort nous soit ores moins dure,
Quand aurons demi fait aux esprits ouverture.
LE CHŒUR.
Mais où va, dites moy, dites moy, damoyselles,
Où va ma Roine ainsi ? quelles plaintes mortelles,
Quel soucy meurdrissant ont terni son beau teint ?
Ne l’avoit pas assez la seiche fiebvre atteint ?
CHARMIUM.
Triste elle s’en va voir des sepulchres le clos,
Où la mort a caché de son ami les os.
LE CHŒUR.
Que sejournons nous donc ? Suivons nostre maistresse.
ERAS.
Suivre vous ne pouvez, sans suivre la destresse.
LE CHŒUR.
Le gresle petillante
Dessus les toits
Et qui mesme est nuisante
Au verd des bois,
Contre les vins forcene
En sa fureur,
Et trompe aussi la peine
Du laboureur :
N’estant alors contente
De son effort,
Ne met toute l’attente
Des fruits à mort.
Quand la douleur nous jette
Ce qui nous poind,
Pour un seul sa sagette
Ne blesse point.
Si nostre Roine pleure,
Lequel de nous
Ne pleure point à l’heure ?
Pas un de tous.
Mille traits nous affolent,
Et seulement
De l’envieux consolent
L’entendement.
Faisons ceder aux larmes
La triste voix,
Et souffrons les alarmes
Tels que ces trois.
Ja la Roine se couche
Pres du tombeau,
Elle ouvre ja sa bouche :
Sus donc tout beau.
CLEOPATRE.
Antoine, ô cher Antoine, Antoine, ma moitié,
Si Antoine n’eust eu des cieux l’inimitié,
Antoine, Antoine, helas ! dont le malheur me prive,
Entens la foible voix d’une foible captive,
Qui de ses propres mains avoit la cendre mise
Au clos de ce tombeau, n’estant encore prise ;
Mais qui, prise et captive à son malheur guidee,
Sujette et prisonniere en sa ville gardee,
Ore te sacrifie, et non sans quelque crainte
De faire trop durer en ce lieu ma complainte,
Veu qu’on a l’œil sus moy, de peur que la douleur
Ne face par la mort la fin de mon malheur :
Et à fin que mon corps de sa douleur privé
Soit au Rommain triomphe en la fin reservé :
Triomphe, dy-je, las ! qu’on veult orner de moy,
Triomphe, dy-je, las ! que l’on fera de toy.
Il ne faut plus desor de moy que tu attendes
Quelques autres honneurs, quelques autres offrandes :
L’honneur que je te fais, l’honneur dernier sera
Qu’à son Antoine mort Cleopatre fera.
Et bien que toy vivant la force et violence
Ne nous ait point forcé d’écarter l’alliance,
Et de nous separer ; toutes fois je crains fort
Que nous nous separions l’un de l’autre à la mort,
Et qu’Antoine Rommain en Égypte demeure,
Et moy Egyptienne dedans Romme je meure.
Mais si les puissans Dieux ont pouvoir en ce lieu
Où maintenant tu es, fais, fais que quelque Dieu
Ne permette jamais qu’en m’entrainant d’ici,
On triomphe de toy en ma personne ainsi ;
Ains que ce tien cercueil, ô spectacle piteux
De deux pauvres amans, nous racouple tous deux,
Cercueil qu’encore un jour l’Égypte honorera
Et peut estre à nous deux l’epitaphe sera :
« Ici sont deux amans qui, heureux en leur vie,
D’heur, d’honneur, de liesse, ont leur ame assouvie :
Mais en fin tel malheur on les vit encourir,
Que le bon heur des deux fut de bien tost mourir ».
Recoy, recoy moy donc, avant que Cesar parte,
Que plustost mon esprit que mon honneur s’écarte :
Car entre tout le mal, peine, douleur, encombre,
Souspirs, regrets, soucis, que j’ay souffert sans nombre,
J’estime le plus grief ce bien petit de temps
Que de toy, ô Antoine, esloigner je me sens.
LE CHŒUR.
Voila pleurant, elle entre en ce clos des tombeaux.
Rien ne voyent de tel les tournoyans flambeaux.
ERAS.
Est-il si ferme esprit, qui presque ne s’envole
Au piteux escouter de si triste parole ?
CHARMIUM.
O cendre bien heureuse estant hors de la terre !
L’homme n’est point heureux tant qu’un cercueil l’enserre.
LE CHŒUR.
Auroit donc bien quelqu’un de vivre telle envie,
Qui ne voulust ici mespriser ceste vie ?
CLEOPATRE.
Allons donc, cheres soeurs, et prenons doucement
De nos tristes malheurs l’heureux allegement.
LE CHŒUR.
Strophe.
Plus grande est la peine,
Que l’outrageux sort
Aux amis ameine,
Que de l’Ami mort
N’est la joye grande,
Alors qu’en la bande
Des esprits heurez,
Esprits asseurez
Contre toute dextre,
Quitte se voit estre
Des maux endurez.
Antistrophe.
Chacune Charite
Au tour de Cypris,
Quand la dent dépite
Du sanglier épris
Occit en la chasse
De Myrrhe la race
Ne plouroit si fort,
Qu’on a fait la mort
D’Antoine, que l’ire
Transmit au navire
De l’oublieux port.
Epode.
Les cris, les plains
Des Phrygiennes,
Estans aux mains
Myceniennes,
N’estoyent pas tels,
Que les mortels
Que pour Antoine
Fait nostre Roine.
Strophe.
Mais ore j’ay crainte
Qu’il faudra pleurer
Nostre Roine esteinte,
Qui ne peut durer
Au mal de ce monde,
Mal qui se feconde,
Tousjours enfantant
Nouveau mal sortant :
On la voit delivre
Du desir de vivre,
Mille morts portant.
Antistrophe.
Tantost gaye et verte
La forest estoit,
La terre couverte
Sa Cerés portoit :
Flore avoit la pree
De fleurs diapree,
Quand pour tout ceci
Tout soudain voici
Cela qui les pille,
L’hyver, la faucille,
Et la faulx aussi.
Epode.
Ja la douleur
Rompt la liesse,
La joye, et l’heur
A ma Princesse ;
Reste le teint,
Qui n’est esteint ;
Mais la mort blesme
L’ostera mesme.
Strophe.
Elle vient de faire
L’honneur au cercueil :
O ! qu’elle a peu plaire
Et deplaire à l’œil,
Plaire, quand les roses
Ont esté decloses,
Avec le Cyprés,
Mille fois aprés
Baisotant la lame,
Qui semble à son ame
Faire les aprests.
Antistrophe.
Versant la rosee
Du fond de son cœur,
Par les yeux puisee,
Et puis la liqueur
Que requiert la cendre :
Et faisant entendre
Quelques mots lachez,
Bassement machez,
Pour fin de la feste
Meslant de sa teste
Les poils arrachez.
Epode.
Elle a depleu,
Pource qu’il semble
Qu’elle n’a peu
Que vivre ensemble,
Et que soudain
De nostre main
Luy faudra faire
Un mesme affaire.
== ACTE V ==
PROCULEE, LE CHŒUR.
PROCULEE.
O juste Ciel, si ce grief malefice
Ne t’accusoit justement d’injustice,
Par quel destin de tes Dieux conjuré,
Ou par quel cours des astres mesuré,
A le malheur pillé telle victoire,
Qu’en la voyant on ne la pourroit croire ?
O vous, les Dieux des bas enfers et sombres,
Qui retirez fatalement les ombres
Hors de nos corps, quelle palle Megere
Estoit commise en si rare misere ?
O fiere terre, à toute heure souillee
Des corps des tiens, et en leur sang touillee,
As tu jamais soustenu sous les flancs
Quelque fureur de courages plus grands ?
Non, quant tes fils Jupiter eschellerent,
Et contre luy serpentins se meslerent.
Car eux, pour estre exemps du droit des cieux,
Voulurent mesme embuscher les grands Dieux,
Desquels en fin fierement assaillis,
Furent aux creus de leurs monts recueillis,
Mais ces trois ci, dont le caché courage
N’eust point esté mescreu de telle rage,
Qui n’estoient point geantes serpentines,
En redoubalnt leurs rages feminines,
Pour au vouloir de Cesar n’obeir,
Leur propre vie ont bien voulu trahir.
O Jupiter ! ô Dieux ! quelles rigueurs
Permets tu donc à ces superbes cœurs ?
Quelles horreurs as tu fait ores naistre,
Qui des nepveux pourront aux bouches estre,
Tant que le tour de la machine tienne
Par contrepois balancé se maintienne ?
Dictes moy donc, vous, brandons flamboyans,
Brandons du Ciel toutes chose voyans,
Avez-vous peu dans ce val tant instable
Découvrir rien de plus espouventable ?
Accusez-vous maintenant, ô Destins,
Accusez-vous, ô flambeaux argentins :
Et toy, Égypte, à l’envie matinee,
Maudi cent fois l’injuste destinee :
Et toy, Cesar, et vaus autres, Romains,
Contristez vous ; la Parque de vos mains
A Cleopatre à ceste heure arrachee,
Et maugré vous vostre attente empeschee.
LE CHŒUR.
O dure, helas ! et trop dure avanture,
Mille fois dure et mille fois trop dure !
PROCULEE.
Ha ! je ne puis à ce crime penser,
Si je ne veux en pensant m’offenser :
Et si mon cœur à ce malheur ne pense,
En le fermant, je luy fais plus d’offense.
Escoutez donc, Citoyens, escoutez,
Et m’escoutant, vostre mal lamentez.
J’estois venu pour le mal supporter
De Cleopatre, et la reconforter,
Quand j’ay trouvé ces gardes qui frappoyent
Contre sa chambre, et sa porte rompoyent,
Et qu’en entrant en ceste chambre close,
J’ay veu (ô rare et miserable chose)
Ma Cleopatre en son royal habit
Et sa couronne, au long d’un riche lict
Peint et doré, blesme et morte couchee,
Sans qu’elle fust d’aucun glaive touchee,
Avecq’Eras, sa femme, à ses pieds morte,
Et Charmium vive, qu’en telle sorte
J’ay lors blamee ; A, a, Charmium, est-ce
Noblement faict ? Ouy, ouy, c’est de noblesse
De tant de Rois Egyptiens venue
Un tesmoignage. Et lors peu soustenue
En chancelant, et s’accrochant en vain,
Tombe à l’envers, restant un tronc humain,
Voila des trois la fin espouventable,
Voila des trois le destin lamentable :
L’amour ne peut separer les deux corps,
Qu’il avoit joints par longs et longs accords ;
Le Ciel ne veut permettre toute chose,
Que bien souvent le courageux propose.
Cesar verrra, perdant ce qu’il attent,
Que neul ne peut au monde estre contant :
L’Égypte aura renfort de sa destresse,
Perdant, après son bon heur, sa maistresse :
Mesmement moy qui suis son ennemi,
En y pensant, je me pasme à demi,
Ma voix s’infirme, et mon penser defaut :
O ! qu’incertain est l’ordre de là haut !
LE CHŒUR.
Peut on encores entendre
De toy, troupe, quelque voix ?
Peux tu ceste seule fois
De ton deuil la plainte rendre,
Veu que, helas ! tant douloureuse,
De ton support le plus fort
Tu ne remets qu’en la mort,
Mort, helas ! à nous heureuse ?
Mais prens, prens donc ceste envie
Sur le plus blanc des oiseaux,
Qui sonne au bord de ses eaux
La retraite de sa vie.
Et en te débordant mesme,
Despite moy tous les cieux,
Despite moy tous leurs Dieux,
Autheurs de ton mal extreme.
Non, non, ta douleur amere,
Quand j’y pense, on ne peut voir
Si grande, que quelque espoir
Ne te reste en ta misere.
Ta Cleopatre ainsi morte
Au monde ne perira :
Le temps la garantira,
Qui desja sa gloire porte,
Depuis la vermeille entree
Que fait ici le Soleil,
Jusqu’au lieu de son sommeil
Opposez à ma contree.
Pour avoir, plustost qu’en Romme
Se souffrir porter ainsi,
Aimé mieux s’occire ici,
Ayant un cœur plus que d’homme.
PROCULEE.
Que diray-je à César ? ô l’horreur
Qui sortira de l’estrange fureur !
Que dira-t-il de mourir sans blessure
En telle sorte ? Est-ce point par morsure
Se quelque Aspic ? auroit-ce point esté
Quelque venin secrettement porté ?
Mais tant y a qu’il faut que l’esperance,
Que nous avions, cede à ceste constance.
LE CHŒUR.
Mais tant y a qu’il nous faudra renger
Dessous les lois d’un vainqueur estranger,
Et desormais en nostre ville apprendre
De n’oser plus contre Cesar méprendre,
Souvent nos maux font nos morts desirables,
Vous le voyez en ces trois miserables.