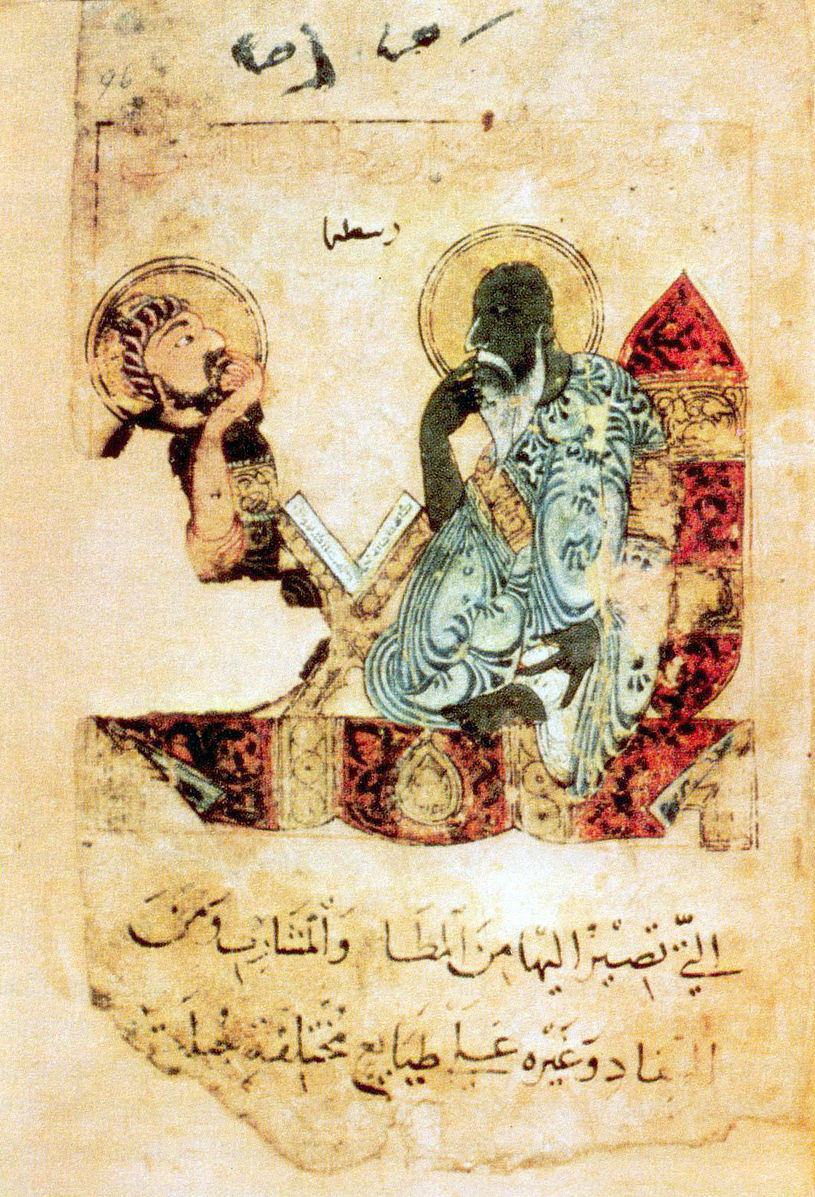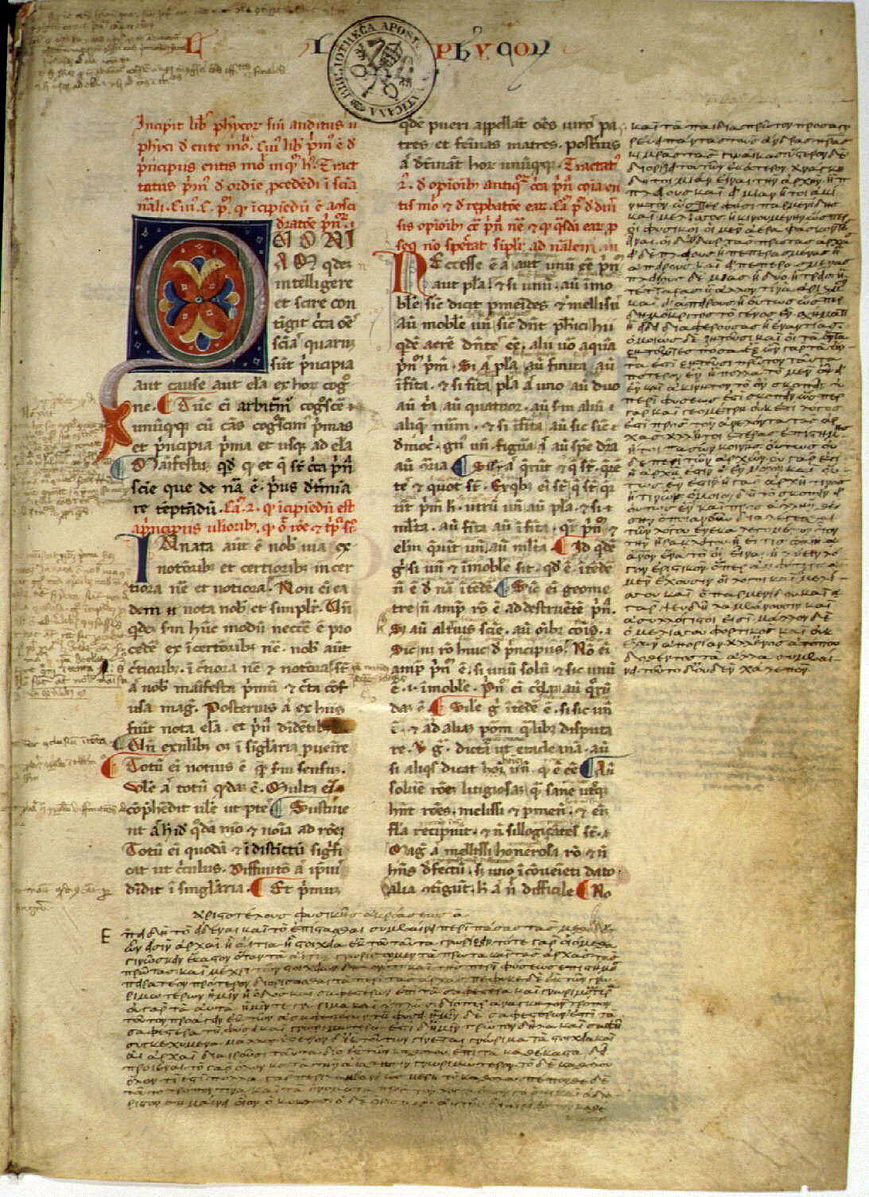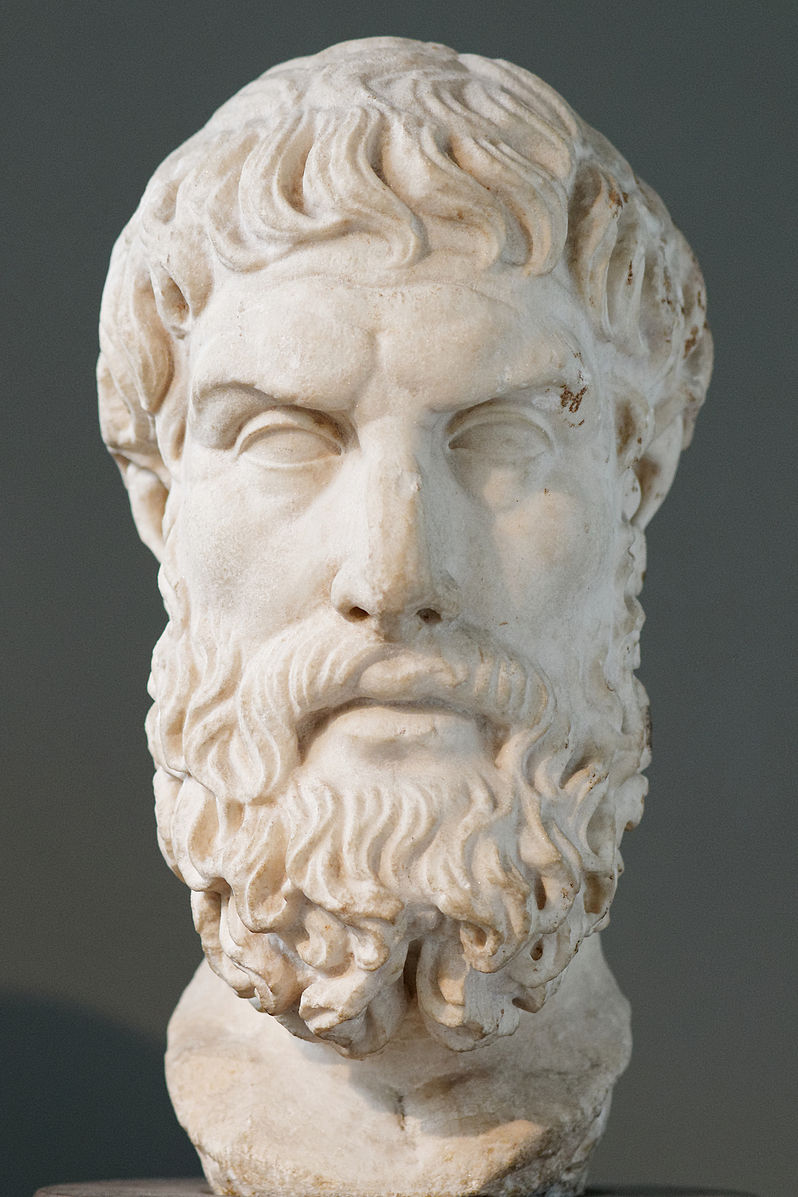Le caractère réactionnaire des propos du soir à Yenchan
et de la chronique du Village des Trois
par Yao Wen-yuan
1966
Le 16 avril, la revue Qianxian (Front) et le Beijing Ribao (Quotidien de Pékin) ont publié un texte sous le titre »Critique du ‘Village des Trois’ et des Propos du soir à Yenchan », qu’ils ont accompagné d’une note des rédactions dans laquelle on lisait :
« Notre revue et notre journal commirent l’erreur de publier ces articles sans les soumettre en temps utile à la critique.
La raison en est que nous n’avions pas placé la politique prolétarienne au poste de commandement et que nous étions influencés par l’idéologie bourgeoise et féodale.
C’est ainsi que nous nous étions écartés de notre position et avions relâché notre vigilance dans le sévère combat qui se menait ».
C’est là un grossier mensonge.
Les Propos du soir à Yenchan ont pour auteur Teng Touo, tandis que le «Village des Trois » est en quelque sorte une sinistre auberge tenue par Teng Touo, Liao Mocha et Wou Han. Teng Touo était le rédacteur en chef du Qianxian.
Il contrôlait et monopolisait les postes dirigeants du travail idéologique et culturel de la municipalité de Pékin. Ses collaborateurs du « Village des Trois » et lui-même firent du Qianxian, du Beijing Ribao et du Beijing Wanbao (Pékin-soir) etc., des instruments dirigés contre le Parti et le socialisme. Ces publications poursuivirent fiévreusement une ligne opportuniste de droite, antiparti, antisocialiste, c’est-à-dire révisionniste ; elles se firent les porte-paroles des classes réactionnaires et des opportunistes de droite, qui attaquaient notre Parti.
Peut-il n’être question que d’un « relâchement de la vigilance » et de n’avoir « pas soumis en temps utile à la critique » ces articles ? Comment peuvent-elles prétendre n’avoir été que quelque peu « influencées » par l’idéologie bourgeoise, après avoir distillé tant de venin contre le Parti et le socialisme ?
Cette énorme supercherie doit être dénoncée à fond.
Tout le monde se souvient que Teng Touo fit mine d’adopter une position juste au moment où commença la critique de La destitution de Hai Jouei.
A la suite d’intenses intrigues et machinations, il fit paraître simultanément dans le Beijing Ribao et le Qianxian, sous le pseudonyme de Hsiang ïang cheng, un long article intitulé « De La destitution de Hai Jouei au problème de l’héritage des valeurs morales ».
Cet article, qui visait à sauver Wou Han au nom de la «critique », n’est qu’une grande plante vénéneuse, il est antiparti et antimarxiste à cent pour cent.
La place accordée par le Beijing Ribao et le Qianxian à l’article dans lequel Teng Touo «critiquait » Wou Han, était-elle uniquement due à un « relâchement de la vigilance » ? A une «négligence dans la lutte de classe sur les fronts culturel et académique » ?
Loin de là.
Ces deux publications étaient au contraire fort « vigilantes ». Elles accordaient une très grande importance à leur «lutte de classe » contre le Parti et le peuple.
Lorsque le problème de Wou Han ne put plus être dissimulé, on s’empressa de faire faire à Teng Touo une «critique » pour la forme ; mais celui qui a longtemps joué un rôle négatif ne parvient pas à se montrer convaincant dans un rôle positif, et les lacunes furent nombreuses.
Ayant perdu tout espoir de sauver Teng Touo. Elles se livrent maintenant à la hâte, au nom de leurs rédactions, à une nouvelle « critique » pour la forme et combattent pied à pied pour empêcher que la lutte ne gagne en profondeur. Tout ce trompe-l’œil est néanmoins encore plus maladroit, les lacunes sont encore plus nombreuses.
Elles prétendent qu’elles n’ont pas su « placer la politique prolétarienne au poste de commandement » ni « soumettre en temps utile à la critique » ces articles, et tout cela ne vise qu’à donner le change, car elles cherchent, par leur « critique » formelle de Teng Touo et du « Village des Trois », à faire croire aux lecteurs et au Parti qu’elles sont du bon côté.
Comment peuvent-elles tirer le problème au clair en adoptant pareille attitude ?
Comment peuvent-elles « se livrer à une critique sérieuse » ? La note des rédactions indique que Wou Han «n’a cessé de défendre les opportunistes de droite destitués de leurs fonctions ».
Il leur faut admettre aujourd’hui ce qu’elles ont vainement cherché à dissimuler.
La note ajoute que Liao Mocha est « un meneur qui s’oppose consciemment au Parti, au socialisme et à la pensée de Mao Zedong ».
Mais parlant de Teng Touo à la fin, elle en dit simplement qu’il a « glorifié les morts et recommandé obstinément de se mettre à leur école. . .
Il a largement propagé les idées féodales et bourgeoises, il s’est opposé au marxismeléninisme et à la pensée de Mao Zedong ».
En revanche, il n’est nullement fait mention de ses activités antiparti, antisocialistes, et l’ensemble en devient donc 5difficilement croyable.
L’abondant venin que contiennent les 150 et quelques articles des Propos du soir à Yenchan et la Chronique du Village des Trois ne ferait-il que préconiser «de se mettre à l’école des morts » et propager largement les idées féodales et bourgeoises ? Ne constituerait-il qu’une erreur idéologique et non un problème politique ?
Peut-on penser, en toute logique, que deux des auteurs du « Village des Trois » étant antiparti et antisocialistes, le troisième, qui a écrit le plus, ne fait que « recommander de se mettre à l’école des morts » ?
La rodomontade s’est achevée en dérobade, la critique pour la forme ne visait qu’à l’esquive, et par une « critique » à grande mise en scène, les deux publications essaient tout simplement de contrecarrer les instructions du Comité central du Parti. N’est-ce pas très clair ?
L’article paru sous le titre « Que préconisaient, en fin de compte, les Propos du soir à Yenchan ? » et destiné à étayer la note des rédactions, occupe deux pages entières du Beijing Ribao, mais il cherche, lui aussi, à masquer le problème politique qui est aigu.
Il a pour intertitres : « Où l’on déformait la politique du Parti ‘que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent’, en donnant libre cours à l’idéologie bourgeoise », « Où l’on idéalisait tous les aspects du système féodal », « Où les cadavres de l’époque féodale servaient à rendre vie à la bourgeoisie », « Où l’on propageait la décadente philosophie de l’existence qui est celle des classes exploiteuses ».
« Où l’on utilisait le passé pour faire la satire du présent : insinuations ».
Ces intertitres révèlent les penchants et l’opinion des rédacteurs.
On veut, par ce procédé, faire croire aux lecteurs que les Propos du soir à Yenchan ne contenaient rien, ou fort peu de chose, qui fût contre le Comité central du Parti et le président Mao ou en faveur des opportunistes de droite, qu’ils n’avaient pas le caractère de La destitution de Haï Jouei.
« La déformation de la politique du Parti « que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent » a été nettement mise en évidence dans la première partie de l’article, tandis que la section « Où l’on utilisait le passé pour faire la satire du présent » figure en fin d’article ; elle n’a que quelques phrases, est agrémentée de quelques commentaires succincts et assortie d’un ou deux exemples pour parvenir à l’effet recherché.
Quiconque est capable de discernement décèlera au premier coup d’œil le but dans lequel les rédacteurs se donnent tout ce mal.
Notre enquête nous a cependant révélé tout autre chose. Un grand nombre de commentaires politiques qui calomnient perfidement le Comité central du Parti et le président Mao, qui soutiennent les opportunistes de droite et attaquent la ligne générale et la cause du socialisme, ont été passés sous silence ou abrégés ; pour en minimiser la gravité, les rédacteurs ont inséré dans d’autres sections de l’article certains commentaires dont la perfidie était plus particulièrement flagrante, qui se servaient du passé pour faire la satire du présent, et qui attaquaient le Parti et le socialisme ; on n’y trouve pas un seul mot sur l’influence pernicieuse des Propos du soir à Yenchan dans l’ensemble du pays.
D’autre part, les extraits qui ne touchent pas aux problèmes vitaux sont présentés en grande pompe.
Par là, les rédacteurs tentent de réduire l’importance des grands problèmes et de les esquiver. Ils ont en particulier dissimulé le fait que la majorité des articles attaquant le Parti, écrits durant cette période par Teng Touo, Wou Han et Liao Mocha, n’étaient pas sans lien entre eux, mais bien l’œuvre de l’association du «Village des Trois », qui avait un commandant, un plan et agissait en étroite coordination.
Wou Han était à l’avant, Liao Mocha le suivait de près, mais le vrai « commandant » de ces trois chevaliers, le patron et le tenancier de la sinistre auberge qu’est le « Village des Trois », n’était autre que Teng Touo.
Le camarade Mao Zedong nous a appris que «nous devons défendre fermement la vérité et la vérité exige une prise de position nette » (Causerie pour les rédacteurs du Quotidien du Chansi-Soueiyuan).
Des apparences trompeuses de mille sortes se manifestent inévitablement dans toute lutte de classes aiguë et complexe. Ce n’est qu’en levant haut et sans équivoque le drapeau révolutionnaire de la pensée de Mao Zedong en s’en tenant aux principes et à la vérité, en exposant sans réticence ni ambiguïté la nature réelle des choses que l’on évitera de se laisser tromper par les apparences.
Le Qianxian et le Beijing Ribao ayant brusquement soulevé le problème des Propos du soir à Yenchan et de la Chronique du 9Village des Trois, tout en cachant la vérité, les révolutionnaires ont naturellement le devoir de dénoncer complètement le caractère réactionnaire de ces œuvres.
En dépit de leur contenu vaste et complexe, nous pouvons, en procédant par analyse, déceler qu’une ligne noire, antiparti et antisocialiste, les parcourt tout au long, comme il en va de Hai Jouei invective l’empereur et de La destitution de Hai Jouei, et que cette ligne noire a, au cours de ces dernières années, amené de sombres nuées dans le ciel politique de la Chine.
Le moment est de révéler entièrement ce qui se trouve à l’intérieur de cet le grande et sinistre auberge qu’est le « Village des Trois » !
COMMENT ONT DÉBUTÉ LES PROPOS DU SOIR A YENCHAN
ET LA CHRONIQUE DU VILLAGE DES TROIS !
Les Propos du soir à Yenchan et la Chronique du Village des Trois ont suivi de près La destitution de Hai Jouei. Ils représentaient une attaque d’envergure, minutieusement machinée, orientée, planifiée et organisée contre le Parti et le socialisme par le « Village des Trois ».
Un coup d’œil à la chronologie des événements nous permettra 10d’en sonder les profondeurs.
La destitution de Hai Jouei a paru en janvier 1961 dans la revue Beijing Wenyi (Arts et lettres de Pékin).
Le caractère réactionnaire de cette pièce est maintenant de plus en plus clair.
Elle vise la réunion de Louchan, le Comité central du Parti dirigé par le camarade Mao Zedong, et cherche à remettre en cause les décisions adoptées à cette réunion.
Il y est proclamé que la « destitution de Hai Jouei, fonctionnaire intègre », autrement dit des opportunistes de droite, est « injuste » et que ces derniers doivent reprendre l’administration des « affaires de la cour », c’est-à-dire l’application de leur programme révisionniste.
A cette époque-là, l’auteur désirait ardemment appuyer la rentrée en scène des opportunistes de droite et restaurer le capitalisme.
C’était aussi le désir commun des «frères » du «Village des Trois ».
Dès sa publication, la pièce fut encensée et approuvée par certains ; et les « frères » du « Village des Trois » ne purent contenir leur joie, s’imaginant que leur avant-garde avait gagné la première manche.
S’apprêtant au combat, Liao Mocha écrivait dans le Beijing Wanhao du 2 janvier 1961 : « Les tambours sonnent la fin de l’hiver, l’herbe du printemps se met à pousser », « une grande action sera engagée au printemps ».
C’était, pour le « trio », le début du printemps. Puis, le 16 février, en guise d’« encouragement », Liao Mocha adressa à Wou Han une lettre ouverte dans laquelle il le « félicitait » d’« être sorti en enfonçant la porte ».
Il lui souffla « une division du travail et une coopération » entre l’« histoire » et le ‘ »théâtre »’. Le 18 février, Wou Han, en tant qu’avant-garde, répondit à son «frère » : «Puis-je te suggérer, mon cher, de sortir aussi en enfonçant la porte ? »
Se frappant la poitrine, il poursuivait : « Tu dis que je suis sorti en enfonçant la porte ; tu vois juste et c’est précisément ce que je voulais. C’est indispensable. »
Quelle agressivité, quel air menaçant ! Il semblait vraiment qu’il voulût en finir.
Il croyait que l’heure de l’offensive était là, que les tambours d’hiver avaient résonné avec la publication clé La destitution de Haï Jouei, et qu’ils devaient s’apprêter tous pour la « grande action ».
Le 25 février 1961, une semaine après avoir crié « il faut enfoncer cette porte », Wou Han, dans son article « Tribunes libres et Cent écoles rivalisent », s’exclama : « Nous devons organiser des ‘tribunes libres’ aux divers échelons et ce jusqu’à l’échelon car les gens à l’échelon de base dans leur travail pratique sont en contact aven la réalité, les problèmes qu’ils rencontrent sont d’autant plus concrets, plus frappants et plus circonscrits. »
Il appela ceux qui, à l’échelon de base, avaient « des arrière-pensées » à entrer en action.
Il clama qu’il voulait « balayer tous les obstacles qui encombrent le chemin de la rivalité entre cent écoles ». Et il prit plaisir à se vanter : «Peut-être puis-je être considéré comme un intellectuel avec plus de quarante ans d’étude, une vingtaine d’années d’enseignement supérieur et les quelques livres que j’ai écrits. »
Il estimait donc, avec son capital et le soutien de ses patrons dans les coulisses, que le moment était venu pour eux, les intellectuels bourgeois anticommunistes, d’entrer en scène et de montrer les prouesses dont ils étaient capables.
En mars 1961, aux accents des tambours et des gongs et dans le climat d’« euphorie » né de la noire tourmente provoquée par La destitution de Hai Jouei, et après que Wou Han eut « déblayé le chemin » avec son bâton, le général Teng Touo entra en scène. Avec ses Propos du soir à Yenchan, il « sortit en enfonçant la porte », « à la demande des amis ».
Il dit qu’il avait été « obligé de se mettre en selle », mais c’était faux. On l’avait plutôt « prié de se mettre en selle ». L’avant-garde ayant déblayé le chemin, et l’autre «frère » tenant le fouet pour lui, le moment n’était-il pas venu pour lui, le général, de se mettre en selle ?
La Chronique du Village des Trois suivit de près la préface que Wou Han avait écrite pour La destitution de Hai Jouei. En août 1961, les classes réactionnaires du pays intensifiant leurs attaques, Wou Han souligna dans sa préface que « cette pièce met l’accent sur la droiture de Hai Jouei, sur sa volonté de ne pas se laisser intimider par la force, ni décourager par l’échec et de recommencer après l’échec ».
Il encouragea et aida activement les opportunistes de droite «destitués de leurs fonctions », à reprendre leurs attaques contre 14le Parti.
Il se complut, dans, cette préface, à raconter comment ses « amis » l’avaient aidé dans ses projets et déclara que son «modeste effort était destiné à susciter de plus grandes contributions », qu’il voulait « faire pousser » en grand nombre des plantes vénéneuses.
Puis, le 5 octobre 1961, dans un article intitulé « Se préoccuper de tout », paru dans la rubrique des Propos du soir à Yenchan, Teng Touo cita le couplet suivant :
Le bruit du vent, de la pluie et de la lecture me remplit les oreilles ;
Les affaires de la famille, du pays et du monde me préoccupent toutes.
Il déclara avec beaucoup de sentiment : « cela exprime pleinement les aspirations politiques des membres du parti Tonglin de ce temps-là », «ce couplet a une très profonde signification en vérité ».
Le parti Tonglin était, sous la dynastie des Ming, un « parti d’opposition » au sein de la classe des propriétaires fonciers. Si Teng Touo admirait tant « les aspirations politiques des 15membres du parti Tonglin », c’est que l’expression « parti d’opposition » trouvait en lui une résonance toute particulière. Il est évident que le « bruit du vent et de la pluie », l’état d’agitation dû à cette pluie et à ce vent malfaisants ont poussé Teng Touo à poursuivre la réalisation de ses « aspirations politiques », à « se préoccuper de tout », et à attaquer plus ouvertement encore le Parti et le socialisme !
Quelques jours après, le 10 octobre 1961, la revue Qianxian, dont Teng Touo était le rédacteur en chef, arbora ouvertement l’enseigne du « Village des Trois ».
Une officine clandestine était ainsi devenue une société en commandite.
Le « trio » concentra ses tirs et dès les premiers numéros, les coups les plus perfides, dont l’article « Les grandes paroles creuses »’, furent portés contre la direction du Comité central du Parti.
Les Propos du soir à Yenchan et la Chronique du Village des Trois parus après La destitution de Hai Jouei, poursuivent l’attaque, organisée et orchestrée, menée pas à pas contre le Parti. Il est nécessaire d’établir le lien existant entre les écrits du «trio » si l’on veut mettre complètement à jour les secrets de cette sinistre auberge.
UNE LIGNE NOIRE ET DES RAFALES D’UN VENT MAUVAIS
Teng Touo a expliqué comment étaient choisis les sujets des Propos du soir à Yenchan : « Il m’arrivait souvent de penser a des choses, de voir ou d’entendre dire des choses de sentir qu’il y avait un problème ; et voilà mon sujet trouvé. »
Que pouvaient bien être ces choses que « voyait » Ten Touo, lui qui occupait une position dirigeante ?
Et qui donc étaient ces gens qu’il « entendait » parler ? Ses remarques montrent que ses Propos du soir étaient destinés à traiter de « problèmes » de la vie réelle qui suscitaient son mécontentement.
Une partie de ses thèmes perfides, antiparti et antisocialistes figurent parmi les choses qu’il avait d’abord «entendu dire » et en suite mises par écrit.
Le point de départ et le thème de ces chroniques étaient invariablement un important problème politique, lié de façon frappante à la réalité, et ce n’était pas une simple manière d’« idéaliser les anciens ».
Cette clé, que nous devons à l’auteur lui-même, nous permet de voir clairement que la ligne noire antiparti, antipopulaire et antisocialiste qui court à travers les Propos du soir et la Chronique du Village des Trois est la même que celle de Hai Jouei invective l’empereur et de La destitution de Hai Jouei : elle est faite de calomnies et d’attaques contre le Comité central du Parti dirigé par le camarade Mao Zedong ; d’attaques contre la ligne générale du Parti ; de soutien plein et entier aux attaques des opportunistes de droite qui avaient été «démis » de leurs «fonctions », pour tenter d’obtenir que soient rapportées les justes décisions prises antérieurement à leur encontre ; de soutien enfin aux furieuses attaques des forces féodales et capitalistes.
Au fur et à mesure que des changements intervenaient dans la situation de la lutte des classes à l’intérieur et à l’étranger, et que les trois « pensaient » à des «problèmes », qu’ils « voyaient » des «problèmes » et «entendaient parler » de « problèmes », ils orientaient leurs attaques dans tel ou tel sens, pratiquaient la «division du travail et la coopération », se faisaient mutuellement écho et s’entendaient comme larrons en foire pour soulever une vague noire après l’autre, une rafale de vent funeste après l’autre.
La neuvième session plénière du Comité central issu du VIII Congrès du Parti, qui eut lieu en janvier 1961, disait : « Les grands succès obtenus par la Chine au cours des trois années écoulées montrent que la ligne générale du Parti pour l’édification socialiste, le grand bond en avant et la commune populaire sont conformes à la réalité de la Chine » ; elle disait encore : «En raison des sérieuses calamités naturelles qui ont affecté la production agricole au cours de deux années consécutives, en 1961, toute la nation doit concentrer ses forces sur le renforcement du front agricole. »
Le communiqué de la session plénière indiquait sans ambiguïté : « … il y a encore un petit nombre de propriétaires fonciers et d’éléments bourgeois mal rééduqués représentant un pourcentage minime de la population . . . et qui aspirent toujours à une restauration. . . Ils ont mis à profit des difficultés provoquées par des calamités naturelles et certains défauts dans le travail des organismes de base pour entreprendre des activités de sabotage » (Communiqué de la neuvième session plénière du Comité central issu du VIIIe Congrès du Parti communiste chinois).
Ces éléments soulevèrent un vent funeste antiparti et antisocialiste, ils firent l’impossible pour dénigrer et calomnier la cause socialiste du Parti et du peuple, et, dans le vain espoir de torpiller la ligne générale du Parti, ils insultèrent son Comité central.
Répondant aux besoins politiques des éléments de la bourgeoisie et de la classe des propriétaires fonciers qui tentaient d’opérer un retour, les Propos du soir à Yenchan, qui firent leur apparition peu après la session plénière, mirent à profit certaines difficultés économiques causées par les graves calamités naturelles pour lancer une série d’attaques perfides contre la ligne générale et apporter leur soutien aux activités menées dans le sens d’une restauration par la bourgeoisie et la classe des propriétaires fonciers.
Le 26 mars 1961, Teng Touo lançait l’appel : «Salut aux personnes de grande culture ».
Qui donc étaient ces « personnes de grande culture » ? C’étaient, disait-il, des hommes «pourvus d’un large éventail de connaissances », des hommes «plus ou moins versés dans les choses les plus diverses ».
«Les savants en renom du temps jadis, disait-il, se classaient tous plus ou moins parmi les personnes de grande culture ». Et d’ajouter cet avertissement au Parti : « Ce sera une grande perte pour nous si nous ne reconnaissons pas la grande importance que revêt pour le travail de direction sous toutes ses formes et pour la recherche scientifique, l’ample éventail de connaissances des personnes de grande culture ». Notez bien ces mots : « le travail de direction… » Voilà le point crucial.
De ces paroles de Teng Touo, il ressort à l’évidence que ces « personnes de grande culture » n’étaient autres que ces éléments mal rééduqués de la bourgeoisie, de la classe des propriétaires fonciers, et des milieux intellectuels de ces classes, une poignée de personnages au caractère politique douteux, et ces réactionnaires qu’étaient les « savants » de la bourgeoisie et de la classe des propriétaires fonciers.
Dans toute cette cohorte d’ombres — empereurs, généraux et ministres, oiseaux de tout vol, féodaux à tous crins et charlatans du genre géomanciens — il n’est pas un de ces personnages que Teng Touo évoquait avec une sacro-sainte vénération dans ses articles qui n’ait ses tablettes ancestrales au temple des «personnes de grande culture ».
Se faisant un capital de leur « savoir », ce genre de personnages ne cesse de faire des pieds et des mains pour se glisser dans nos rangs, se hisser jusqu’aux postes de direction des divers échelons et y travailler à la transformation du caractère de la dictature du prolétariat.
En demandant que nous prenions dûment en considération la «grande importance » qu’avaient, pour le « travail de direction », les « personnes de grande culture », Teng Touo exigeait en fait que le Parti ouvrît les portes et laissât ces « personnes de grande culture », qui empruntaient la voie capitaliste, se saisir des rênes «dans le travail de direction sous toutes ses formes » et dans «la recherche scientifique » — autrement dit, dans les domaines académique et idéologique —, et ainsi préparer l’opinion publique à la restauration du capitalisme.
Il se présentait quant à lui comme une «personne de grande culture » de premier ordre.
C’était l’époque où certains éléments bourgeois pressaient la « direction » de « prendre dûment en considération » leur « ample éventail de connaissances » touchant la manière de pratiquer l’exploitation capitaliste.
Ne songeaient-ils pas à faire usage de leur « savoir pour transformer les entreprises socialistes en entreprises capitalistes ?
L’appel : « Salut aux personnes de grande culture », lancé par le « Village des Trois » pour appuyer l’accaparement de la direction par les membres des classes exploiteuses ne doit pas être envisagé comme des paroles en l’air.
Les « personnes de grande culture » du « Village des Trois » ne contrôlaient-elles pas un certain nombre de «postes de direction » ?
Dans sa chronique « Mieux vaut guider que barrer la route », publiée le 13 avril 1961, Teng Touo demandait de nouveau que « toute chose » soit « activement guidée de façon à se développer favorablement ».
« Barrer la route au mouvement et au développement des choses » est une entreprise «vouée à l’échec ».
« Toute chose », notez-le bien, y compris tout ce qui est ténébreux et réactionnaire, donc antiparti et antisocialiste. Si nous entendons poursuivre dans la voie socialiste, nous devons barrer la route à la restauration du capitalisme ; si nous entendons soutenir tout ce qui est naissant et révolutionnaire, nous devons nous attaquer à tout ce qui est décadent et contre-révolutionnaire.
« Pas de construction sans destruction, pas de courant sans digue, et pas de mouvement sans repos. » Pour frayer la voie à la marée révolutionnaire, il nous faut endiguer le flux de la réaction.
En demandant que, loin de «barrer la route », nous aidions «toute chose », y compris les choses antisocialistes, à « se développer favorablement ». Teng Touo ne nous demandait-il pas clairement de procéder à la libéralisation bourgeoise, de courber la tête et de capituler face aux tendances funestes qui se manifestaient à cette époque et qui se nommaient «faire son chemin » (c’est-à-dire la restauration de l’économie individuelle) et « étendre les parcelles individuelles et les marchés libres, multiplier les petites entreprises assumant l’entière responsabilité de leurs profits et de leurs pertes, fixer les normes de production sur la base de la famille ». . .?
« Guider » signifiait frayer la voie, et ces gens-là se présentaient comme « l’avant-garde qui fraye la voie » aux forces capitalistes. Le «Village des Trois » comptait sur l’« échec » du socialisme et sur le « triomphe certain » du vent noir de la restauration capitaliste, il pensait qu’il pouvait désormais se jeter ouvertement dans les bras des forces réactionnaires qui tendaient au « développement » du capitalisme !
Le 30 avril 1961, dans un article intitulé « Théorie du ménagement clé la force de travail », Teng Touo nous attaqua directement, nous accusant de ne pas «ménager la force de travail ».
Plaçant la dictature du prolétariat et celle clé la classe des propriétaires fonciers sur le môme pied, il soutint que « déjà vers l’époque de Tchouentsieou et des Royaumes Combattants », « à travers l’expérience de leur domination », les classes exploiteuses « avaient découvert certaines lois objectives gouvernant l’augmentation et la diminution de la force de travail » et elles étaient à même de calculer les limites de « la force de travail à utiliser dans divers types de construction de base ».
Teng Touo demandait que «nous tirions de nouvelles lumières de l’expérience des anciens, et que nous fassions plus dans tous les domaines pour ménager notre force de travail ». Or, tout le monde sait que notre force de travail, nous la ménageons plus que quiconque.
Tout le travail du Parti communiste chinois est dicté par les intérêts fondamentaux des grandes masses populaires et il est de tout cœur au service du peuple.
En revanche, dans toute l’histoire, la classe des propriétaires d’esclaves et celle des propriétaires fonciers n’ont fait qu’exploiter le peuple travailleur avec une avidité et une cruauté sans bornes, poussant ainsi les esclaves et les paysans à déclencher une grande révolte après l’autre.
Comment auraient-elles pu connaître les « lois objectives gouvernant l’augmentation et la diminution de la force de travail » ?
C’était tout simplement essayer de calomnier la ligne générale et le grand bond en avant, en profitant des difficultés temporaires de l’époque dues aux calamités naturelles, pour accuser le Parti clé n’avoir pas « ménagé la main-d’œuvre », et exiger que nous abandonnions la ligne générale consistant à déployer tous nos efforts, aller toujours de l’avant pour édifier le socialisme selon le principe de quantité, rapidité, qualité et économie, que nous abandonnions le développement en grand de l’agriculture, que nous abandonnions la politique révolutionnaire de travailler assidûment à la prospérité du pays en nous appuyant sur le principe consistant à compter sur ses propres efforts, et que nous utilisions plutôt inexpérience de la domination » de la classe des propriétaires fonciers pour miner la dictature du prolétariat.
En d’autres termes. Teng Touo disait ceci : il est « au-delà de vos capacités » d’appliquer ce principe.
C’est « ‘trop forcer ». Arrêtez sur-le-champ. Abandonnez rapidement et utilisez les méthodes éprouvées des «personnes de grande culture » de la classe des propriétaires fonciers ! Cela n’était-il pas clairement coordonné avec les attaques perfides que lançaient l’impérialisme américain et le révisionnisme moderne ?
Si nous avions suivi cette ligne, non seulement nous n’aurions eu ni Taking et Tatchai ni bombe atomique, mais nous aurions été réduits à l’état de colonie des impérialistes.
Il n’est nullement fortuit que Teng Touo ait prêché bien haut, avant et après la publication de cet article, la nécessité de se mettre à l’école de la clique révisionniste de Khrouchtchev. Dans son article « La manière de se faire des amis et de recevoir ses hôtes », il préconisait de « prendre exemple sur » et de «s’unir à » des pays «plus puissants », et il disait : «on doit se réjouir d’avoir un ami plus puissant que soi-même ».
Dans « De trois à dix mille », il écrivait : « Le présomptueux qui, voyant qu’il étudie facilement, renvoie son maître, n’apprendra jamais rien. »
C’était là s’en prendre perfidement à notre lutte contre le révisionnisme moderne, nous demander de lancer une invitation aux révisionnistes et de laisser entrer les loups dans la bergerie.
Nous souhaitons nous inspirer de toutes les expériences et de toutes les leçons utiles à l’édification du socialisme que nous fournit le monde, mais il n’est pas question de nous mettre à l’école des révisionnistes. Nous saluons chaleureusement le grand développement de toutes les causes révolutionnaires, mais nous n’avons pas à saluer le révisionnisme.
Dans toutes ses insinuations, «injuriant l’acacia en pensant au mûrier », Teng Touo chantait exactement sur le ton des opportunistes de droite, calomniant la ligne du Parti pour l’édification du socialisme, qu’il qualifiait de «forcée », et proclamant que la seule « issue » pour la Chine était de « se mettre à l’école » de la clique révisionniste soviétique et de pratiquer le révisionnisme.
Non content de faire lever ce souffle funeste, le « Village des Trois » applaudit aux manifestations des génies malfaisants et s’efforça de frayer la voie à la collaboration entre les forces néfastes du dedans et du dehors.
De connivence avec les réactionnaires de l’intérieur et de l’étranger et avec les révisionnistes modernes, il attaqua perfidement la ligne générale du Parti pour l’édification socialiste, le grand bond en avant et les communes populaires, et peignit le révisionnisme moderne sous des couleurs séduisantes pour tenter, mais en vain, de créer un courant public favorable au retour des opportunistes de droite.
En juin et juillet 1961, le « Village des Trois » déclencha un autre souffle funeste. Le premier juillet de cette année-là marquait le 40ème anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois.
Brandissant haut le drapeau rouge de la ligne générale, le grand, glorieux et juste Parti communiste chinois, ayant à sa tête le camarade Mao Zedong, dirigeait le peuple chinois dans sa marche triomphale sur la voie socialiste au travers de la lutte ardue contre les réactionnaires de l’intérieur et de l’étranger, et contre de sérieuses calamités naturelles.
Les forces réactionnaires de l’intérieur et les opportunistes de droite, qui avaient été « démis » de leurs « fonctions » et qui ne se résignaient pas à leur défaite, s’efforçaient avec plus d’acharnement que jamais d’obtenir que «fussent rapportées les décisions antérieures », dans le dessein de nier le bien-fondé de la dénonciation des opportunistes de droite, qui avait eu lieu à la réunion de Louchan, et les fruits des diverses autres luttes politiques importantes menées après la Libération. C’est à ce moment-là que les « frères » du «Village des Trois » firent pleuvoir des flèches empoisonnées sur le Comité central du Parti en vue de soutenir les opportunistes de droite.
Le 7 juin 1961, dans un article insidieux, écrit ostensiblement à la mémoire de Yu Tsian, Wou Han rapporta un autre «cas inventé ».
Il y glorifia Yu Tsian, qui avait été «démis de ses fonctions », le qualifiant de «loyal et simple », d’homme dont «l’esprit vivra éternellement ».
Il souligna que Yu Tsian avait été «réhabilité », que «les ennemis politiques de Yu Tsian avaient échoué les uns après les autres » et que, par ailleurs, il avait été nommé «connétable (ministre de la Défense nationale) ».
Les empereurs n’auraient pu se servir de «réhabiliter », qui est un terme moderne. Wou Han l’utilisa et révéla ainsi ce qu’il avait en tête : les révolutionnaires prolétariens « échoueraient les uns après les autres » et les opportunistes de droite seraient bientôt «réhabilités ».
Le 22 juin 1961, immédiatement après la parution de l’article de Wou Han sur l’affaire Yu Tsian, Teng Touo publiait « Les cas de Tchen Kiang et de Wang Keng ».
L’article était si perfide et si flagrant dans ses allusions que l’auteur luimême hésita et qu’il n’osa l’inclure plus tard dans le recueil Propos du soir à Yenchan.
Il se trouve toujours dans les colonnes des Propos du soir du Beijing Wanbao.
L’auteur affirmait qu’il avait emprunté l’ »anecdote » à un vieux livre parce qu’elle était «stimulante pour la pensée ».
L’article procédait par insinuations au sujet d’un « cas délibérément exagéré et inventé », mais la révélation venait dans le dernier paragraphe, qui disait : « Sous le règne de l’impératrice douairière Mirig Sou, le gouvernement des Song s’était corrompu chaque jour davantage. Il n’y avait pas, au 30sommet, de premier ministre intelligent et capable, disposant de collaborateurs ayant le sens des responsabilités pour se charger du personnel et de l’administration, en sorte qu’aux échelons inférieurs, les fonctionnaires locaux faisaient ce que bon leur semblait. »
Il en résulta, écrivait Teng Touo, que « ce cas avait pris une ampleur démesurée et s’était compliqué. »
C’était une calomnie perfide, dirigée contre notre Parti et exprimée dans le langage contre-révolutionnaire des propriétaires fonciers, des paysans riches, des contre-révolutionnaires, des mauvais éléments et des éléments de droite ; c’était, sous prétexte d’attaquer « l’impératrice douairière Ming Sou » et son «premier ministre », dénigrer odieusement le Comité central de notre Parti ; et c’était, en affirmant que «les fonctionnaires locaux faisaient ce que bon leur semblait », calomnier odieusement les cadres du Parti à tous les échelons, tout cela pour protester contre l’injustice dont les opportunistes de droite et les autres éléments antiparti auraient été victimes. L’auteur utilisait encore une expression moderne : « prit une ampleur démesurée ».
Et quel genre de «pensée » voulait-il «stimuler » ?
Cette «pensée », n’était-ce pas l’« annulation des décisions 31antérieures » concernant les opportunistes de droite et autres éléments antiparti ? L’attaque des génies malfaisants contre le socialisme et la dictature du prolétariat ?
Ce qui donne à réfléchir, c’est que Teng Touo plaçait ses espoirs d’une «annulation des décisions antérieures » en un « premier ministre intelligent et capable » qui surgirait et prendrait le pouvoir. Pour ceux qui savent discerner, le genre d’individus auquel il faisait appel pour la saisie du pouvoir est clair comme le jour.
C’est là le ton même du général du «Village des Trois ». Il s’est bien gardé d’inclure cet article dans son recueil, mais essaie-ton de cacher les choses, qu’elles attirent d’autant plus l’attention.
En même temps, dans un autre article intitulé «Prospérité et déclin de deux temples », Teng Touo donna libre cours à ses «’sentiments » au sujet du sort de deux temples.
L’un avait beaucoup de fidèles et jouissait d’une «grande renommée ». l’autre était sur le «déclin » et «totalement abandonné ».
De crainte que l’on ne saisisse pas bien ce qu’il entendait, Teng Touo pressait ses lecteurs de songer à des « cas semblables », signifiant par là que nous avions manifesté trop de froideur envers les opportunistes de droite et que plus personne n’allait leur rendre hommage.
Il exprimait son vif mécontentement pour le sort échu à ces idoles de terre, antiparti et antisocialistes, «totalement abandonnées », qui étaient tombées de leur piédestal politique, c’est-à-dire les opportunistes de droite et autres éléments antiparti, que le Parti et le peuple rejetaient carrément. Il voulait que le Parti les prît de nouveau en «estime », qu’il replaçât dans leurs sanctuaires ces idoles de terre sur le « déclin ».
Immédiatement après, dans sa préface à La destitution de Haï Jouei, Wou Han proclama plus ouvertement encore que, «bien que démis de ses fonctions, Hai Jouei ne capitula pas et ne perdit pas courage ».
Il claironna qu’il fallait avoir « la volonté de ne pas se laisser décourager par l’échec et de recommencer après l’échec ». C’était là l’appel commun des trois et il ne s’agit nullement d’un cas isolé.
Ils incitaient non seulement les opportunistes de droite à « revenir à la charge », mais encore redoublaient eux-mêmes d’ »effort ».
Le 25 juillet 1962, les trois lançaient « Le traitement spécifique de l’amnésie », « article violemment anticommuniste par lequel ils accusaient calomnieusement des camarades responsables du Parti de souffrir d’« amnésie », et ainsi ces derniers « oubliaient rapidement ce qu’ils avaient vu et dit… reniaient leur propre parole, ne tenaient pas leurs promesses et étaient d’humeur fort changeante ».
Ils proposaient de «frapper les malades à la tête avec une matraque spéciale pour les plonger dans un état de ‘commotion’ ».
Usant du même langage que les opportunistes de droite qui haïssaient et calomniaient le Comité central du Parti, les trois voulaient, en fait, en finir d’un coup avec les combattants révolutionnaires prolétariens.
Que de venin ! N’espéraient-ils pas étourdir les révolutionnaires ou les assommer afin que le révisionnisme pût s’emparer du pouvoir ?
L’article révélait brutalement leur profonde haine de classe pour le Parti, il constituait une attaque contre notre Parti lancée à partir des positions des propriétaires fonciers, des paysans riches, des contre-révolutionnaires, des mauvais éléments et des éléments de droite.
L’ensemble des faits cités plus haut montre de façon définitive que La destitution de Haï Jouei n’était pas seulement une manifestation de l’attitude politique personnelle clé Wou Han, mais le prélude aux activités politiques antiparti et antisocialistes de la clique du «Village des Trois », activités visant à soutenir les opportunistes de droite qui avaient été «démis ».
Une poignée de gens de cette clique, qui espéraient que les éléments antiparti et antisocialistes accapareraient le pouvoir dans le Parti et l’Etat, provoquèrent un courant contraire. « Telles des fourmis essayant clé renverser un arbre géant, ils se surestimèrent ridiculement » ; les calomnies et les attaques lancées par cette poignée de gens qui s’opposaient à notre Parti et au socialisme, loin de nuire le moins du monde à l’immense prestige clé notre Parti, ne pouvaient que révéler leur nature criminelle, provoquer l’indignation du peuple et faire que leurs auteurs soient répudiés par le Parti et le peuple.
L’offensive lancée par les trois culmina entre le début de la parution de la Chronique du Village des Trois et la convocation en mars 1962 de la troisième session de la Deuxième 35Assemblée populaire nationale.
Sur le plan international, cette époque avait vu en premier lieu les impérialistes, les réactionnaires et les révisionnistes modernes amplifier leur chœur antichinois, qui fut fort bruyant pendant un temps.
Au XXIIe Congrès du P.C.U.S., en octobre 1961, la direction du Parti soviétique systématisa la ligne révisionniste qu’elle avait peu à peu développée depuis le XXe Congrès, et fit un pas de plus dans l’application de sa ligne politique révisionniste visant à la scission du mouvement communiste international et à la restauration du capitalisme.
En Chine, profitant des graves calamités naturelles que nous avions subies pendant trois années consécutives, les classes réactionnaires qui tentaient de revenir au pouvoir, et leurs agents politiques, attaquèrent avec plus d’acharnement dans les domaines politique, économique et culturel, pour essayer, mais en vain, de renverser la direction du Parti et la dictature du prolétariat, au moment même où nous mettions en application la politique de « rajustement, consolidation, complètement et élévation ».
Deux articles montrent de manière typique comment les trois apprécièrent la situation de l’époque. L’un de Wou Han, intitulé « Vagues », fut publié le 1er janvier 1962.
36Il saluait, avec un enthousiasme délirant, les « vagues » qui martelaient la société «depuis plus de six mois » et déclarait joyeusement : « C’est une véritable lame de fond ! »
Il vantait le contre-courant d’opposition à la direction du Parti et à la dictature du prolétariat comme un effet de ces «vagues ». Il prédisait que « cette lame de fond » deviendrait «de plus en plus puissante ».
Aveuglé par sa rapacité, Wou Han s’imaginait que son groupe l’emporterait et que le courant contraire, révisionniste, deviendrait le courant principal.
Peu après, le 4 février, dans un article intitulé « La Fête du Printemps, celte année », qu’il n’eut pas l’audace d’inclure dans son recueil, Teng Touo était encore plus explicite : « Le froid rigoureux amené par le vent du nord va prendre fin ; à sa place soufflera un vent d’est caressant et la vaste terre connaîtra le dégel. »
Le « dégel » n’est-il pas un terme à cent pour cent contre-révolutionnaire employé contre Staline par la clique révisionniste khrouchtchévienne ?
Aveuglés par leur rapacité ces gens-là prédisaient qu’en 1962, 37la Chine nouvelle, socialiste, « prendrait fin », que la dictature du prolétariat serait emportée par la « lame de fond » contraire, antisocialiste, qu’ »à sa place » s’installerait un régime des opportunistes de droite, des révisionnistes, et que le « Village des Trois » gagnerait encore en influence et pourrait agir à sa guise.
Camarades, voyez avec quelle impatience ils souhaitaient que la Chine connût un «dégel » révisionniste !
C’est à partir de cette estimation de la situation que les trois déclenchèrent leur offensive forcenée sur tous les fronts.
Le 10 novembre 1961, Teng Touo publiait son article «Les grandes paroles creuses » dans sa Chronique du Village des Trois. Sous le prétexte de critiquer ces deux vers d’un poème d’enfant : « Le vent d’Est est notre bienfaiteur ; le vent d’Ouest est notre ennemi », qu’il qualifiait de « paroles creuses », «jargon », «clichés » et «emphase », injuriant l’acacia en désignant le mûrier, il accusait en fait la thèse scientifique marxiste léniniste : « Le vent d’Est l’emporte sur le vent d’Ouest » de n’être que «paroles creuses ».
Il affirmait que «’dans certaines circonstances spéciales, ce genre de grandes paroles creuses est inévitable », cela pour faire entendre aux lecteurs que ce qu’il condamnait, ce n’était pas ce poème d’enfant mais l’arme idéologique que notre Parti utilise 38pour mener la lutte et éduquer les niasses dans «des circonstances spéciales », c’est-à-dire dans la lutte des classes sur les plans international et intérieur. Quel était le dessein de Teng Touo ?
C’était d’accuser perfidement la grande pensée de Mao Zedong, guide de notre marche en avant, d’être «des paroles creuses », de tenter de nous faire renoncer à la pensée de Mao Zedong et rejeter la ligne marxiste-léniniste de notre vie politique.
Il poussa l’arrogance jusqu’à demander que notre Parti «’parle moins et se repose à chaque fois qu’il veut prendre la parole ». Si la pensée de Mao Zedong était amenée à «se reposer », les idées révisionnistes ne pourraient-elles pas commencer à se répandre ?
Mais, loin de lui porter préjudice, ces calomnies débridées montrent plus clairement encore que la pensée de Mao Zedong est une arme idéologique d’une puissance révolutionnaire sans limite, une arme qui fait trembler tous les génies malfaisants.
Le « Village des Trois » publia, en étroite liaison avec ce qui précède, une série d’articles attaquant la pensée de Mao Zedong et diffamant les révolutionnaires.
« Lâchez prise et vous tomberez sur un terrain solide » parut dans les Propos du soir à Yenchan. Il était centré sur l’idée que le Parti devrait « lâcher » la ligne générale pour l’édification socialiste : et il ridiculisait ceux qui ne veulent pas lâcher prise, les traitant d’« aveugles » qui « s’épuisent inutilement ».
Il demandait que le Parti « lâchât courageusement prise », de manière à tomber sur «un terrain solide », c’est-à-dire le terrain du capitalisme. Le 25 novembre, Liao Mocha publiait deux articles : « En quoi réside la grandeur de Confucius ? » et «Plaisanteries sur la peur des fantômes ».
Dans le premier, il louait Confucius d’être «plutôt ‘démocrate’ et accueillant pour les critiques sur ses théories », ce qui impliquait que le Parti devait encourager la « démocratie » bourgeoise et, donc, permettre aux éléments réactionnaires de se lever pour combattre la pensée de Mao Zedong.
Dans le deuxième article, il calomniait, en termes haineux, la pensée de Mao Zedong et salissait les marxistes-léninistes révolutionnaires, les traitant de «fanfarons… qui proclament qu’ils n’ont pas peur des fantômes, mais qui en fait, les craignent à en perdre la raison » : il cherchait à les « ridiculiser ».
Tout le monde sait que le grand Parti communiste chinois et le grand peuple chinois, formés par la pensée de Mao Zedong, non seulement ne craignent ni les génies malfaisants ni les fantômes, mais qu’ils sont déterminés à détruire tous les génies malfaisants et les fantômes du monde.
Seuls, les héros ont pu dompter tigres et panthères, Jamais ours n’a tenu la vaillance en effroi.
Ces vers résument l’héroïsme indomptable du grand peuple chinois, héroïsme qui triomphe de toutes les tendances néfastes.
Liao Mocha comptait même publier un recueil : Avoir peur des fantômes.
N’était-ce pas collaborer ouvertement avec les réactionnaires, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, avec les révisionnistes modernes, pour diffamer le peuple chinois qui ne craint pas les fantômes, diffamer noire Parti et les révolutionnaires qui s’en tiennent à la pensée de Mao Zedong ?
Le lendemain de la parution des deux articles en question, les Propos du soir à Yenchan publiaient « Deux fables étrangères », une autre attaque contre la prétendue fanfaronnade.
Il y était dit que « même aujourd’hui, on peut rencontrer de tels fanfarons en tout temps et tout lieu » et, perfidement, « Nous ne devons pas laisser échapper ces charlatans à la légère ». Vous voulez faire la révolution ?
Vous voulez avoir le pays au cœur et le monde comme horizon ?
Vous voulez surmonter les difficultés en comptant sur vos propres efforts ? Tout cela est « fanfaronnade » et « vantardise ». Le «Village des Trois » vous demandera des comptes. Lorsque l’article fut repris dans le recueil, l’auteur raya la phrase suivante : « Les difficultés ne pourront être surmontées, elles se feront chaque jour plus nombreuses et plus graves ».
Voyez avec quelle vilenie ces hommes se gaussaient de la politique de notre Parti qui consiste à compter sur ses propres forces pour vaincre les difficultés !
Ils croyaient même que les difficultés se feraient «plus nombreuses ».
Peu de temps après, dans son article « Tchao Kouo et Ma Sou », Wou Han utilisa deux récits du passé traitant de ce qu’il appelait « gagner la confiance du public par des paroles ronflantes » et la « vantardise » en vue de railler le présent, et de nous demander, en nous sermonnant, de « revoir aujourd’hui » les « leçons des échecs », les « leçons du préjudice porté à soi-même, à autrui et au pays ».
Wou Kan s’imaginait de toute évidence que le grand peuple chinois avait « subi des revers », que la ligne générale pour l’édification socialiste avait « échoué » et que les opportunistes de droite seraient bientôt au pouvoir. Le coup de vent néfaste qui s’était levé avec les « Grandes paroles creuses » de Teng Touo était étroitement lié aux clameurs appelant les opportunistes de droite à prendre le pouvoir.
En relisant ces phrases aujourd’hui, alors que l’édification socialiste de la Chine connaît un nouvel et vigoureux essor, nous ne pouvons parvenir qu’à une seule conclusion : ces «héros » de la lutte antiparti et antisocialiste sont à jamais incapables de déceler la grande puissance des masses, ils sont plus aveugles que les aveugles pour ce qui est d’estimer la situation politique.
Camarades et amis !
Ces calomnies et ces attaques, ayant pour noyau les articles de Teng Touo, furent lancées en une période vraiment courte, elles étaient concentrées sur les mêmes objectifs et faites en des termes identiques.
Est-il possible qu’elles n’aient pas été organisées, coordonnées, selon un plan établi ?
Quelle frénésie chez ces gens dans leur opposition au Parti et au socialisme !
Comment ne pas être soulevé par une profonde indignation ? Comment pourrions-nous nous empêcher de les écraser ?
Une série d’articles ultérieurs, également du genre «sortir en enfonçant la porte », mena plus crûment encore l’attaque contre le Comité central du Parti ayant à sa tête le camarade Mao Zedong. Ils attaquaient avec une sauvagerie exceptionnelle, et firent passer le centre de gravité du politique à l’organisationnel.
Dans l’article «Peut-on compter sur la sagesse ? » publié le 22 février 1962, Teng Touo exhortait « l’empereur » à «demander conseil de tous côtés ».
Il fit ressortir qu’ail n’est pas nécessaire de tout concevoir soi-même » et déclara, dans un but inavoué, que « si un homme conçoit tout lui-même, les flatteur profiteront pour le flatter ». Il ne voulait certainement dire que ceux qui se trouvent aux postes de direction doivent écouter avec modestie les opinions d’en bas : ce qu’il voulait c’est que le Comité central du Parti adopte la ligne révisionniste que ses semblables et lui-même soutenaient.
Ils avertirent insolemment le Parti : « A vouloir prendre toutes les décisions soi-même dans l’espoir de remporter des succès grâce à des idées originales », à refuser les « bons conseils » d’« en bas » en d’autres termes, du «Village des Trois », on « se prépare à subir, un jour, de lourds revers ».
C’était là demander ouvertement que leur « projet » de restauration du capitalisme soit pris comme ligne du Parti, et c’était dénigrer grossièrement le Comité central du Parti. Leurs « bons conseils » signifiaient que nous devions nous engager dans la voie du révisionnisme et restaurer le capitalisme, qui replongeraient plus de 90 % du peuple chinois dans un état de sombre et douloureuse oppression. On ne peut trouver pire que ce «bon conseil ».
Ici, de même que pour la question des fleurs odorantes et des plantes vénéneuses, le peuple révolutionnaire et la petite poignée d’éléments antiparti et antisocialistes ont des vues diamétralement opposées quant à ce qui est «bon » et ce qui est « mauvais ».
Ils n’ont pas de langage commun.
Seulement trois jours après, le 25 février 1962, un autre article 45paraissait : « Le régime éclairé et le régime despotique ». La théorie marxiste sur l’État nous apprend que « le régime éclairé » et « le régime despotique » sont tous deux des dictatures de la classe des propriétaires fonciers et représentent la violence contre-révolutionnaire.
Tout régime de la classe des propriétaires fonciers, aussi « éclairé » qu’il soit en apparence, est néanmoins essentiellement despotique.
Le soi-disant «gouvernement bienveillant » est tout au plus un masque dont s’affuble la violence contre-révolutionnaire sanguinaire.
Comme l’a montré de façon pénétrante Lou Sin, « en Chine, régime éclairé est, en apparence, à l’opposé du régime despotique ; en fait, ils sont complémentaires. Le régime despotique précède invariablement le régime éclairé et lui succède » (Œuvres choisies de Lou Sin).
Cependant, Ten Touo a fait grand bruit autour du «régime éclairé » en disant que «dans l’antiquité, le régime éclairé valait nettement mieux que le régime despotique ».
Pourquoi cet éloge absurde de la dictature de la classe des propriétaires fonciers ?
C’était dans le but de nous faire accepter la « leçon » qu’il avait inventée de toutes pièces : «Nous voyons au premier coup d’œil comment ceux qui sont à la poursuite de l’hégémonie se font des ennemis partout et deviennent impopulaires. »
Teng Touo expliqua : «Dans notre langue [langue du «Village des Trois »], le régime despotique. . . signifie l’arrogance, le subjectivisme et l’arbitraire du mode de penser et du style de travail de celui qui est décidé à aller jusqu’au bout, envers et contre tout ».
N’est-ce pas un air que nous avons trop souvent entendu ? Les révisionnistes modernes ont loué l’impérialisme américain, qui s’efforce vainement de parvenir à l’hégémonie mondiale, comme étant un archange de paix, et ils ont calomnié la Chine qui s’oppose fermement à l’impérialisme américain, l’accusant d’être « belliqueuse » et « à la poursuite de l’hégémonie ».
Chez nous, les classes réactionnaires prêchent activement «la liquidation de la lutte dans nos relations avec l’impérialisme, les réactionnaires de tous les pays et le révisionnisme moderne, la réduction de notre aide et soutien à la lutte révolutionnaire des peuples du monde entier », et elles nous attaquent, nous accusant d’être «isolés » et de nous «faire des ennemis partout ».
Une comparaison nous révèle clairement que lorsque les Propos du soir à Yenchan calomniaient ceux qui « sont à la poursuite de l’hégémonie », «se font des ennemis partout », «deviennent impopulaires » et « sont décidés à aller jusqu’au bout, envers et contre tout », ils visaient la ligne révolutionnaire de notre dictature du prolétariat ; ils singeaient les réactionnaires l’intérieur et de l’étranger.
Il ne s’agissait pas simplement « d’idéaliser le système féodal » comme l’a proclamé le Beijing Ribao.
Le 29 mars 1962 parut l’article «Pour la défense de Li San-tsai ». Le titre en lui-même était étrange, car à l’époque personne n’attaquait Li San-tsai, mort depuis 4 siècles : aussi pourquoi ce cri pour sa « défense » ?
Selon l’auteur, Li San-tsai était «un personnage historique positif », un grand héros qui «attaqua la politique obscurantiste de la féodalité ».
Mais si nous consultons L’Histoire de La Dynastie des Ming, nous trouvons quelque chose de tout à fait différent. Li San-tsai était un boucher qui écrasa férocement des insurrections paysannes, qui «utilisa diverses tactiques pour capturer et exterminer les grands brigands », et dont l’existence n’était qu’une suite de crimes sanglants.
48Laquais fidèle des propriétaires terriens, loyal serviteur de la politique obscurantiste de la féodalité, il adressa de nombreux mémoires à l’empereur pour lui demander d’exterminer les soi-disant «fauteurs de trouble » et les «grands brigands », afin de « préserver à jamais » la domination de la classe des propriétaires fonciers.
Quel but recherchai-ton vraiment en «défendant » un homme pareil ?
En fait. Li San-tsai était un arriviste qui voulait faire partie du Cabinet.
Il ne cessa d’attaquer, en qualité de membre de l’ »opposition », la faction de la classe des propriétaires fonciers alors au pouvoir, parce qu’il était en contradiction avec elle.
Il avait utilisé, dans ses pétitions à l’empereur, le mot d’ordre «plaidoyer pour le peuple ».
Cette mêlée lui valut d’être « démis » de ses « fonctions ». Teng. Touo a salué ce membre de l’« opposition » qui fut «démis » et l’a fait passer pour un grand héros, en vue de se servir de ce mort pour défendre les opportunistes de droite.
Il insista tout particulièrement sur les événements survenus après la destitution de Li : «Même après que Li San-tsai se fût retiré chez lui, il fut accusé d’« avoir volé des matériaux de la famille impériale pour se construire une résidence personnelle »… Il écrivit encore de nombreux mémoires… mais la Cour de l’empereur Wanli n’osa pas procéder à une enquête approfondie ».
L’affirmation : « n’osa pas procéder à une enquête approfondie » est un pur mensonge fabriqué pour servir d’allusions, car les annales historiques disent clairement que des fonctionnaires furent envoyés aux fins d’« enquête ».
Teng Touo voulait tout simplement porter aux nues les opportunistes de droite qui avaient été « démis », pour empêcher le peuple révolutionnaire de poursuivre ses enquêtes sur leurs activités criminelles, pour faire casser le jugement qui les avait frappés et les aider à lancer de nouvelles et virulentes attaques contre le Parti par la rédaction de «mémoires ».
« Pour la défense de Li San-tsai » est une suite à La destitution de Haï Jouei. «Li San-tsai » n’était qu’un autre «Hai Jouei », un autre «fonctionnaire intègre » destitué.
N’est-ce pas clair jusqu’à l’évidence ?
Il est tant d’exemples des attaques directes lancées par le «Village des Trois » contre le Comité central du Parti, le 50président Mao Zedong et la ligne générale, qu’ils ne peuvent tous être cités.
Mais de certains des articles parus après la publication de La destitution de Hai Jouei, au moment où un vent mauvais soufflait en rafales, il ressort déjà clairement à quel point les secrets du « Village des Trois » sont étonnants, quelle haine de classe implacable cette poignée d’hommes voue au Parti et à la cause du socialisme, quels éloges dithyrambiques elle a eu pour les opportunistes de droite, c’est-à-dire les révisionnistes, et quel soutien elle leur a accordé.
Ils espéraient que la Chine troquerait sa couleur rouge contre du noir.
« La sinistre auberge » était un antre important de la restauration du capitalisme, un nid de vipères, qui doit être entièrement démasqué et complètement détruit.
Notre tâche de combat d’aujourd’hui est de nous dresser pour détruire le «Village des Trois » et poursuivre la révolution jusqu’au bout.
S’INFILTRER PARTOUT ET FAIRE L’IMPOSSIBLE POUR PROMOUVOIR L’ »EVOLUTION PACIFIQUE »
En plus des articles ouvertement antiparti, antipopulaires et antisocialistes, les Propos du soir à Yenchan et la Chronique du Village des Trois contiennent d’innombrables plantes vénéneuses sous forme d’« études académiques », « recherches historiques » et « divertissements ».
Sous prétexte d’« acquérir les connaissances utiles d’hier et d’aujourd’hui », leurs auteurs ont lancé une attaque générale contre le socialisme.
Ils ne cherchaient pas seulement à «enjoliver le régime féodal » et à «glorifier les morts », ils avaient des buts politiques bien précis.
D’une part, parallèlement à leur ligne noire ouvertement antiparti, antipopulaire et antisocialiste, ils se servaient de l’ »histoire », du «savoir » et des «questions de goût » comme d’un écran de fumée pour émousser la vigilance révolutionnaire du peuple, abuser davantage de lecteurs et étendre leur influence.
D’autre part, ils recouraient à la méthode dite de la «décapitation en douceur », pour mener leur attaque généralisée contre la ligne prolétarienne préconisée avec constance par le Parti et le camarade Mao Zedong dans tous les domaines, et par là, ils s’efforçaient de corrompre les cadres et le peuple révolutionnaires avec les idées des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, et de promouvoir l’ »évolution pacifique ». Qui prend goût à tout ceci et en est obsédé finira par dégénérer et devenir un nouvel élément bourgeois.
La double tactique du «Village des Trois » consistait à utiliser des flèches empoisonnées bien acérées et toutes sortes de balles enrobées de sucre.
Dans le tout premier article de ses Propos du soir à Yenchan, Teng Touo affichait son ambition d’occuper «le tiers de la vie ». Il disait que «l’attention des gens devait être éveillée pour qu’ils chérissent le tiers de la vie, afin que chacun, après sa journée de travail, puisse, dans une atmosphère détendue, acquérir quelques connaissances utiles, d’hier et d’aujourd’hui ».
En apparence, le « tiers de la vie » signifie les heures de loisir. Mais le «Village des Trois » ne se limitait pas à ce « tiers », son vrai but était de renverser l’ensemble de la dictature du prolétariat et de restaurer le capitalisme.
Et ce «tiers » lui servait justement de couverture pour s’emparer des «deux tiers » restants.
En recommandant à chacun de lire « dans une atmosphère détendue » les Propos du soir à Yenchan, il essayait trémousser la vigilance révolutionnaire du peuple, dans l’espoir de corrompre ceux dont la position révolutionnaire manquait de fermeté, d’abord pendant «un tiers de leur vie », pour les recruter et en faire une force organisée et la base sociale de la clique du «Village des Trois », afin de promouvoir l’« évolution pacifique ».
Recourant abondamment aux réponses à ses lecteurs, Teng Touo s’étendait longuement dans ses Propos du soir à Yenchan sur la manière dont il recevait les jeunes, comment il obtenait « inspirations » et « suggestions » de « compatriotes », « camarades », « amis », « enfants », « rédacteurs », « étudiants », « enseignants », et même de cadres de la profession «travaillant » dans divers services, et comment il répondait à leurs «questions ».
Tout cela permet de se faire une idée de l’étendue des activités du «Village des Trois ». La propagation d’idées antisocialistes allait de pair avec des activités à grande échelle.
Ils empoisonnèrent certains esprits et attirèrent des gens à leurs côtés. Sous prétexte de diffuser des « connaissances », ils s’efforçaient d’amener des jeunes à la sinistre auberge du « Village des Trois ».
Deux exemples suffiront.
Dans « Pauvre, mais digne », Teng Touo disait : « Un étudiant est venu me voir avant-hier », «il a l’intention de transposer en langage moderne les Vies des pauvres lettrés compilées par Houang Ki-chouei sous la dynastie des Ming, et m’a demandé si j’approuvais son projet ».
Les Vies des pauvres lettrés constituent un recueil de biographies de propriétaires fonciers ruinés, elles exaltent «la force de caractère » de la classe des propriétaires fonciers et peuvent donc exercer une influence extrêmement pernicieuse sur le peuple.
Mais l’étudiant, qui était sérieusement atteint par l’idéologie bourgeoise, n’était pas encore décidé.
Teng Touo croyait avoir mis la main sur une merveille : non seulement il complimenta l’étudiant en disant que son idée était « excellente », mais il profita de l’occasion pour faire une longue dissertation politique, en liant la transposition des Vies des pauvres lettrés au sentiment de « haut respect » pour la classe des propriétaires fonciers et à la «haute intégrité morale », qui doit servir de modèle ; il insinua que certains, « lorsqu’ils se trouveraient, plus tard, en butte à des difficultés inattendues », pourraient tirer « exemple » de ces «Vies ».
N’est-ce pas pousser quelqu’un dans le puits et le lapider ensuite ?
N’est-ce pas utiliser cet étudiant, le mettre au service des « pauvres lettrés » d’aujourd’hui, autrement dit des éléments antisocialistes ?
L’« étudiant de l’Institut de Radiodiffusion de Pékin qui m’a écrit » était également fort influencé par l’idéologie bourgeoise. En proie à des préoccupations vulgaires, «dans l’autobus », il n’avait d’yeux que pour «la longueur de cheveux des passagères », et il demandait à Teng Touo de lui dire «ce que peuvent nous inspirer les longues chevelures ».
Celui-ci répondit aussitôt par un article qui est typique de la classe décadente.
Non seulement il encouragea cet «étudiant », mais encore il fit beaucoup de publicité pour les « longs cheveux » des « beautés » des cours impériales les plus scandaleuses de l’histoire. N’est-ce pas là accélérer la décadence et la dégénérescence de ceux qui sont déjà atteints par l’idéologie bourgeoise, pour les transformer en nouveaux éléments bourgeois ?
Tous les jeunes qui ont été contaminés et se sont laissés gagner par la clique du «Village des Trois » doivent se dresser et dénoncer ses agissements criminels.
De ce point de vue, le but politique de ces articles qui prônent l’idéologie réactionnaire n’est que trop clair.
En matière d’éducation, Teng Touo et sa clique ont suivi énergiquement une ligne bourgeoise et réactionnaire pour préparer une force organisée en vue de la restauration du capitalisme.
Ils ont pris la théorie bourgeoise de la nature humaine comme base de l’éducation, préconisé qu’« on devrait approuver, pour l’essentiel, l’affirmation de Mencius : « Les hommes naissent bons » ».
Ils se sont opposés à l’utilisation du point de vue de classe pour analyser et éduquer la jeune génération ; ils ont cherché ainsi à camoufler leur criminelle tentative pour empoisonner l’esprit des jeunes.
Ils sont allés jusqu’à prôner que « l’ensemble des méthodes utilisées dans les vieilles troupes d’opéra pour former les acteurs sont conformes aux principes de la pédagogie », et ont demandé que « l’emploi de ces méthodes soit généralisé dans la société ».
Ils voulaient substituer à la ligne de classe le soi-disant principe « d’utiliser les gens selon leurs capacités » et par là, former en grand nombre et « de façon systématique » ceux qui prendraient la relève des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie. Ils recommandèrent vivement aux jeunes de « suivre la méthode qui consiste à lier les études personnelles aux traditions familiales », de « devenir des savants célèbres » en «étudiant assidûment », d’ »acquérir une formation de base » « en exploitant tous les matériaux disponibles », etc.
Ici, il n’est pas seulement question de parvenir à la célébrité, de devenir un spécialiste à la manière bourgeoise ; il s’agissait essentiellement pour eux de tâcher, par ce moyen, de corrompre et d’attirer un certain nombre de gens, de recruter des disciples pour le « Village des Trois », afin qu’ils deviennent les propagateurs de leurs idées anticommunistes, et d’en faire leurs instruments pour la restauration du capitalisme.
En cherchant à séduire les jeunes, par des paroles doucereuses, pour les pousser à devenir des « savants » et des «célébrités », la clique du «Village des Trois » nourrissait les desseins les plus perfides.
Elle s’en tint à une ligne réactionnaire et bourgeoise dans le domaine académique en vue de préparer les esprits à la restauration du capitalisme.
Elle lança le mot d’ordre : «Plus d’études et moins clé critiques ! », autrement dit, «il s’agit, en toute chose, de plus étudier et de moins critiquer ».
Elle raillait ceux qui portent haut le drapeau révolutionnaire, les accusant de «prendre plaisir à chercher les défaillances », de «censurer en toute occasion » et affirmait qu’ils «finiraient par le payer cher ».
Que signifiait donc « plus d’études et moins de critiques » ? C’était s’arroger le droit de diffamer la pensée de Mao Zedong, d’exalter la culture des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie et de placer le «travail académique » au service de la restauration du capitalisme.
C’était nous interdire de critiquer la culture des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, et priver tout simplement le peuple révolutionnaire du droit de les critiquer ; c’était faire accepter en bloc la culture des classes exploiteuses, la faire considérer comme une chose sacro-sainte.
Attaquer le prolétariat, soutenir la bourgeoisie, renforcer le contrôle exercé sur les différents secteurs académiques par ceux de la sinistre auberge, encourager la libre croissance de toutes les plantes vénéneuses, et notamment celles du « Village des Trois »’, voilà l’essence même de la ligne académique et réactionnaire de Teng Touo et de sa clique.
Et il en va de même pour la littérature et l’art.
Parallèlement au mot d’ordre «Plus d’études et moins de critiques ! », ils en ont avancé un autre : « Équité en tout ». Ils prétendaient que «toutes les pièces de théâtre sont sur un pied d’égalité, qu’elles soient à thèmes modernes ou traditionnels, et nous devons toujours les considérer avec équité ».
Dans une société de classes, il n’y a pas d’égalité au-dessus des classes, il n’y a jamais « égalité » entre le prolétariat et la bourgeoisie, il ne peut y avoir que le triomphe de l’un sur l’autre.
Si en soutient les pièces à thèmes modernes et révolutionnaires du prolétariat, force est de critiquer les pièces anciennes des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie.
Si on fait l’éloge de l’« héritage dramatique » en prétendant qu’il y existe d’excellentes pièces répondant parfaitement aux besoins actuels, on ne peut qu’attaquer et exclure les pièces révolutionnaires à thèmes modernes.
Le mot d’ordre « Équité en tout » fait d’une pierre deux coups : il combat tout soutien actif aux pièces révolutionnaires à thèmes modernes ; il accorde la plus grande importance à nombre de plantes vénéneuses et les met à l’abri de la critique, afin qu’elles puissent être mises au service des activités antiparti et antisocialistes.
Teng Touo et consorts ont constamment prôné la morale réactionnaire des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie en vue de restaurer la domination des classes exploiteuses dans le domaine social.
Ils ont préconisé la philosophie de l’existence, complètement décadente, propre aux propriétaires fonciers et à la bourgeoisie, y compris leurs prétendus « force de caractère », « désintéressement », « patience », « argent bien gagné », etc. Ils ont prôné l’étude de «la vertu de patience » du philosophe réactionnaire Tchou Hsi, de « l’esprit de révolte » qui se manifeste dans le «mépris du travail » chez Tchang Che, de la manière de «se plier aux règles de l’étiquette par la contrainte sur soi » de Confucius. . .
Ils ont même plaidé avec énergie la remise en honneur de la façon féodale de se saluer : les mains serrées devant la poitrine. Tout cela revient à appeler ouvertement à un retour à la vieille Chine, celle du féodalisme et du capitalisme.
Camarades ! Réfléchissez : si tout cela venait à se réaliser, la morale et les mœurs nouvelles, communistes, ne seraient-elles pas foulées aux pieds ?
Notre société ne serait-elle pas transformée en un monde obscur régi par l’ordre féodal ?
Si nous devions faire preuve de «respect » pour les éléments des classes exploiteuses que nous rencontrerions, cela ne signifierait-il pas la restauration contre-révolutionnaire ? Ne serait-ce pas soumettre de nouveau la grande masse des ouvriers, paysans et soldats à la cruelle oppression de ces « gentilshommes » dotés de «force de caractère », c’est-à-dire des enragés des classes exploiteuses ?
Ils ont demandé ouvertement, en leur qualité de descendants respectueux de la classe des propriétaires fonciers, que soit rédigée la biographie de certains membres de leur classe.
Voyons ce passage de Teng Touo : « Autrefois, il était coutume, en publiant clés chroniques locales, d’établir la liste de la ‘noblesse rurale’ et ensuite de réunir des matériaux pour écrire la biographie de chacun de ceux qui en faisaient partie. Si nous voulons rédiger les chroniques de Pékin, il est évident que nous devrons accorder une place appropriée à ‘Mi l’Ancien et à Mi le Jeune de Wanping’ » (allusion à Mi Wantchong et Mi Hanwen, deux bureaucrates, l’un de la dynastie des Ming, l’autre de la dynastie des Tsing, originaires de la ville de Wanping).
« Autrefois », cela signifie à l’époque féodale et sous la domination réactionnaire du Kuornintang ; « il était coutume », cela veut dire en fait selon la «coutume » des propriétaires fonciers et de la « noblesse rurale », et particulièrement des propriétaires fonciers despotiques ; tous ceux qu’ils louaient jusqu’à la nausée comme étant de la « noblesse rurale » étaient en fait des membres reconnus de la classe des propriétaires fonciers.
Si nous voulons écrire les biographies de la «noblesse rurale », cela signifie que les propriétaires fonciers et les despotes locaux renversés depuis la réforme agraire devraient, maintenant, être réinstallés en haut, avec leurs tablettes ancestrales, et que la grande masse des anciens paysans pauvres et paysans moyens de la couche inférieure devraient de nouveau être piétines par la « noblesse rurale ».
Ceci montre que leur délire était sans limite. Répondant à l’appel de leur général, les auteurs de la Chronique du Village des Trois ont soulevé la question à de nombreuses reprises, demandant que les seigneurs de la guerre, les bureaucrates, les propriétaires fonciers et autres «personnages négatifs » aient l’honneur d’une biographie.
C’était là agir en faveur de la restauration au sens le plus profond du terme.
C’était très exactement une tentative pour accroître le capital politique de la classe des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, pour créer les conditions qui permettraient à ces classes de dominer à nouveau le peuple chinois.
La masse des ouvriers, paysans et soldats ne permettra jamais que de telles activités criminelles aboutissent !
Ce qui a été cité plus haut n’est qu’une infime partie des matériaux se rapportant au problème.
Mais même ainsi, on peut constater que toute la propagande qui se faisait au nom de « l’étude » et de « la connaissance » se résumait en ceci : opposition à la pensée de Mao Zedong, négation du socialisme clans sa totalité, efforts pour causer la dégénérescence des cadres et de la jeunesse, efforts pour restaurer intégralement le capitalisme.
Le camarade Mao Zedong a dit : « Le prolétariat cherche à transformer le monde selon sa propre conception, tout comme la bourgeoisie » (De la juste solution des contradictions au sein du peuple).
Le plaisir que prenait le «Village des Trois » à décrire tout ce qui était décadent et réactionnaire montre bien sa conception réactionnaire du monde.
Voilà qui permet de voir le fond même de l’âme pourrie des chevaliers du «Village des Trois ».
Wou Han avait une « phrase célèbre » : «Les heures de loisir constituent un univers de liberté où chacun peut donner libre cours à ses intérêts primordiaux. »
Cette phrase révèle que lorsqu’ils se drapaient dans le manteau du communisme pour assister à des réunions, pour accomplir leur travail, pour faire des rapports, etc., il s’agissait d’apparence trompeuse et non de leurs « intérêts primordiaux », et qu’ils le faisaient à contre-cœur.
Mais une fois arrivées les «heures de loisir », une fois réunis au «Village des Trois », leur véritable attitude, leurs « intérêts primordiaux », se manifestaient sans aucune retenue : conspirer contre le Parti et le socialisme.
Leur façon de vivre consistait à bien jouir de la vie, discuter de chiens et de chats, chanter les louanges des propriétaires fonciers, se passionner pour les antiquités et le mah-jong, faire des affaires, chercher à vivre comme les intellectuels révisionnistes Soviétiques ; réciter, avec un « sentiment d’amertume », les vers de Tou Fou : «Le riche ne meurt pas de faim.
La plupart des lettrés échouent dans leur carrière », ou trouver l’« inspiration » dans les sensations agréables que procure « le miracle des longs cheveux » des « beautés ». . .
Rien de ce qui est corrompu ne les rebute. Ce sont des fourbes et des hypocrites.
Ils ont fait passer certaines clé leurs idées dans leurs écrits pour corrompre le peuple et notre Parti.
Voulez-vous savoir ce que signifie «évolution pacifique » ? Il suffit de regarder les vivants exemples du «Village des Trois ».
Toutes leurs laides paroles, toutes les formes de leurs activités et les buts qu’ils comptaient atteindre ne font que promouvoir « l’évolution pacifique » dans le sens le plus strict du terme. Nous pouvons tirer de ces odieux «professeurs par la négative » une inoubliable leçon en matière de lutte de classes.
LES STRATAGÈMES A L’HEURE DU REPLI
En septembre 1962 fut convoquée la dixième session plénière du Comité centrai issu du Ville Congrès du Parti communiste chinois.
Le camarade Mao Zedong y lança son grand appel à tout le Parti et à tout le peuple : N’oubliez jamais la lutte des classes. Cette session leva haut le grand drapeau rouge de la pensée de Mao Zedong et sonna l’appel à la lutte résolue contre les forces du capitalisme et du féodalisme en quête de restauration. Elle fit remarquer que »cette lutte des classes se reflétera inévitablement dans le Parti ».
Pris de court, les génies malfaisants de tous genres tremblèrent de peur.
La situation lui devenant défavorable, le « Village clés Trois » se mit à battre en retraite, à commencer par son général. Peu après, en octobre 1962, Teng Touo écrivait clans une «Lettre aux lecteurs », qui figure dans le volume V de ses Propos du soir à Yenchan : «J’ai abandonné les Propos du soir à Yenchan étant donné que j’ai porté dernièrement mon attention sur d’autres sujets pendant mes heures de loisir. »
Le dernier billet des Propos du soir à Yenchan, publié le 2 septembre 1962, était intitulé : «Les trente-six stratagèmes ». Cela signifiait qu’il s’apprêtait à filer, car « des trente-six stratagèmes, le meilleur reste la retraite ».
Ayant réuni ces « Propos » en un volume, l’auteur craignit de laisser une trace de sa «fuite » et inséra le billet en question au milieu du livre, au lieu clé le placer à la fin suivant l’ordre chronologique.
Le ton du billet est significatif : « La retraite » ne fut pas le seul stratagème auquel recourut Tan Taochi.
Sans faire appel à d’autres, il n’aurait pu battre en retraite même s’il l’eût voulu.
C’est grâce à plusieurs stratagèmes utilisés en coordination tels que faux déploiement militaire, semer la discorde chez l’ennemi. . . qu’il réussit à « se retirer en toute sécurité ». Après la dixième session plénière du Comité central issu du VIIIe Congrès du Parti, le « Village des Trois », tout en poursuivant ses attaques, eut vraiment recours à «plusieurs stratagèmes en coordination » dans l’intention de se retirer en toute sécurité, une fois déclenchée la contre-attaque menée par le peuple révolutionnaire.
C’est ainsi qu’il monta encore un certain nombre de numéros passionnants. Voyons quelques-uns de ses stratagèmes :
1. L’insertion d’un «avis » hypocrite dans le volume V des Propos du soir à Yenchan : «II y a un certain temps, on m’a mis en selle pour que j’écrive les Propos du soir : si je démonte aujourd’hui, c’est pour ne plus être perpétuellement mécontent de moi-même.
Il ne sera pas trop tard d’écrire de nouveau, quand il y aura vraiment quelque chose à dire et que le besoin d’écrire se fera impérieux. »
Teng Touo essaye d’expliquer, d’une part, qu’il n’a pas lancé d’attaques de propos délibéré, qu’il a agi sous contrainte aussi bien pour créer sa rubrique que pour la supprimer, et d’autre part, il laisse entendre qu’à l’avenir, lorsque la situation le permettra, il «écrira de nouveau » et reviendra à la charge.
2. Le maintien de son autre position, la Chronique du Village des Trois. Tout en poursuivant ses attaques, le «Village des Trois » écrit aussi, pour couvrir sa retraite, des articles du genre « Ode au pétrole », en signe d’approbation de la politique qui consiste à compter sur ses propres efforts et qui a été définie par le camarade Mao Zedong.
3. L’encouragement à d’autres journaux locaux pour qu’ils maintiennent longtemps encore les « rubriques spéciales pour essais divers » créées sur le modèle des Propos du soir à Yenchan, afin clé conserver davantage de positions.
4. La critique de l’article de Liao Mocha « Le caractère inoffensif des pièces clé fantômes » s’étendit sur les années 1963-1964. L’enseigne de la Chronique du Village des Trois fut enlevée en juillet 1964, de crainte que Liao Mocha ne compromette le «Village des Trois ».
5. L’autocritique pour la forme, dans laquelle Liao Mocha imputait son « erreur » à une « conception bourgeoise du monde » qui « dominait encore » son esprit et à son »oubli de l’existence continue dans notre société socialiste des classes, des contradictions de classes et clé la lutte des classes ». Il convient de noter que, plus tard, Wou Han a pratiquement repris ces propos mot pour mot dans son « autocritique » ! Liao Moeha ajouta qu’il avait ‘ »’inconsciemment prêté la main à la classe bourgeoise et aux forces féodales dans leurs attaques débridées contre le Parti et le socialisme ».
Puisque Liao Mocha n’avait fait que prêter main-forte à Meng Tchao, bien entendu il n’était naturellement pas question d’ouvrir une enquête sur le «Village des Trois ». N’étaitce pas un merveilleux stratagème ?
6. Après le déclenchement du mouvement de critique de La destitution de Haï Jouei, Teng Touo écrivit à la hâte, sous le pseudonyme de Hsiang Yangcheng, une « critique » disant que «la pensée directrice » et « l’idée de base » clé cette pièce consistaient à « propager la morale de la classe dominante féodale » et ne faisaient que « propager l’idéalisme historique ». Ce faisant, il essayait, d’une part, de couvrir le but politique et le caractère réactionnaire de cette pièce sur le plan politique, de lancer une bouée de sauvetage à Wou Han, de conduire la discussion clans une impasse, et d’autre part, il donnait à entendre qu’il n’existait pas de «Village des Trois » et qu’il avait « rompu » avec Wou Han.
Vers la fin de son article, il ajoutait une ligne pour rappeler à celui-ci : «J’espère que le camarade Wou Han continuera à écrire, s’il a quelque chose à dire. . . et qu’il fera une analyse et entreprendra une étude à partir des faits afin de rechercher la vérité ».
Il donnait ainsi ses instructions à Wou Han pour le pas suivant à accomplir.
7. Wou Han réagit immédiatement à cet appel, il écrivit article 71sur article pour témoigner sa « reconnaissance » à Hsiang Yang-cheng, tout en continuant ses attaques forcenées sous couvert d’autocritique.
Enhardi par le soutien qu’il avait reçu, il fit son propre éloge et, reprenant les armes que Liao Hocha utilisait dans son «autocritique », il déclara : « La pensée correcte ne régit pas encore mon esprit » et «en un mot, j’ai oublié la lutte des classes ! »
« La critique de Hsiang Yangcheng, ajouta-t-il, m’a aidé à comprendre mon erreur ».
Il s’imaginait qu’il pourrait s’en tirer ainsi.
8. Finalement, la situation devenant de plus en plus intenable, on se mit subitement à «critiquer » Teng Touo au nom des rédactions ; pour couvrir la retraite, on a recouru au stratagème de la cigale dorée qui fuit en laissant derrière elle l’enveloppe de sa nymphe.
Tous ces « stratagèmes coordonnés » peuvent-ils leur permettre de « se retirer en toute sécurité » ?
Ils ont joué tant de tours et sont allés trop loin en dupant le peuple.
Mais ils ont sous-estime à l’excès le pouvoir de discernement du peuple révolutionnaire et la volonté révolutionnaire du prolétariat.
Peuvent-ils placer leurs secrets sous clef ? Peuvent-ils s’esquiver ?
Guidées et éduquées par le Comité central du Parti communiste chinois et le camarade Mao Zedong, les larges masses du peuple révolutionnaire sont décidées à éliminer complètement cette ligne noire, antiparti et antisocialiste.
Ces gens-là croient leurs stratagèmes extrêmement astucieux. En réalité, leurs agissements étaient stupides et n’ont servi qu’à les dénoncer.
Ils ont non seulement des «idées politiques réactionnaires en commun », mais aussi un programme d’action.
Ils sont une clique antiparti, antipopulaire et antisocialiste, une poignée d’hommes. N’est-ce pas clair comme le jour ?
En mars 1962, au plus fort des furieuses attaques du «Village des Trois », Teng Touo publiait dans le Beijing Wanbao un poème intitulé «Le cygne noir ».
Il y est dit : «La brise printanière apporte le rêve, les vagues du lac envoient leur chaleur, moi seul ai la prescience ! »
Comme il s’enorgueillissait de sa « prescience » !
Mais elle ne joue plus. Seul la possède vraiment le peuple révolutionnaire qui a assimilé la pensée de Mao Zedong. Les secrets du «Village des Trois » ne sont-ils pas graduellement percés par les grandes masses populaires ?
=>Revenir au dossier sur la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne