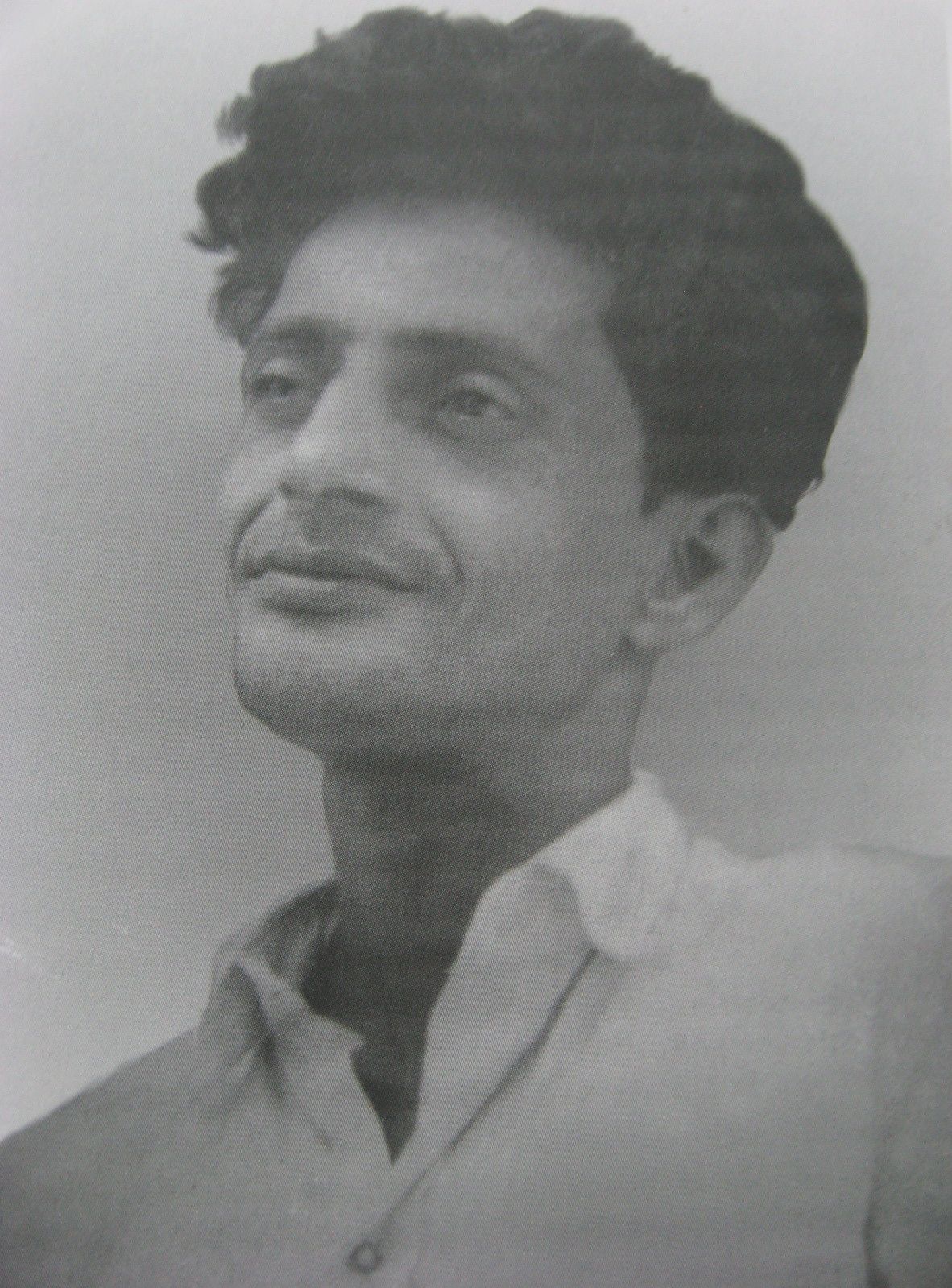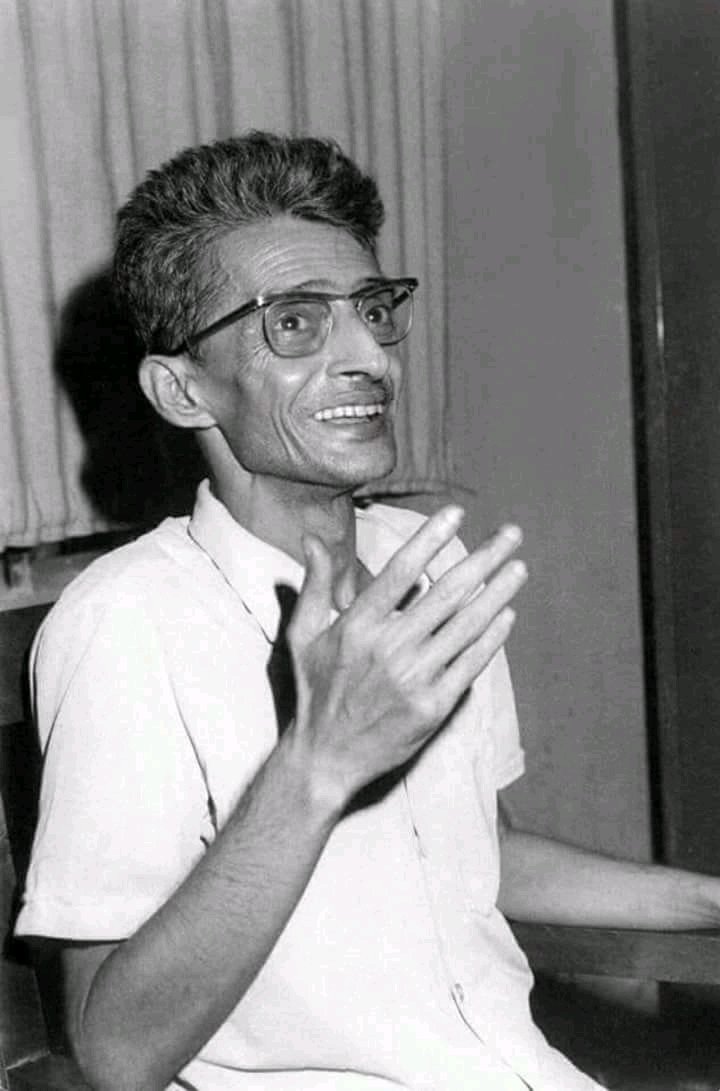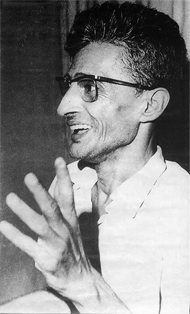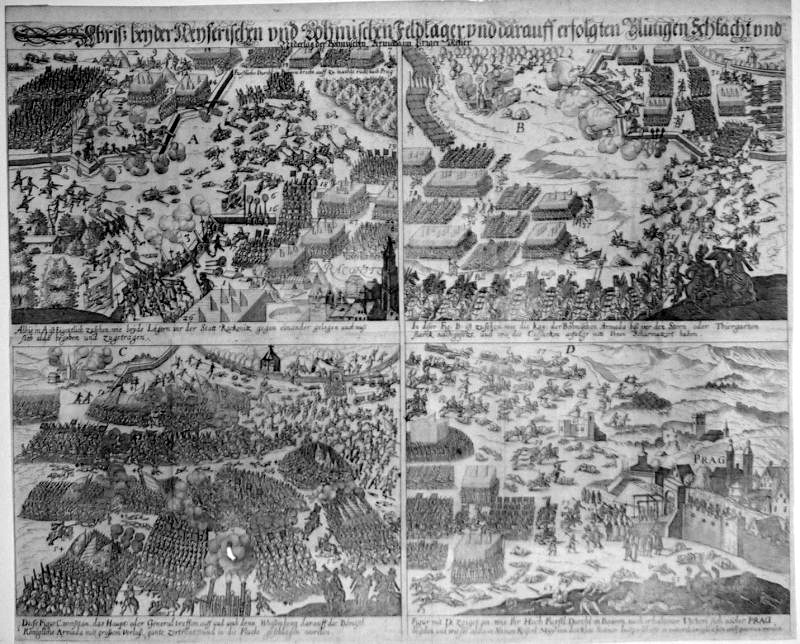A PROPOS DU NEOCOLONIALISME (1994)
PC d’INDE (MARXISTE-LENINISTE) – GUERRE POPULAIRE
Le texte que nous avons reproduit ci-dessus représente des commentaires de la direction du Parti Communiste d’Inde (People’s War) sur la résolution politique adoptée par leur Congrès en 1992. Le texte a paru pour la première fois dans la revue People’s War de septembre-décembre 1994.
1. Néocolonialisme et colonialisme
Qu’est-ce que le néocolonialisme ? En quoi diffère-t-il de l’ancien type de colonialisme ?
Le colonialisme et le néocolonialisme sont deux formes, deux méthodes, deux lignes politiques adoptées par l’impérialisme en vue de l’asservissement, de la domination et de l’exploitation des pays et nations opprimés.
Alors que le colonialisme a été la forme prédominante jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le néocolonialisme a prédominé après cette même Seconde Guerre mondiale.
Quant à leur contenu, il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux.
La principale différence entre le néocolonialisme et l’ancien type de colonialisme consiste dans une réorientation des méthodes d’asservissement, de domination et d’exploitation des pays arriérés : d’ouvertes et directes, ces méthodes sont devenues dissimulées.
Le Parti Communiste de Chine (PCC), dans La polémique autour de la ligne générale du mouvement communiste international, qui a eu lieu au cours de la Grande controverse de 1963, expliquait le phénomène du néocolonialisme de la façon suivante : «Après la Seconde Guerre mondiale, les impérialistes n’ont certainement pas renoncé au colonialisme, mais ils en ont simplement adopté une nouvelle forme, le néocolonialisme.
Une caractéristique importante de ce néocolonialisme est que les impérialistes ont été forcés de modifier leur ancien style de domination coloniale directe dans certaines régions et d’adopter un nouveau style de domination et d’exploitation coloniale en s’appuyant sur les agents qu’ils ont sélectionnés et formés.
Les impérialistes, avec à leur tête les Etats-Unis, asservissent ou contrôlent les pays coloniaux et les pays qui ont déjà proclamé leur indépendance, en organisant des blocs militaires, en installant des bases militaires, en établissant des ‘fédérations’ ou des ‘communautés’ et en favorisant des régimes fantoches.
Par le biais d’une ‘aide’ économique ou par d’autres formes, ils s’approprient ces pays en tant que marchés pour leurs marchandises, en tant que sources de matières premières et débouchés pour leurs exportations de capitaux, ils pillent les richesses et sucent le sang des habitants de ces pays.
Qui plus est, ils se servent des Nations Unies comme d’un outil important pour intervenir dans les affaires internes de ces pays et les soumettre à des agressions militaires, économiques et culturelles. Lorsqu’ils sont incapables de poursuivre la domination sur ces pays par des moyens ‘pacifiques’, ils orchestrent des coups d’Etat militaires, se livrent à la subversion ou même, recourent à l’intervention armée et à l’agression directe.»
Les Etats-Unis sont des plus énergiques et habiles dans leur promotion du néocolonialisme.
Avec cette arme, les impérialistes américains essaient de s’emparer des colonies et des sphères d’influence des autres impérialistes et d’établir leur domination mondiale. (…)
Ce néocolonialisme est une forme plus pernicieuse et plus sinistre de colonialisme. (…) Le néocolonialisme n’est pas simplement un phénomène postérieur à la Seconde Guerre mondiale, bien qu’il soit devenu le phénomène dominant de l’après-guerre.
Lénine en personne pointait du doigt cette forme cachée de colonialisme lorsqu’il soulignait « la nécessité d’expliquer et de dénoncer inlassablement aux larges masses laborieuses de tous les pays – et plus particulièrement à celles de tous les pays arriérés – la duperie pratiquée systématiquement par les puissances impérialistes qui, sous le couvert de la création d’Etats politiquement indépendants, créent en fait des Etats entièrement sous leur dépendance dans les domaines économique, financier et militaire. »
Il faisait également remarquer : « Le capital financier est un facteur si puissant, si décisif, pourrait-on dire, dans toutes les relations économiques et internationales, qu’il est capable de subordonner et subordonne effectivement même des Etats jouissant d’une complète indépendance politique. »
Il expliquait également comment le capital financier donne naissance à un certain nombre de formes transitoires de dépendance étatique : « Dès l’instant qu’il est question de politique coloniale à l’époque de l’impérialisme capitaliste, il faut noter que le capital financier et la politique internationale qui lui est conforme et se réduit à la lutte des grandes puissances pour le partage économique et politique du monde, créent pour les Etats diverses formes transitoires de dépendance.
Cette époque n’est pas seulement caractérisée par les deux groupes principaux de pays : possesseurs de colonies et pays coloniaux, mais encore par des formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l’indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d’une dépendance financière et diplomatique.
Nous avons déjà indiqué une de ces formes : les semi-colonies.
L’Argentine est un exemple d’une autre forme de dépendance. »
L’ensemble de l’Amérique latine et certaines parties du Moyen-Orient ont été soumises à l’exploitation et à la domination néocoloniale des diverses puissances impérialistes dès avant la Seconde Guerre mondiale.
L’Egypte a été déclarée indépendante en 1922, l’Irak en 1927 ; l’Iran n’a jamais été réduit à un véritable statut colonial, mais tous ces pays ont fait partie de la ‘sphère d’influence’ britannique.
Bien qu’ils aient joui du statut constitutionnel d’Etats indépendants, ils ont été sous la domination économique, militaire et politique de la Grande-Bretagne.
De même, la Chine sous Tchang Kaï-chek n’était indépendante que de nom et ce, jusqu’au moment de sa libération en 1949, puisqu’elle était une semi-colonie de plusieurs puissances impérialistes : la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon y avaient des investissements.
Toutes ces puissances bénéficiaient de ‘règlements internationaux’ dans chaque port, qui leur permettaient d’y avoir leurs propres lois, police et forces armées, leurs usines, banques et cinémas et, tout autour, leurs canonnières. Les diverses puissances impérialistes recouraient à des formes tant coloniales que néocoloniales pour se livrer au pillage de la Chine semi-coloniale.
Ce fut cependant en Amérique latine que la forme néocoloniale fut la plus fréquente avant la Seconde Guerre mondiale.
Depuis la fin de la domination coloniale espagnole qui s’étendit sur presque trois siècles, depuis les années 1520 jusqu’aux années 1820, sur l’ensemble de l’Amérique latine, hormis le Brésil qui était sous domination portugaise, les pays de l’Amérique latine ont été officiellement indépendants mais, en réalité, se sont trouvés sous la domination de l’impérialisme américain.
La politique américaine à l’égard de l’Amérique latine débute avec la doctrine de Monroe, énoncée en 1823, qui déclare que « les continents américains (…) par conséquent, ne doivent pas être considérés comme objets de colonisation future par quelque puissance européenne que ce soit (…) nous devons à une certaine naïveté (…) de déclarer que nous considérerions toute tentative de leur part d’étendre leur système à quelque portion que ce soit de cet hémisphère comme dangereuse pour notre paix et notre sécurité. »
Les Etats-Unis, naturellement, ont ravi le Texas et la Californie au Mexique (quasiment la moitié de son territoire) au cours des années 1840.
Ils ont fomenté une ‘révolution séparatiste’ panaméenne, ont ravi Panama à la Colombie et en ont fait un régime fantoche.
Seuls les impérialistes britanniques, qui étaient les alliés des Américains, ont été autorisés à prendre les îles Falkland à l’Argentine et Belize au Honduras.
Par conséquent, partout, les pays de l’Amérique latine ont été des Etats officiellement indépendants depuis plus d’un siècle et demi, mais ils ont été soumis à la domination économique, politique, militaire et idéologique de l’impérialisme et, tout particulièrement, de l’impérialisme américain.
Partout où ses intérêts stratégiques en Amérique latine ont été en danger, l’impérialisme américain est intervenu directement, comme on l’a vu dans le cas du bombardement par l’US Navy et de la prise de Veracruz au Mexique, en 1914, et lors de l’intrusion de l’armée américaine au Mexique, en 1916, afin de capturer le dirigeant rebelle Pancho Villa – bien qu’elle eût échoué dans sa mission.
Du fait qu’il avait débarqué tardivement dans la lutte pour l’appropriation des colonies, la ligne néocolonialiste convenait aux intérêts de l’impérialisme américain.
En installant leurs régimes fantoches dans la quasi-totalité des vingt pays latino-américains, les impérialistes américains, conformément à la doctrine de Monroe, empêchèrent les autres puissances impérialistes de s’emparer des pays de l’Amérique latine. On retrouve la même politique dans la phase consécutive à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les impérialistes américains envisagèrent de s’approprier le monde entier via les institutions issues de Bretton Woods, comme la Banque mondiale, le FMI et le GATT.
Via ce genre de politique néocolonialiste, l’impérialisme américain n’a pas seulement tenu ses rivaux en dehors de l’Amérique latine, mais il a également créé l’illusion que ces pays étaient indépendants.
Car, en apparence, c’étaient les Mexicains qui gouvernaient le Mexique, les Vénézuéliens qui gouvernaient le Venezuela, les Boliviens qui gouvernaient la Bolivie, les Cubains qui gouvernaient Cuba, et ainsi de suite. Porfirio Diaz, le dictateur tant détesté du Mexique, était mexicain ; Juan Vicente Gómez, le boucher du Venezuela, était vénézuélien ; Batista, le despote de Cuba, était cubain ; ou, pour considérer des cas plus récents, Pinochet, le dictateur du Chili, était chilien et Fujimori était péruvien.
Constitutionnellement, tous ces pays étaient indépendants mais le véritable pouvoir était enraciné à Wall Street et Washington.
Une description de la manière dont fut établie la domination américaine sur ces territoires nous a été fournie par le général major Smedley, en 1935 :
« J’ai passé trente-trois ans et quatre mois en service actif comme membre de la force militaire la plus performante de notre pays, le corps des marines. J’ai occupé tous les grades d’officiers, depuis second lieutenant jusqu’à général major.
Et, au cours de cette période, j’ai passé la majeure partie de mon temps à jouer au Monsieur Muscle de haut niveau pour le compte de la Grosse Galette, pour Wall Street, et pour les banquiers. En bref, je rackettais pour le capitalisme…
Ainsi donc, en 1914, j’ai aidé à garantir les intérêts pétroliers américains au Mexique et, plus particulièrement, à Tampico.
J’ai aidé à transformer Haïti et Cuba en des endroits décents afin que la National City Bank puisse y engranger des revenus (…)
En 1909-1912, j’ai aidé à purifier le Nicaragua au profit de la société internationale de banque des frères Brown.
En 1916, j’ai mis de l’ordre dans la République dominicaine pour le compte des intérêts sucriers américains.
En 1903, j’ai aidé à remettre le Honduras ‘d’aplomb’ au profit des compagnies fruitières américaines… »
1.1. Le néocolonialisme après la Seconde Guerre mondiale
Bien que les méthodes dissimulées du colonialisme ne soient pas une forme tout à fait inédite de domination coloniale, ce qui est neuf, dans le phénomène du néocolonialisme d’après la Seconde Guerre mondiale, c’est qu’il est devenu la forme dominante et non plus une exception.
C’est la désintégration du système de la domination coloniale directe, due aux insurrections anti-impérialistes des nations opprimées dans les colonies et à l’apparition d’un puissant camp socialiste, qui a forcé l’impérialisme à adopter la stratégie nouvelle du néocolonialisme.
Bien que l’apparition du néocolonialisme ne constitue pas une phase nouvelle, elle signifie néanmoins l’affaiblissement de l’impérialisme dans sa nouvelle phase, celle de l’après-Seconde Guerre mondiale.
L’impact des mouvements de libération nationale, dans l’histoire du monde, a été si profond en Asie, en Afrique et en Amérique latine que les puissances impérialistes, telles les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal, furent forcées de rendre le pouvoir d’Etat à leurs anciennes colonies.
Les coups sévères assénés par les peuples du monde ont forcé l’impérialisme à revêtir la couverture d’une nouvelle forme, dissimulée, de colonialisme.
Pour l’impérialisme, une telle politique ne relevait pas d’un choix, mais d’une nécessité désespérée.
Pour résumer tout ceci en une seule phrase, le néocolonialisme est la forme typique de politique coloniale adoptée par l’impérialisme dans sa phase de retraite stratégique et de déclin. On pourrait évaluer l’importance de la faiblesse de l’impérialisme sur le fait suivant. Alors qu’en 1919, plus de 1,2 milliard de personnes sur une population mondiale de 1,8 milliard (pas loin de 70%) vivaient dans les colonies et semi-colonies, en 1966, la domination coloniale directe avait disparu dans la quasi-totalité de l’Asie, de l’Afrique et des Caraïbes.
C’est la combinaison des trois principaux facteurs politiques suivants sur la scène internationale qui a scellé le sort du système de domination coloniale directe :
1. l’apparition d’un puissant camp socialiste qui a apporté son soutien maximal aux luttes de libération nationale;
2. l’acharnement des mouvements anti-impérialistes de libération nationale eux-mêmes,
3. et les mouvements ouvriers et les mouvements pour la restauration de la démocratie et de la paix dans les pays impérialistes.
La Seconde Guerre mondiale a contribué au renforcement des facteurs politiques ci-dessus en même temps qu’elle affaiblissait l’impérialisme dans son ensemble, le forçant ainsi à battre en retraite.
Après des siècles de domination coloniale directe, la plupart des nations soumises réussissaient à se débarrasser de la domination impérialiste directe, et ce au cours des deux décennies qui allaient suivre la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, la quasi-totalité de l’Asie, moins de dix ans après la fin de la guerre, alors que, durant la seconde décennie de l’après-guerre, on assistait à la fin de la domination coloniale directe en Afrique.
Pourtant, en 1955, seuls cinq Etats pour l’ensemble de l’Afrique avaient proclamé leur indépendance, même si celle-ci n’était que purement formelle.
C’étaient l’Egypte, le Liberia, l’Ethiopie, la Libye et l’Union sud-africaine où un régime blanc, minoritaire et raciste était au pouvoir.
Au milieu de l’année 1968, le nombre de pays sortis de la domination coloniale directe s’élevait à quarante.
L’année 1960 a été appelée ‘l’année de l’Afrique’ : 17 pays accédèrent à l’ ‘indépendance’.
Ce développement énorme de la conscience nationale, les diverses puissances impérialistes furent obligées d’en tenir compte lorsqu’elles élaborèrent leurs stratégies à venir visant à poursuivre leur pillage et leur exploitation de ces pays.
La reconnaissance de ces réalités nouvelles et la nécessité de mettre sur pied une nouvelle approche fut exprimée sans équivoque par le général de Gaulle, le chef d’Etat français, dans le discours qu’il adressa aux officiers de l’armée française en décembre 1960.
Il tenta de convaincre ses officiers de se rendre compte de ce qui se passait dans le monde, de comprendre que les vieilles méthodes d’oppression et de domination par la force des armes, ainsi que l’exercice direct du pouvoir d’Etat, devenaient impossibles et qu’il fallait trouver une nouvelle façon de « poursuivre l’oeuvre de la France en Algérie ».
Pour « poursuivre leur oeuvre » dans leurs anciennes colonies, les impérialistes ont et élaboré leurs méthodes d’exploitation et de domination. De nouveaux organismes et instruments, comme les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, le GATT, l’USAID, etc. furent mis en service, on embaucha du nouveau personnel et on se servit de nouvelles armes – l’ensemble constituant le système du néocolonialisme.
1.2. Des tentatives avortées de perpétuer la domination directe
Les diverses puissances impérialistes, naturellement, n’allaient pas abandonner si facilement leur bonne vieille méthode de domination coloniale directe.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les puissances impérialistes occidentales utilisèrent tous les moyens à leur disposition pour reconquérir tous les territoires asiatiques qu’ils avaient perdus au profit des fascistes japonais durant la guerre.
Le camp socialiste n’était pas encore entièrement consolidé (la Chine était toujours en pleine guerre de libération) et les mouvements de libération nationale n’avaient pas encore atteint leur pleine maturité.
Par conséquent, tirant parti de cette situation, les puissances impérialistes occidentales essayèrent de rétablir promptement leur domination coloniale dans de vastes portions de l’Asie en écrasant les mouvements de libération avec une extrême férocité.
Pendant la guerre, toutes les puissances impérialistes occidentales ont été chassées de la région Asie-Pacifique par les impérialistes japonais: les Britanniques de la Birmanie et de la Malaisie, les Français de l’Indochine, les Hollandais de l’Indonésie et même les Américains des Philippines.
Ces puissances n’allaient jamais défendre les peuples contre le fascisme ni fournir des armes aux peuples pour qu’ils se défendent eux-mêmes.
Les peuples, évidemment, entrèrent en résistance contre le fascisme japonais et, avec la défaite du Japon en 1945, il y eut des insurrections populaires partout.
La République démocratique du Vietnam fut établie dans l’ensemble du Vietnam, tant le Nord que le Sud, en 1945.
En Indonésie, le peuple reprit le pouvoir de l’Etat des mains des Japonais et installèrent leur propre république en août 1945.
Le même mois, en guise de point culminant à la résistance héroïque opposée durant toute la guerre par l’Armée du Peuple malais contre le Japon, l’Union du Peuple malais contre le Japon établit son contrôle sur l’ensemble de la Malaisie. En Corée du Sud, la République populaire fut proclamée par le Congrès national réuni à Séoul en septembre 1945.
Aux Philippines, l’Armée du Peuple philippin contre le Japon, connue sous le nom de Hukbalahap, qui avait une force armée réelle de 10.000 hommes et une réserve de 40.000 autres en septembre 1944, libéra son pays des Japonais et, à la fin de la guerre, elle avait établi son contrôle sur la totalité du pays.
En Chine, dirigée par le Parti communiste chinois sous le commandement de Mao, la guerre en vue de la libération complète vis-à-vis du féodalisme et de l’impérialisme passa au stade d’offensive stratégique après l’effondrement du Japon.
En Inde, la mutinerie navale de 1946, les révoltes de Tebhaga et de Telangaga ainsi que les nouvelles insurrections de l’après-guerre parmi diverses sections de la population ébranlèrent les fondements même de la domination impérialiste britannique.
Confrontées à de telles difficultés, toutes les puissances impérialistes, y compris les Japonais, vaincus, combinèrent leurs forces pour renverser les gouvernements populaires et piétiner les flammes de la renaissance du militantisme national.
Au Vietnam, les troupes britanniques, françaises et japonaises attaquèrent en même temps le nouveau gouvernement, licencièrent les milices populaires et la milice, instaurèrent la loi martiale, s’emparèrent de tous les organes clés du pouvoir de l’Etat et rétablirent la domination française dans le pays.
Les événements de 1945 au Vietnam furent résumés par un auteur : « Par la grâce des Britanniques, et avec l’aide des Japonais, les Français avaient repris pied en Indochine. » Mais les Français furent battus lors de l’historique bataille de Diên Biên Phu, en 1954, et furent obligés de retirer leurs forces du Vietnam.
La tâche fut reprise plus tard par les impérialistes américains qui, eux aussi, durent subir une humiliante défaite, en 1973, des mains du peuple vietnamien.
En Indonésie, au cours d’une manoeuvre similaire, les impérialistes hollandais, avec l’aide des forces armées britanniques et des 80.000 Japonais libérés et armés par les Britanniques, reprirent toutes les villes clés, y compris Jakarta, et tentèrent de rasseoir leur domination sur leur ancienne colonie.
Mais l’intransigeante lutte armée du peuple indonésien, durant les trois ans et demi qui suivirent, chassa les impérialistes hollandais et l’Indonésie devint une république en 1948. Les tentatives en vue de rétablir la domination impérialiste en Indonésie se poursuivirent même plus tard et, en octobre 1965, à la faveur d’un coup d’Etat militaire, des centaines de milliers de communistes et d’autres patriotes et démocrates furent massacrés.
En Malaisie, les troupes britanniques débarquèrent moins d’un mois après la prise de pouvoir par l’Union du Peuple malais contre le Japon, refusèrent de reconnaître les nouvelles autorités gouvernementales et lancèrent une offensive générale d’une grande brutalité contre les syndicats et autres organisations démocratiques. Des milliers de personnes furent tuées ou arrêtées.
La lutte armée se poursuivit contre les Britanniques mais fut brutalement réprimée par le déploiement d’une armée britannique de 130.000 hommes.
Ce n’est qu’après que les forces révolutionnaires en Malaisie eurent subi de sérieux revers et que les Britanniques furent en mesure de transférer le pouvoir aux classes indigènes féodales et compradores que la Malaisie put enfin accéder à son indépendance constitutionnelle en 1957.
En Birmanie, la Grande-Bretagne fut obligée d’accorder l’indépendance en janvier 1948, mais seulement après avoir assassiné Aunug San et la plupart des dirigeants anti-impérialistes de premier plan.
Les troupes américaines qui arrivèrent en Corée du Sud un mois après la reddition du Japon en septembre 1945 supprimèrent le gouvernement démocratiquement élu de la République populaire de Corée, assassinèrent le dirigeant libéral Lyuh Woonhgung et ce fut un gouvernement droitier de marionnettes à la solde des Américains qui fut installé avec, à sa tête, le dictateur Syngman Rhee et ce, contre la volonté du peuple coréen.
Avant de déclarer l’indépendance des Philippines en juillet 1946, sur la base du Philippine Independence Act promulgué par le Congrès américain en 1934, les impérialistes américains prirent toutes les mesures utiles pour écraser les forces révolutionnaires et pour garder le contrôle économique et politique du pays.
Les Philippins furent obligés de donner leur accord à la liberté de commerce avec les Etats-Unis et d’autoriser l’installation de 22 bases militaires américaines dans l’archipel en vertu d’un bail de 99 ans libre de loyer.
L’Union nationale des Paysans, le Hukbalahap et le Parti communiste furent bannis et la marionnette américaine, le président Manuel Rojas, soutenu par 90.000 soldats américains, déclencha une guerre sanglante en vue de supprimer la paysannerie et les diverses forces révolutionnaires.
En Inde aussi, confrontés à la perspective d’une révolution et afin de sauvegarder leurs intérêts économiques dans le pays, les Britanniques n’eurent d’autre choix que de transférer le pouvoir aux classes de la grande bourgeoisie, des gros propriétaires et des compradores.
En Chine, les impérialistes américains injectèrent massivement 5 milliards de dollars entre 1945 et 1948 pour sauver le régime décadent de Tchang Kaï-chek, mais ne purent empêcher la victoire de la révolution chinoise.
En Afrique, durant toute la décennie qui suivit la Seconde Guerre mondiale, les luttes populaires furent matées par la force.
En 1947, à Madagascar, des milliers de personnes furent massacrées par les troupes françaises. Au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et au Kenya, au Congo, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, des milliers de personnes durent prendre les armes pour combattre la sauvage répression déclenchée par les diverses puissances impérialistes.
Ainsi donc, pendant plus d’une décennie après la Seconde Guerre mondiale, les diverses puissances impérialistes luttèrent désespérément et sans la moindre pitié pour rétablir l’ancien modèle de domination coloniale directe en Asie et en Afrique, mais elles furent forcées de le remplacer par le modèle néocolonial, en raison de la puissance croissante des mouvements de libération nationale et du camp socialiste. Dans un même temps, comme nous l’avons déjà vu, le modèle néocolonial n’a été instauré qu’après avoir écrasé les forces anti-impérialistes et révolutionnaires. Par conséquent, la contre-révolution est un élément essentiel du néocolonialisme.
Le but des puissances impérialistes était d’empêcher à tout prix l’apparition de gouvernements indépendants représentant les forces anti-impérialistes les plus consistantes.
Donc, avant de concéder l’indépendance formelle, les impérialistes se sont assurés que ce seraient les forces les plus conservatrices et de droite qui viendraient au pouvoir dans ces pays.
En Guyane, la question d’accorder l’indépendance fut tenue en suspens pendant plus d’une décennie afin de s’assurer que leur propres compradores viendraient au pouvoir.
A partir de 1953, lorsque le Parti populaire progressiste (PPP), dirigé par le Dr Cheddi Jagan, remporta les élections et constitua le gouvernement sous un système d’autonomie interne limitée, les impérialistes britanniques et américains ourdirent d’abord d’innombrables intrigues visant à liquider le PPP avant d’accorder l’indépendance à la Guyane.
Le PPP remporta les élections à trois reprises, entre 1953 et 1964, mais, en 1964, le pouvoir fut transféré à une coalition de partis compradores avant qu’on n’accorde l’ ‘indépendance’.
Les principales motivations sous-tendant les manoeuvres impérialistes visant à refuser l’indépendance à la Guyane furent mises en évidence par un auteur dans The Guardian : « La haine à l’égard de Jagan, la crainte de la moindre touche de socialisme et, économiquement, la sauvegarde de l’hémisphère au profit de Standard Oil, International Telephone, la United Fruit Company et d’autres encore (…). »
Au Basutoland (aujourd’hui, le Lesotho), lors des élections de 1965, juste avant l’ ‘indépendance’, le Parti du Congrès du Basutoland et le Parti Moremaflou de la Liberté récoltèrent la majorité des suffrages. Mais le gouvernement britannique passa le pouvoir à Chef Leabua et à son ‘Parti national’ qui était ouvertement soutenu par l’Afrique du Sud et l’Allemagne de l’Ouest.
En Amérique latine aussi, on poursuivit la même politique contre-révolutionnaire après 1945. Le Parti communiste brésilien, avec ses 800.000 voix aux élections de 1946, fut banni en 1947.
Au Venezuela, le gouvernement libéral de Gallegos fut renversé par un coup d’Etat en 1948, le parti communiste avait été banni en 1947 et on déclencha une sanglante campagne de répression.
Les coups d’Etat militaires contre des gouvernements libéraux, les assassinats de dirigeants de la classe ouvrière, les arrestations massives, les attaques contre les Partis communistes et la suppression générale des droits démocratiques constituèrent les éléments essentiels de la politique américaine en Amérique latine.
C’est pourquoi la Seconde Déclaration de La Havane proclama: « L’Amérique latine d’aujourd’hui subit un impérialisme plus féroce, plus puissant et plus impitoyable que sous l’empire colonial espagnol. »
A l’époque de l’impérialisme, il existe une règle générale : les révolutions démocratiques nationales, dans quelque colonie ou semi-colonie que ce soit, ne peuvent être menées à bien que par le prolétariat.
Il n’y eut donc qu’en Chine, en Corée du Nord, au Nord-Vietnam et à Cuba que l’impérialisme et le féodalisme purent être totalement renversés grâce au fait que la révolution démocratique nationale était dirigée par le prolétariat.
La bourgeoisie nationale, dans un pays colonial ou semi-colonial, comme l’a fait remarquer le camarade Mao et comme l’a prouvé l’expérience historique, est « extrêmement peu rigoureuse sur les plans économique et politique» et elle a une « propension à la conciliation avec les ennemis de la révolution ».
Citant le cas de la Turquie, où la bourgeoisie nationale, qui avait instauré une république indépendante en 1922, fut bientôt réduite à une position de soumission à l’impérialisme, le camarade Mao expliquait :
« Même si l’insignifiante dictature kémaliste de la bourgeoisie a émergé en Turquie après la première guerre impérialiste mondiale et après la révolution d’Octobre, suite à certaines conditions spécifiques (le succès de la bourgeoisie lorsque l’agression grecque fut repoussée et la faiblesse du prolétariat), il ne pourrait y avoir de seconde Turquie, et encore moins une ‘Turquie’ de 450 millions d’habitants, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l’accomplissement de la construction du socialisme en Union soviétique.
Dans les conditions propres à la Chine (le manque de rigueur de la bourgeoisie et sa propension à la conciliation et la force du prolétariat, avec sa profonde conscience révolutionnaire), les choses ne se déroulent jamais aussi facilement qu’en Turquie. Certains membres de la bourgeoisie chinoise ne se sont-ils pas réclamés du kémalisme après que la première Grande Révolution eut échoué en 1927 ?
Mais où est le Kemal de la Chine? Et où sont la dictature bourgeoise et la société capitaliste de la Chine ?
En outre, même la Turquie kémaliste dut se jeter elle-même dans les bras de l’impérialisme anglo-français, se muant de plus en plus en semi-colonie et en partie constituante du monde impérialiste réactionnaire.
Au vu de l’actuelle situation internationale, de deux choses l’une: les ‘héros’ dans les colonies et les semi-colonies s’alignent sur le front impérialiste et deviennent partie constituante des forces de la contre-révolution mondiale, ou ils s’alignent sur le front anti-impérialiste et deviennent partie constituante des forces de la révolution mondiale. Ils doivent faire l’un ou l’autre, car il n’y a pas de troisième choix. »
Par conséquent, dans chaque pays colonial qui est arrivé à décrocher son ‘indépendance’, soit les forces les plus conservatrices des compradores et des grands propriétaires sont venues au pouvoir en s’alliant avec l’impérialisme, comme en Inde, soit, là où la bourgeoisie nationale a pu accéder au pouvoir grâce à une puissante insurrection populaire comme en Algérie, au Congo, en Zambie etc., elle s’est soumise à l’impérialisme en permettant à ce dernier de poursuivre son exploitation et sa domination par le biais de méthodes indirectes.
A Zanzibar, par exemple, le pouvoir fut transféré aux forces pro-britanniques en 1963, mais 33 jours à peine après le transfert de pouvoir, le régime pro-britannique fut renversé par une insurrection armée soutenue par le peuple.
Mais, en l’absence d’une direction prolétarienne, le pays retomba une fois de plus dans le piège du néocolonialisme.
Partout, donc, les colonies de type ancien se transformèrent soit en semi-colonies, soit en néocolonies.
Le Parti communiste chinois, s’opposant au point de vue révisionniste soviétique prétendant que le colonialisme a presque disparu de la surface du globe et qu’il ne constitue donc aucune menace, expliquait comment le tigre néocolonialiste est entré par la porte de derrière :
« Les dirigeants du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) ont fréquemment émis l’opinion que le colonialisme avait disparu ou était occupé à disparaître du monde d’aujourd’hui.
Ils insistent sur le fait ‘que cinquante millions de personnes sur terre gémissent toujours sous la domination coloniale’, qu’on ne peut trouver les vestiges du colonialisme que dans quelques endroits comme les colonies portugaises d’Afrique, l’Angola, le Mozambique, et que l’abolition de la domination coloniale est presque entrée dans sa ‘phase terminale’.
Quels sont les faits?
Considérez, pour commencer, la situation en Asie et en Afrique.
Tout un groupe de pays y ont proclamé leur indépendance.
Mais un grand nombre de ces pays ne se sont pas complètement débarrassés du contrôle et de l’asservissement impérialiste et colonial et demeurent les objets du pillage et de l’agression impérialiste en même temps que des arènes de rivalités entre les anciens et les nouveaux colonialistes.
Dans certains de ces pays, les anciens colonialistes se sont mués en néocolonialistes et maintiennent leur domination coloniale par l’intermédiaire des agents qu’ils ont formés à cet effet.
Dans d’autres de ces pays, le loup est sorti par la porte de devant mais le tigre est rentré par celle de derrière, l’ancien colonialisme a donc été remplacé par le nouveau colonialisme américain, plus puissant et plus dangereux.
Les peuples d’Asie et d’Afrique sont gravement menacés par les tentacules du néocolonialisme, représenté par l’impérialisme américain. »
La déclaration de 1960 des 81 Partis insistait elle aussi sur le fait que «les impérialistes, avec à leur tête les Etats-Unis, font des efforts désespérés pour préserver l’exploitation coloniale des peuples des anciennes colonies par de nouvelles méthodes et de nouvelles formes» et qu’ils « essaient de maintenir leur emprise sur les leviers du contrôle économique et de l’influence politique dans les pays asiatiques, africains et latino-américains ». Là où le pouvoir du capital financier ne peut mettre certain régime du tiers monde à genoux, les impérialistes tendent par d’autres moyens tels blocus économique, complots en vue d’assassinats et coups d’Etats, y compris intervention militaire directe, à subordonner le régime audacieux comme au Vietnam, en Corée, au Nicaragua, au Salvador et, récemment, en Irak, en Libye et à Haïti.
Par conséquent, le néocolonialisme ne s’arrête pas simplement à la question de garder et d’étendre le contrôle économique de l’impérialisme mais il englobe toutes les sphères de l’existence.
La troisième Conférence des Peuples panafricains, lors de son réunion du Caire en 1961, insistait sur le fait que : « Le néocolonialisme, qui est la survivance du système colonial, en dépit de la reconnaissance formelle de l’indépendance politique de pays émergeants qui deviennent les victimes d’une forme indirecte et subtile de domination par des moyens politiques, économiques, sociaux, militaires ou techniques, est la pire des menaces pour les pays africains qui ont nouvellement acquis leur indépendance ou pour ceux qui sont proches de ce statut. »
Une résolution similaire sur ‘le colonialisme et le néocolonialisme’ adoptée lors de la Première Conférence de Solidarité des Peuples africains, asiatiques et latino-américains, tenue à La Havane en janvier 1966, insistait sur le caractère universel du néocolonialisme : « Pour garantir sa domination, l’impérialisme essaie de détruire les valeurs nationales, culturelles et spirituelles de chaque pays et constitue un appareil de domination qui inclut des forces armées nationales dociles vis-à-vis de leur ligne politique, la mise en place de bases militaires, la création d’organes de répression, avec des conseillers techniques en provenance des pays impérialistes, la signature de pactes militaires secrets, la formation d’alliances régionales et internationales fomenteuses de guerres.
Il encourage et mène des coups d’Etat et des assassinats politiques afin de mettre en place des gouvernements de marionnettes ; dans un même temps, dans le domaine économique, il recourt à des formules trompeuses, comme la prétendue Alliance pour le Progrès, Food for Peace et d’autres trucs du même genre, tout en utilisant des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque internationale de reconstruction et de développement pour renforcer sa domination économique. »
Naturellement, la haine a été grandissante à l’égard des méthodes néocolonialistes adoptées par l’impérialisme après la Seconde Guerre mondiale.
La puissance économique et militaire croissante du bloc socialiste au cours des années 1950 a également encouragé certaines classes dirigeantes du tiers monde à adopter, à certaines époques, une position anti-impérialiste.
On a craint de plus en plus, dans les pays impérialistes, que certains pays du tiers monde, dont la résistance du peuple était forte, n’aillent se lancer sur la voie du socialisme ou rejoindre le bloc anti-impérialiste.
La contradiction existant entre le camp impérialiste dirigé par l’impérialisme américain d’un côté, et le camp socialiste de l’autre, au cours des années 1950 et celle existant entre le camp impérialiste et le camp social-impérialiste durant les années 1960 et 1970, ont fourni de l’espace à certaines classes dirigeantes du tiers monde pour manoeuvrer et gagner quelques concessions de la part des impérialistes.
Lors de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), à Genève en 1965, 85 des 121 pays présents ont voté pour la proposition demandant instamment que des « mesures supplémentaires soient prises pour corriger la chute des prix des produits de base afin de protéger les producteurs de ces produits de base contre des pertes de revenus ». Seuls treize pays votèrent contre, parmi lesquels les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
La Conférence de Bandoung des dirigeants afro-asiatiques en 1955, les revendications émises par des dirigeants comme Nasser, d’Egypte, et, par-dessus tout, la libération de Cuba en 1959, après le renversement de la marionnette des Américains, Batista, ainsi que la menace de véritables révolutions dans certains pays du tiers monde, tout cela poussa les impérialistes à affiner leur stratégie. Ils reconnurent que la contre-insurrection armée devait être accompagnée par un certain degré de stabilité économique, pour ne pas dire de prospérité.
L’essence de la nouvelle stratégie libérale de l’endiguement avait été résumée en 1964 par le secrétaire d’Etat de Kennedy, Robert McNamara, lorsqu’il avait déclaré que « le programme d’aide alimentaire est la meilleure arme dont nous disposons pour nous garantir que nos propres hommes en uniforme ne seront pas obligés d’aller se battre » et que « les pauvres peuvent gagner une meilleure part de la prospérité nationale sans soulèvements politiques et sociaux ou sans priver gravement les élites locales ». Il est évident qu’à long terme, il s’agit d’une stratégie impossible car elle signifie courir avec le lièvre et chasser avec le chien, c’est-à-dire préserver le statu quo tout en réservant une part plus grande de la richesse nationale aux pauvres.
Puisqu’on s’était arrangé pour appliquer cette stratégie via l’injection massive de capitaux étrangers dans les pays du tiers monde, elle finit par capoter à la fin des années 1970, avec l’apparition de la crise de la dette.
Mais, dans son premier quart de siècle d’existence, la Banque mondiale s’était appuyée sur un modèle ‘néokeynésien’ qui insistait sur la planification gouvernementale et les dépenses en vue de créer de l’emploi tout en encourageant l’entreprise privée. Cette stratégie libérale de l’endiguement n’empêcha naturellement pas les impérialistes américains de se lancer dans une guerre à grande échelle au Vietnam mais, ce qui est important surtout, c’était qu’ils avaient également injecté au Sud-Vietnam des sommes colossales en vue de promouvoir le développement capitaliste et ce, de façon à détourner le peuple du socialisme.
Il vaut la peine de citer la fameuse Alliance pour le Progrès (appelée aussi l’Alianza), en fait une Alliance pour le Pillage (néocolonialiste), car il s’agissait d’un plan grandiose, promettant en Amérique latine un développement accompagné de réformes sociales limitées.
Lancée par John F. Kennedy en 1961, l’Alianza n’est autre qu’un programme de développement coopératif en dix ans, destiné à l’Amérique latine et prévoyant 100 milliards de dollars de dépenses, 80 milliards provenant de l’Amérique latine même, alors que 20 milliards étaient financés par les Etats-Unis.
On peut juger du caractère colossal du plan en songeant que même le plan Marshall, qui prépara la voie à la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, n’avait coûté qu’environ 17 milliards de dollars.
Les Etats-Unis, via l’USAID, la Banque interaméricaine de Développement, la Banque mondiale et le FMI, injectèrent en Amérique latine 2 milliards de dollars par an durant dix ans afin de contenir le ‘danger’ du communisme.
Cette stratégie transforma la totalité de l’Amérique latine en jardin de l’impérialisme américain. Bien qu’en apparence, on assista à une croissance rapide des économies, reposant sur les dettes extérieures, ce développement ne créa qu’une classe de nouveaux riches parmi les classes moyennes alors que la grande majorité de la population continua à mener une existence précaire dans l’indigence et la misère.
Vers la fin des années 1970, l’Alianza, le Peace Corps, les prétendus Programmes d’Aide entrepris par les institutions néolibérales comme le FMI, la Banque mondiale, l’IDA, l’ADB et autres institutions impérialistes n’ont fait que renforcer l’emprise déjà très forte des transnationales, des banques multinationales et des pays impérialistes sur les économies du tiers monde, tout particulièrement en Amérique latine.
Au Brésil, à la fin des années 1970, les transnationales prenaient à leur compte la moitié du total des ventes de produits manufacturés, alors qu’au Mexique, elles couvraient 30% de la production manufacturée.
La société transnationale s’est révélée comme le véhicule le plus important de l’exploitation néocoloniale du tiers monde.
En 1984, les 200 premières transnationales du monde avaient un chiffre d’affaires total de plus de 3.000 milliards de dollars, soit presque 30% du PIB mondial.
Du fait que les transnationales géantes commençaient à dominer chaque sphère de la vie, les violations à l’égard des droits de l’homme dans le tiers monde, et particulièrement en Amérique latine, ne connurent plus de limites.
En fait, en Amérique latine, les sociétés basées aux Etats-Unis, aidées par la CIA et la machine étatique américaine, orchestrèrent 60 coups d’Etat militaires dans les 15 premières années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale.
La situation empira encore au cours des années 1970 et 1980.
La Bolivie, sous le général Hugo Banzer, entre 1971 et 1978, le Chili sous Pinochet, qui reprit le pouvoir après l’assassinat de Salvador Allende en septembre 1973, le Nicaragua sous Somoza, le Guatemala sous le général et boucher Lucas Garcia, Haïti sous ‘Papa Doc’ et ‘Baby Doc’ Duvalier jusqu’en 1986, sans parler du Salvador, de la Colombie, du Honduras, du Pérou, du Brésil et des autres pays de l’Amérique latine et des Caraïbes qui ont vu disparaître des milliers de personnes – dirigeants syndicaux, militants paysans, intellectuels de gauche, étudiants et militants des droits civiques, etc.
Au Guatemala, au moins 25.000 civils furent tués par les troupes gouvernementales durant le règne de terreur déclenché par le général Luca Garcia entre 1978 et 1982.
On entreprit une militarisation massive dans chaque pays de l’Amérique latine en vue de supprimer toute forme de dissension et d’opposition au pillage des transnationales et aux lignes politiques pro-impérialistes (principalement pro-américaines) des classes dirigeantes.
Il vaut la peine de citer quelques extraits du discours prononcé par Salvador Allende devant les Nations unies et dans lequel il mettait le monde en garde contre la menace posée par les transnationales :
« Nous assistons à une confrontation directe entre les grandes sociétés transnationales et les Etats. Les sociétés font de l’ingérence dans les décisions fondamentales, tant politiques et économiques que militaires, des Etats.
Les sociétés sont des organisations mondiales qui ne dépendent d’aucun Etat, dont les activités ne sont pas contrôlées et qui n’ont de comptes à rendre devant aucun parlement ni aucune autre institution représentative de l’intérêt collectif.
En bref, toute la structure politique mondiale est en train d’être sapée. »
Il appréhendait également le danger que représentaient ces transnationales prédatrices pour la souveraineté de son pays :
« Non seulement nous endurons un blocus financier, mais nous sommes également les victimes d’une agression évidente.
Deux firmes faisant partie du noyau central des grosses sociétés transnationales qui ont enfoncé leurs griffes dans mon pays, à savoir l’International Telegraph and Telephone et la Kennecott Copper Corporation, ont tenté de gérer notre vie politique…
Dès l’instant où le mouvement populaire a été victorieux lors des élections de septembre 1970, ITT, une gigantesque société dont le capital est plus important que le budget de plusieurs pays de l’Amérique latine mis ensemble, voire plus important que celui de certains pays industrialisés, a entamé une action des plus sinistres afin de me tenir éloigné de la présidence. »
En septembre 1973, soit moins de neuf mois après son discours aux Nations unies, Allende était assassiné par la CIA afin qu’ITT puisse disposer en toute quiétude du Chili.
Les tentatives d’Allende visant à combattre l’impérialisme en comptant sur la bonne vieille machine de l’Etat, qui avait été jusque-là entraînée et nourrie par l’impérialisme américain, ne pouvaient que mener à un tel désastre.
La situation n’était guère différente aux Philippines, en Corée du Sud, à Singapour, à Taiwan, en Indonésie et dans la plupart des pays d’Afrique et du Moyen-Orient.
Nous ne citerons que quelques exemples des tactiques impérialistes de subversion et d’ingérence ouverte dans les affaires de ces pays : en Indonésie, jusqu’à un million de communistes et d’autres patriotes furent massacrés au milieu des années 60 ; au Congo, Patrice Lumumba, dirigeant du mouvement national de libération du Congo, fut assassiné ; au Ghana, Kwame Nkrumah fut renversé ; en Irak, la victoire du peuple en 1958 fut sapée par un coup d’Etat qui laissa des milliers de morts (la dernière en date des agressions contre l’Irak par les armées coalisées dirigées par les Etats-Unis s’est soldée par le massacre de centaines de milliers d’Irakiens) ; les atrocités les plus barbares ont été commises par les impérialistes américains en Indochine lors de leur guerre d’agression qui allait durer toute une décennie; en 1986, les Etats-Unis ont bombardé le palais présidentiel libyen dans une tentative d’éliminer Muammar al-Kadhafi ; ils ont envahi Grenade, une petite île pourtant nation souveraine ; ils ont enlevé Noriega au Panama et ont persécuté pour ainsi dire les communistes et les forces anti-impérialistes dans quasiment chaque pays de la planète.
En ce qui concerne l’exploitation économique, les dimensions du vol et du pillage des pays du tiers monde par les impérialistes de la phase néocoloniale dépassent de loin celles de l’époque coloniale.
Parmi les innombrables méthodes employées par les impérialistes pour arnaquer le tiers monde de son agriculture, de ses richesses et ressources, voici les principales: 1. via des investissements directs à l’étranger; 2. via des échanges inégaux de marchandises; 3. via des taux élevés d’intérêt sur les prêts.
Par exemple, les flux de capitaux totaux en investissements directs, nets, en provenance des Etats-Unis furent de 13,7 milliards de dollars entre 1950 et 1961, alors que le revenu total de ces investissements, pour la même période, fut de 23,2 milliards de dollars, c’est-à-dire un profit de 9,5 milliards de dollars.
Entre 1950 et 1960, rien qu’en Amérique latine, les investissements directs à l’étranger furent de 6,2 milliards de dollars, alors que les bénéfices transférés à l’étranger furent de 11 milliards de dollars, c’est-à-dire une perte sèche, pour l’Amérique latine, de 5 milliards de dollars.
Dans son discours de décembre 1972 aux Nations Unies, quelques mois avant son assassinat, le président chilien Salvador Allende parlait du pillage sans retenue de son pays par les corporations américaines comme l’Anaconda Company et la Kennecott Copper Corporation.
Il s’agissait dans ce cas du cuivre :
« Les mêmes firmes qui ont exploité le cuivre chilien durant de nombreuses années ont réalisé plus de 4 milliards de dollars de bénéfices au cours des 42 dernières années, alors que leurs investissements initiaux avaient été inférieurs à 30 millions de dollars. Un exemple simple et pénible, un contraste flagrant: dans mon pays, il y a 600.000 enfants qui ne pourront jamais profiter de la vie dans des conditions humaines normales parce que, durant les huit premiers mois de leur existence, ils ont été privés de la quantité indispensable de protéines.
Mon pays, le Chili, aurait été totalement transformé, avec ces 4 milliards de dollars.
Seule une infime partie de ce montant assurerait une fois pour toutes des protéines à tous les enfants de mon pays. »
Alors que la crise de l’économie mondiale s’aggravait, les pays impérialistes se mirent à accroître de façon massive leurs investissements directs dans les pays du tiers monde, et ce, dès les années 1970.
Comme les pays du tiers monde fournissaient de la main-d’oeuvre bon marché (par exemple, le revenu moyen d’un travailleur américain était de 1.220 dollars en 1972, alors que le travailleur taiwanais ne recevait qu’un salaire moyen de 45 dollars, le Sud-coréen 68 dollars, le travailleur de Singapour 60 dollars et le travailleur de Hong Kong 82 dollars), les gigantesques sociétés transnationales déplacèrent de plus en plus leurs opérations en direction des zones à bas salaires afin de contrebalancer la chute du taux de profit industriel résultant de l’augmentation massive de la composition organique du capital.
Entre 1965 et 1980, les investissements privés à l’étranger furent multipliés par quatre, passant de 50 milliards de dollars à 214 milliards, et le stock global d’actions des IDE (investissements directs à l’étranger) atteignit 500 milliards de dollars en 1980.
Au cours des années 1980 et 1990, du fait qu’un nombre sans cesse croissant de pays du tiers monde furent forcés d’ouvrir la totalité de leur propre marché, y compris le secteur des services, au capital, à la technologie et aux marchandises des impérialistes, on lança des mesures spécifiques telles le swapping, c’est-à-dire une opération d’échange couvrant – largement – le montant de la dette ainsi que des programmes de privatisation. Les flux des IDE en direction du tiers monde atteignirent des proportions effarantes.
Entre 1986 et 1990, les afflux d’IDE en direction du tiers monde crûrent à une moyenne annuelle de 21% en dollars actuels.
Le stock global d’actions des IDE fit plus que tripler, passant d’environ 500 milliards de dollars en 1980 à 1.700 milliards en 1990.
Bien que la plupart de ces transactions aient eu lieu entre les pays impérialistes eux-mêmes, il y eut toutefois un accroissement de flux des IDE en direction du tiers monde après que la Banque mondiale eut lancé son premier programme d’ajustement structurel en 1980.
En 1991, les afflux d’IDE vers le tiers monde passèrent à 36 milliards de dollars et à 40 milliards de dollars en 1992.
La part du tiers monde dans les IDE mondiaux a augmenté de 25% en 1991.
Il sera intéressant de comparer ceci avec les chiffres des exportations de capitaux durant la période coloniale.
En 30 années environ (de 1880 à 1913) d’exportation rapide vers les pays de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine, de capitaux provenant des anciens pays impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, les investissements totaux à l’étranger dans ces pays ne furent que de 19 milliards de dollars, en prix de 1970.
Avec un tel flux massif d’IDE en direction du tiers monde, l’industrie, la banque et autres services locaux sont invariablement confrontés à la fermeture, ils sont incapables de résister à la concurrence des puissantes sociétés et banques transnationales.
Par conséquent, les peuples du tiers monde sont exploités par les sociétés transnationales en tant que travailleurs (qui vendent leur main-d’oeuvre bon marché aux monopoles étrangers), en tant que producteurs paysans (dont les produits agricoles sont vendus à des prix extrêmement bas) et en tant que consommateurs (qui achètent des produits sur le marché, mais à des prix très élevés).
Une autre méthode pour amasser les richesses des pays du tiers monde consiste à leur concéder des prêts à des taux d’intérêt exorbitants.
En 1956, la dette extérieure totale des pays de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine s’élevait à 9,7 milliards de dollars, sur lesquels les pays payaient un intérêt, service compris, équivalant à 3% de leurs gains annuels sur les exportations.
Au début de la crise de la dette en 1982, le fardeau de la dette du tiers monde s’élevait à 785 milliards de dollars et, en 1993, il atteignait la somme faramineuse de 1.500 milliards de dollars, soit le double par rapport à dix ans plus tôt et 150 fois plus qu’en 1956.
Les transferts nets de ressources financières en provenance du tiers monde vers les banques commerciales s’élevaient à 178 milliards, entre les années 1984 et 1990.
La dette totale extérieure des 47 pays africains représente actuellement 110% de leur PNB combiné. Les opérations de remboursement des dettes des pays du tiers monde ont plus que quintuplé en 12 ans – passant de 7 milliards de dollars en 1980 à plus de 36 milliards de dollars en 1992.
Depuis que la crise de la dette a éclaté en 1982, il y a eu, dans l’autre sens, un afflux excédentaire de ressources en provenance du tiers monde vers les pays impérialistes de l’ordre moyen de 30 milliards de dollars chaque année, c’est-à-dire que, chaque année, les pays du tiers monde paient à leurs créanciers impérialistes 30 milliards de dollars de plus que ce qu’ils ont reçu sous forme de nouveaux prêts.
Cette ponction massive des richesses du tiers monde s’est traduite pour ces pays par un accroissement sans précédent du nombre de pauvres, de sans-abri et de sans-emploi.
En Afrique, 200 millions d’habitants, sur une population totale de 690 millions, vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. En Amérique latine, dont la population est à peu près la moitié de celle de l’Inde (environ 1 milliard d’habitants en 2001), près de 180 millions d’habitants vivaient dans la pauvreté au seuil des années 1990.
La relation entre dette extérieure et pauvreté a été clairement résumée par l’archevêque de Sao Paulo, au Brésil, mais la même chose vaut aujourd’hui pour tout autre pays du tiers monde.
« L’énorme effort des deux dernières années s’est traduit dans un excédent des exportations d’un milliard de dollars par mois.
Pourtant, cet argent n’a servi qu’à payer les intérêts de la dette.
Il est impossible de continuer dans cette voie.
Nous avons déjà pris tout ce que les habitants avaient à manger, même si les deux tiers d’entre eux crèvent déjà de faim.
Lorsque nous avons emprunté, les taux d’intérêt étaient de quatre pour-cent ; aujourd’hui, ils sont de huit pour-cent et, à certain moment, ils ont même été de vingt et un pour-cent. Pire encore, ces emprunts ont été contractés par les militaires et à des fins généralement militaires – 40 milliards de dollars ont été engloutis par six centrales nucléaires dont aucune ne fonctionne aujourd’hui. On attend aujourd’hui des gens qu’ils remboursent ces dettes moyennant de bas salaires et la famine.
Mais nous avons déjà remboursé cette dette une ou deux fois de trop, si l’on considère les intérêts payés. Nous devons cesser de donner le sang de notre peuple et sa misère pour rembourser le premier monde. »
Dans l’ensemble du tiers monde, le nombre de personnes vivant dans une extrême indigence atteint presque les 700 millions.
La majeure partie de l’Afrique est devenue une région chroniquement exposée à la famine et des centaines de milliers de personnes meurent comme des mouches chaque année.
Même si la grande majorité des habitants du tiers monde meurent de faim et de maladie, la faim des maîtres néocoloniaux, elle, devient de plus en plus insatiable. Les avoirs des sociétés dans les pays débiteurs passent aux mains des énormes monopoles via certains schémas tels le swapping, c’est-à-dire des échanges correspondant au montant de la dette.
L’inégalité des échanges constitue toutefois une autre méthode de vol utilisée par les impérialistes commerçant avec le tiers monde.
La plupart des pays du tiers monde dépendent de leurs exportations de produits de base et de l’importation de marchandises industrielles et de technologie de l’Occident.
Alors que les prix des produits de base sur les marchés internationaux baissent chaque année, en raison surtout des manigances des sociétés de l’agrobusiness et autres monopoles, les prix des produits industriels, eux, grimpent sans cesse.
Par exemple, entre 1955 et 1959, les prix à l’exportation ont baissé de 15%, entraînant une perte, pour l’Afrique tropicale, de 600 millions de dollars, soit le double du montant de l’aide extérieure.
Une simple comparaison entre les prix à l’exportation et à l’importation donne une image graphique du vol perpétré par les prédateurs néocoloniaux via cette inégalité des échanges:
| Pour acheter une tonne d’acier importé | En 1951 | En 1961 | Augmentation |
| Le Ghana devait exporter un poids de cacao de | 90 kg | 255 kg | 283 % |
| Le Brésil devait exporter un poids de café de | 70 kg | 169 kg | 241 % |
| La Malaisie devait exporter un poids de caoutchouc de | 58 kg | 196 kg | 332 % |
En 1952, à l’époque où le Ghana était sous domination coloniale directe, il recevait 467 £ par tonne (1.016,05 kg) de cacao exporté. A l’époque de l’ ‘indépendance’, en 1957, il ne percevait plus que 200 £ la tonne. En 1968, le prix descendit dramatiquement à 85 £ la tonne.
Le cacao étant le produit le plus important dont dépendait la vie économique du Ghana, une telle dégringolade dans les prix de son marché se traduisit par un mécontentement des masses puis, par un coup d’Etat contre le président Nkrumah.
Même aujourd’hui, l’Afrique dépend uniquement des exportations de ses richesses naturelles, comme les diamants, le cuivre, les denrées alimentaires, les boissons, etc.
Entre 90 et 95% des échanges de la Zambie avec l’étranger proviennent d’un seul métal, le cuivre.
En 1985, le prix du cuivre chuta à un tiers de ce qu’il était en 1966, alors que les prix des denrées alimentaires, de l’essence et des marchandises industrielles essentielles fut multiplié plusieurs fois. Au cours du quart de siècle qui a suivi son ‘indépendance’, la Zambie s’est muée en pays gravement endetté et elle doit dépendre des impérialistes, même pour sa nourriture.
En 1986, l’Argentine, un grand exportateur de denrées alimentaires, a subi une perte d’au moins 2 milliards de dollars due à une dégringolade des prix de ses exportations.
Les exportations de froment richement subsidiées en provenance des Etats-Unis et de la CEE sont la cause de la chute des prix du froment sur le marché mondial.
Les pays impérialistes et leurs organismes multilatéraux comme la Banque mondiale ont découragé les pays du tiers monde à produire des récoltes destinées à leur propre consommation alimentaire et les ont poussés à se tourner vers des récoltes destinées à la vente.
Il s’en est suivi une faillite complète des économies de plusieurs pays du tiers monde en raison de la chute sévère des prix des récoltes destinées à la vente.
En 1986, le prix du thé – l’une des principales exportations du Kenya – a été réduit de moitié par rapport à l’année précédente.
En 1985, en Tanzanie, les gains des exportations sur les produits comme le coton se situaient 40% plus bas que ceux de 1980. En 1986, la situation empira encore.
Pour reprendre les mots du président de l’époque, Julius Nyereree :
« Les paysans de nos grandes régions cotonnières ont plus que doublé leur récolte de coton par rapport à celle de l’an dernier.
Nous sommes désespérément à court d’échanges avec l’étranger qui nous permettraient de faire venir des importations essentielles, et le coton est l’une de nos principales exportations ; c’est pourquoi nous avons été enchantés par cette grosse augmentation de la production. Mais, en juillet de cette année, le prix du coton sur le marché mondial a chuté, passant de 68 cents la livre à 34 cents la livre en une seule journée.
Le résultat pour notre économie – et pour les revenus des paysans – est semblable à celui d’une catastrophe naturelle : une moitié de notre récolte et, partant, une moitié de nos revenus, est perdue. Nos paysans – et notre nation – ont produit l’effort, mais le pays ne gagne pas un seul cent de plus dans ses échanges avec l’étranger.
C’est du vol ! »
Suite à sa dépendance vis-à-vis du marché mondial pour sa survie, la Tanzanie, elle aussi, est devenue gravement endettée et est désormais forcée de sacrifier 60 pour-cent de tous ses gains à l’exportation pour rembourser sa dette.
Après que le Maroc eut obtenu son ‘indépendance’ vis-à-vis de la France, en 1956, la Banque mondiale lui conseilla de cultiver des variétés pour l’exportation, comme les citrons et les légumes frais.
A cette fin, elle finança plusieurs barrages et avança des prêts. Résultat : le Maroc, jadis l’un des greniers de l’Afrique et fournisseur majeur de la France, importe aujourd’hui plus de 3 millions de tonnes de froment chaque année alors que ses oranges et ses tomates pourrissent dans ses champs en raison du manque de demande sur les marchés mondiaux.
En outre, le pays a aujourd’hui une colossale dette extérieure de 16 milliards de dollars et il est forcé de verser 47% de son budget annuel rien que pour le remboursement de sa dette.
Au cours du premier semestre de 1985, sur les conseils du FMI, la Thaïlande a accru ses exportations de caoutchouc de 31% par rapport à la même période de 1984.
Mais ses revenus ont baissé de 8% en raison de la chute des prix du caoutchouc.
Entre 1984 et 1985, les sociétés qui transforment les matières premières du tiers monde ont bénéficié d’une baisse de 10% dans le coût des matières premières agricoles et d’une baisse de 15% dans les prix des métaux, c’est-à-dire qu’en l’espace d’une seule année, il y a eu une ponction de 65 milliards de dollars dans le tiers monde en raison de la chute des prix des exportations de marchandises de base.
Voilà le pillage massif auquel se livrent les impérialistes dans la phase néocoloniale.
Dans la plupart des pays du tiers monde, les sources d’information elles aussi sont soit influencées soit contrôlées par les impérialistes.
Via leur réseau mondial, les médias occidentaux, presse, radio, TV, éducation etc., tentent de mouler les opinions et idées des gens en faveur du modèle occidental du capitalisme et contre le socialisme, l’indépendance et la démocratie.
En résumé, le néocolonialisme poursuit la même vieille ligne de soumission politique et d’exploitation économique des gens du tiers monde.
Il continue à extraire du tiers monde de superprofits monopolistes, de trente-six façons différentes.
Les années 1950 et 1960 (et même durant la période courant jusqu’au milieu des années 1970) ont permis d’assister à des insurrections massives contre le pillage et la domination coloniale et néocoloniale du tiers monde, insurrections qui ont même abouti à quelques succès significatifs dus à la force organisée des luttes populaires de libération, à la force et au soutien des pays socialistes (en dépit de la dégénérescence d’une partie du camp socialiste après l’accession au pouvoir de Khrouchtchev) et à la solidarité témoignée par la classe ouvrière et les peuples des pays impérialistes.
Mais, à partir du milieu des années 1970, l’impérialisme répondait par une offensive de grande envergure. L’inextricable crise dans laquelle l’impérialisme s’était retrouvé lui-même depuis le début des années 1970 et la collusion et les querelles croissantes entre les diverses puissances impérialistes en vue d’une part plus importante du marché mondial allaient déboucher sur une intensification de l’offensive contre le tiers monde.
L’une des caractéristiques importantes du néocolonialisme est qu’en plus de fournir de nouvelles opportunités d’exploitation à chaque puissance impérialiste, il rend également possible leur ‘exploitation conjointe’ du tiers monde, c’est-à-dire un colonialisme collectif tel qu’il s’exprime par le biais d’institutions collectives comme la Banque mondiale, le FMI, le GATT et d’autres. Ces tentatives de colonialisme collectif ne vérifient pas la thèse kautskiste de l’ultra-impérialisme, mais indiquent la faiblesse de l’impérialisme dans son ensemble.
Sans aucun doute, la crise générale croissante et la chute des taux de profit donneront-elles lieu, avec le temps, à des rivalités plus féroces et à des confrontations violentes entre les diverses puissances impérialistes et leurs sociétés transnationales.
Commençant par l’Amérique latine, l’offensive néocolonialiste se répandit dans le reste du tiers monde au cours des années 1980 et 1990. Dans cette offensive vigoureuse, lancée avec une brutalité et une férocité extrêmes, les acquis, de quelque importance qu’ils eussent été, des peuples du tiers monde furent réduits à néant. Par conséquent, il ne nous faut entretenir aucune illusion : le néocolonialisme n’est pas seulement un impérialisme en retraite, bien qu’il soit dans sa phase finale de déclin.
En fait, l’impérialisme a trouvé une nouvelle base pour poursuivre ses activités prédatrices dans le tiers monde.
2. L’impact du néocolonialisme sur les rapports féodaux et semi-féodaux en agriculture et sur le développement du capitalisme dans les pays arriérés
Quel est l’impact du néocolonialisme sur les rapports féodaux et semi-féodaux en agriculture et sur le développement du capitalisme dans les pays arriérés ?
On a avancé plusieurs théories, depuis la Seconde Guerre mondiale, à propos du rôle du néocolonialisme dans les pays du tiers monde. Alors que certains affirment que l’impérialisme, via ses lignes politiques néocolonialistes, a amené un changement qualitatif profond dans les rapports de production précapitalistes – et ce, par le biais d’un développement rapide des forces productives dans le tiers monde, en vue de créer un marché pour ses produits et des débouchés pour ses surplus de capitaux accumulés et d’exploiter la main-d’oeuvre bon marché, les terres et les ressources des pays du tiers monde – d’autres, toutefois, se refusent à voir le moindre changement qui soit dans les anciens rapports de production précapitaliste.
La vérité, cependant, réside quelque part entre ces deux extrêmes. Avant de comprendre les changements engendrés par les formes néolibérales d’exploitation après la fin de la domination coloniale, dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, il convient d’abord d’examiner les changements qui se sont produits durant la période coloniale.
2.1. L’impact de la domination coloniale directe sur les structures et classes précapitalistes
L’ancien système de domination coloniale consistait, en essence, en une alliance entre l’impérialisme extérieur et les forces précapitalistes locales – les seigneurs féodaux, les princes, les rajahs, les cheikhs, les chefs tribaux etc. – bien que dans certaines colonies développées comme l’Inde, des sections de la classe capitaliste locale coopérèrent aussi et se commirent avec l’impérialisme.
Ceci était dû au fait que les rapports de production dans les colonies et les semi-colonies étaient à prédominance précapitaliste et, par conséquent, la bourgeoisie nationale était soit absente (comme dans la majeure partie de l’Afrique), soit très faible.
Sous le colonialisme, un certain développement eut lieu, mais c’était un développement complètement déformé qui se traduisait par une économie totalement déséquilibrée et par un appauvrissement de la vaste majorité du peuple.
L’impérialisme transforma les pays coloniaux en bases de production de matières premières ou de produits de base – des minerais et de la production agricole destinés à l’exportation.
Souvent, toute l’économie d’un pays reposait sur la production et l’exportation d’une ou deux marchandises – le Ghana sur le cacao, la Gambie sur les arachides, Zanzibar sur les clous de girofle, le Tanganyika sur le sisal et le café, la Malaisie et l’Indonésie sur le caoutchouc et l’étain, Ceylan sur le thé et le caoutchouc, la Jamaïque sur le sucre et les bananes, etc.
Toutes les mines et plantations étaient aux mains des gros monopoles des impérialistes qui employaient la main-d’oeuvre locale à des salaires extrêmement bas ou amenaient de la main-d’oeuvre bon marché de l’extérieur (comme les ouvriers agricoles chinois dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est).
Les monopoles commerciaux étrangers achetaient également les produits des producteurs paysans locaux à des prix très bas.
Les rapports marchands furent développés en convertissant la terre en une marchandise, en collectant des taxes en espèces, en payant les salaires en cash dans les plantations et les mines européennes, en achetant chez les producteurs paysans locaux des matières premières telles le coton, le jute, les arachides, le sucre, etc. pour les firmes monopolistes et en vendant les marchandises impérialistes aux habitants des colonies.
Les intérêts de l’ancien système colonialiste consistaient donc à empêcher l’industrialisation des colonies et à les préserver en tant qu’hinterlands pour la fourniture de matières premières à bon marché – des produits agricoles et miniers – aux industries des pays impérialistes.
Le Sixième Congrès de la Troisième Internationale, dans sa Thèse sur le mouvement révolutionnaire dans les pays coloniaux et semi-coloniaux, expliquait ce développement capitaliste déformé dans les termes suivants :
« Dans la mesure où, toutefois, l’exploitation coloniale présuppose un certain encouragement du développement de la production dans les colonies, ce développement, grâce au monopole impérialiste, est dirigé selon les seules lignes de conduite et selon le seul degré qui correspondent aux intérêts de la métropole (les Etats impérialistes) et, en particulier, aux intérêts de la préservation de son monopole colonial.
Ceci peut amener une partie de la paysannerie, par exemple, à passer de la culture céréalière à la production de coton, de sucre ou de caoutchouc (cultures destinées à l’exportation), mais ceci se fait de telle façon et selon de tels moyens que cela ne coïncide non seulement pas du tout avec les intérêts du développement économique indépendant du pays colonial, mais, au contraire, renforce toujours plus solidement la dépendance de ce dernier à l’égard de la métropole impérialiste.
Dans le but d’élargir la base des matières premières au profit de l’impérialisme mondial, on a lancé de nouvelles cultures agricoles destinées à remplacer celles détruites par la ligne de conduite coloniale.
Avec les mêmes objectifs à l’esprit, on construit de nouveaux systèmes d’irrigation en remplacement des anciens que l’on a détruits et, dans les mains des impérialistes, ils deviennent une arme permettant d’accroître l’exploitation de la paysannerie.
Dans l’intention d’agrandir le marché interne, on y va de tentatives en vue d’adapter au mode capitaliste de production les relations agricoles qui ont été partiellement créées par la ligne de conduite coloniale elle-même.
Des plantations de différentes sortes servent les intérêts du capital financier métropolitain (impérialiste).
L’exploitation des richesses minérales des colonies s’effectue en fonction des besoins de l’industrie du pays impérialiste, et tout spécialement de ses besoins de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis des sources de matières premières d’autres pays dans lesquels le monopole de cet impérialisme en particulier n’étend pas ses tentacules.
Voilà les principales sphères de la production coloniale. En tout cas, les entreprises capitalistes créées par les impérialistes dans les colonies (à l’exception de quelques entreprises installées à des fins militaires) sont majoritairement, voire exclusivement, de caractère capitaliste agraire et elles se distinguent par une faible composition organique de leur capital.
La véritable industrialisation du pays colonial, en particulier la construction d’une industrie mécanique florissante qui pourrait permettre le développement indépendant des forces productives du pays, n’est pas accélérée mais, au contraire, elle est freinée au maximum par les impérialistes.
Telle est l’essence de sa fonction d’asservissement colonial : le pays colonial est forcé de sacrifier les intérêts de son développement indépendant et de jouer un rôle d’annexe économique (avec ses matières premières agricoles) du capitalisme étranger, ce qui, aux dépens des classes laborieuses du pays colonial, renforce la puissance économique et politique de la bourgeoisie impérialiste afin de perpétuer le monopole de cette dernière dans les colonies et d’accroître son expansion par rapport au reste du monde. »
Pour comprendre plus clairement ce développement déformé des économies dans les colonies, illustrons-le au moyen du cas d’un seul pays, le Ghana.
A l’époque de la conquête de son indépendance, en 1957, le pays exportait de la bauxite et importait des pots et des casseroles d’aluminium. Exportant de l’huile de palme, il importait du savon. Exportant du bois, il importait des meubles et du papier.
Exportant des peaux, il importait bottes et chaussures. Le plus grand producteur mondial de cacao exportait du cacao brut et devait importer le moindre bâton de chocolat ou boîte de cacao dont il avait besoin. Il dépensait même des centaines de millions de livres par an pour importer les sacs de jute servant à emballer ses fèves de cacao brut pour l’exportation.
Plus incroyable encore, si c’est possible : une firme britannique possédant des plantations de citrons au Ghana pressait le jus des fruits, acheminait le jus en vrac par bateau en direction de la Grande-Bretagne où on le mettait en bouteille ; le produit final était réexporté au Ghana où il était détaillé à haut prix dans les boutiques locales.
Mais, afin de mener ce pillage à bien, les puissances coloniales devait inévitablement construire des routes et des lignes de chemin de fer, installer des ports et développer certaines infrastructures qui, inévitablement, menaient au développement de certains rapports capitalistes.
L’exportation de capitaux, à partir de la dernière décennie du 19e siècle, a accéléré ce développement. Le camarade Lénine faisait remarquer que « l’exportation de capitaux influence et accélère grandement le développement du capitalisme dans ces pays vers lesquels ils sont exportés ».
Mais, comme on l’a déjà dit plus tôt, ce développement capitaliste a été déformé et adapté uniquement aux besoins en matières premières des monopoles impérialistes. Les rares industries établies là-bas étaient contrôlées par les impérialistes ; les industries minières et d’extraction du pétrole, ainsi que les plantations étaient entièrement aux mains du capital impérialiste.
Comme ce développement partial dans les colonies n’était pas destiné à satisfaire le marché interne mais à servir les métropoles impérialistes, il ne pouvait se développer au-delà de certaines limites.
Et, pour la même raison, les rapports précapitalistes demeurèrent prédominants dans les colonies alors que les rapports capitalistes leur étaient juxtaposés artificiellement de l’extérieur, au contraire du développement du capitalisme dans la matrice des formations sociales précapitalistes existant en Europe et en Amérique où le marché interne assurait une base solide à la pleine maturation du capitalisme.
Le capitalisme qui émergeait dans les pays occidentaux avait son propre dynamisme interne qui lui permit de prendre une expansion sans limite et de transformer les structures féodales, semi-féodales et autres structures précapitalistes qui se présentaient au travers de sa route, détruisant même par la force ces rapports précapitalistes de production.
Tout acte de destruction de ce qui existait auparavant fut, en même temps, un acte de création de nouveaux rapports capitalistes.
Le développement rapide des forces productives dans les pays capitalistes reposait sur les propres marchés internes, en dépit de l’exploitation et du pillage sans retenue des colonies et semi-colonies et du commerce barbare des esclaves qui fournit l’élan initial en fournissant une accumulation primitive de capitaux.
Même au Japon où, du fait de la révolution démocratique inachevée, les rapports semi-féodaux se maintinrent dans l’agriculture jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme put se développer à un rythme rapide puisqu’il reposait entièrement sur le capital indigène, lequel avait un développement indépendant.
En dépit de son extrême arriération jusqu’au dernier quart du 19e siècle et d’une grave pénurie de matières premières, le principal avantage du Japon était qu’il ne fut jamais une colonie ni même une semi-colonie.
Comme le marché interne était très limité, avant la Seconde Guerre mondiale, en raison des rapports semi-féodaux qui agissaient comme une entrave, le capital japonais, aidé par une machine étatique hautement militarisée, s’empara des marchés et sources extérieurs de matières premières.
Mais, par un contraste impressionnant, dans les colonies et les semi-colonies, l’ancien mode de production ne fut que partiellement détruit sans que l’on créât quelque chose de neuf pour le remplacer; des ‘enclaves’ capitalistes se développèrent côte à côte avec des structures et rapports précapitalistes.
Les artisans ruinés ne purent être absorbés dans la sphère de production puisqu’il n’y avait que peu de nouvelles industries et, de ce fait, ils durent se tourner vers les campagnes, aggravant ainsi la crise agraire.
Ce fut une véritable régression économique qui se répercuta par une autre dépression du marché interne dans les colonies et semi-colonies.
En raison de l’extrême faiblesse des marchés internes des colonies et semi-colonies, les investissements étrangers dans ces pays furent réalisés presque exclusivement en fonction des marchés impérialistes.
Par exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, la proportion des investissements étrangers dans les industries et visant le marché interne tournait autour de 15% des investissements étrangers totaux dans les pays coloniaux, semi-coloniaux et dépendants.
Les exploitations minières, les plantations, le transport, les groupements commerciaux, les banques et les compagnies d’assurances etc., furent tous installés dans l’optique des exportations.
Le secteur capitaliste dans le processus du développement fut donc totalement étranger à l’économie locale.
Les rapports et structures précapitalistes furent adaptés aux besoins des dirigeants coloniaux mais ne subirent pas de transformations radicales en vue de créer un véritable mode capitaliste de production.
De même, politiquement, les dirigeants coloniaux furent confrontés au besoin pressant de créer des appuis sociaux pour la minorité de leur personnel dirigeant.
La bourgeoisie commerçante et prêteuse de fonds, quand elle était présente, s’allia au capital étranger et se mua donc en une bourgeoisie compradore.
Les propriétaires terriens et les chefs tribaux devinrent les appuis sociaux des dirigeants coloniaux.
Le camarade Mao, se référant à la Thèse sur le mouvement révolutionnaire dans les pays coloniaux et semi-coloniaux du 6e Congrès du Komintern, qui avait eu lieu en 1928, et à La révolution en Chine et les tâches du Komintern du camarade Staline, expliquait ce phénomène dans le contexte de la Chine :
« Les puissances impérialistes ont fait de la classe des seigneurs féodaux, de même que de celle des compradores les principaux appuis sociaux de leur pouvoir en Chine.
L’impérialisme commence d’abord par s’allier avec les couches dirigeantes de la précédente structure sociale, avec les seigneurs féodaux et la bourgeoisie commerçante et prêteuse de fonds contre la majorité du peuple. Partout, l’impérialisme tente de préserver et de perpétuer toutes ces formes précapitalistes d’exploitation (tout particulièrement dans les villages) qui servent de base à l’existence de ces alliés réactionnaires.
L’impérialisme, avec tout son pouvoir financier et militaire, est la force, en Chine, qui soutient, inspire, favorise et préserve les survivances féodales, en même temps que la totalité de leur superstructure bureaucratico-militariste. »
Plus loin, il faisait encore remarquer :
« Toutefois, l’apparition et le développement du capitalisme n’est qu’un des aspects du changement qui s’est produit depuis la pénétration impérialiste en Chine.
Il y a un autre aspect concomitant et obstructif, c’est la collusion de l’impérialisme avec les forces féodales chinoises afin d’arrêter le développement d’un capitalisme chinois. »
Mais, en même temps que les classes sociales caractéristiques des formations précapitalistes, telles les seigneurs féodaux, la paysannerie asservie ou attachée à la glèbe, les hommes de métier et artisans des villages, les prêtres, les chefs, les cheikhs et les rajahs, de nouvelles classes de travailleurs salariés et de capitalistes apparut également durant la période coloniale.
Une couche de personnel professionnel, technique et spécialisé dans les services, occupant des postes modestes dans l’administration coloniale, les forces armées, les services postaux, les hôpitaux, les écoles et collèges etc., apparurent également en tant que forces nouvelles.
Le camarade Mao, dans A propos de la nouvelle démocratie, expliquait ces nouveaux changements survenus en Chine dans le sillage de l’apparition d’un secteur capitaliste dans l’économie chinoise :
« La société chinoise a progressivement changé de caractère depuis l’apparition d’une économie capitaliste en Chine ; ce n’est plus une société entièrement féodale, mais semi-féodale, quoique l’économie féodale prédomine toujours. Comparée à l’économie féodale, cette économie capitaliste représente un type nouveau.
Les forces politiques de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie et du prolétariat sont les nouvelles forces politiques qui ont surgi et se sont développées simultanément avec cette nouvelle économie capitaliste. Et la nouvelle culture reflète ces nouvelles forces économiques et politiques dans le domaine de l’idéologie et les sert.
Sans l’économie capitaliste, sans la bourgeoisie, la petite bourgeoisie et le prolétariat, et sans les forces politiques de ces classes, la nouvelle idéologie ou nouvelle culture ne serait jamais apparue. »
Bien que le capitalisme se soit développé jusqu’à un certain point dans l’agriculture – le rythme du développement lui-même étant conditionné par l’importance des exportations de cultures destinées à la vente dont ont besoin les pays impérialistes – elle a survécu comme forme secondaire avec les rapports féodaux et semi-féodaux.
C’est ce que mettait en évidence les fameuses Thèses du Komintern :
« Le capitalisme, qui a incorporé le village colonial dans son système de taxation et son appareil commercial et qui a bouleversé les rapports précapitalistes (par exemple, la destruction de la communauté villageoise), ne libère pas, ce faisant, les paysans du joug des formes féodales de servitude et d’exploitation, mais donne à ces dernières une expression monétaire (les services et locations féodaux alors que le paiement des taxes en nature est remplacé par des taxes en espèces, et ainsi de suite) qui accroît encore davantage la souffrance de la paysannerie.
Au ‘secours’ des paysans dans leur misérable condition vient l’usurier qui les dépouille et qui, dans certaines conditions (par exemple, dans certaines localités de la Chine et de l’Inde), crée même un esclavage héréditaire reposant sur leur endettement (…)
En dépit de la grande variété des rapports agraires dans divers pays coloniaux, et même dans différentes parties d’un seul et même pays, la condition des masses paysannes frappées par la pauvreté est presque partout la même (…)
La grosse propriété terrienne, ici, n’a pas grand-chose à voir que ce soit avec l’agriculture à grande échelle, mais sert uniquement de moyen d’extorquer des loyers aux paysans. On peut fréquemment trouver une hiérarchie à niveaux multiples, consistant en seigneurs, vassaux, chaînons parasitaires intermédiaires entre le cultivateur qui travaille son champ et le grand propriétaire (le zamindar) ou l’Etat. (…)
Des masses importantes de la paysannerie sont exclues du processus de production; elles n’ont aucune chance de trouver du travail dans les villes et n’en trouvent guère non plus dans les villages, où elles se transforment en misérables coolies (…)
Les tentatives dérisoires d’appliquer des réformes agraires sans porter préjudice au régime colonial sont voulues pour faciliter la conversion progressive de la propriété terrienne semi-féodale en propriété terrienne capitaliste; et, dans certains cas, pour établir une couche étroite de paysans de type koulak.
En pratique, ceci ne conduit qu’à une paupérisation toujours croissante qui, à son tour, paralyse une fois de plus le développement des marchés internes! »
Faisant référence aux changements qui ont eu lieu dans l’économie chinoise avec l’avènement du capital étranger, le camarade Mao écrivait :
« Les fondements de l’économie naturelle autosuffisante de l’époque féodale ont été détruits, mais l’exploitation de la paysannerie par la classe des propriétaires terriens, qui est la base du système de l’exploitation féodale, non seulement demeure intacte mais, liée comme elle est à l’exploitation par le capital compradore et usuraire, elle domine clairement la vie sociale et économique de la Chine. »
« Le capitalisme national s’est développé jusqu’à un certain niveau et a joué un rôle considérable dans la vie politique et culturelle de la Chine, mais il n’est pas devenu le modèle principal de l’économie chinoise ; il manque de vigueur et il est généralement associé à l’impérialisme étranger et au féodalisme domestique à des degrés divers. »
Finalement, il ne faudrait pas oublier que les effets de la domination coloniale n’ont pas été uniformes dans toutes les colonies. Ils dépendaient du degré de développement des économies locales à l’époque de la domination coloniale et de la force des classes sociales dans les colonies.
Les développements en Amérique latine, qui se trouvait sous domination coloniale directe depuis plus de trois siècles, mais où le pouvoir s’est transféré aux grands propriétaires et à la bourgeoisie compradore dans le premier quart du 19e siècle – longtemps avant l’avènement de l’impérialisme moderne – sont absolument différents de ceux de l’Afrique subsaharienne qui n’a jamais eu ni gros propriétaires ni aucune bourgeoisie compradore ou nationale à la fin de la domination coloniale directe.
Le capitalisme agraire du type latifundia s’appuyant sur des structures semi-féodales et les limitations imposées par une économie d’exportation empêchent son plein développement.
En Inde, en Egypte etc., une bourgeoisie puissante existait à l’époque de la conquête coloniale même et, de là, elle se transforma rapidement en une bourgeoisie compradore.
En Asie, sous la domination coloniale, le capitalisme ne pouvait se développer à un niveau important, bien que les rapports et structures féodaux se fussent progressivement transformés en rapports et structures semi-féodaux. Les plantations capitalistes modernes aux mains d’Unilever, de United Fruit, de Firestone etc., coexistaient avec l’agriculture de subsistance.
Même dans le secteur capitaliste de l’agriculture, on recourait également à des formes féodales de servitude et d’exploitation afin d’extraire de la valeur excédentaire supérieure.
L’Afrique, qui fut la dernière à être colonisée vers la fin du 19e siècle, en était toujours à un stade primitif de développement à l’époque de la conquête coloniale.
En Afrique du Nord, l’installation de Blancs pauvres restreignit la formation de classes sociales similaires à celles de l’Asie.
Tout le personnel administratif était recruté parmi les colonialistes étrangers, au contraire des autres colonies d’Asie et du Moyen-Orient. Dans ces derniers pays, le capitalisme commença d’abord à se développer dans les villes et la grande bourgeoisie urbaine, qui avait des liens étroits avec la classe des gros propriétaires terriens, était bien développée alors que la bourgeoisie rurale ou la classe des koulaks, était très faible.
En Afrique, il n’y a pratiquement pas de développement urbain ni de bourgeoisie urbaine. La bourgeoisie rurale, par ailleurs, s’est progressivement développée au cours de la période coloniale en raison du passage de l’agriculture primitive à une économie reposant sur des plantations, laquelle économie visait l’exportation vers les pays impérialistes.
C’est cette bourgeoisie rurale qui a lentement commencé à se muer en une bourgeoisie urbaine.
Ces différents types de développement sous la domination coloniale ont une incidence directe sur la situation et le statut dans la phase néocoloniale de l’impérialisme après la Seconde Guerre mondiale.
2.2. La relation entre néocolonialisme et classes sociales ainsi que les rapports de production dans le tiers-monde
Les changements momentanés qui se sont produits après la Seconde Guerre mondiale (les plus importants étant l’apparition d’un camp socialiste puissant et l’affirmation croissante des nouvelles forces politiques et sociales qui étaient apparues dans les colonies en raison du processus de développement capitaliste, aussi limité et déformé qu’il ait pu être) avaient forcé l’impérialisme non seulement à passer aux méthodes de la domination indirecte (c’est-à-dire au néocolonialisme), mais également à trouver une nouvelle base sociale à la poursuite de son pillage et de son exploitation.
Le ‘spectre du communisme’ hantait partout les impérialistes et leurs larbins et les anciennes couches précapitalistes – seigneurs féodaux, princes, rajahs, cheikhs et chefs qui agissaient en tant que principaux piliers de l’ancien type de colonialisme – avaient perdu tout crédit dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et les habitants ne leur faisaient plus confiance.
Dans la plupart des colonies et des semi-colonies, les mouvements de libération nationale étaient dirigés non seulement contre l’impérialisme mais également contre les classes précapitalistes protégées et appuyées par les troupes impérialistes.
Alors que les anciens dirigeants traditionnels ne demandaient pas mieux que de maintenir le même système économique et social que celui qui avait existé durant des décennies, les nouvelles forces sociales révélées par les mouvements nationaux représentaient des classes qui étaient intéressées par la création d’Etats modernes, de nouvelles industries, d’universités et d’institutions parlementaires.
Les puissances coloniales comprirent qu’elles ne pouvaient contrôler les Etats nouvellement constitués qu’au travers de ces nouvelles forces sociales qui avaient acquis des positions de pouvoir dans certains pays – la bourgeoisie naissante, la petite bourgeoisie, l’intelligentsia, les élites bureaucratiques et techniques, les dirigeants militaires, etc.
Partout où ce fut possible, l’impérialisme poursuivit ses relations avec les forces précapitalistes – avec les seigneurs féodaux et les chefs tribaux.
Dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Niger, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, le Soudan et l’Inde, les nouveaux gouvernements furent constitués en tant que coalitions des forces précapitalistes et de la bourgeoisie en collusion avec l’impérialisme.
Alors que dans des pays comme l’Inde, où une classe bourgeoise compradore s’était entièrement développée, le pouvoir fut directement transféré vers une alliance des forces féodales et de la grande bourgeoisie compradore, dans la plupart des pays de l’Afrique, où l’économie primitive et la domination des colons blancs entravaient l’émergence d’une classe capitaliste, les impérialistes commencèrent délibérément à entretenir une nouvelle classe moyenne servant les intérêts de l’impérialisme. Cette volonté de créer une nouvelle classe moyenne dans les pays africains, les institutions impérialistes la proclamèrent à l’occasion de plusieurs forums et rencontres.
La bourgeoisie rurale africaine, n’ayant ni les moyens financiers ni les capacités techniques, trop disséminée, trop amorphe, est incapable de créer d’elle-même une industrie moderne.
La seule option laissée à la génération plus jeune de la bourgeoisie rurale africaine est le service de l’Etat.
La nouvelle bureaucratie est donc devenue une élite privilégiée et la principale force motrice au sein de la société africaine.
Les fonctionnaires investissent l’argent de leurs proches et semblables des campagnes dans des secteurs tels la construction de routes, les taxis, les services, la construction de bâtiments et autres programmes de travaux publics qui ne requièrent pas des capitaux excessifs. Dans la majeure partie de l’Afrique, c’est à cette bureaucratie d’Etat et à la bourgeoisie rurale que l’impérialisme a commencé à s’allier, principalement au cours de la phase néocoloniale, plutôt qu’aux dirigeants traditionnels.
Progressivement, cette bourgeoisie administrative s’est transformée en une bourgeoisie d’Etat soumise aux intérêts de l’impérialisme.
Un objectif essentiel du néocolonialisme est d’empêcher, dans les pays du tiers monde, une transformation révolutionnaire qui aurait signifié un combat acharné mené contre l’impérialisme et le féodalisme par l’alliance entre la classe ouvrière et les paysans.
Ainsi donc, dans certains pays d’Asie et d’Afrique, incapables de préserver les sociétés féodales ou semi-féodales comme piliers de leur influence, les impérialistes eux-mêmes ont initié des réformes agraires, comme à Taiwan, en Corée du Sud et au Sud-Vietnam, ils ont créé une nouvelle classe de koulaks composée de fermiers capitalistes ainsi qu’une classe capitaliste soumise à l’impérialisme.
Certains des anciens propriétaires terriens et seigneurs, eux aussi, devinrent des fermiers capitalistes de gros calibre, comme en Egypte, à Taiwan ou dans certaines parties de l’Inde.
Alors que la motivation politique d’amener certains changements dans les rapports capitalistes de production dans les pays du tiers monde provient de la concurrence à l’échelle mondiale entre le capitalisme et le socialisme et de la crainte d’un glissement possible de ces Etats vers le socialisme, la motivation économique, elle, est d’accroître les exportations de capitaux et le commerce des pays impérialistes.
Une autre contrainte consiste à fournir une part du butin impérialiste aux nouvelles classes dirigeantes de ces pays et de combler, du moins partiellement, les attentes naissantes des gens, ce qui ne pourrait se faire en se basant uniquement sur l’ancien mode de production. Par conséquent, on a encouragé une certaine expansion des marchés du tiers monde en même temps qu’un certain développement technologique, dans des limites restreintes, toutefois.
Ceci n’implique pas que les intérêts de classe de la bourgeoisie, qui a fini par acquérir une position dirigeante dans l’alliance de pouvoir dans les pays du tiers monde, soient opposés à ceux des forces sociales féodales et précapitalistes.
En fait, partout il s’agit d’une alliance de seigneurs féodaux soucieux de maintenir ou de regagner leurs anciennes positions privilégiées au sein de la société, alliance des marchands et des spéculateurs qui craignent l’avènement du socialisme et qui veulent se maintenir comme intermédiaires des grands monopoles internationaux ; alliance de sections de la nouvelle élite qui s’engraissent de la corruption et des malversations du pouvoir officiel.
Et tous les parasites du capitalisme, les nouveaux riches, les politiciens, les diplomates, les chefs de la police et de l’armée, tous ceux qui ne sont que trop heureux d’accepter les dividendes que leur refilait l’ancien pouvoir colonial alors que la majorité du peuple vit dans des conditions effroyables.
L’un des objectifs essentiels du néocolonialisme est d’alimenter et de constituer de telles classes parasitaires.
C’est par le biais de ces forces que l’impérialisme contrôle toujours les affaires des pays du tiers monde.
Par exemple, nous avons au Zaïre, aujourd’hui, une minorité ténue de 2.700 familles immensément riches à côté de 27 millions d’autres qui connaissent la pauvreté absolue et vivent dans des conditions de quasi-famine.
Mobutu, tyran et marionnette de l’impérialisme, a volé 5 milliards de dollars des richesses du pays (soit un montant égal à la dette extérieure du Zaïre), il a construit des dizaines de villas en Europe, possède de nombreux bateaux, des avions à réaction et un empire sous forme de plantations qui produit un sixième des exportations agricoles du pays, sans parler de ses participations et de ses autres propriétés.
Au Brésil, en 1978, d’après l’Institut brésilien d’Analyse sociale et économique, le revenu moyen de la classe la plus fortunée était de 225 fois supérieur à celui des classes les plus pauvres.
Deux tiers des Brésiliens – 86 millions de personnes – souffrent de malnutrition, d’après des estimations de 1985.
Alors que les 10% des personnes les plus riches du Brésil accaparaient la moitié du total des revenus ménagers, les 20% les plus pauvres touchaient un dérisoire 2% (selon les seuls chiffres disponibles, qui concernent 1972).
En République dominicaine, 0,07% des propriétaires terriens monopolisent 45% de la terre arable et plus de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté.
Aux Philippines, au moins 15% de la dette extérieure du pays qui s’élève à 26 milliards de dollars, se sont retrouvés dans les poches du dictateur Marcos lorsqu’il s’est enfui du pays en 1986.
D’après une estimation du président de la Banque interaméricaine de Développement, les fuites de capitaux pour le seul Mexique, entre 1979 et 1983, s’élevaient à 90 milliards de dollars.
Pour toute l’Amérique latine, quelque 130 milliards de dollars ont été expédiés à l’étranger par les familles fortunées appartenant à la classe dirigeante.
Dans chaque pays du tiers monde, l’impérialisme a donc transmis le pouvoir soit à la grande bourgeoisie compradore (qui elle-même était alliée avec la classe des grands propriétaires terriens), là où elle était assez forte pour assumer le pouvoir ou a favorisé un certain développement du capitalisme afin de créer une nouvelle classe compradore, subordonnée à l’impérialisme.
Comme l’expliquait Amilcar Cabral, dirigeant du peuple de la Guinée ‘portugaise’, l’un des objectifs essentiels du néocolonialisme «est de créer une fausse bourgeoisie afin de freiner la révolution et d’élargir les possibilités de la petite bourgeoisie de neutraliser la révolution ».
Il est important pour nous de reconnaître que les possibilités de développement du capital national sont sévèrement restreintes dans les pays dominés par le capital étranger, comme en Amérique latine ou dans certains pays d’Asie et du Moyen-Orient comme l’Inde et l’Egypte.
En Afrique, les conditions sont bien pires encore, puisqu’un niveau minimal d’accumulation primitive n’a pas été atteint et que, partant, il n’y avait pas de capital national à la fin de la domination coloniale directe.
L’Afrique, en fait, a été intégrée dans le marché mondial à un stade primitif de développement social où même l’emploi de l’argent était marginal.
Historiquement, le capital qui a été investi est sorti de l’exploitation des secteurs non capitalistes, c’est-à-dire via l’accumulation primitive de capital.
Plus tard, les profits en provenance des capitaux investis ont été conservés afin d’être réinvestis, de manière à étendre la capacité de production – c’est un processus que l’on appelle la reproduction accrue.
Sans accumulation primitive de capital et reproduction accrue, le développement capitaliste ne peut avoir lieu.
Dans la plupart des pays du tiers monde, les niveaux d’accumulation primitive de capital par les classes dirigeantes locales sont très bas en raison du pillage auquel se livrent les impérialistes, c’est-à-dire en raison du transfert continu des surplus en direction des pays impérialistes.
L’ampleur de la reproduction accrue par les capitalistes indigènes est limitée, elle aussi, en raison d’un faible marché intérieur et de l’extrême dépendance vis-à-vis du marché extérieur.
Sous les conditions de l’impérialisme, la bourgeoisie locale ne peut se développer que dans les proportions permises par la ligne envisagée par le capital dominant.
Ce qui fait que, sous le néocolonialisme, l’ampleur de l’accumulation primitive et de la reproduction accrue par le capital local est très limitée dans la plupart des pays du tiers monde, puisque les fonctions économiques importantes sont toujours contrôlées par le capital étranger.
Par conséquent, l’Etat a joué un rôle très important dans la totalité du tiers monde en promouvant l’accumulation primitive du capital et en aidant le développement de la bourgeoisie privée. Dans quelques pays, en utilisant le soutien apporté par les pays socialistes ou en utilisant les contradictions régnant entre les diverses puissances impérialistes, le capitalisme d’Etat s’est développé plus rapidement et, à des degrés divers, a même nationalisé des capitaux étrangers, comme ce fut le cas en Egypte, au Congo, en Zambie et en Tunisie.
En Inde, le secteur capitaliste d’Etat s’est développé de façon phénoménale dans les quatre décennies qui ont suivi la passation de pouvoir et ce, avec l’aide de l’impérialisme et du social-impérialisme, sans recourir à la nationalisation des capitaux étrangers.
Dans l’ensemble, le secteur de l’Etat, dans le tiers-monde, revêt un caractère compradore. Il a créé un marché intérieur élargi et a amené certains changements dans les rapports de production féodaux et autres rapports précapitalistes concernant l’agriculture.
A travers le monde, l’impérialisme a transformé et façonné le féodalisme et les autres rapports de production précapitalistes de façon adaptée à ses besoins sans cesse changeants.
Alors qu’en phase néocoloniale, dans certains pays d’Afrique et d’Amérique latine et dans certaines régions des pays d’Asie, le capitalisme agraire, qui repose sur une économie de plantation moderne et qui est orienté vers l’exportation d’une ou de deux cultures destinées à la vente, s’est développé à un niveau significatif, nous constatons qu’il s’agit d’une croissance atrophiée puisque son développement même est tributaire non pas des besoins du marché local, mais des demandes et des exigences du marché impérialiste mondial.
Chaque fois qu’il y a un effondrement dans les prix des cultures destinées à la vente sur le marché mondial, nous constatons qu’il y a une sévère crise agricole dans ces pays ainsi qu’une paupérisation accrue de la grande majorité de leur paysannerie.
Nous découvrons également le phénomène étrange – pour des pays correctement définis comme agricoles vu le caractère de leur économie – qui consiste à devoir s’appuyer sur des importations de nourriture pour leur consommation quotidienne.
Ainsi, par exemple, le Maroc a été un exportateur de céréales dans les années 1950 alors qu’aujourd’hui, il ne couvre plus qu’un cinquième de ses propres besoins.
Les importations de nourriture ont augmenté de 17% par an en moyenne entre 1970 et 1983 – soit de 220%.
A partir du milieu des années 1960, lorsque l’impérialisme américain commença à affronter une sévère crise de surproduction dans ses machines agricoles et son arsenal destiné aux cultures, il se mit à promouvoir la stratégie de la ‘révolution verte’ par le biais de la Banque mondiale.
L »offre d’aide’ de l’impérialisme américain et, plus tard, des autres puissances impérialistes au tiers monde comprenait des fertilisants, des graines et semences à haut rendement, des herbicides, des pesticides, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et autres équipements agricoles.
Au cours des années 1970 et 1980, le tiers monde connut un énorme accroissement de l’utilisation de tout ce matériel et équipement agricole. Par conséquent, afin de résoudre sa propre crise économique, l’impérialisme accéléra le rythme du développement capitaliste de l’agriculture dans le tiers monde au cours du dernier quart du 20e siècle.
Cela déboucha sur l’apparition d’une nouvelle classe de koulaks, c’est-à-dire une classe de fermiers capitalistes. Mais, dans plusieurs pays, les structures semi-féodales n’en demeurèrent pas moins un obstacle à la transformation complète vers l’agriculture capitaliste.
Tous ces changements qui se sont produits sous le néocolonialisme n’indiquent donc qu’une rupture partielle avec les formes précapitalistes d’économie.
Une rupture complète avec les formes féodales et autres formes précapitalistes est impossible dans le système impérialiste mondial actuel sans une véritable révolution prolétarienne.
En résumé, nous pouvons dire que, dans la phase néocoloniale, il y a eu un développement plus rapide du capitalisme à la fois dans l’agriculture et dans l’industrie des pays du tiers monde sans toutefois que ces économies mêmes deviennent capitalistes.
Les structures semi-féodales et la domination des pays du tiers monde par le capital étranger, la technologie étrangère, les marchandises étrangères (et même, aujourd’hui, les services) opèrent comme des entraves au plein développement du capitalisme dans ces pays et les réduisent au statut de pays semi-féodaux, semi-coloniaux ou néocolonies.
Ce n’est qu’en brisant ces entraves qu’un véritable développement industriel et agricole pourra avoir lieu dans ces pays. Ce n’est qu’en s’échappant de cette économie capitaliste mondiale qu’un pays du tiers monde pourra devenir un ensemble cohérent et développer une économie autosuffisante en se créant un vaste marché interne.
2.3. Les tendances contemporaines dans l’économie capitaliste mondiale : la globalisation et son impact sur le tiers monde
En tant que telle, la globalisation du capitalisme n’est pas un phénomène nouveau mais ce qui est nouveau dans la phase néocoloniale de l’impérialisme, c’est que la globalisation progresse à un rythme sans précédent et qu’elle revêt même de nouvelles formes afin d’assurer la survivance de l’impérialisme.
Le capital a une tendance inhérente à l’expansion continue et à intégrer les divers types d’économie dans un seul marché mondial. Un marché mondial a déjà fait son apparition au cours de la seconde moitié du 19e siècle et Marx en personne a déjà insisté sur ce fait.
Depuis lors, le capitalisme a essayé d’intégrer les activités économiques éparpillées à travers le monde et d’amener les diverses formes d’économie au sein d’un seul marché mondial unifié.
Dans cette première phase, qui s’étend des années 1860 jusqu’au début du 20e siècle, la globalisation du capitalisme a revêtu la forme d’un commerce international de biens manufacturés. A ceci vint s’ajouter l’exportation de capital financier et ce, à partir de la fin du 19e siècle.
Lénine, qui vivait à une époque où l’exportation de capital financier était devenue une caractéristique de premier plan de l’économie mondiale, fit remarquer que ceci allait conduire à « l’expansion et l’intensification du capitalisme à travers le monde ».
Le camarade Staline en parlait également en 1925 :
« En raison de l’accroissement des exportations de capitaux des pays avancés vers les pays arriérés, accroissement encouragé par la relative stabilisation du capitalisme, le capitalisme dans les pays coloniaux se développe et continuera à se développer à un taux rapide, démantelant les anciennes conditions sociales et politiques et en implantant de nouvelles. »
La Seconde Guerre mondiale fut suivie d’une période de globalisation des investissements via des financements, des crédits et des aides.
Après l’éclatement de la crise la plus longue de l’impérialisme, qui commença au début des années 1970, la globalisation de la production via les Investissements directs à l’Etranger (IDE) commença à assurer sa domination.
Un principe fondamental bien connu dit que le seul objectif du capital est d’accumuler de plus en plus de capital. Tous les changements susmentionnés dans l’économie mondiale ne sont nécessités que par le besoin des monopoles impérialistes d’accumuler de plus en plus de capital.
Le changement dans les rôles des économies de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine, ainsi que les changements qui se produisent au sein des économies de ces pays ne peuvent être compris que dans le contexte des changements qui se sont produits dans la totalité du processus de globalisation du capitalisme tel qu’on l’a décrit plus haut.
Par conséquent, nous trouvons, dans cette première phase de la globalisation du capitalisme, des régions entières de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine qui sont converties en hinterlands destinés à fournir des matières premières agricoles et autres aux industries européennes.
Au cours de cette période, le capital européen a été investi dans des plantations, des activités minières et dans les secteurs tertiaires liés au développement colonial, comme les chemins de fer, les installations portuaires, la banque, les assurances, le commerce et autres services.
Alors que les pays impérialistes fournissaient les produits finis prêts à la consommation, les colonies, semi-colonies et pays dépendants fournissaient les matières premières, c’est-à-dire qu’ils jouaient le rôle d’entrepôts à matières premières pour les centres industriels de l’Occident.
Au cours du quart de siècle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la caractéristique principale des pays de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine (dont la plupart se sont ‘débarrassés’ de la domination coloniale directe) a consisté en l’établissement de groupes d’industries légères.
Cette ligne de conduite des ‘substitutions d’importations’ (en d’autres termes, des produits finis qui ont été importés précédemment), n’a pas été, comme le prétendent les révisionnistes, une politique visant à promouvoir l’autosuffisance, mais elle a été entièrement dictée par les besoins de l’impérialisme dans sa phase néocoloniale.
La production de biens de consommation (industries légères), comme nous le savons, requiert des biens d’équipement, c’est-à-dire des moyens de production tels qu’un outillage moderne et du savoir-faire technique.
Les pays impérialistes ont procédé à l »industrialisation’ du tiers monde durant la Seconde Guerre mondiale et tout de suite après et ce, pour deux raisons : la première, c’est qu’il y avait un amas sans précédent de biens d’équipement dans les pays impérialistes et, la seconde, les coûts de production étaient meilleur marché et le taux de profit plus élevé dans les pays du tiers monde.
Par conséquent, les impérialistes faisaient d’une pierre deux coups, deux bénéfices en une seule opération : ils disposaient de biens d’équipement qui, autrement, auraient été envoyés au rebut au fil du temps (la fermeture des usines produisant les biens d’équipement aurait signifié un chômage à grande échelle et une crise sociale insupportable dans les pays impérialistes) et à des coûts très élevés, et en même temps, ils s’appropriaient, pour leur propre usage domestique, les biens de consommation manufacturés à meilleur marché dans les pays du tiers monde.
En outre, dans plusieurs pays du tiers monde (et dans l’Afrique tout entière excepté l’Afrique du Sud, pays impérialiste), l’industrie légère elle aussi avait été établie directement par les sociétés transnationales et multinationales qui rapatriaient la plupart des profits à l’étranger puisqu’il n’y avait pas la moindre pression de la part des classes compradores dirigeantes qui eussent pu obliger ces monopoles étrangers à réinvestir leurs profits dans les pays concernés.
Par ailleurs, les biens d’équipement vendus aux capitalistes indigènes étaient d’une qualité inférieure alors que les sociétés multinationales disposaient de la technologie la plus avancée, bloquant de ce fait la possibilité d’une réelle concurrence entre les secteurs locaux et étrangers dans la fabrication de biens de consommation.
Afin d’être compétitives, n’importe quelle petite ou moyenne entreprise du tiers monde n’aurait était que trop disposée à vouloir collaborer d’une façon ou d’une autre avec les multinationales.
Les prêts, l »aide’ etc. des impérialistes aux pays du tiers monde étaient liés à un certain nombre de conditions nuisant aux intérêts de ces derniers.
Cette prétendue industrialisation du tiers monde via l’installation d’industries légères constituait, par conséquent, un développement déformé et dépendant, en permanence à la merci des impérialistes pour l’amélioration des technologies. Aussi, au cours de cette période, apparut une nouvelle division internationale du travail, par laquelle les pays impérialistes allaient fournir les biens d’équipement et les pays du tiers monde les biens de consommation manufacturés issus des industries légères, dominées par les multinationales de plusieurs pays.
Durant les années 1950, 1960 et la première moitié des années 1970, la ligne de conduite des gouvernements des pays du tiers monde fut dictée par l’impérialisme afin de faciliter le processus décrit plus haut et consistant à déplacer une partie de l’industrie de consommation des pays impérialistes vers le tiers monde.
Selon des plans de la Banque mondiale en vue d’une efficacité maximale de cette nouvelle division internationale du travail, on développa une vaste infrastructure industrielle, consistant entre autres en la construction de routes et de nouvelles lignes ferroviaires, l’installation de ports, de centrales d’énergie et de réseaux de télécommunication etc.
Avec la crise sévère provoquée par la quasi-stagnation du marché mondial depuis le début des années 1970, la concurrence féroce entre les diverses transnationales et multinationales et la baisse constante des taux de profit industriel dans les pays impérialistes poussa les monopoles impérialistes à chercher, dès ces mêmes années 1970, de nouvelles voies de spécialisation internationale.
C’est ainsi qu’apparut la globalisation de la production, c’est-à-dire la division et la subdivision des processus de production en plusieurs opérations, de façon à les répartir dans divers pays afin d’augmenter le taux général de profit.
L’extraordinaire révolution scientifique et technique de notre époque a permis de décentraliser la production dans l’espace tout en centralisant son management.
Les pays impérialistes gardent les industries ultramodernes, caractérisées par une composition organique élevée du travail et requérant une main-d’oeuvre hautement qualifiée, comme c’est le cas pour le nucléaire, les communications par satellite et autres activités aérospatiales, ou pour la production d’ordinateurs et autres techniques de l’électronique, de la robotique etc., alors que l’on demande aux pays du tiers monde de se spécialiser dans les lignes classiques de production, y compris les traditionnelles industries lourdes comme le fer et l’acier, la chimie, la construction mécanique et autres moyens de production qui requièrent une main-d’oeuvre principalement non qualifiée et semi-qualifiée.
Par conséquent, à l’exception des formes automatisées de production requérant une main-d’oeuvre hautement qualifiée, toutes les autres branches de l’activité industrielle, y compris la production des moyens de production des industries traditionnelles sont généralement déplacées en direction des marchés du tiers monde où la main-d’oeuvre est très bon marché.
Inversement, la main-d’oeuvre hautement qualifiée du tiers monde est déplacée vers les pays impérialistes au cours d’un processus surnommé ‘vol de cerveaux’.
Les pays du tiers-monde sont encouragés à installer ces véritables bagnes qu’on appelle ‘zones de traitement pour l’exportation’, ‘zones de libre échange’ ou ‘parcs industriels’ où, dans des conditions épouvantables, on exploite une main-d’oeuvre non qualifiée et semi-qualifiée à des tâches d’assemblage ou à la fabrication de produits chimiques et ce, à des seules fins d’exportation.
Ces ‘bagnes’ qui, particulièrement depuis les années 1970, exploitent une main-d’oeuvre extrêmement bon marché (jusqu’à 40 ou 80 fois meilleur marché que les salaires pratiqués dans leurs propres pays) et très peu organisée, répondent au besoin des multinationales de relocaliser les opérations requérant un travail intensif.
Ces transformations – issues de la substitution des importations de l’industrialisation sous planification d’Etat avec l’aide de capitaux étrangers, durant les années 1950 et 1960, vers des industries centrées sur l’exportation, depuis les années 1970 – ne peuvent se comprendre que si l’on garde à l’esprit la globalisation de la production et l’apparition d »usines aux dimensions mondiales’, en raison des niveaux élevés de concentration et de spécialisation atteints par le capital transnational durant les deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale – c’est-à-dire au cours des années d’expansion rapide de l’économie mondiale – et de la baisse qu’ont subie ensuite les taux de profit industriel.
Aussi longtemps que les taux de profit sont différents dans divers pays (c’est-à-dire tant qu’on n’a pas égalisé le taux de profit à l’échelle mondiale), la tendance inhérente du capital à l’expansion mondiale va inévitablement dans le sens d’une intégration accrue du marché mondial dans un réseau unifié de production et d’échanges capitalistes.
C’est la seule voie qui reste au capital international dans sa sempiternelle soif d’accumulation à l’échelle mondiale.
Les lignes de conduite des diverses institutions néocoloniales telles la Banque mondiale, le FMI, le GATT etc. visent, depuis les années 70, à réaliser l’intégration susmentionnée du marché mondial.
C’est le principal facteur qui pousse tous les pays du tiers monde à passer, les uns après les autres, de la substitution des importations au syndrome ‘exporter ou mourir’.
Un autre facteur consiste en la faiblesse des marchés internes des pays du tiers monde, faiblesse due à la prévalence de structures semi-féodales, voire primitives, qui gardent l’écrasante majorité des masses dans des conditions d’existence incroyablement misérables.
Ces conditions extrêmement pénibles font qu’il leur est difficile de couvrir leurs besoins alimentaires croissants ainsi que les biens de consommations de première nécessité.
En raison de l’extrême dépendance de ces industries vis-à-vis d’un marché mondial qui n’a pas le moindre espoir d’expansion rapide, en raison également de la concurrence grandissante entre les pays du tiers monde (avec, en outre, l’entrée en compétition de pays n’appartenant pas au tiers monde tels que la Chine, les pays de l’Est et les anciennes républiques soviétiques) qui veulent chacun solder aux impérialistes leur main-d’oeuvre bon marché disponible en abondance, la condition des masses ne cessera d’empirer jusqu’à l’apparition d’une dépression encore plus grave du marché interne et, par conséquent, d’une crise encore plus grave de l’économie mondiale.
Seule une infime fraction de la population – les élites appartenant aux classes dirigeantes et les minces strates de la classe moyenne supérieure – en tirera profit, alors que la classe moyenne et même certaines sections de la bourgeoisie nationale en sortiront appauvries, sans parler de la majorité écrasante des masses laborieuses.
Mais la poignée de capitalistes compradores (ainsi que les élites dirigeantes des pays du tiers monde qui, en collusion avec l’impérialisme, ont accumulé d’énormes richesses en exploitant les masses laborieuses et qui, au lieu des innombrables fils qui les lient aux structures semi-féodales, trouvent plus avantageux de maintenir leur alliance avec ces forces parasitaires et de bloquer ainsi le développement d’un marché interne) ne sont que trop impatients de passer à la globalisation et de se satisfaire des parts de marché que leur concèdent les impérialistes.
Inutile de le dire : la globalisation de la production, en réduisant les industries du tiers monde au statut de simples composantes des usines aux dimensions mondiales des multinationales, conduit en droite ligne à une crise sans précédent dans les économies du tiers monde, au fur et à mesure que la crise de l’économie mondiale s’intensifiera.
Plus un pays sera intégré dans le marché mondial, plus grand sera le désastre au moment d’une crise mondiale sévère.
Les pays qu’on a appelés les ‘tigres asiatiques’, comme la Corée du Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong, ainsi que les ‘tigres’ en devenir de l’Asie du Sud-Est, qui dépendent tous du marché mondial pour assurer leur survie, seront les plus durement touchés.
2.4. Le néocolonialisme et le cas de l’Inde
Les changements qui se sont produits en Inde après le transfert du pouvoir (l’indépendance) peuvent se comprendre dans le vaste contexte des changements survenus dans l’économie mondiale que nous avons soulignés plus haut.
Comme le savent les révolutionnaires communistes dirigeant la nouvelle révolution démocratique et menant une lutte armée contre le féodalisme et l’impérialisme, la société indienne a été transformée en société semi-féodale et semi-coloniale après la fin de la domination coloniale directe de l’impérialisme britannique.
Nous allons brièvement résumer les changements qui se sont produits durant la longue période de la domination coloniale britannique.
Avant cette domination, la société indienne était une société féodale avec une économie de biens de consommation développée, s’appuyant sur des villes florissantes et qui, de ce fait, portait en elle les germes du capitalisme.
A l’époque de la conquête britannique, une masse considérable de richesse s’était déjà accumulée entre les mains de la classe des marchands indiens, tant par le commerce international qu’intérieur ainsi que par le biais de l’usure.
Les artisans et les gens de métier témoignaient d’un savoir-faire considérable et ils avaient déjà mené de nombreuses luttes dans différentes parties du pays, comme ce fut le cas, par exemple, avec les mouvements bhakti.
Plusieurs Etats-nations aussi auraient pu se constituer avec la poursuite du développement capitaliste et durant la lutte contre le féodalisme menée par la bourgeoisie naissante des diverses nationalités.
Ainsi donc, s’il n’y avait eu l’occupation britannique, la société indienne, en renversant le féodalisme, se serait progressivement développée en une société capitaliste.
Ce cours naturel dans l’évolution de la société indienne fut interrompu par la conquête coloniale qui eut lieu dans la seconde moitié du 18e siècle.
La pénétration du capital étranger et l’intervention de l’Etat colonial conduisirent à la désintégration de l’économie naturelle autosuffisante de l’Inde, elles détruisirent les industries artisanales et réduisirent les grands centres urbains au statut de grands villages.
La bourgeoisie commerçante et prêteuse de fonds s’allia au capital britannique, joua le rôle de classe compradore et, au fil du temps, se développa en une grande bourgeoisie compradore en investissant dans les industries modernes.
Mais le développement du capitalisme fut stoppé à cause de la politique britannique consistant à s’allier aux dirigeants traditionnels et à créer une nouvelle classe de zamindars (grands propriétaires) dans les campagnes.
L’impérialisme britannique fut heureux de recevoir les impôts de cette classe de zamindars qui lui fut utile en tant que pilier social de sa domination. Pourtant, suite à la politique britannique tendant à convertir la terre en propriété privée, ou à collecter des impôts en espèces chez les paysans et les zamindars, et en payant également en espèces les produits agricoles amenés par les commerçants britanniques, l’économie de biens de consommation se développa jusqu’à un certain point dans les campagnes.
Comme ils le faisaient partout, les Britanniques créèrent également des plantations dans certains secteurs de production agricole et ils encouragèrent – ou plutôt forcèrent – les producteurs paysans à passer de la culture des céréales aux cultures destinées à l’exportation, comme le coton et le jute. Suite à ces mesures, le mode féodal de production dans l’agriculture commença à se désintégrer et se transforma en mode semi-féodal.
Deux conditions sont nécessaires à l’apparition du mode capitaliste de production : la première est que la production de marchandises soit la forme généralisée de production et la seconde est l’existence d’une main-d’oeuvre salariée libre.
Comme le faisait remarquer Lénine : « Le capitalisme, c’est la production de marchandises à son stade suprême de développement, lorsque la force de travail devient elle-même une marchandise. »
Les autres caractéristiques du mode capitaliste de production, comme le paiement des salaires en espèces, la reproduction accrue – c’est-à-dire le réinvestissement des surplus pour extraire encore plus de surplus, ce qui débouche sur une accumulation toujours plus grande -, une polarisation constante et continue de la société en une classe de capitalistes et en salariés etc., dérivent toutes de la définition du capitalisme citée ci-dessus.
Ce n’est que par la transformation radicale du mode féodal et des autres modes précapitalistes de production que le mode capitaliste de production peut acquérir une position dominante et pour autant qu’il remplisse les conditions mentionnées plus haut.
Mais, en Inde, en raison de l’alliance de l’impérialisme britannique avec la bourgeoisie compradore et les forces féodales, et du fait que la révolution démocratique n’a pas été achevée, une telle transformation ne pouvait pas se produire.
Les modes capitaliste et féodal de production ont coexisté avec un mode semi-féodal de production qui est devenu le mode dominant dans l’agriculture.
Même à l’époque du transfert de pouvoir, seulement 35% – soit un petit peu plus d’un tiers – de la production agricole totale était produite pour le marché.
Deux tiers des ventes représentaient des ventes de nécessité dans le village même.
Par conséquent, la production de marchandises n’était pas le caractère dominant et déterminant de la production agricole. De plus, les ouvriers agricoles n’étaient pas libres non plus.
Ils étaient soit endettés soit en position de servage ou de toute autre forme de servitude vis-à-vis des propriétaires terriens qui représentaient souvent une seule et même famille de propriétaires.
A l’époque de la passation de pouvoir, l’Inde connaissait trois types de systèmes de possession des terres : le système zamindari (grosse propriété terrienne), qui représentait 57%, le ryotwari (fermage), 38% et le mahalwari (sous-fermage), 5%.
Mais sous chacun des trois systèmes, les rapports agraires constituaient une variante des rapports de production semi-féodaux caractérisés par une répartition des terres très distordue, par la sous-inféodation, l’usure, le travail en servage, etc. Ces rapports de production semi-féodaux débouchèrent naturellement sur une stagnation de la production agricole et sur l’appauvrissement de la paysannerie rurale.
Après la passation de pouvoir, lorsque la grande bourgeoisie compradore eut scellé une alliance avec le féodalisme et l’impérialisme, il n’y eut plus de transformation fondamentale dans les rapports de production semi-féodaux de l’agriculture.
En tant que système, le capitalisme présente une contradiction inconciliable vis-à-vis du féodalisme car ce dernier opère comme une entrave à la poursuite du développement du capitalisme.
Le féodalisme agit comme un frein à l’expansion du marché en tenant d’importantes sections des masses paysannes en servitude.
C’est un obstacle au développement des forces productives.
Par ailleurs, le capitalisme a une tendance à agrandir le marché en supprimant tous les rapports précapitalistes et en libérant le paysan de la servitude féodale et en le convertissant en ouvrier agricole salarié, ‘libre’ de vendre sa force de travail sur le marché selon les lois de l’offre et de la demande.
Le capitalisme, par conséquent, accroît énormément les forces productives.
L’Inde avait toujours disposé d’un abondant effectif de main-d’oeuvre à bon marché dans les villes – effectif plus que suffisant pour les faibles niveaux d’industrialisation du pays.
Au début de la domination britannique, on assista même à un étrange phénomène de migration des sans-emploi des villes vers les zones rurales, ce qui accrût la pression sur l’agriculture. Avec de faibles niveaux d’industrialisation et une immense armée de réserve de sans-emploi, aucune contrainte économique ne force la grande bourgeoisie indienne à libérer la paysannerie du carcan des rapports semi-féodaux.
De plus, politiquement, il serait dangereux pour la grande bourgeoisie de le faire, puisque les masses réveillées ne s’arrêteront pas avant d’avoir lancé une révolution sociale en l’absence d’une industrie qui pourrait absorber le plus gros de leurs effectifs.
Comme il n’y a pas de perspective de poussée massive vers une industrialisation qui absorberait les excédents de la population agraire, du fait précisément que l’économie indienne est rivée aux roues du chariot de l’impérialisme, la grande bourgeoisie indienne et l’impérialisme estiment qu’il est plus sage de garder la majorité de la population agraire dans le carcan des rapports semi-féodaux.
Toutefois, on assiste à plusieurs tentatives d’accroître la productivité de l’agriculture via l’introduction de machines modernes, de nouvelles technologies, de fertilisants, de pesticides, de semences à haut rendement, de l’irrigation et autres apports dans certains secteurs choisis.
Ces efforts ont pour but d’augmenter la production agricole de façon à ce qu’elle satisfasse aux besoins toujours croissants de l’économie et de procurer un marché pour les produits des multinationales et des compagnies appartenant à la grande bourgeoisie.
Par conséquent, au Pendjab, dans le Haryana, dans l’Uttar Pradesh occidental, dans le delta du Krishna et du Godavari situé dans l’Andhra Pradesh et dans certaines parties du Kerala, du Tamil Nadu, du Bengale Occidental, dans près d’un tiers des régions cultivées, une transformation capitaliste s’est produite.
Cette transformation a donné naissance à une nouvelle classe de koulaks ou fermiers capitalistes qui ont déjà acquis pas mal d’autorité politique dans certains Etats.
Certains grands propriétaires féodaux, eux aussi, se sont mués en propriétaires capitalistes. Mais même dans ces zones de capitalisme agraire, les formes féodales d’exploitation se combinent aux formes capitalistes.
Dans l’ensemble, les rapports semi-féodaux de production prédominent toujours sur la scène rurale indienne d’aujourd’hui.
Il y a une concentration élevée de terres aux mains de quelques propriétaires.
Au début des années 1980, 4,29% des holdings de l’Andhra Pradesh détenaient 37,25% des terres.
Au Bihar, 1,35% en détenaient 15,34% et, pour le Pendjab et le Haryana, 6,33% en détenaient 40,29%.
Pour l’ensemble du pays, 1% des propriétaires les plus riches détenaient 14,35% des terres.
On assiste également à un important affermage de terres.
Des petites familles marginales, y compris des familles sans terre, ont loué 6.255.000 hectares.
L’endettement rural continue à affecter gravement la paysannerie. Les dettes en provenance des sources traditionnelles – les prêteurs, les employeurs et les propriétaires, dans les villages – et à des taux d’intérêt exorbitants jouent toujours un rôle de premier plan dans la vie économique des familles rurales.
Dans les plaines du Bihar, du Telangana, ainsi que dans d’autres parties du pays, le mode d’appropriation ou de valeur en surplus venant des producteurs directs est dominé par la location à bail et l’usure et une proportion importante d’ouvriers agricoles sont soumis à divers degrés d’asservissement et ne sont pas vraiment libres de vendre sur le marché leur force de travail en tant que marchandise.
Le ‘jajmani’, c’est-à-dire le paiement annuel traditionnel fixé soit en nature, soit sous forme de terre à cultiver, voire les deux, à la classe des services et aux artisans, se rencontre toujours fréquemment dans les zones rurales du Bihar et d’ailleurs.
La coercition extra-économique par les propriétaires, comme les procès en justice contre les paysans et leur incarcération sur de fausses accusations de vol et autres délits similaires, est une pratique commune dans les grandes zones rurales de l’Inde.
Nous constatons également que la plupart des riches paysans et propriétaires ne réinvestissent pas dans la terre les surplus accumulés mais qu’à la place, ils tentent de pénétrer d’autres activités comme les moulins à riz ou à huile, les contrats routiers, les firmes de transports, etc.
En conséquence, la composition organique du capital tend à être faible, ce qui se traduit par de faibles niveaux de productivité.
Il n’y a pas non plus de polarisation de classe du genre de celle que la transformation capitaliste engendrerait inévitablement dans la plupart des zones rurales de l’Inde.
De petites parcelles de terre aux mains de la paysannerie pauvre et moyenne, voilà toujours une caractéristique fréquente de la scène rurale dans de nombreuses régions de l’Inde. La polarisation en propriétaires capitalistes possédant les moyens de production et en prolétariat rural dépendant seulement de la vente de sa force de travail constitue toujours un phénomène marginal.
Sur base d’indicateurs secondaires comme la production destinée au marché et le paiement des salaires en espèces, certains groupes marxistes-léninistes adoptent le point de vue selon lequel les rapports capitalistes de production, voire même le mode capitaliste de production, sont devenus prédominants dans l’agriculture et que l’impérialisme et la grande bourgeoisie indienne, dans leurs propres intérêts de classe, ont transformé le féodalisme en capitalisme agraire.
En se basant sur une analyse superficielle, ils prétendent qu’aujourd’hui le féodalisme ne survit plus que dans la superstructure – les idées, les coutumes, la culture, les habitudes etc.
Certains, comme les théoriciens de l’école latino-américaine, du type ‘périphérie centrale’ ou ‘satellite de la métropole’, André Gunder Frank, Emmanuel Arrighiri, Samir Amin (un Egyptien) et d’autres, affirment que le féodalisme a été transformé par l’impérialisme dans chaque pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et que la tâche qui attend le prolétariat de ces pays consiste à entreprendre une révolution socialiste et non une révolution de démocratie nouvelle.
Certains marxistes-léninistes prétendent que le stade de la révolution en Inde aujourd’hui est socialiste et non un nouveau stade de révolution démocratique.
Même un paysan pauvre utilisant sa propre force de travail produira pour le marché s’il trouve que ça lui rapporte plus. Certaines de ces ventes sont des ventes à prix bradés.
L’agriculture de subsistance, elle aussi, est présente à une échelle considérable, dans plusieurs parties de l’Inde.
Mais de là à conclure que les rapports capitalistes de production ou le mode capitaliste de production sont devenus prédominants dans l’agriculture, ce serait à tout le moins ridicule. Le paiement des salaires en espèces est une condition nécessaire, quoique insuffisante, du capitalisme.
Même les ouvriers agricoles asservis sont payés en espèces si cela s’avère avantageux pour le propriétaire.
Dans les sociétés précapitalistes aussi, on rencontre la circulation de l’argent et le système de paiement des salaires.
Alors que nous reconnaissons la primauté des rapports semi-féodaux dans l’agriculture indienne, nous devons nous garder d’une autre tendance extrême défendue par certains groupes marxistes-léninistes qui réfutent en bloc jusqu’à la transformation capitaliste limitée qui s’est produite dans l’agriculture indienne.
En se référant à la prolifération du « communalisme » [« communautarisme »] et des atrocités de castes de ces derniers temps, ils prétendent même qu’un processus de ‘reféodalisation’ a lieu actuellement en Inde.
Il s’agit d’une conclusion complètement antihistorique et antidialectique. En fait, les atrocités de castes sont une réponse des castes supérieures à l’expression croissante et à la conscience démocratique que l’on rencontre parmi les castes opprimées et qui émergent en raison du développement des rapports capitalistes.
Et c’est l’impérialisme, fidèle à sa vieille devise ‘diviser pour régner’, qui a mis sur pied les émeutes communales [« communautaires »] en collusion avec les classes dirigeantes indiennes, en vue de détourner le peuple de la voie révolutionnaire.
Ceux qui réfutent tout développement du capitalisme dans l’agriculture indienne et qui prétendent que l’impérialisme est incapable de faire apparaître quelque transformation que ce soit dans les rapports agraires ne sont pas moins dangereux pour les intérêts de la révolution indienne que ceux qui affirment que le féodalisme s’est désintégré et qu’il s’est complètement transformé en capitalisme.
Alors que les seconds insistent sur l’abandon de la lutte antiféodale et de la révolution agraire armée, les premiers tendent à confiner la lutte révolutionnaire à de seules exigences antiféodales et empêchent ainsi le prolétariat de prendre l’initiative dans la direction des larges masses populaires contre les assauts croissants de l’impérialisme.
Il nous faut donc rejeter ces deux tendances et, en lieu et place, nous concentrer sur la mise en place, contre les assauts de l’impérialisme, d’un mouvement populaire de résistance à l’échelle du pays, mouvement qui s’appuiera fermement sur la révolution agraire armée afin de supprimer le carcan des rapports semi-féodaux.
En résumé, durant les quatre décennies et plus qui ont suivi la passation du pouvoir, une transformation capitaliste s’est produite dans certaines poches de l’agriculture indienne et une désintégration des formes extrêmes du féodalisme dans plusieurs parties du pays.
Mais cette transformation était basée sur les besoins changeants de l’impérialisme et de la grande bourgeoisie compradore de l’Inde, comme nous l’avons souligné plus haut.
Toutefois, dans l’ensemble, les rapports semi-féodaux de production continuent de prédominer sur la scène rurale, empêchant le développement des forces productives en Inde.
Le désir de la grande bourgeoisie compradore de l’Inde de s’engager dans la voie de la ‘globalisation’ émane de son impuissance et de sa mauvaise volonté à briser ces chaînes féodales qui entravent l’expansion du marché intérieur.
En même temps, nous devons reconnaître la portée politique et sociale de la transformation capitaliste qui s’est produite dans l’agriculture indienne, toute limitée qu’elle puisse être.
Le développement le plus important qu’il convient de prendre en considération afin de réaliser avec succès la nouvelle révolution démocratique en Inde, c’est que la paysannerie indienne, et particulièrement la paysannerie moyenne et riche, avec sa dépendance vis-à-vis du marché pour la vente de ses produits et pour l’achat d’équipement et de matériel agricole, entre de plus en plus en contradiction avec l’impérialisme et avec la grande bourgeoisie compradore de l’Inde.
Etant donné la toute dernière phase de globalisation entreprise par l’impérialisme et étant donné que la grande bourgeoisie compradore de l’Inde saute joyeusement dans le train en marche en signant le traité du GATT, la paysannerie moyenne et riche vont se trouver de plus en plus à la merci d’un marché mondial complètement contrôlé et dirigé par les monopoles impérialistes.
Ces caractéristiques vont forcer la paysannerie à engager des luttes militantes contre la domination impérialiste. Par conséquent, afin de réaliser avec succès la nouvelle révolution démocratique en prenant comme axe la révolution agraire armée, les communistes révolutionnaires devrons non seulement mobiliser les paysans pauvres et sans terre et la paysannerie inférieure et moyenne dans des luttes antiféodales destinées à briser le carcan des rapports semi-féodaux de production, mais également mobiliser les autres sections de la paysannerie, qui constituent un élément à part entière des forces motrices de la révolution démocratique indienne, dans des luttes anti-impérialistes militantes. Ils réaliseront ainsi la double tâche consistant à chasser à la fois le féodalisme et l’impérialisme.
3. Inde : semi-colonie ou néocolonie ?
Est-il vrai que la plupart des pays du tiers monde ont été transformés en néocolonies de l’impérialisme?
Quelle est la différence entre une colonie, une semi-colonie et une néocolonie?
Etant donné la faiblesse de l’impérialisme dans son ensemble, est-il possible de réduire les pays du tiers monde au statut de néocolonies?
Certains groupes marxistes-léninistes attribuent le statut de néocolonie à la quasi-totalité des pays du tiers monde.
Ils ont également déclaré que l’Inde elle aussi est une néocolonie de l’impérialisme.
Un tel point de vue peut surgir soit d’une confusion dans la compréhension des concepts de l’exploitation néocoloniale et de la néocolonie ou d’une conclusion erronée prétendant que la principale contradiction dans les pays du tiers monde est celle qui règne entre l’impérialisme et les peuples de ces pays.
Au début, à l’époque de la mise sur pied du Parti communiste d’Inde (marxiste-léniniste), nous n’avions pas, nous non plus, une compréhension très claire de ce qu’était une néocolonie.
Par exemple, dans la déclaration publiée par le Comité pan-indien de coordination des révolutionnaires communistes le 14 mai 1968, il était indiqué :
« L’Inde, qui était encore une colonie de la Grande-Bretagne il y a vingt ans à peine, est devenue aujourd’hui une néocolonie de plusieurs puissances impérialistes, en premier lieu des Etats-Unis et de l’Union soviétique. Les impérialistes américains, qui sont les ennemis les plus agressifs de toute l’humanité, sont également les pires ennemis du peuple indien.
Leur emprise néocoloniale sur l’Inde est aujourd’hui totale. »
La même phrase décrivait également l’Inde comme une « néocolonie à la fois des Etats-Unis et de l’Union soviétique ».
Cependant, le Comité pan-indien et notre Parti, tout au long de leur quart de siècle d’existence, ont correctement reconnu que la principale contradiction est celle qu’il y a entre le féodalisme et les masses populaires.
Il n’y eut de confusion que durant la période initiale en ce qui concerne les concepts d’exploitation néocoloniale et de néocolonie.
D’autre part, les groupes marxistes-léninistes comme le Red Flag, bien qu’ils reconnaissent superficiellement le Programme de 1970 du Parti, ont en fait avancé l’hypothèse selon laquelle l’impérialisme a transformé l’économie de l’Inde et que la principale contradiction en Inde réside entre l’impérialisme et le peuple indien.
C’est sur cette base que repose leur conception de l’Inde en tant que néocolonie.
Nous avons déjà vu en détail ce que signifie le mode néocolonialiste d’exploitation et de domination.
C’est une forme, un nouveau style de tactique poursuivi par l’impérialisme après qu’il ait été forcé d’abandonner la domination coloniale.
Une néocolonie, cela signifie un schéma d’exploitation basé sur la production de biens de consommation propre à un certain pays.
L’ensemble de l’économie et le pouvoir d’Etat de ce pays passent sous le contrôle d’une puissance impérialiste particulière, bien que le pouvoir d’Etat soit exercé par le biais d’une marionnette de cette puissance impérialiste particulière.
Par conséquent, une néocolonie signifie la domination indirecte par le biais d’une marionnette d’une certaine puissance impérialiste donnée.
Dans une telle situation, la principale contradiction dans ce pays sera transformée en contradiction entre l’impérialisme (la puissance impérialiste particulière qui contrôle l’économie et le pouvoir d’Etat dans ce pays) et la nation tout entière ou le peuple de ce pays.
La contradiction entre le féodalisme et les larges masses, qui était dominante avant la transformation de ce pays en néocolonie, sera temporairement reléguée au second plan.
Ensuite, la classe ouvrière doit tendre à construire un large front uni comprenant même ces sections des classes dirigeantes alliées aux autres puissances impérialistes et qui annoncera même certaines concessions à ces classes en vue de vaincre la principale cible. Voilà l’acception marxiste-léniniste d’une néocolonie.
Par ailleurs, décrire un pays en tant que néocolonie de l’impérialisme dans son ensemble revient à réfuter les contradictions et rivalités interimpérialistes qui caractériseront le système impérialiste aussi longtemps qu’il subsistera.
En fait, cela insuffle un nouveau regain de vie à la thèse kautskiste de l’ultra-impérialisme, réfutée par le camarade Lénine il y a longtemps, et qui dit que l’impérialisme peut dominer et asservir le monde entier par des moyens pacifiques, par un partage mutuel via une compréhension collective.
Il ne faudrait pas, naturellement, nier le fait que les divers puissances impérialistes et groupes monopolistes internationaux – comme les transnationales et les multinationales – peuvent entrer dans des alliances temporaires afin de procéder à une exploitation conjointe d’un pays particulier ou de plusieurs pays (via la Banque mondiale, le FMI, le GATT etc.) ou joindre leurs forces pour ‘donner une leçon’ à tel ou tel régime qui les défie (comme l’illustre le cas de l’Irak).
Mais, en soi, une telle exploitation conjointe par les diverses puissances impérialistes ne réduit pas un pays particulier à un statut néocolonial.
Dans chaque pays semi-colonial également, il y a rivalité et collusion entre les diverses puissances impérialistes.
Dans une néocolonie, la rivalité devient la plus aiguë quand l’une ou l’autre puissance impérialiste contrôlant la vie économique et la politique d’une néocolonie empêche les autres puissances impérialistes de s’approprier une part des surplus extraits.
En résumé, la différence entre une colonie et une néocolonie réside en ce que la première est dirigée directement par une puissance impérialiste, via la propre administration impérialiste et l’armée de cette dernière, tandis que, dans une néocolonie, la puissance impérialiste exerce le contrôle politique via ses agents ou ses marionnettes, c’est-à-dire par des moyens indirects.
Dans les deux cas, toutefois, les autres puissances impérialistes sont empêchées d’avoir la moindre part dans le pouvoir d’Etat, ce qui donne naissance à de sévères contradictions entre les groupes féodaux compradores alliés à diverses puissances impérialistes.
Une semi-colonie, par ailleurs, est une forme transitoire de dépendance étatique qui se caractérise par une domination indirecte exercée par plus d’une puissance impérialiste, lesquelles agissent via leurs compradores.
Lorsque nous disons que la forme semi-coloniale est une forme transitoire de dépendance étatique, cela signifie que c’est un phénomène passager : la semi-colonie doit soit se libérer du carcan des diverses puissances impérialistes, ce qui n’est possible que par le biais d’une révolution, soit, au fil du temps, se transformer en néocolonie sous la domination d’une puissance impérialiste.
C’était ce que le camarade Lénine voulait dire lorsqu’il décrivait une semi-colonie comme étant une forme transitoire de dépendance étatique.
La caractéristique permettant de distinguer une semi-colonie est qu’elle n’est sous la domination directe ou indirecte d’aucun pays impérialiste mais qu’elle est dominée par plusieurs puissances impérialistes par le biais d’une pression économique, politique, diplomatique et même militaire.
En guise d’explication, le camarade Mao disait :
« Comme nous le savons tous, depuis environ une centaine d’années, la Chine est un pays semi-colonial communément dominé par plusieurs puissances impérialistes.
En raison de la lutte du peuple chinois contre l’impérialisme et de conflits qui ont opposé les puissances impérialistes, la Chine a pu conserver un statut semi-indépendant.
Pendant tout un temps, la Première Guerre mondiale a fourni à l’impérialisme japonais l’occasion de dominer la Chine exclusivement.
Mais le traité rendant la Chine au Japon, les Vingt et une Exigences signées par Yuan Shikai, l’archi-traître de l’époque, fut inévitablement déclaré nul et vide de sens suite à la lutte du peuple chinois contre l’impérialisme japonais et à l’intervention d’autres puissances impérialistes.
En 1922, lors de la Conférence des Neuf Puissances convoquée par les Etats-Unis, un traité fut signé qui, une fois de plus, plaçait la Chine sous la domination conjointe de plusieurs puissances impérialistes.
Mais la situation ne tarda guère à changer une fois de plus.
L’incident du 18 septembre 1931 initia le stade actuel de la colonisation de la Chine par le Japon. Du fait que l’agression japonaise s’est provisoirement limitée aux quatre provinces du Nord-Est, certaines personnes ont pensé que les impérialistes japonais n’avanceraient probablement pas plus loin.
Aujourd’hui, les choses sont différentes.
Les impérialistes japonais ont déjà montré leur intention de pénétrer au sud de la Grande Muraille et d’occuper toute la Chine. Désormais, ils veulent transformer l’ensemble de la Chine, de semi-colonie partagée par plusieurs puissances impérialistes qu’elle était, en colonie monopolisée par le Japon. »
Considérant la principale contradiction dans un pays semi-colonial, le camarade Mao faisait remarquer :
« Dans un pays semi-colonial comme la Chine, la relation entre la principale contradiction et les contradictions non principales présente un aspect compliqué.
Lorsque l’impérialisme lance une guerre d’agression contre un tel pays, toutes ses différentes classes, à l’exception de quelques traîtres, peuvent s’unir temporairement dans une guerre nationale contre l’impérialisme.
A ce moment précis, la contradiction entre l’impérialisme et le pays en question devient la contradiction principale, alors que toutes les contradictions existant entre les diverses classes du pays même (y compris celle qui était la principale contradiction, entre le système féodal et les larges masses du peuple) sont temporairement reléguées au second plan, dans une position subordonnée.
Ce fut le cas en Chine durant la guerre de l’Opium de 1840, durant la guerre sino-japonaise de 1894 et la guerre de Yi Ho Tuan de 1900, et c’est encore le cas dans la présente guerre sino-japonaise.
Mais dans une autre situation, les contradictions changent de position. Lorsque l’impérialisme exerce son oppression, non pas par la guerre, mais par des moyens plus doux – politiquement, économiquement et culturellement -, les classes dirigeantes des pays semi-coloniaux capitulent devant l’impérialisme, et les deux constituent une alliance visant à opprimer ensemble les masses du peuple.
Dans une telle situation, les masses recourent souvent à la guerre civile contre l’alliance entre l’impérialisme et les classes féodales, alors que l’impérialisme préfère souvent recourir à des méthodes indirectes plutôt qu’à l’action directe, en aidant les réactionnaires des pays semi-coloniaux à opprimer le peuple et, ainsi donc, les contradictions internes deviennent particulièrement aiguës. C’est ce qui s’est produit en Chine au cours de la guerre révolutionnaire de 1911, de la guerre révolutionnaire de 1924-1927 et durant les dix années de la guerre révolutionnaire agraire, après 1927. Les guerres entre les divers groupes dirigeants réactionnaires dans les pays semi-coloniaux, et c’est le cas des guerres entre les seigneurs de guerre chinois, appartiennent à la même catégorie. »
Après l’invasion de la Chine par le Japon (entre 1931 et 1945), le camarade Mao avait décrit le caractère de la société chinoise non pas comme semi-colonial et semi-féodal, mais comme colonial, semi-colonial et semi-féodal :
« Depuis l’invasion du capitalisme étranger et le développement progressif d’éléments capitalistes au sein de la société chinoise, le pays s’est graduellement transformé en société coloniale, semi-coloniale et semi-féodale.
Aujourd’hui, la Chine est coloniale dans les zones occupées par les Japonais et elle est fondamentalement semi-coloniale dans les zones du Kuomintang, et elle est à prédominance féodale ou semi-féodale dans les deux. Voilà donc le caractère de l’actuelle société chinoise et l’état de la situation dans notre pays. La politique et l’économie de cette société sont à prédominance coloniale, semi-coloniale et semi-féodale, et la culture prédominante, qui reflète la politique et l’économie, est également coloniale, semi-coloniale et semi-féodale. »
L’Inde a été une semi-colonie de diverses puissances impérialistes après la passation de pouvoir de 1947. Mais une telle forme transitoire de dépendance étatique ne peut durer très longtemps.
Au cours des 47 années d’existence semi-coloniale de l’Inde, plusieurs changements se sont produits dans son économie, sa politique et sa culture, comme on l’a expliqué plus haut.
Les relations de l’Inde avec diverses puissances impérialistes ont changé, elles aussi, comme le montrent les relations élaborées dans la résolution politique d’août 1992.
Au départ, l’impérialisme américain et, plus tard, au cours des années 1970 et de la première moitié des années 1980, l’impérialisme social soviétique, ont tenté désespérément, chacun de leur côté, de faire de l’Inde leur néocolonie. Mais aucune des deux superpuissances n’a pu atteindre ses objectifs en raison de la révolte croissante du peuple, partout dans le monde, contre leurs plans d’hégémonie mondiale.
Les peuples de Corée, du Vietnam, du Laos, du Cambodge, du Pérou, des Philippines, de l’Afghanistan, de l’Erythrée, de la Somalie, du Nicaragua, du Salvador et de plusieurs autres pays ont opposé une résistance héroïque aux deux superpuissances et ont contribué à leur affaiblissement.
Par conséquent, il est particulièrement malaisé pour les superpuissances de convertir un vaste pays comme l’Inde en leur néocolonie, bien qu’ils poursuivent leur politique néocoloniale d’exploitation en Inde aussi bien que dans le reste du tiers monde.
La rivalité entre les diverses puissances impérialistes – les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne et la France – en vue d’établir leur contrôle sur l’Inde est appelée à s’intensifier dans le futur.
Les classes dirigeantes d’un pays semi-colonial, tout en étant subordonnées à l’impérialisme dans l’ensemble, peuvent, à certain moment, obtenir quelques concessions de la part de l’impérialisme en se servant des contradictions aiguës régnant entre les diverses puissances impérialistes.
Mais même la capacité de manoeuvre des classes dirigeantes dans le tiers monde a connu un déclin au cours de la dernière décennie, qui a vu chaque pays tenter d’évincer les autres en recherchant les connivences avec l’impérialisme et rivaliser avec les autres pour vendre à l’impérialisme sa main-d’oeuvre à bas prix, ses ressources et ses marchés, dans l’espoir de récolter les quelques miettes qui allaient tomber au cours de la phase de ‘globalisation’ lancée par l’impérialisme.
Certains pays du tiers-monde, et tout particulièrement les plus petits, sont même sur le point de devenir des néocolonies de l’une ou l’autre puissance impérialiste. Bien que l’impérialisme s’affaiblisse de jour en jour, il serait naïf d’imaginer que les puissances impérialistes n’ont pas la capacité de convertir plusieurs pays du tiers monde en leurs colonies respectives.
Tandis que l’impérialisme américain, s’appuyant sur le nouveau traité NAFTA placé sous son hégémonie, tente de s’assurer le contrôle absolu sur l’Amérique latine, le Japon, de son côté, échafaude des plans en vue de ressusciter son rêve perdu d’étendre la sphère de coprospérité de l’Est de l’Asie à l’ensemble de la région Asie-Pacifique.
La Communauté économique européenne, et particulièrement l’Allemagne, tente de resserrer son emprise non seulement sur les pays de l’Europe de l’Est et sur certaines républiques dissidentes de l’ancienne Union soviétique, mais elle essaie également d’étendre son contrôle sur l’Afrique du Nord et sur d’autres régions.
Ce n’est que par une révolution prolétarienne que les pays du tiers monde pourront venir à bout complètement de l’impérialisme.
Dans les pays où le prolétariat et les forces anti-impérialistes sont faibles, il existe un danger de voir les classes dirigeantes compradores devenir les marionnettes de l’une ou l’autre puissance impérialiste et, de ce fait, de voir leur statut de pays se réduire à celui de néocolonies.
Le terme de ‘recolonisation’, peut-on l’utiliser alors pour décrire la mainmise impérialiste croissante sur les pays du tiers monde ?
L’usage de ce terme ne risque-t-il pas de donner l’impression que les pays du tiers monde ont joui d’une véritable indépendance dans le temps et que ce n’est que maintenant qu’ils se transforment en semi-colonies et néocolonies?
Le terme a été utilisé puisqu’il a déjà été popularisé dans les médias pour décrire la toute dernière offensive de l’impérialisme dans les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine par le biais des programmes d’ajustements structurels et autres politiques néocolonialistes de la Banque mondiale, du FMI, du GATT, etc., avec lesquelles même l’indépendance nominale de ces pays se trouve menacée.
Pris dans son sens littéral, le terme ‘recolonisation’ peut donner l’impression, effectivement, que les pays du tiers monde ont jusqu’à présent bénéficié d’une indépendance véritable bien qu’il n’y ait personne qui, après avoir lu entièrement notre point de vue, pourra encore avoir cette impression. Pourtant, en gardant en vue la confusion qui peut naître en raison de l’emploi de ce terme, il faut mieux supprimer ce mot et le remplacer par les termes de ‘mainmise croissante de l’impérialisme’.
=>Retour au dossier sur Charu Mazumdar
et le PC d’Inde (marxiste-léniniste)