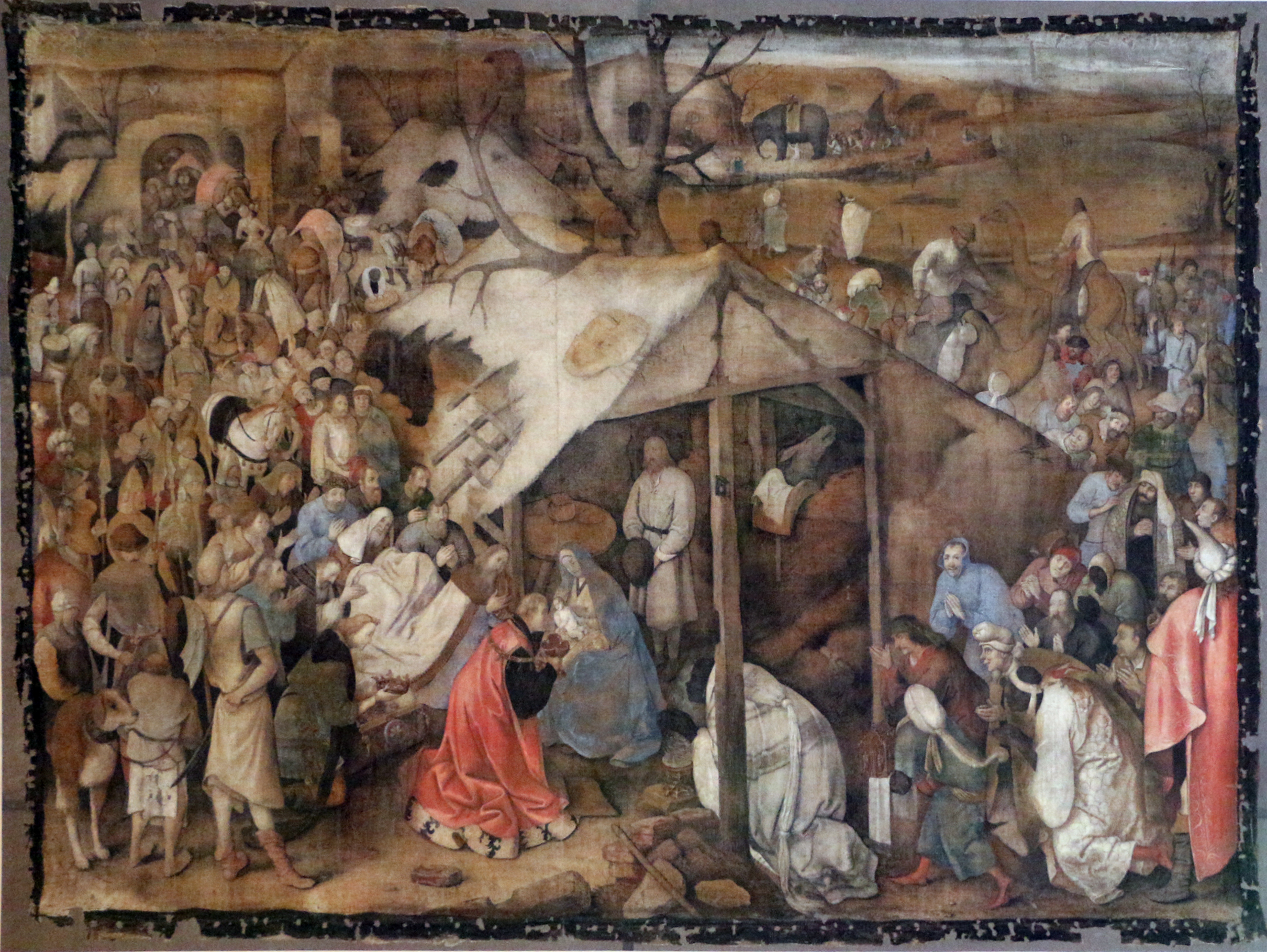Les paroles des chansons du Parti Communiste du Pérou reflètent l’engagement, l’idéologie, la ligne révolutionnaire. Les chansons elles-mêmes sont disponibles au format MP3 (et les paroles ci-dessous au format pdf).
Elles ont été enregistrées de manière clandestine dans deux prisons péruviennes, Miguel Castro Castro et Lurigancho. Cela s’est déroule entre 1990 et 1992, avant qu’en 1999 le Mouvement Populaire Pérou ne procède à la sortie d’un CD avec les chansons. Nous avons même diffusé ensuite cela en MP3 et nous ne savons pas, ce qui est de toutes façons secondaire, dans quelle mesure les MP3 diffusés en ligne proviennent de notre initiative.
L’arrivée massive de prisonniers politiques a souvent permis l’établissement de bastions politiques au sein des prisons elles-mêmes, en Turquie par exemple. Au Pérou, cela a pris toutefois les proportions les plus importantes, de par la prise d’initiative des membres du Parti Communiste du Pérou.
Ceux-ci ont réussi à contrôler leur propre vie quotidienne, prenant l’initiative sur tous les plans.

Ce fut obtenu au prix d’une grande lutte, issu d’une grande définition initiale : le Parti Communiste du Pérou soulignait que le combat ne s’arrête pas une fois arrêté, et définissait les prisons comme de « Lumineuses Tranchées de Combat ».
Il faut ici mentionner la grande révolte des 18-19 juin 1986, dans les prisons de Lurigancho, d’El Frontón, et de Santa Mónica, avec la répression faisant 224 morts, dont une centaine de militants exécutés après l’assaut de l’armée réactionnaire. Cette dernière intervint également en mai 1992 à la prison de Castro Castro, exécutant 13 membres du Comité Central (sur 19, alors qu’on est dans le contexte de l’arrestation de Gonzalo).
Les paroles s’appuient sur le corpus idéologique du PCP ; on a ainsi souvent la référence à l’océan armé, qui est l’océan armé des masses, les masses devant être en armes jusqu’au Communisme. On a également des références andines, plus ou moins difficiles à saisir. La multiplication des bases d’appui de la guérilla est ainsi apparentée à des « cordes enfilées » : il s’agit possiblement d’une allusion aux quipus, assemblage de cordes enfilées formant le moyen de communication historique dans les Andes (la civilisation Inca notamment ne pratiquant pas l’écriture).
Il faut se souvenir ici que les masses paysannes mobilisées sont le plus souvent illettrées, et que la langue employée au quotidien est le plus souvent le quechua. L’agitation et la propagande du PCP ont par contre toujours été en espagnol.
On notera que certaines vidéos parlent du « sendero luminoso » (sentier lumineux), ce qui n’existe pas et n’a jamais existé. Cette expression sert historiquement à criminaliser le Parti Communiste du Pérou.
La Internacional – L’internationale
¡Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos
¡Viva la Internacional!
Removamos todas las ramas
que impiden nuestro bien
cambiemos el mundo de fase
hundiendo al imperio burgués
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos (con valor)
por la Internacional
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni hambrientos habrá
la tierra sera el paraíso
de toda la humanidad
Que la tierra dé todos sus frutos
y la dicha en nuestro hogar
el trabajo será el sostén que a todos
de la abundancia hará gozar
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos (con valor)
por la Internacional
En avant les pauvres du monde
Debout les esclaves sans pain
et crions tous unis
Vive l’Internationale !
Enlevons toutes les branches
qui entravent notre bien
changeons le monde de face
en coulant l’empire bourgeois
Regroupons-nous tous
dans la lutte finale
et que les peuples se lèvent (avec courage)
pour l’Internationale
Le jour où la victoire nous atteindrons
ni esclaves ni affamés il n’y aura plus
la terre sera le paradis
de toute l’humanité
Que la terre donne tous ses fruits
et la joie dans notre foyer
le travail sera le soutien qui à tous
de l’abondance nous fera jouir
Regroupons-nous tous
dans la lutte finale
et que les peuples se lèvent (avec courage)
pour l’Internationale
Al Presidente Gonzalo / Au Président Gonzalo
Jefe signifie « chef », par Jefatura il faut comprendre le principe de direction, le dirigeant en action.
El Presidente Gonzalo el más grande
marxista-leninista-maoísta
viviente sobre la faz de la tierra
es garantía de triunfo comunista
es jefatura del Partido y la revolución
El pensamiento Gonzalo en nuestra patria
aplicación creadora del maoísmo
el Presidente Gonzalo lo ha plasmado
luz en el mundo de rojo amanecer
El Presidente Gonzalo lo ha plasmado
luz en el mundo de rojo amanecer
Dirigiendo la Guerra Popular
nos ha dado el Nuevo Poder
comités populares abiertos
sostenidos en ejércitos y las masas
con un Partido Comunista militarizado
El Presidente Gonzalo nos conduce
al Comunismo nuestra meta final
él es el gran continuador de Marx
Lenin y el Presidente Mao Tsetung
Él es el gran continuador de Marx
Lenin y el Presidente Mao Tsetung
Le Président Gonzalo, le plus grand
marxiste-léniniste-maoïste
vivant sur la face de la terre
il est la garantie du triomphe communiste
il est le cheffature du parti et de la révolution
La pensée Gonzalo dans notre patrie
application créative du maoïsme
Le président Gonzalo l’a incarnée
lumière dans le monde de l’aube rouge
Le président Gonzalo l’a incarnée
lumière dans le monde de l’aube rouge
En menant la guerre populaire
il nous a donné le Nouveau Pouvoir
des comités populaires ouverts
soutenus par les armées et les masses
avec un Parti Communiste militarisé
Le président Gonzalo nous conduit
vers le communisme, notre objectif final
il est le grand continuateur de Marx
Lénine et du président Mao Zedong
Il est le grand continuateur de Marx
Lénine et le président Mao Zedong
Himno A La Camarada Norah / Hymne à la camarade Norah
Norah est le nom de guerre d’Augusta La Torre (1946-1988), figure du Parti depuis le début et par ailleurs femme de Gonzalo, avec qui elle était dans la clandestinité dès 1978. Elle a également mené en 1980 la première action armée de l’Armée Populaire de Guérilla.
Les trois montagnes, l’expression de montagne relevant de Mao Zedong, sont la réalité semi-féodale et semi-coloniale, et le capitalisme bureaucratique qui en découle dans le pays.
Elevándose en la gloria
imperecedera de la historia
en inagotable sendero
de heroicidad comunista
El Partido y la Guerra Popular
heroína nos dio
por siempre recordada Camarada Norah
heroína nos dio
por siempre recordada Camarada Norah
Flameante bandera roja
firme desafiante contra el viento
luminoso ejemplo en dar la vida
por el Partido y la revolución
Acero rojo temple de Gonzalo
firme comunista gran dirigente
camarada Norah
firme comunista gran dirigente
camarada Norah
Torrente hermoso es tu sangre
que ha regado nuestra revolución
firme juramento de la clase
compromiso de rojos combatientes
en conquistar el poder hasta el Comunismo
en conquistar el poder hasta el Comunismo
Irradiando luz poderosa
marxismo-leninismo-maoísmo
y su aplicación creadora
pensamiento gonzalo en nuestra patria
luchando a muerte contra el vil revisionismo
con odio de clase barremos tres montañas
asaltamos los cielos
con odio de clase barremos tres montañas
asaltamos los cielos
Torrente hermoso es tu sangre
que ha regado nuestra revolución
firme juramento de la clase
compromiso de rojos combatientes
en conquistar el poder hasta el Comunismo
en conquistar el poder hasta el Comunismo
en conquistar el poder hasta el Comunismo
S’élevant dans la gloire
impérissable de l’histoire
dans un chemin inépuisable
de l’héroïsme communiste
Au Parti et à la guerre populaire
L’héroïne nous a donné
à jamais à se souvenir de la Camarade Norah
L’héroïne nous a donné
à jamais à se souvenir de la Camarade Norah
Drapeau rouge flottant
flottant avec défi face au vent
exemple lumineux en donnant la vie
pour le Parti et la révolution
Acier rouge trempé de Gonzalo
ferme communiste grand dirigeante
camarade Norah
ferme communiste grand dirigeante
camarade Norah
Beau torrent est ton sang
qui a arrosé notre révolution
serment ferme de la classe
engagement des combattants rouges
à conquérir le pouvoir jusqu’au communisme
à conquérir le pouvoir jusqu’au communisme
Rayonnante la lumière puissante
le marxisme-léninisme-maoïsme
et son application créative
la Pensée Gonzalo dans notre patrie
lutter à la mort contre l’ignoble révisionnisme
avec haine de classe, nous balayons trois montagnes
nous prenons d’assaut les cieux
avec haine de classe, nous balayons trois montagnes
nous prenons d’assaut les cieux
Beau torrent est ton sang
qui a arrosé notre révolution
serment ferme de la classe
engagement des combattants rouges
à conquérir le pouvoir jusqu’au communisme
à conquérir le pouvoir jusqu’au communisme
à conquérir le pouvoir jusqu’au communisme
Salvo El Poder / À part le pouvoir
Le titre est une référence à un propos de Lénine : « À part le pouvoir tout est illusion ». La première strophe fait allusion aux flambeaux allumés dans les monts au loin et formant notamment le marteau et la faucille, mais bien entendu également aux coups d’éclat de la guérilla. L’expression « à l’assaut du ciel » a été employé par Karl Marx pour désigner les Communards menant la révolution en 1871.
Siglos se hunden ídolos caen
se quiebra un viejo orden de opresión
y en la montaña un relámpago de fuego
hiende la noche con su gran puñal
y en la montaña un relámpago de fuego
hiende la noche con su gran puñal
Se agitan los mares la tormenta arrecia
y en el gran desorden se levanta el Sol
salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
Obreros campesinos rompan sus cadenas
levanten la bandera de la Guerra Popular
salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
Partido Comunista conduce a nueva vida
se esfuma como el humo la duda, el temor
tenemos la fuerza es nuestro el futuro
Comunismo es meta y será realidad
tenemos la fuerza es nuestro el futuro
Comunismo es meta y será realidad
Salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
salvo el poder todo es ilusión
asaltar los cielos con la fuerza del fusil
Les siècles s’effacent, les idoles tombent
fait faillite un vieil ordre d’oppression
et dans la montagne un éclair de feu
fend la nuit de son grand poignard
et sur la montagne un éclair de feu
fend la nuit de son grand poignard.
Les mers sont agitées, la tempête fait rage
et dans le grand désordre se lève le Soleil
à part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
à part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
Ouvriers paysans brisez vos chaînes
levez la bannière de la Guerre Populaire
à part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
à part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
Le parti communiste guide à une nouvelle vie
s’évanouissent comme de la fumée le doute, la peur
nous avons la force l’avenir est à nous
Le communisme est l’objectif et deviendra réalité
nous avons la force l’avenir est à nous
Le communisme est l’objectif et sera réalité
À part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
À part le pouvoir, tout n’est qu’illusion
prendre d’assaut les cieux avec la force du fusil
El Partido / Le Parti
La référence aux aigles relève indéniablement de la culture andine et plus généralement américaine d’avant la colonisation.
Las águilas remontan su vuelo
elevando nuevo grito al desplegar
pese a voces orientan su grito
puños en alto hacia la libertad
De púrpura el cielo
va embelleciendo
legiones hombro a hombro
fundidos en su imagen
bebiendo de la luz
fuente inagotable
Vivan al Partido
uno es como ninguno
el Partido es huracán bravío
donde voces quedas se han hundido
en la inmortalidad de nuestra
causa entera
el cerebro de la clase
de la gloria de la clase
una mano de un millón de dedos
que demoliendo está al enemigo
De púrpura el cielo
va embelleciendo
legiones hombro a hombro
fundidos en su imagen
bebiendo de la luz
fuente inagotable
Vivan al Partido
uno es como ninguno
el Partido es huracán bravío
donde voces quedas se han hundido
en la inmortalidad de nuestra
causa entera
el cerebro de la clase
de la gloria de la clase
que guiando está a la libertad.
Les aigles élèvent leur vol
poussant un nouveau cri en se déployant
malgré les voix ils dirigent leur cri
es poings levés vers la liberté
Pourpre est le ciel
il va s’embellissant
les légions épaule contre épaule
fondées à son image
s’abreuvant à la lumière
source inépuisable
Longue vie au Parti
l’un ne ressemble à aucun autre
le Parti est un ouragan indomptable
où les voix laissées derrière ont sombré
dans l’immortalité de notre
cause entière
le cerveau de la classe
de la gloire de la classe
une main aux millions de doigts
qui est démolissant l’ennemi
Pourpre est le ciel
il va s’embellissant
les légions épaule contre épaule
fondées à son image
s’abreuvant à la lumière
source inépuisable
Longue vie au Parti
l’un ne ressemble à aucun autre
le Parti est un ouragan indomptable
où les voix laissées derrière ont sombré
dans l’immortalité de notre cause entière
le cerveau de la classe
de la gloire de la classe
qui mène à la liberté.
El Guerrillero / Le guérillero
Por los valles y los Andes
guerrilleros libres van
los mejores luchadores
del campo y la ciudad
los mejores luchadores
del campo y la ciudad
Ni el dolor ni la miseria
los harán desfallecer
seguiremos adelante
sin jamás retroceder
seguiremos adelante
sin jamás retroceder
Nuestro pueblo nos ordena
combatir hasta triunfar
adelante camaradas
nuestra consigna es vencer
adelante camaradas
nuestra consigna es vencer
Venceremos al fascismo
en la batalla final
¡Abajo el imperialismo!
¡Muera!
¡Viva nuestra libertad!
¡Abajo el imperialismo!
¡Muera!
¡Viva nuestra libertad!
Las banderas de combate
como mantos cubrirán
a los bravos guerrilleros
que en la lucha caerán
a los bravos guerrilleros
que en la lucha caerán
À travers les vallées et les Andes
les guérilleros libres vont
les meilleurs combattants
de la campagne et de la ville
les meilleurs combattants
de la campagne et de la ville
Ni la douleur ni la misère
ne les fera défaillir
nous irons de l’avant
sans jamais reculer
nous irons de l’avant
sans jamais se reculer
Notre peuple nous ordonn
de combattre jusqu’à ce que nous triomphions
En avant camarades
notre mot d’ordre est de vaincre
en avant camarades
notre mot d’ordre est de vaincre
Nous vaincrons le fascisme
dans la bataille finale
A bas l’impérialisme !
Meurs !
Vive notre liberté !
À bas l’impérialisme !
Meurs !
Vive notre liberté !
Les drapeaux de combat
comme des manteaux couvriront
les courageux guérilleros
qui dans la lutte tomberont
les braves guérilleros
qui dans la lutte tomberont
Los Rojos Guerreros / Les guerriers rouges
Los rojos guerreros, tropas de Gonzalo
con plomo han abierto las puertas de la historia
afirman la vida en la guerra
arrancando lauros a la misma muerte
Sus armas combativas se levantan
haciendo las sombras retroceder
Sus armas combativas se levantan
haciendo las sombras retroceder
Los rojos guerreros de nuestro Partido
con furia de clase barren tres montañas
los campos se tiñen de rojo
por eso es progenia transformadora
Seguimos luminoso sendero
camino al reino del Comunismo
Seguimos luminoso sendero
camino al reino del Comunismo
Aprendemos de Gonzalo nuestro guía
a dar la vida hoy, mañana y siempre
por el Partido y la revolución
Aprendemos de Gonzalo nuestro guía
a dar la vida hoy, mañana y siempre
por el Partido y la revolución
Nada es imposible para quien se atreve
a escalar las alturas
Nada es imposible para quien se atreve
a escalar las alturas
Nada es imposible para quien se atreve
a escalar las alturas
Nada es imposible para quien se atreve
a escalar las alturas
Les guerriers rouges, les troupes de Gonzalo
avec du plomb ont ouvert les portes de l’histoire
ils affirment la vie dans la guerre
arrachant les lauriers à la mort elle-même
Leurs armes militantes s’élèvent
faisant les ombres reculer
Leurs armes militantes s’élèvent
faisant les ombres reculer
Les guerriers rouges de notre Parti
avec une fureur de classe balaient trois montagnes
les champs sont teints en rouge
c’est pourquoi c’est la progéniture transformée
Nous suivons lumineux le chemin
sur le chemin au royaume du communisme
Nous suivons lumineux le chemin
sur le chemin au royaume du communisme
Nous apprenons de Gonzalo notre guide
à donner notre vie aujourd’hui, demain et toujours
pour le Parti et la révolution
Nous apprenons de Gonzalo notre guide
à donner notre vie aujourd’hui, demain et toujours
pour le Parti et la révolution
Rien n’est impossible à ceux qui osent
d’escalader les sommets
Rien n’est impossible à ceux qui osent
d’escalader les sommets.
Rien n’est impossible à ceux qui osent
d’escalader les sommets
Rien n’est impossible à ceux qui osent
d’escalader les sommets
Canto De Batalla / Champ de bataille
Imperecedero hito de victoria
en el crisol de ardiente fragua
ha quedado estampado
en la historia de nuestro Partido
es Gonzalo que en el mundo
va imponiendo la verdad universal
Ardorosa marcha, vanguardia combatiente
de largo camino recorrido
en máquina de guerra devino en una gran brega
conductor de masas, acero de Gonzalo
en máquina de guerra devino en una gran brega
conductor de masas, acero de Gonzalo
Legiones de hierro, ejército invencible
con todapoderosa invicta ideología
florece la violencia desarrollando acciones
muralla invencible, canto de batalla
florece la violencia desarrollando acciones
muralla invencible, canto de batalla
De historias eternas resurge desafiante
florece el mañana con su luz brillante
cubriéndonos de rojo va irradiando al mundo
que en nuestros corazones latiendo nueva vida
cubriéndonos de rojo va irradiando al mundo
que en nuestros corazones latiendo nueva vida
Asumimos firmes histórico llamado
potenciando la Guerra Popular
construyendo la conquista
del poder total en nuestra patria
Más ejército y masas
dirigidos por nuestro Partido
Más ejército y masas
dirigidos por nuestro Partido
L’impérissable jalon de la victoire
dans le creuset de l’ardente forge
a été inscrit
dans l’histoire de notre Parti
c’est Gonzalo qui dans le monde
va imposant la vérité universelle
Ardente marche, avant-garde combattante
d’un long chemin parcouru
en une machine de guerre devenue au moyen d’une grande lutte
chef d’orchestre des masses, l’acier de Gonzalo
en une machine de guerre devenue au moyen d’une grande lutte
chef d’orchestre des masses, l’acier de Gonzalo
Légions de fer, armée invincible
avec une toute puissante et invaincue idéologie
fleurit la violence, les actions se développant
muraille invincible, chant de bataille
fleurit la violence, les actions se développant
muraille invincible, chant de bataille
Des histoires éternelles ressurgissent avec défi
fleurit le lendemain avec sa lumière éclatante
nous couvrant de rouge rayonnant dans le monde entier
qui dans nos cœurs fait battre une nouvelle vie
nous couvrant de rouge rayonnant dans le monde entier
qui dans nos cœurs fait battre une nouvelle vie
Nous assumons fermement l’histoire appelant
en renforçant la guerre du peuple
en construisant la conquête
du pouvoir total dans notre patrie
Plus d’armée et de masses
dirigées par notre Parti
Plus d’armée et de masses
dirigées par notre Parti
Soldados Rojos / Soldats rouges
Marchamos firmes y seguros a la victoria
soldados rojos somos del Nuevo Poder
Partido Comunista es el que nos dirige
camino a nuestra libertad
Banderas rojas con hoces y martillos llevamos
firmes empuñamos con furia y decisión
a las hienas barremos sus cenizas esparcemos
y nunca más ya volverán
Vamos obreros, campesinos, todo el pueblo
rugen los Andes llamando a combatir
Pueblos del mundo unidos triunfaremos
la gran hoguera se extiende más y más
desarrollando Guerra Popular
Vamos obreros, campesinos, todo el pueblo
rugen los Andes llamando a combatir
Pueblos del mundo unidos triunfaremos
la gran hoguera se extiende más y más
desarrollando Guerra Popular
Desarrollando Guerra Popular
Nous marchons fermes et assurés à la victoire
soldats rouges nous sommes du Nouveau Pouvoir
Le Parti communiste est celui qui nous dirige
le chemin à notre liberté
Des drapeaux rouges avec des marteaux et des faucilles nous portons
fermes nous les empoignons avec fureur et détermination
aux hyènes nous barrons la route, leurs cendres nous dispersons
et jamais plus elles ne reviendront
Allons ouvriers, paysans, tout le peuple
les Andes rugissent appelant au combat
Peuples du monde unis nous triompherons
le grand brasier s’étend de plus en plus
développant la Guerre Populaire
Allons ouvriers, paysans, tout le peuple
les Andes rugissent appelant au combat
Peuples du monde unis nous triompherons
le grand brasier s’étend de plus en plus
développant la Guerre Populaire
Développant la Guerre Populaire
Canto Al Nuevo Poder / Chanson au Nouveau Pouvoir
Pueblos, pueblos del mundo
en pie de guerra
viva Gonzalo gloria al maoísmo,
en nuestra mente el Comunismo brillará
Comités populares abiertos
luz radiante brillante ante el sol
camaradas combatientes y masas
el triunfo es nuestro viva el Nuevo Poder
Desarrollando bases con Guerra Popular
construimos la conquista del poder
bandera de combate flameando en altas cumbres
hoguera de esperanza brilla el Nuevo Poder
Bandera de combate flameando en altas cumbres
hoguera de esperanza, brilla el Nuevo Poder
Comités populares abiertos
luz radiante brillante ante el sol
camaradas combatientes y masas
el triunfo es nuestro viva el Nuevo Poder
Camaradas, combatientes y masas
el triunfo es nuestro brilla el Nuevo Poder
Peuples, peuples du monde
sur le pied de guerre
vive Gonzalo gloire au maoïsme
dans notre esprit le communisme brillera
Comités populaires ouverts
lumière irradiante rayonnante devant le soleil
Camarades combattants et masses
le triomphe est nôtre vive le nouveau pouvoir
Développant des bases avec la Guerre Populaire
nous construisons la conquête du pouvoir
le drapeau de combat flotte sur les hauts sommets
sur le bûcher de l’espoir brille le Nouveau Pouvoir
Le drapeau de combat flotte sur les hauts sommets
le feu de l’espoir fait briller le nouveau pouvoir
Comités populaires ouverts
lumière irradiante rayonnante devant le soleil
Camarades combattants et masses
le triomphe est nôtre vive le nouveau pouvoir
Camarades, combattants et masses
le triomphe est nôtre vive le nouveau pouvoir
Por El Gran Camino / Par la grande voie
Por el camino marchamos
luchamos con firme decisión
Mao Tsetung guía la revolución
desafiando la tormenta
Mao Tsetung guía la revolución
desafiando la tormenta
Por el camino marchamos
luchamos con firme decisión
Mao Tsetung guía la revolución
desafiando la tormenta
Mao Tsetung guía la revolución
desafiando la tormenta
Marchamos marchamos
adelante la revolución
marchamos marchamos
adelante la revolución
Marchamos, marchamos
adelante la revolucion
marchamos marchamos
adelante la revolucion
Marchamos marchamos
adelante la revolucion
Sur la route, nous marchons
nous luttons avec une ferme détermination
Mao Zedong dirige la révolution
défiant la tempête
Mao Zedong dirige la révolution
défiant la tempête
Sur la route nous marchons
nous luttons avec une ferme détermination
Mao Zedong mène la révolution
défiant la tempête
Mao Zedong mène la révolution
défiant la tempête
Nous marchons nous marchons
en avant la révolution
Nous marchons, nous marchons
en avant la révolution
Nous marchons nous marchons
en avant la révolution
Nous marchons nous marchons
en avant la révolution
Nous marchons nous marchons
en avant la révolution
Brilla, Brilla el Nuevo Poder / Brille, brille le Nouveau Pouvoir
Brilla, brilla el Nuevo Poder a la luz del sol
prédica y desafiante realidad
nace de la guerra Guerra Popular
guerra de las masas hoguera de esperanza
nace de la guerra Guerra Popular
guerra de las masas, hoguera de esperanza
El poder que estamos ejerciendo es bandera roja
a enarbolarla en todo el país, en todo el mundo
a enarbolarla en todo el país, en todo el mundo
Fuerza núcleo, máquina de guerra
con ejército y las masas vamos rumbo
al Comunismo con el maoísmo
Gonzalo luz inmarcesible brilla el Nuevo Poder Gonzalo luz inmarcesible brilla el Nuevo Poder
Fuerza núcleo máquina de guerra
con ejército y las masas vamos rumbo
al Comunismo con el maoísmo
Gonzalo luz inmarcesible brilla el Nuevo Poder Gonzalo luz inmarcesible, brilla el Nuevo Pode
Brille, brille le Nouveau Pouvoir à la lumière du soleil
prêchante et défiante réalité
né de la guerre la Guerre Populaire
guerre des masses feu de joie de l’espoir
né de la guerre la Guerre Populaire
guerre des masses feu de joie de l’espoir
Le pouvoir que nous sommes exerçant est le drapeau rouge
à déployer dans tout le pays, dans le monde entier
à déployer dans tout le pays, dans le monde entier
Force noyau machine de guerre
avec l’armée et les masses nous maintenons le cap
vers le communisme avec le maoïsme
Gonzalo lumière immarcescible brille sur le Nouveau Pouvoir
Gonzalo lumière immarcescible brille sur le Nouveau Pouvoir
Force noyau machine de guerre
avec l’armée et les masses nous maintenons le cap
vers le communisme avec le maoïsme
Gonzalo lumière immarcescible brille sur le Nouveau Pouvoir
Gonzalo lumière immarcescible brille sur le Nouveau Pouvoir
Bandera Roja / Drapeau rouge
De los Andes hasta los mares
rugen las masas embravecidas
enarbolando bandera roja
iniciamos la Guerra Popular
Desplegando las guerrillas
va floreciendo la nueva aurora
conquistando bases de apoyo
derrochando heroicidad
Presidente Gonzalo
Jefatura del Partido y la revolución
con pensamiento Gonzalo hoy tenemos
realidad bélica actuante
son diez años de pujante y victoriosa
e invencible Guerra Popular
Demoliendo los viejos muros
desarrollamos las bases de apoyo
nos acercamos a la conquista
del poder total en nuestra patria
Comités populares abiertos
brillando a la luz del sol
desarrollemos la Guerra Popular
y construyamos la conquista del poder
Proletarios del mundo marchemos
al Comunismo meta final
pueblos del mundo unidos marchemos
al Comunismo meta final
Des Andes jusqu’aux mers
grondent les masses agitées
arborant le drapeau rouge
nous déclenchons la guerre populaire
Déployant les guérilleros
va florissant l’aube nouvelle
conquérant des bases de soutien
dispersant l’héroïsme
Le président Gonzalo
Chefature du parti et de la révolution
avec la pensée Gonzalo aujourd’hui nous avons
la réalité belliqueuse en action
cela fait dix ans de vigoureuse et victorieuse
et invincible Guerre Populaire
Démolissant les vieux murs
nous développons les bases d’appui
nous approchons de la conquête
du pouvoir total dans notre patrie
Les comités populaires ouverts
brillant au soleil
nous développons la guerre populaire
et construisons la conquête du pouvoir
Prolétaires du monde, marchons
au communisme but final
peuples du monde unis marchons
au but final du communisme
Canto De Mar Armado / Chant de l’océan armé
Grandes contiendas amasan la aurora
con plomo escribimos la nueva historia
cruzando los mares la tierra temblando
asaltando cielos abrimos la aurora
asaltando cielos abrimos la aurora
Invictas legiones guiadas por Gonzalo
dirige vanguardia militarizada
retando a la muerte avance incontenible
con rojas banderas marchando al futuro
con rojas banderas marchando al futuro
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Nos sustentamos en el latido
inagotable de rebelión
Hermoso canto de mar armado
se siente real hasta ser revolución
Hermoso canto de mar armado
se siente real hasta ser revolución
En la tierra ya florecen rosas rojas del Nuevo Poder
de la Guerra Popular amanece el Nuevo Poder
Hermoso canto de mar armado
se siente real hasta ser revolución
Hermoso canto de mar armado
se siente real hasta ser revolución
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Vanguardia combatiente crisol acero puro
dirigiendo a las masas conquistando el poder
Vanguardia combatiente crisol acero puro
dirigiendo a las masas conquistando el poder
Florecen baluartes con cuerdas engarzadas
guiando ante el mundo el nuevo amanecer
nosotros tenemos pensamiento Gonzalo
y en el alma fusiles de ahí sale el poder
se asienta en las balas de ahí sale el poder
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Marchamos en ardorosa y victoriosa Guerra Popular
Les grandes conflits amassent l’aube
avec le plomb nous écrivons la nouvelle histoire
traversant les mers, la terre tremblante
prenant d’assaut le ciel nous ouvrons l’aube
prenant d’assaut le ciel nous ouvrons l’aube
Invaincues légions guidées par Gonzalo
dirige l’avant-garde militarisée
défiant la mort avancée irrépressible
avec des drapeaux rouges marchant vers l’avenir
avec des drapeaux rouges marchant vers l’avenir
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Nous nous alimentons dans les battements de cœur
inépuisables de la rébellion
Beau chant de l’océan armé
qui se sent réel jusqu’à ce qu’il devienne révolution
Beau chant de l’océan armé
qui se sent réel jusqu’à ce qu’il devienne révolution
En la terre fleurissent les roses rouges du Nouveau Pouvoir
de la guerre populaire se lève le jour, le Nouveau Pouvoir
Beau chant de l’océan armé
qui se sent réel jusqu’à ce qu’il devienne révolution
Beau chant de l’océan armé
qui se sent réel jusqu’à ce qu’il devienne révolution
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Avant-garde combattante, creuset d’acier pur
Dirigeant les masses conquérant le pouvoir
Avant-garde combattante, creuset d’acier pur
Dirigeant les masses conquérant le pouvoir
Fleurissent des bastions avec des cordes enfilées
guidant devant le monde la nouvelle aube
nous autres avons la pensée Gonzalo
et dans l’âme des fusils de là vient le pouvoir
il est assis sur des balles de là vient le pouvoir
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Nous marchons dans une ardente et victorieuse Guerre Populaire
Marcha Triunfal / Marche triomphale
Nacen tiempos de guerra
incendiando el campo y la ciudad
miles de hombres en armas
con el Partido marchan a triunfar
con el maoísmo, la luz universal
desarrollamos la Guerra Popular
Bases de apoyo cual perlas engarzadas
embelleciendo de rojo el cielo está
el pensamiento Gonzalo ilumina el nuevo estado
se expande más
Conquistar el poder total en nuestra patria
para el Partido de la clase y nuestro pueblo
sirviendo a la revolución mundial
Conquistar el poder total en nuestra patria
para el Partido de la clase y nuestro pueblo
sirviendo a la revolución mundial
Guerra de movimientos
desarrollando y potenciando más y más
firmes en los principios
resistiendo en nuestro centro es combatir
Del cañón del fusil nace el Poder
de la Guerra Popular Nuevo Poder
como las flores del campo en primavera
van flameando miles de banderas rojas
Comités populares abiertos
van anunciando y nos convocan
conquistar el poder total en nuestra patria
para el Partido de la clase y nuestro pueblo
sirviendo a la revolución mundial
Conquistar el poder total en nuestra patria
para el Partido de la clase y nuestro pueblo
sirviendo a la revolución mundial
en marcha triunfal
revolución mundial
Naissent des temps de guerre
embrasant les campagnes et les villes
des milliers d’hommes en armes
avec le Parti, marchant pour triompher
avec le maoïsme, la lumière universelle
nous développons la Guerre Populaire
Bases d’appui comme des perles enfilées
embelli de rouge le ciel est
la pensée Gonzalo illumine le nouvel État
qui s’étend davantage
Conquérir le pouvoir total dans notre patrie
pour le Parti de la classe et notre peuple
servant la révolution mondiale
Conquérir le pouvoir total dans notre patrie
pour le Parti de la classe et notre peuple
servant la révolution mondiale
Les guerres de mouvements
en se développant et en se renforçant de plus en plus
fermes sur les principes
résistant dans notre centre c’est combattre
Du bout du fusil naît le Pouvoir
de la Guerre Populaire le Nouveau Pouvoir
comme les fleurs des champs au printemps
vont flottant au cent des milliers de drapeaux rouges
Les comités populaires ouverts
vont annonçant et nous convoquant
conquérir le pouvoir total dans notre patrie
pour le Parti de la classe et notre peuple
servant la révolution mondiale
Conquérir le pouvoir total dans notre patrie
pour le Parti de la classe et notre peuple
servant la révolution mondiale
en marche triomphale
la révolution mondiale
A Las Masas / Aux masses
Las masas con sus infatigables
y fuertes manos crean el nuevo estado
que brilla desafiante al sol
las masas hacen la Guerra Popular
y nutren al Partido y a nuestro
ejército de nuevo tipo
De sus entrañas sale todo
su hambre y su sangre
se ha enardecido con el maoísmo
proletariado y nuestro pueblo
manos armadas han generado Nuevo Poder
En su acción su meta él impulsa
combate indesmayable
al vil imperialismo en lucha tenaz
e implacable contra el revisionismo
y la reacción mundial
imponiendo la luz del maoísmo
Viva el Presidente Gonzalo
gloria al marxismo-leninismo-maoísmo
viva el Partido Comunista
honor y gloria al proletariado
y a nuestro pueblo del Perú
Viva el Presidente Gonzalo
gloria al marxismo-leninismo-maoísmo
viva el Partido Comunista
honor y gloria al proletariado
y a nuestro pueblo del Perú
Les masses, avec leurs infatigables
et fortes mais créent le nouvel État
qui brille avec défi au soleil
les masses font la guerre du peuple
et nourrissent le Parti et notre
armée d’un nouveau type
De leurs entrailles sortent toute
leur faim et leur sang
elles ont été enhardis par le maoïsme
le prolétariat et notre peuple
les mains armées ont généré le Nouveau Pouvoir
Dans son action, son but il impulse
il combat indéfectiblement
le vil impérialisme dans une lutte tenace
et implacable contre le révisionnisme
et la réaction mondiale
en imposant la lumière du maoïsme
Vive le président Gonzalo
gloire au marxisme-léninisme-maoïsme
Vive le Parti Communiste
honneur et gloire au prolétariat
et à notre peuple du Pérou
Vive le président Gonzalo
gloire au marxisme-léninisme-maoïsme
Vive le Parti Communiste
honneur et gloire au prolétariat
et à notre peuple du Pérou
Labor De Titanes / Travail des titan
La clase insurgió
rompiendo el silencio en la historia irrumpió
grandes epopeyas labor de titanes
poderosa ideología insurgió
grandes epopeyas labor de titanes
poderosa ideología insurgió
Tercera nueva y superior etapa
es el maoísmo nuestra concepción
la inmarcesible que se impone
brillando en la tierra con furor
Aplicación creadora y luminosa
pensamiento Gonzalo en el Perú
conquistando el poder en nuestra patria
sirviendo a la revolución mundial
conquistando el poder en nuestra patria
sirviendo a la revolución mundial
Inagotable fuente es nuestro pueblo
donde surgen legiones de hierro
soldados de Gonzalo henchidos de combate
desarrollando Guerra Popular
soldados de Gonzalo henchidos de combate
desarrollando Guerra Popular
Masas ardientes
barren tres montañas
vanguardia obrera militarizada
desarrollando bases resueltos avanzamos
el Comunismo en la Tierra brillará
desarrollando bases con reto a la muerte
el Comunismo en la Tierra brillará
La classe insurgée
rompt le silence de l’histoire a fait irruption
grandes épopées travail de titans
la puissante idéologie s’insurge
grandes épopées travail de titans
la puissante idéologie s’insurge
Troisième nouvelle et plus élevée étape
C’est le maoïsme notre conception
celle immarcescible qui s’impose
brillant sur la terre avec fureur
Application créative et lumineuse
la pensée Gonzalo au Pérou
conquérant le pouvoir dans notre patrie
servant la révolution mondiale
conquérant le pouvoir dans notre patrie
servant la révolution mondiale
Inépuisable source est notre peuple
où surgissent des légions de fer
les soldats de Gonzalo riches de combat
développant la guerre du peuple
les soldats de Gonzalo riches de combat
développant la guerre du peuple
Des masses ardentes
balaient trois montagnes
l’avant-garde ouvrière militarisée
développant des bases résolus nous avançons
Le communisme sur terre briller
développant des bases avec défi face à la mort
Le communisme sur terre brillera
Torrente Rojo / Torrent rouge
El latido inagotable de la historia
hacedora de luminoso amanecer
enarbolando banderas rojas en rebelión
florece de los Andes hasta el mar
Con el maoísmo marcha la clase al Comunismo
y con Partido de nuevo tipo su dirección
se abre paso en la tormenta con el fusil
desarrollando Guerra Popular.
Con la luz universal de Gonzalo se forjó
y ya construye la conquista del poder en el Perú
construyendo en el fragor de la Guerra Popular
el ejército rojo se plasmó
para la acción
Marchan milladas de legiones de hierro
cumplen tareas que asigna el Partido
escribiendo en páginas de acero
la nueva historia con heroicidad
Somos forjados con reto a la muerte
marchando firmes en llama esparciente
transformaremos la guerra de guerrillas
en poderosa guerra de movimientos
Con el maoísmo marcha la clase al Comunismo
y con Partido de nuevo tipo su dirección
se abre paso en las tormentas con el fusil
desarrollando Guerra Popular
desarrollando Guerra Popular
Con los fusiles entramos a triunfar
¡¡¡Viva el Ejército Guerrillero Popular!!!
L’inépuisable battement de cœur de l’histoire
faiseuse d’une lumineuse aube
arborant les drapeaux rouges de la rébellion
leurit des Andes à la mer
Avec le maoïsme la classe marche au Communisme
et avec un Parti d’un nouveau type sa direction
se fraie un chemin à travers la tempête avec le fusil
développant la Guerre Populaire
Avec la lumière universelle de Gonzalo se forge
et se construit la conquête du pouvoir au Pérou
construisant dans le fracas de la Guerre Populaire
l’armée rouge s’est incarnée
pour l’action
Marchent des milliers de légions de fer
qui accomplissent les tâches confiées par le Parti
écrivant en des pages d’acier
la nouvelle histoire avec héroïsme
Nous sommes forgés au mépris de la mort
nous marchons fermement en propageant la flamme
nous transformerons la guerre de guérilla
en une puissante guerre de mouvements
Avec le maoïsme la classe marche au Communisme
et avec un Parti d’un nouveau type sa direction
se fraie un chemin à travers la tempête avec le fusil
développant la Guerre Populaire
développant la Guerre Populaire
Avec les fusils nous entrons dans le triomphe
Longue vie à l’Armée de guérilla populaire !!!!
Sembrando El Fuego / Semant le feu
El pueblo manantial inagotable
donde brotan heroicos combatientes
recio temple, pasión ardiente
nos forjamos en la revolución
Poderosa ideología nos alumbra
como un faro que encamina nuestra acción
levantando la tormenta
arrasamos con toda la opresión
Es Gonzalo quien demanda a dar la vida
por el Partido y la revolución
incontenibles avanzamos
arrinconando a la hiena en su cubil.
Es Gonzalo que demanda a dar la vida
por el Partido y la revolución
asumimos el compromiso
potenciando la Guerra Popular
Mar de masas, mar embravecido
que a su paso va sembrando el fuego
con vanguardia heroico combatiente
va conquistando el Poder
Desarrollando las bases de apoyo
la perspectiva brillante abierta está
la garantía de todos los triunfos
el Presidente Gonzalo
Desarrollando las bases de apoyo
la perspectiva brillante abierta está
la garantía de todos los triunfos
el Presidente Gonzalo
el Presidente Gonzalo
Le peuple une source inépuisable
d’où jaillissent d’héroïques combattants
robuste trempe passion ardente
nous sommes forgés dans la révolution
Une idéologie puissante nous éclaire
comme un phare qui oriente notre action
en soulevant la tempête
nous balayons toute l’oppression
C’est Gonzalo qui exige de donner sa vie
pour le Parti et la révolution
irrépressibles nous avançons
acculant la hyène dans sa tanière
C’est Gonzalo qui exige de donner sa vie
pour le Parti et la révolution
nous assumons l’engagement
renforçant la Guerre Populaire
Mer des masses mer déchaînée
qui sur son passage sème le feu
avec l’avant-garde héroïque des combattants
va conquérant le Pouvoir
Développant les bases d’appui
la perspective lumineuse est ouverte
la garantie de tous les triomphes
le Président Gonzalo
Développant les bases d’appui
la perspective lumineuse est ouverte
la garantie de tous les triomphes
le Président Gonzalo
le Président Gonzalo
Rumbo Al Comunismo / Cap sur le Communisme
Militantes del glorioso Partido Comunista
que forjados en la fragua de la revolución
con mente clara y voluntad resuelta
pasión inextinguible al Comunismo va
Enarbolar, enarbolar, defender, defender
y aplicar el maoísmo universal
enarbolar, enarbolar, defender y aplicar
pensamiento gonzalo en el Perú
Militantes de la heroica vanguardia proletaria
van rompiendo las cadenas de oprobio y opresión
con entrega total a nuestra causa
ofrendan hoy sus vidas con heroicidad
Enarbolar enarbolar defender defender
y aplicar el maoísmo universal
enarbolar enarbolar defender y aplicar
pensamiento Gonzalo en el Perú
Militantes
¡¡¡Marchamos rumbo al Comunismo!!!
Militants du glorieux Parti communiste
qui ont forgé dans le fracas de la révolution
avec un esprit clair et une volonté résolue
la passion inextinguible pour le Communisme
Arborer, arborer, défendre, défendre, défendre
et appliquer le maoïsme universel
arborer, arborer, défendre, défendre, et appliquer
la pensée Gonzalo au Pérou
Les militants de l’héroïque avant-garde prolétarienne
brisent les chaînes de l’opprobre et de l’oppression
avec un dévouement total à notre cause
offrant aujourd’hui leur vie avec héroïsme
Arborer arborer défendre défendre défendre
et appliquer le maoïsme universel
arbore arborer défendre défendre et appliquer
la pensée de Gonzalo au Pérou
Militants
Nous marchons vers le communisme !
Científica Luz / Lumière scientifique
Grandiosa ideología poderosa
punto vital de inmensa trascendencia
grandiosa ideología poderosa
punto vital de inmensa trascendencia
Científica luz de la clase
que nos arma hasta el Comunismo
científica luz de la clase
garantía hasta el Comunismo
garantía hasta el Comunismo
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Las grandes cumbres del proletariado
al marxismo han desarrollado
deviniendo en marxismo-leninismo
hoy en día maoísmo lo más alto
enarbolando, defendiendo y aplicando
el maoísmo como mando y guía
el maoísmo como mando y guía
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Nuestra revolución
con Partido Comunista
invencible Guerra Popular
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Viva el pensamiento Gonzalo
aplicación creadora de la verdad universal
Nuestra revolución
con Partido Comunista
invencible Guerra Popular
invencible Guerra Popular
Grande idéologie puissante
point vital d’une immense transcendance
grandiose idéologie puissante
point vital d’une immense transcendance
Scientifique lumière de la classe
qui nous arme jusqu’au Communisme
Scientifique lumière de la classe
garantie jusqu’au communisme
garantie jusqu’au communisme
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Les grands sommets du prolétariat
le marxisme s’est développé
en devenant le marxisme-léninisme
aujourd’hui le maoïsme au plus haut niveau
arborer, défendre et appliquer
le maoïsme comme commandement et guide
le maoïsme comme commandement et guide
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Notre révolution
avec le Parti communiste
invincible Guerre Populaire
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Vive la pensée Gonzalo
application créative de la vérité universelle
Notre révolution
avec le Parti communiste
invincible Guerre Populaire
invincible Guerre Populaire
Gloria A Los Héroes / Gloire aux héros
Tiempos de guerra viva Gonzalo
y la progenie de los hombres nuevos
que va sembrando que va alumbrando
en nuestra patria un grito de guerra
el 19 junio estalló
en nuestra patria un grito de guerra
el 19 junio estalló
Los prisioneros soldados rojos
en luminosas trincheras combaten
el genocidio de la reacción
el Frontón Lurigancho el Callao
al mundo entero estremeció
el Frontón Lurigancho el Callao
al mundo entero estremeció
Gloriosa muerte
héroes del pueblo
grito de guerra
luminoso ejemplo
como estandartes que anuncian victorias
hoy nuevas cumbres remontando estamos
que en nuestro pecho se agita ardiente
hoy nuevas cumbres remontando estamos
viva Gonzalo gloria a los héroes
viva Gonzalo viva el Comunismo
viva Gonzalo viva el Comunismo
(Luminosa Trinchera de Combate
Cantogrande)
Les temps de la guerre vive Gonzalo
et la progéniture des hommes nouveaux
qui va semant qui va éclairant
dans notre patrie un cri de guerre
le 19 juin a éclaté
dans notre patrie un cri de guerre
le 19 juin a éclaté
Les prisonniers les soldats rouges
dans de lumineuses tranchées combattent
le génocide de la réaction
el Frontón Lurigancho el Callao
le monde entier a été ébranlé
el Frontón Lurigancho el Callao
le monde entier a été ébranlé
Glorieuse mort
héros du peuple
cri de guerre
lumineux exemple
comme des bannières annonçant des victoires
aujourd’hui de nouveaux sommets nous gravissons
qui dans nos poitrines cela s’agite avec ardeur
aujourd’hui de nouveaux sommets nous gravissons
vive Gonzalo gloire aux héros
vive Gonzalo vive le Communisme
vive Gonzalo vive le Communisme
(Lumineuse Tranchée de Combat Cantogrande)
Por El Este Nace El Sol / Le soleil se lève à l’Est
Por las mañanas miro en el este
nace el sol nace el sol
es un sol rojo
el maoísmo
en mi corazón en mi corazón
Por las mañanas miro en el este
nace el sol nace el sol
es un sol rojo
el maoísmo
en mi corazón en mi corazón
Les matins je regarde vers l’est
se lève le soleil se lève le soleil
c’est un soleil rouge
le maoïsme
dans mon cœur dans mon cœur
Les matins je regarde vers l’est
se lève le soleil se lève le soleil
c’est un soleil rouge
le maoïsme
dans mon cœur dans mon cœur