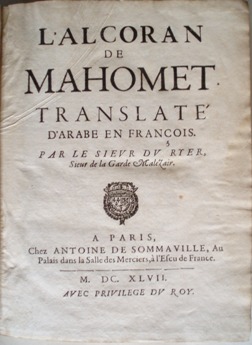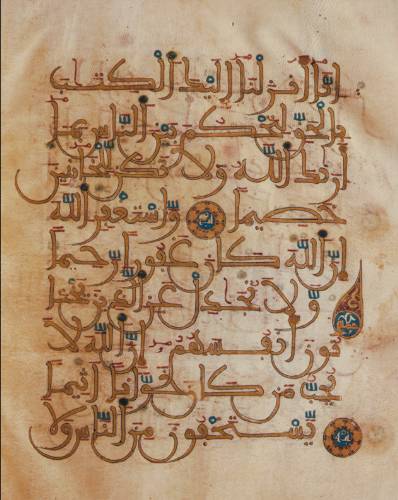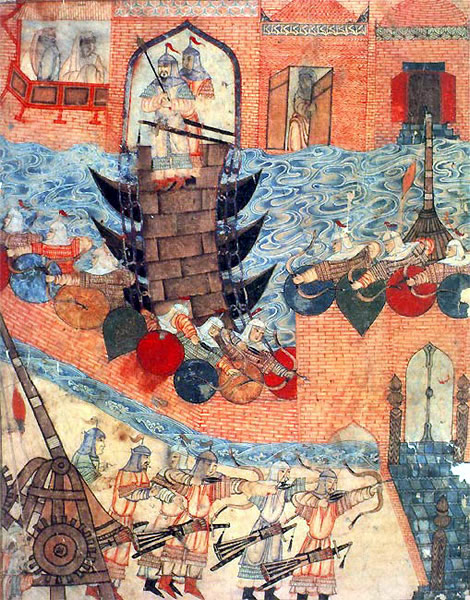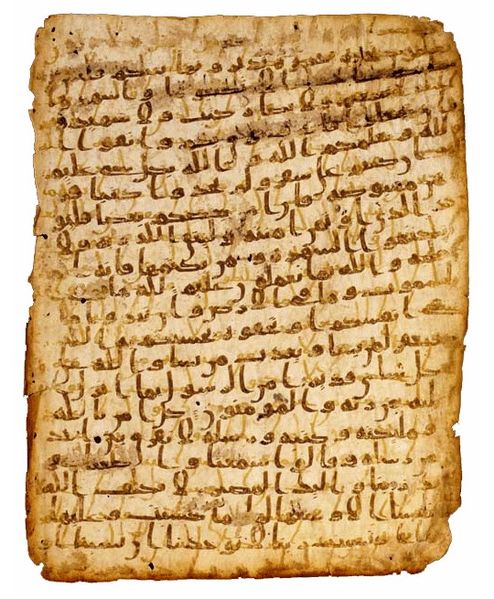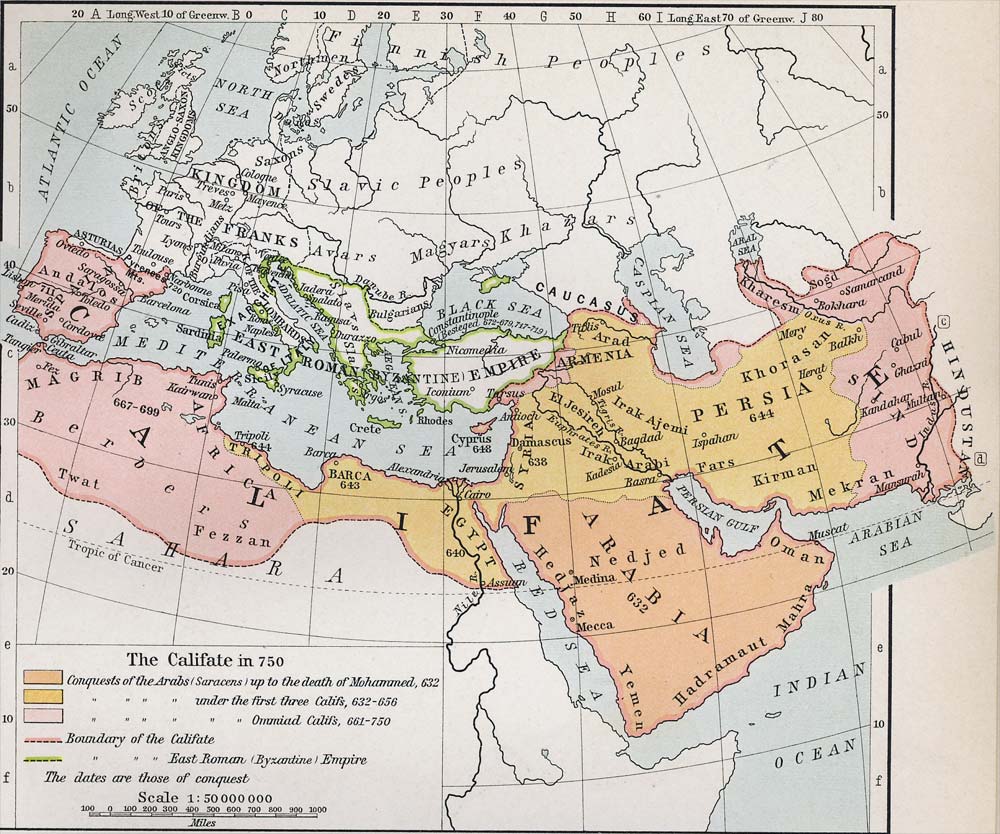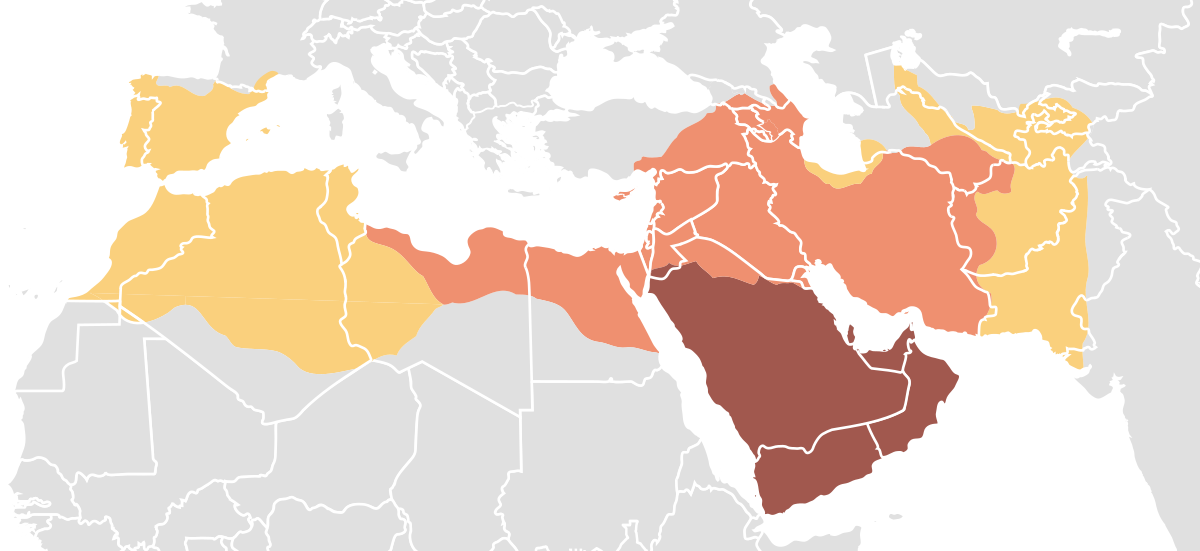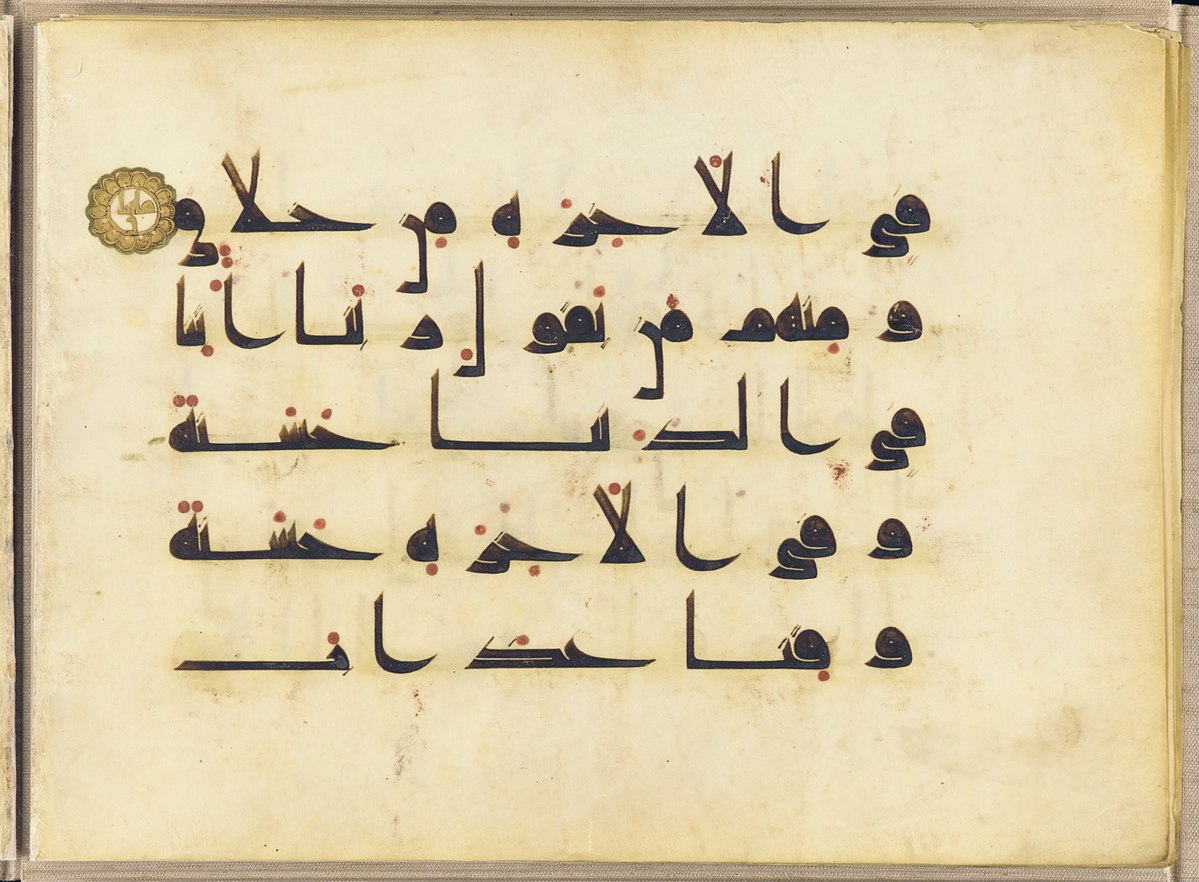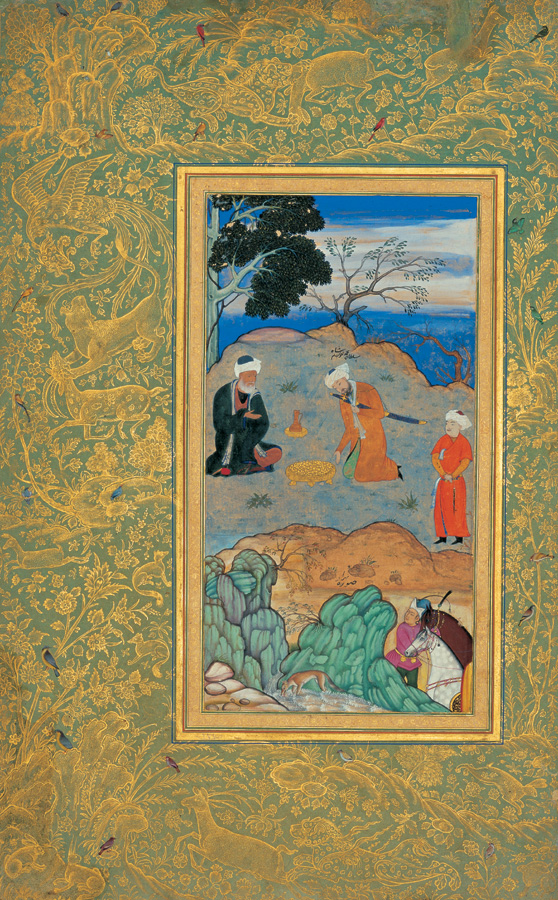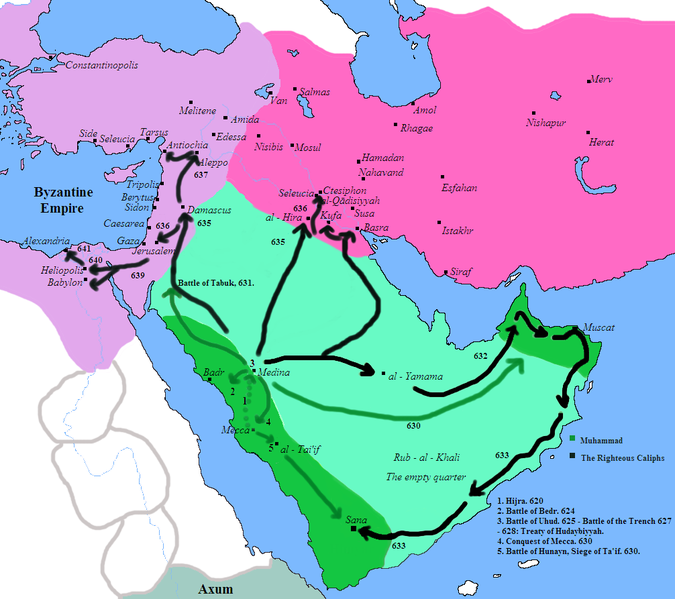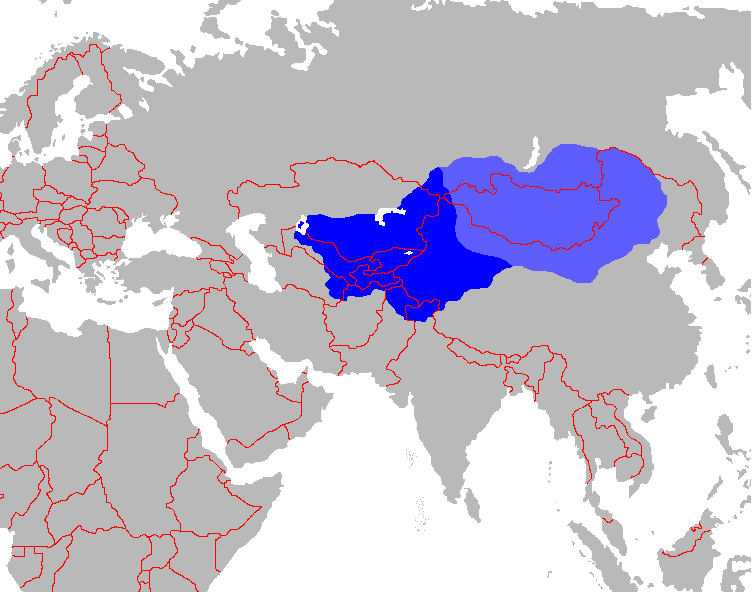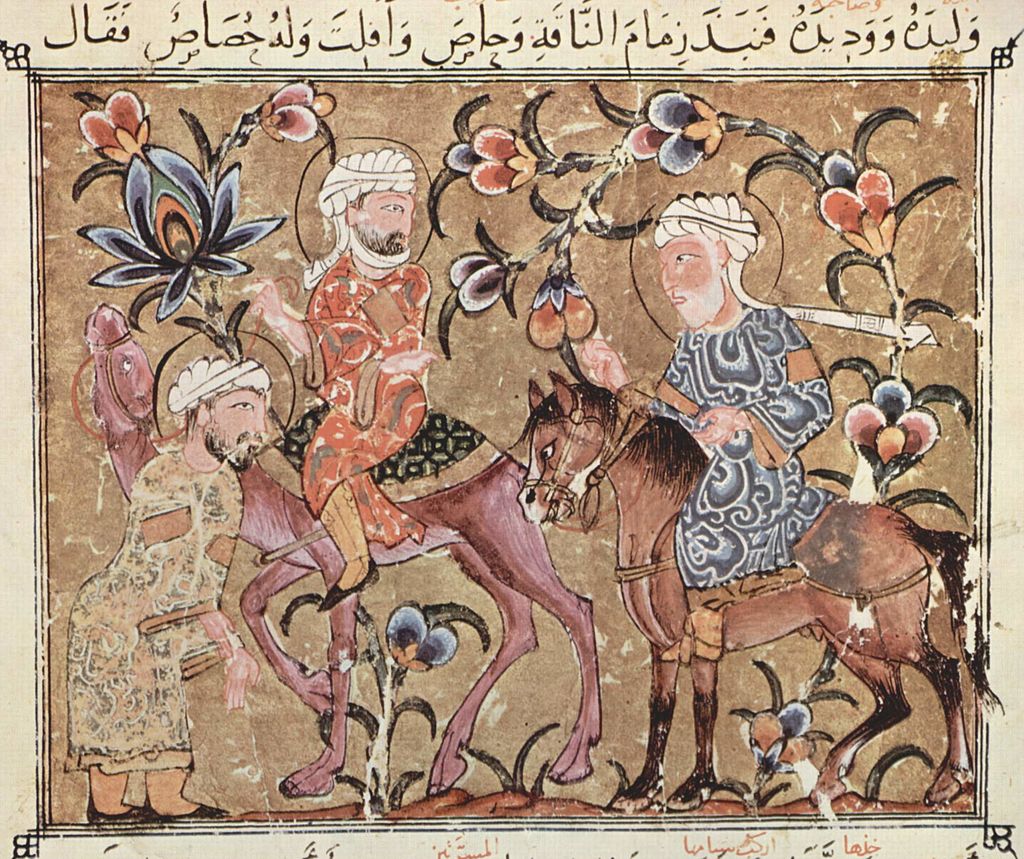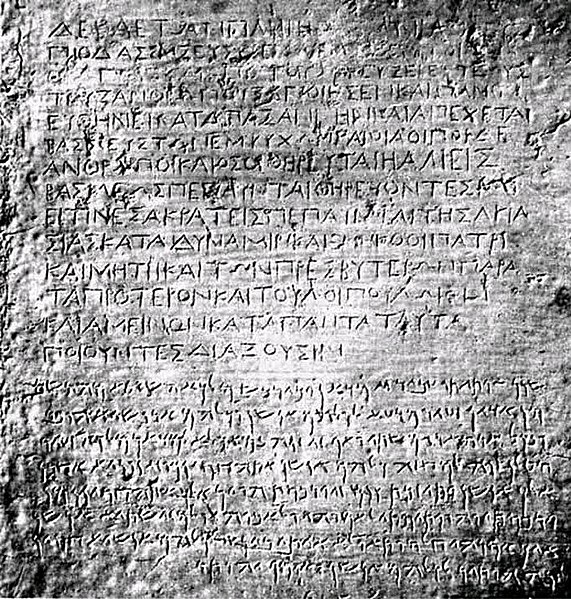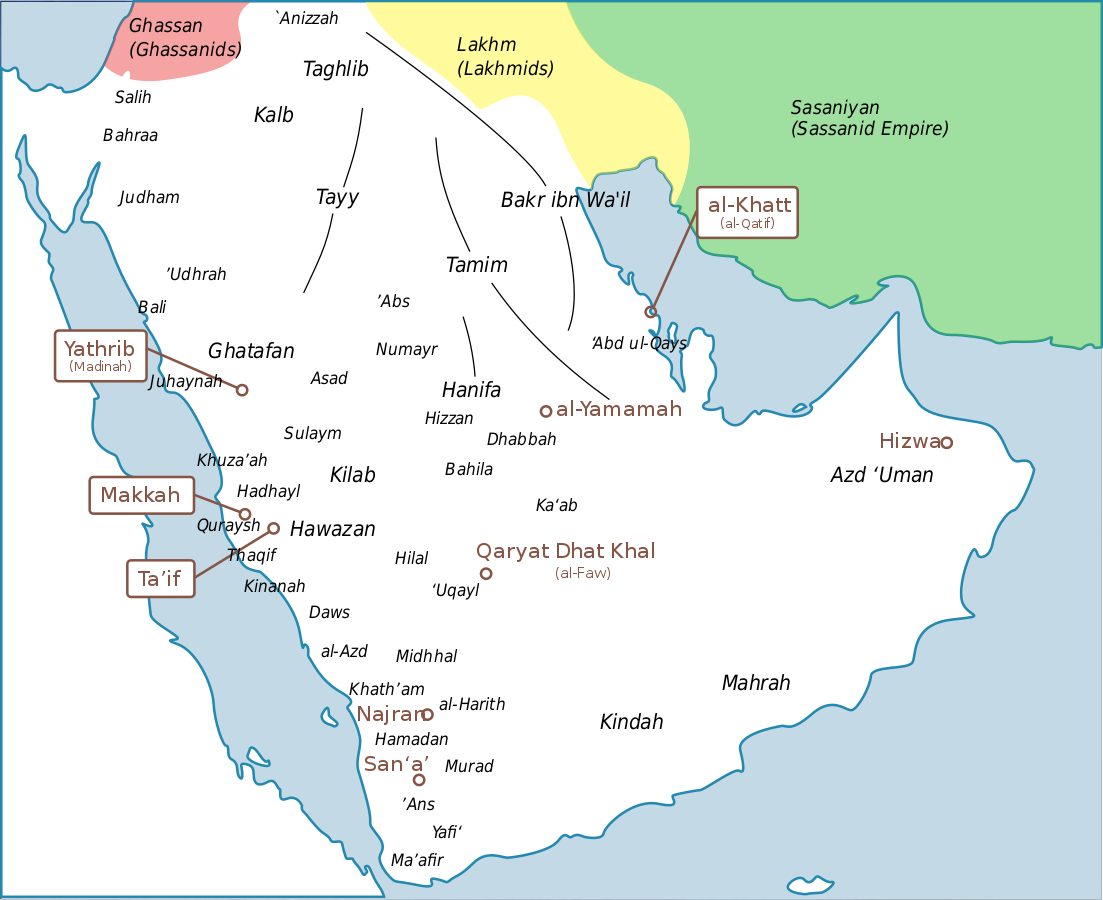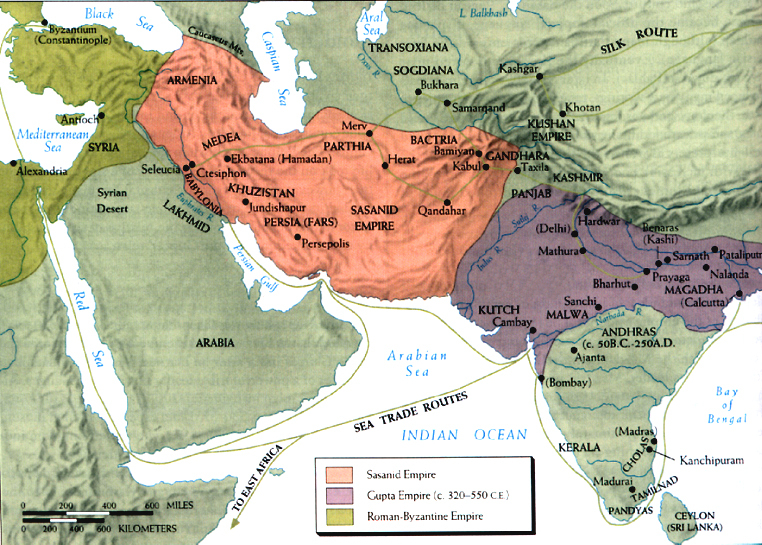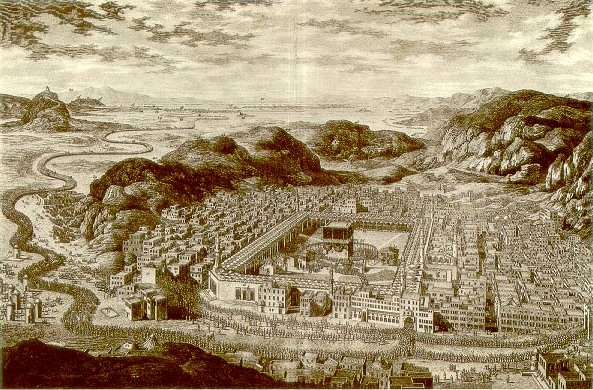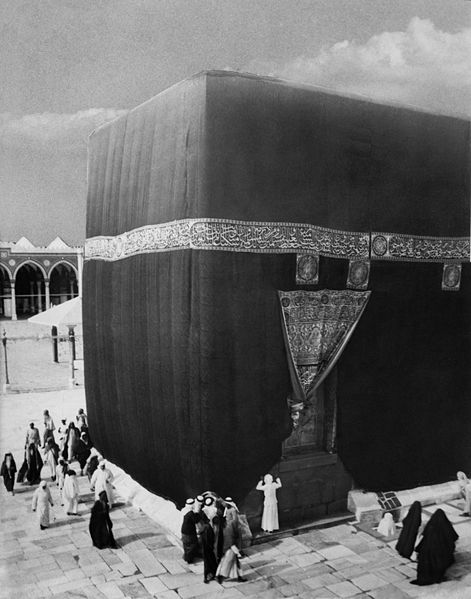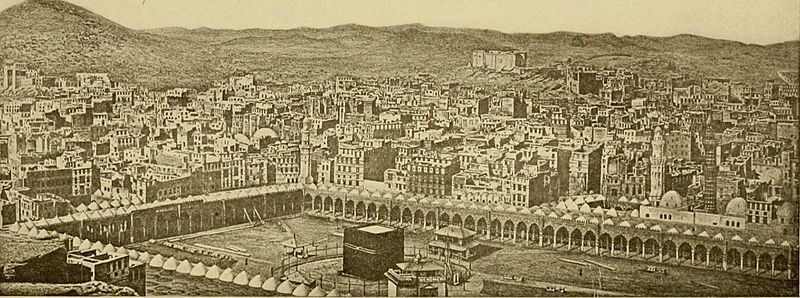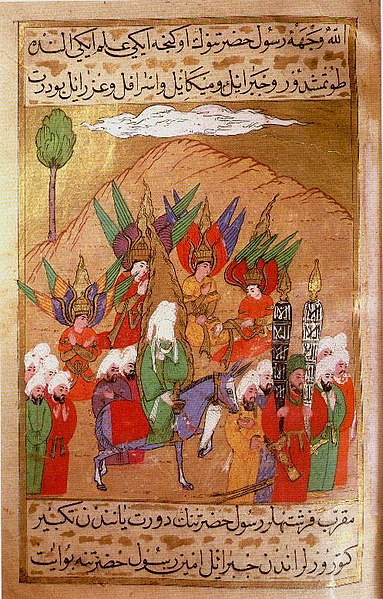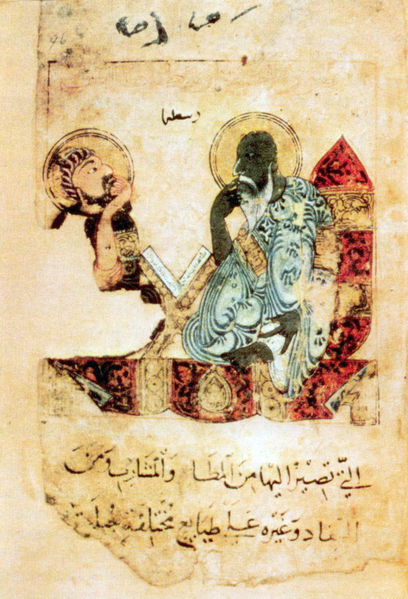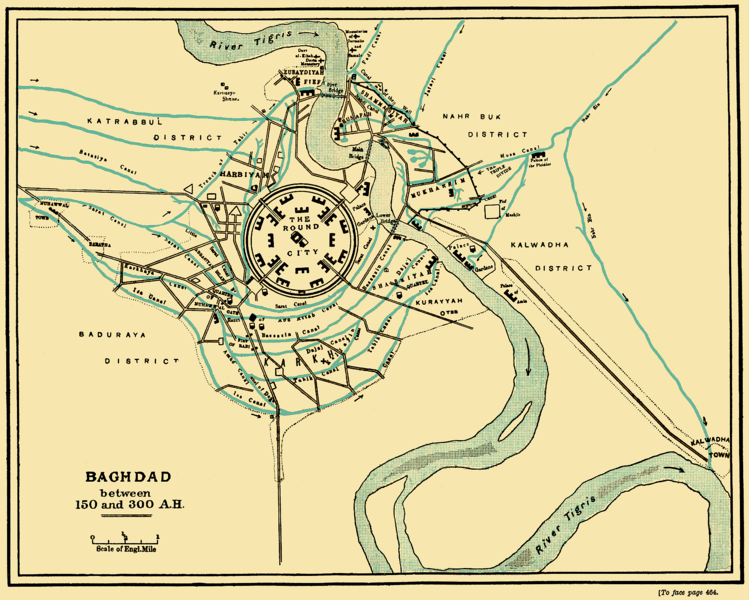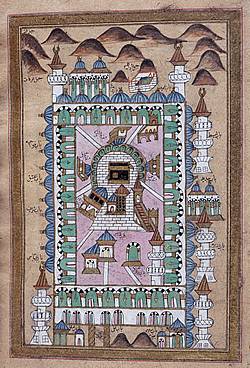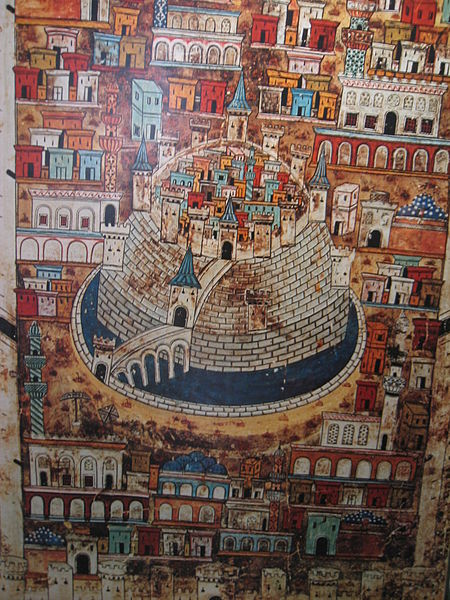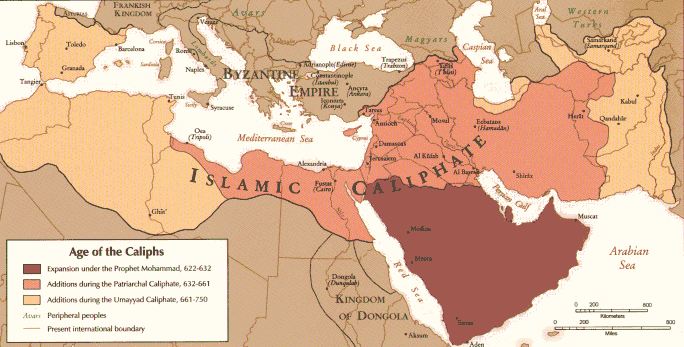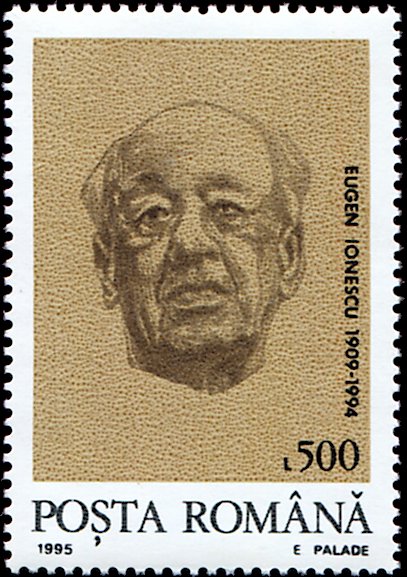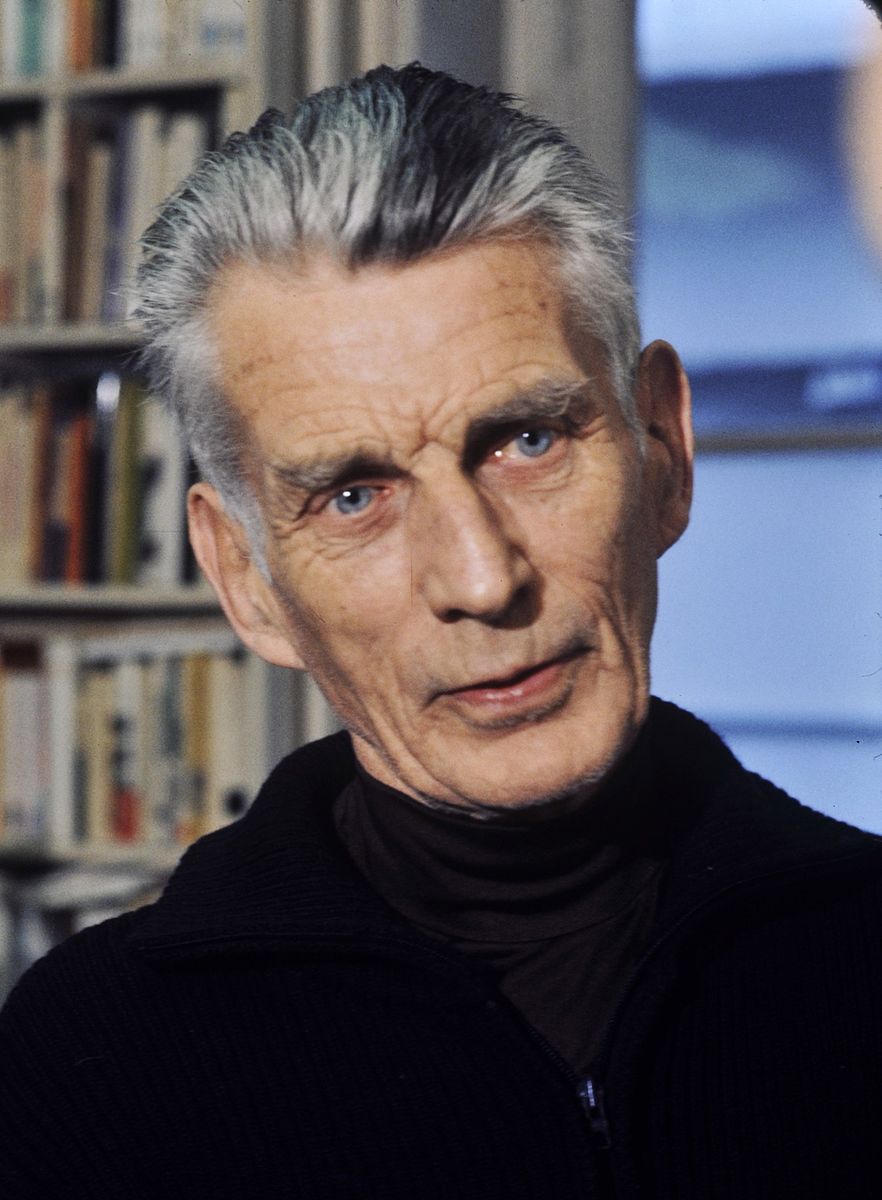Nous voulons ici rendre plus clair le rapport entre la notion de Parti et la question de l’engagement subjectif dans une métropole impérialiste. Nous ne raisonnons en effet pas du tout selon le principe de « l’adhésion », de la carte de membre, de la cotisation, etc.
Cela ne veut pas dire que nous n’assimilons pas les gens qui viennent chez nous, qu’ils ne s’intègrent pas selon des principes, des règles, avec des droits et des devoirs, dans le cadre d’une démocratie centralisée.
Ce que nous voulons dire ici, c’est qu’il y a un processus de reconnaissance naturelle entre notre organisation et les gens se reconnaissant en notre démarche. Nous fonctionnons en termes de longueur d’ondes, pour ainsi dire : il y a un principe d’unité qui tombe sous le sens entre les gens décidant de choisir de rompre avec les valeurs dominantes et d’aller dans le sens du communisme.
Nous ne demandons pas de comprendre parfaitement tel ou tel point idéologique ; ce qui compte c’est d’être en mesure de le comprendre et pour cela il faut être porté par une certaine rébellion dans les métropoles impérialistes.
Nous ne sommes pas une association, ni un syndicat ; nous ne sommes pas un regroupement programmatique de gens « raisonnables » s’étant tourné vers certains « principes ». Ce qui compte, c’est la dignité du réel, d’être porté par un mouvement historique résolument tourné vers le futur, en portant le principe de la transformation, de la collectivité.
Le caractère erroné du regroupement fermé sur lui-même et ne visant qu’à recruter
Il est une erreur connue qui a été faite dans les années 1960-1970 en France.
Face au Parti « Communiste » Français passé dans le camp du capitalisme suite au triomphe des positions révisionnistes, il y a eu des tentatives de reconstruire le Parti. Cependant, ces tentatives ont été formelles. Des gens ont établi un programme, le plus souvent en reprenant ce qui avait été fait dans le passé, puis ont mis en place quelques points théoriques, afin de se distinguer de ce qui n’allait pas à leurs yeux.
C’est une approche erronée, car elle n’est pas portée par la dignité du réel, mais par un esprit de « correction ». Le résultat bien connu est que ces gens ont cherché à recruter d’autres personnes autour de la base formée.
Ensuite, les gens recrutés devaient faire ceci ou faire cela, selon les exigences de l’organisation qu’ils avaient rejointe, chaque organisation se distinguant par un certain style, un certain état d’esprit, une certaine culture. Dans les années 1970, un homme à Lutte Ouvrière ne pouvait pas porter de boucle d’oreille pour ne pas « choquer », alors qu’une femme à la Ligue Communiste Révolutionnaire devait avoir des mœurs « libres ».
Dans tous les cas, les gens adhéraient à une organisation, car ils en appréciaient tel ou tel point, mais on ne prenait pas en compte leur personnalité, leur propre parcours. Ils étaient pris pour être façonnés dans un certain moule et obéir aux directives.
Soit le moule leur plaisait suffisamment et ils restaient un certain temps, soit somme toute cela n’allait rapidement pas et ils partaient d’autant plus vite. Les organisations construites de telle manière connaissaient un intense va-et-vient.
Pourquoi les gens ne restaient pas, de toutes façons ? Car on ne prenait pas en considération leur richesse intérieure, ce qu’ils avaient à dire, à apporter. Un exemple vraiment flagrant est la Gauche Prolétarienne. Il est bien connu qu’après sa dissolution au début des années 1970, de nombreux membres ont eu une carrière significative en tant qu’expert musical, journaliste, intellectuel, philosophe, dans la radio, etc.
C’est là l’expression d’un opportunisme individuel, mais également d’une incapacité de la Gauche Prolétarienne à s’appuyer sur la richesse de ses membres. Forcés à être comme ci ou comme ça, les gens ressentent une certaine frustration et, à un moment, partent.
Cela ne signifie nullement qu’il faille accepter tous les subjectivismes – mais cela veut dire que si on ne comprend pas la subjectivité des gens, on ne peut pas les intégrer correctement et avoir une véritable organisation révolutionnaire.
Le recrutement comme fin en soi
Il est bien connu que les Témoins de Jéhovah ou bien l’Église de la scientologie forment des « contre-mondes » séparés de la société et que le recrutement missionnaire est considéré comme vital pour alimenter un tel « contre-monde ».
Cette approche a été similaire à beaucoup d’organisations des années 1960, provoquant en retour une vague d’anarchisme et de pseudo-spontanéisme, dont l’expression la plus célèbre est De la misère en milieu étudiant.
Les anarchistes, spontanéistes proposaient une réponse totalement erronée à un vrai problème. En effet, des regroupements entièrement tournés vers eux-mêmes sont déconnectés de toute vie sociale et culturelle. Les mentalités deviennent bornées, la vie de l’esprit se tarit, la déconnexion avec la réalité devient toujours plus marquée.
Les gens recrutés avaient comme mission d’en recruter d’autres, qui eux-mêmes devaient en recruter d’autres. La société n’était plus analysée, ni le pays ; l’organisation fonctionnait en cercle fermé, avec comme but de recruter pour elle-même, sans faire attention à rien d’autre.
Le pragmatisme était général ; tous les moyens étaient considérés comme bons. Une technique classique était d’envoyer des gens dans une autre organisation et, au bout de quelques mois, de les faire annoncer qu’en réalité ils s’étaient trompés, que l’autre organisation était en fait la bonne.
Les anarchistes, spontanéistes… ont affirmé que c’était inévitable au principe d’organisation et que, par conséquent, il fallait le supprimer. C’est là une réponse petite-bourgeoise à un travers petit-bourgeois.
Ce n’est en effet pas la question de l’organisation qui est en jeu, mais celui de la rupture. Qui a rompu avec les valeurs dominantes cherche, forcément, à retrouver des gens comme lui. Le recrutement comme fin en soi est une caricature de ce processus.
Aussi ne fallait-il pas dire que l’organisation est un principe mauvais en soi, mais : qui recrute-t-on ? Pourquoi ? Sur quelle base ?
La seule base : la rupture subjective
La question de l’engagement subjectif a été compris de manière progressive dans le mouvement communiste. Ce n’est pas apparent chez Lénine, aussi y a-t-il eu beaucoup d’erreurs dans l’interprétation de son activité.
Il est bien connu qu’il y a chez beaucoup de gens une lecture machiavélique de Lénine. Ce dernier aurait formé un cercle qu’il aurait « militarisé » pour être plus opérationnel en terme militant, formant une sorte de mini-armée prête au coup de force.
Cette lecture de la perspective de Lénine est totalement anti-léniniste. Elle fait de Lénine une sorte de calculateur pragmatique, prêt à tout du moment que cela marche et ce sur la base d’une organisation de petits soldats agissant au doigt et à l’œil selon les besoins pratiques.
Beaucoup de gens dans les années 1920 ont vraiment cru, en Europe de l’Ouest, que c’était cela le « bolchevisme ». Ne connaissant pas le matérialisme dialectique, ils n’ont rien compris de la démarche idéologique de Lénine ; partant de là ils pouvaient encore moins comprendre Staline, qui a souligné avec le marxisme-léninisme la nécessité d’une démarche idéologique, la nécessité d’un engagement dans l’affrontement de classe.
C’est tout le sens de la liquidation violente des contre-révolutionnaires dans les années 1930. L’agent du NKVD, le commissaire politique, le travailleur de choc, le stakhanoviste était la pointe de l’engagement subjectif pour la cause communiste.
C’est également le sens de la diffusion de la pensée Mao Zedong en Chine populaire, où les communistes ont compris qu’il y avait un état d’esprit communiste propre à la situation d’un pays, que c’est cet état d’esprit, cette manière de voir et de sentir les choses qu’il fallait adopter et promouvoir. Le communisme, en Chine, était porté par Mao Zedong et la pensée Mao Zedong, c’est le marxisme-léninisme concrétisé en Chine.
C’est pour cette raison qu’au Pérou, l’idéologie du Parti Communiste n’a pas été défini abstraitement, mais correctement délimitée comme « marxisme-léninisme-maoïsme pensée Gonzalo, principalement pensée Gonzalo ».
Pourquoi cela ? Car il fallait quelqu’un pour concrétiser le matérialisme dialectique, pour porter la transformation.
Gonzalo a saisi la réalité du Pérou de manière matérialiste dialectique, parce qu’il était un révolutionnaire authentique, qui a assumé l’antagonisme, qui a compris ce qui devait se transformer.
De ce fait, tout révolutionnaire du Pérou considère nécessairement les choses comme lui, il retombe sur les mêmes vérités constatées par Gonzalo. Gonzalo a été le premier et il sert de repère.
Comme qui plus est Gonzalo a été à la pointe du regard matérialiste dialectique au Pérou, qu’il a ouvert des espaces, de nouvelles compréhensions, qu’il s’est forgé comme un dirigeant, cela implique que sa pensée sert de guide, car elle balise le chemin à suivre pour les révolutionnaires au Pérou.
Et lorsqu’il n’y a plus Gonzalo, ceux qui ont assumé sa direction prolonge son mouvement et approfondisse sa démarche, jusqu’à faire passer à une autre étape, exactement comme Staline a prolongé le mouvement de Lénine en URSS et comment Mao Zedong a approfondi la démarche de Lénine au point de vue universel, dans le contexte chinois.
La pensée guide n’est ainsi pas un « ajout » au matérialisme dialectique, ni une « interprétation » : c’est au contraire le matérialisme dialectique lui-même, dans une situation concrète, de manière pratique, car c’est la seule manière dont le matérialisme dialectique peut exister, de manière transformatrice.
D’où le mot d’ordre péruvien de « arborer, défendre et appliquer, principalement appliquer ». L’aspect principal est la l’application, la transformation, exactement comme la RAF se fondait sur le primat de la pratique.
Et cela passe par des grands dirigeants, qui affirment la transformation, qui la portent dans leur existence même.
Staline est ici un excellent exemple même d’une abnégation complète de son existence sachant assumer les différentes situations, depuis les braquages de banque jusqu’à la conduite de la construction du socialisme en URSS, puis la direction de la Grande guerre patriotique anti-nazie.
Voilà pourquoi il est tellement la cible de la propagande contre-révolutionnaire ; voilà pourquoi les dirigeants révolutionnaires en général sont la cible de la contre-révolution cherchant à les nier, en dire du mal, les agresser, les exterminer, etc., afin d’écraser ce qu’ils véhiculent.
Parti de cadres ou de militants ?
À l’arrière-plan de la question subjective concernant la définition de qui est communiste, on trouve la question des cadres et des militants. Le cœur de l’erreur des regroupements visant au recrutement comme fin en soi est qu’ils veulent des militants obéissant à des cadres.
Ce n’est pas là la vision correcte du rapport entre communistes. Il n’y a, au sens strict, pas de distinction entre cadres et militants dans une organisation communiste.
Bien entendu, il y a des éléments plus avancés, plus éprouvés, ayant des fonctions techniques, opératives, dirigeantes. Cependant, dans leur nature, ils ne sont pas différents des autres.
En effet, en pratique, tout le monde doit aller dans le sens d’être cadre. C’est un processus long, connaissant un développement inégal. Ce n’est pas un processus linéaire et une véritable organisation est capable de prendre les gens tels qu’ils sont et de les accompagner dans leur montée en puissance sur le long terme.
Staline note, avec une justesse caractéristique de sa part, cette question du facteur individuel (on devrait en fait dire : personnel),en 1937 dans son discours « Pour une formation bolchévik ».
« Enfin, encore une question. Je veux parler de l’attitude formaliste et sèchement bureaucratique de certains de nos communistes pour le sort de tels ou tels membres du Parti, pour les exclusions du Parti ou la réintégration des exclus dans leurs droits de membres du Parti.
La vérité est que certains de nos dirigeants du Parti pèchent par un manque d’attention pour les hommes, pour les membres du Parti, pour les militants. Bien plus, ils ne cherchent pas à connaître les membres du Parti, ils ne savent pas ce qui fait leur vie, ni comment ils progressent ; d’une façon générale, ils ne connaissent pas les militants.
C’est pourquoi, dans leur façon d’aborder les membres du Parti, les militants du Parti, ils ne tiennent pas compte du facteur individuel.
Et, justement parce qu’ils ne tiennent pas compte du facteur individuel en jugeant les membres du Parti et les militants du Parti, ils agissent habituellement au hasard : ou bien ils les vantent en bloc et sans mesure (…).
La plupart du temps, on exclut du Parti pour ce qu’on appelle la passivité. Qu’est-ce que la passivité ?
On considère, paraît-il, que si un membre du Parti ne s’est pas assimilé le programme du Parti, il est passif et doit être exclu.
Mais c’est faux, camarades. On ne peut pourtant pas interpréter de façon aussi pédantesque le statut de notre Parti. Pour s’assimiler le programme du Parti, il faut être un vrai marxiste, un marxiste éprouvé et possédant une formation théorique.
Je ne sais s’il se trouvera beaucoup de membres dans notre Parti, qui se soient déjà assimilé notre programme, qui soient devenus de vrais marxistes éprouvés et possédant une formation théorique. Si l’on continuait à marcher dans cette voie, il ne nous faudrait laisser dans le Parti que les intellectuels, et, en général, les hommes savants. Qui a besoin d’un tel Parti ?
Nous avons pour l’appartenance au Parti une formule léniniste vérifiée et qui a résisté à toutes les épreuves. Selon cette formule, est considéré comme membre du Parti celui qui reconnaît le programme du Parti, paie les cotisations et travaille dans une de ses organisations. Remarquez bien : la formule léniniste ne parle pas d’assimilation du programme, mais de reconnaissance du programme.
Ce sont deux choses absolument différentes. Inutile de démontrer qu’ici c’est Lénine qui a raison, et non pas nos camarades du Parti, qui bavardent inutilement d’assimilation du programme.
Et cela se conçoit.
Si le Parti partait du point de vue que, seuls, les camarades qui se sont assimilés le programme et sont devenus des marxistes théoriquement formés peuvent être membres du Parti, il ne créerait pas dans son sein des milliers de cercles communistes, des centaines d’écoles du Parti, où l’on enseigne le marxisme aux membres du Parti et où on les aide à s’assimiler notre programme.
Il est parfaitement clair que si le Parti organise ces écoles et ces cercles pour ses membres, c’est parce qu’il sait que les membres du Parti n’ont pas encore eu le temps de s’assimiler le programme du Parti, qu’ils n’ont pas encore eu le temps de devenir des marxistes ayant une formation théorique.
Ainsi donc, pour redresser notre politique dans la question de l’appartenance au Parti et des exclusions, il faut en finir avec cette façon stupide d’interpréter la question de la passivité. Mais nous péchons encore sur un autre point, dans ce domaine.
La vérité est que nos camarades ne reconnaissent pas de milieu entre les deux extrêmes. Il suffit qu’un ouvrier, membre du Parti, commette une faute légère, qu’il arrive en retard une ou deux fois à une réunion du Parti, qu’il ne paye pas pour une raison ou pour une autre sa cotisation, pour qu’aussitôt il soit chassé du Parti.
On ne cherche pas à établir le degré de sa culpabilité, le motif pour lequel il n’est pas venu à la réunion, la raison pour laquelle il n’a pas payé sa cotisation. Le bureaucratisme, dans ces questions, est tout simplement inouï. »
Ainsi, à la fameuse alternative Parti de cadres / Parti de masse sur laquelle a buté l’Internationale Communiste pendant les années 1920-1930, nous répondons qu’il faut avoir une forte exigence, donc aller dans le sens d’un Parti de cadres, tout en sachant que dans les faits les masses elles-mêmes peuvent être cadres si elles se lancent réellement.
Il y a ici une dialectique à l’œuvre qui ne peut être saisi que dans la pratique, et il est évident que, dans une métropole impérialiste source de corruption, cette pratique vit dans l’antagonisme : c’est ce terrain qui définit les modalités d’organisation du Parti.
Qu’est-ce que l’activisme communiste dans une métropole impérialiste ?
Un reproche qui nous est fait consiste à dire, pour résumer, est qu’en respectant les parcours personnels et en nous reposant sur la question de la subjectivité, on enlève tout espace pour le « militantisme ».
Une telle lecture est fondamentalement fausse, car elle se fonde sur l’analyse totalement erronée qu’il existerait, dans une métropole impérialiste comme la France, un terrain naturel, spontané, pour l’activité communiste et qu’il suffirait simplement de recruter pour apporter des militants dans un tel cadre.
Il faut vraiment être sur une base syndicaliste pour croire qu’il suffirait de monter un regroupement « militant » et d’intervenir dans un pays pacifié, d’esprit petit-bourgeois jusque dans la classe ouvrière, pour croire qu’on va changer les choses.
En 1988, la RAF et les BR-PCC constataient déjà que :
« Le niveau historiquement atteint par la contre-révolution impérialiste a fondamentalement modifié le conflit entre l’impérialisme et les forces révolutionnaires.
Cela signifie devenir conscient du poids croissant de la subjectivité dans la confrontation des classes et du fait que le terrain révolutionnaire ne peut pas être un simple réflexe aux conditions objectives. »
C’était là la conclusion de toute une réflexion commençant dans les années 1960 et constatant l’impact du 24 heures sur 24 du capitalisme. Aussi, il n’est certainement pas possible d’avoir une conception réduite, bornée de l’activité communiste et de s’imaginer que « militer », c’est diffuser des tracts dans une manifestation ou adhérer au syndicat de son entreprise.
Dans une métropole impérialiste, la question se pose de manière extrêmement complexe, car il n’est tout simplement pas possible d’aborder les gens pour proposer la révolution – même s’ils l’accepteraient, ils resteraient sur une base subjective et une démarche culturelle prisonnières du capitalisme.
On le voit bien avec les mouvements de contestation « anticapitaliste » comme le Parti du Travail en Belgique, La France Insoumise en France, Podemos en Espagne, etc. Il n’y a dans le fond strictement aucune rupture avec le capitalisme.
Il n’y a pas d’espace « naturel » où militer – ce sont aux communistes de les former, de les développer et c’est un processus qui demande des qualités humaines qui n’apparaissent pas du jour au lendemain.
Ce sont ces qualités qui permettent d’asseoir la subjectivité, qu’elle soit à la hauteur face à la corruption et à l’envahissement des valeurs bourgeoises dans le 24 heures sur 24 du capitalisme.
Les porteurs de rupture, chose la plus précieuse
Dans son discours de 1935 prononcé au palais du Kremlin à l’occasion de la promotion des élèves de l’Académie de l’Armée rouge, connu sous le nom de « L’Homme, capital le plus précieux », Staline dit la chose suivante. Auparavant, nous étions dans une situation économique très arriérée et il fallait dire « la technique décide de tout ». Maintenant, il faut dire « les cadres décident de tout », sinon on ne peut pas avancer dans le socialisme.
Il en va de même pour le Parti et la question du poids croissant de la subjectivité dans les métropoles impérialistes, lieu de perdition pour les esprits, de démolition pour la sensibilité. Ce qui porte le Parti, ce sont des êtres humains incarnant une démarche de rupture. Sans de tels êtres humains, il n’y a rien.
On ne peut pas les évaluer de manière formelle, en portant sur eux le même regard que sur des militants associatifs ou des représentants syndicaux. Ce qu’il porte les amène à avoir un profil différent. Il ne faut bien entendu pas faire du fétichisme de ce profil, sinon c’est du subjectivisme. Ce n’est pas évident et c’est un danger « de gauche ».
Mais il est moins dangereux que le danger « de droite » visant à aplatir les gens, à les réduire pour ainsi dire à néant.
Les porteurs de rupture sont la chose la plus précieuse, car ils forment le matériau humain servant de vecteur à l’expression de la révolution. Ils portent en effet la conflictualité, le refus complet d’accepter l’ordre dominant.
Au sens strict, ils expriment le besoin de communisme et véhiculent l’antagonisme. Voilà pourquoi ces porteurs doivent être préservés, doivent voir leur niveau s’élever, doivent se façonner selon les besoins de l’époque.
Staline a résumé cette nature particulière en disant que les communistes sont taillés dans une roche à part ; Gonzalo insiste pareillement sur l’esprit communiste particulier, constitué d’une passion inextinguible, d’une volonté ferme et résolue, avec un esprit clair et audacieux, expression de la révolution.
Gonzalo, auteur du document de mars 1980 du Parti Communiste du Pérou intitulé Commençons à démolir les murs et à déployer l’aurore, dit ici encore :
« Nous sommes communistes, grandis dans un temple à part, faits d’une roche à part ; nous sommes des communistes prêts à tout et nous savons ce que nous avons à affronter.
Nous l’avons déjà affronté, nous l’affronterons encore demain. Le futur, fils du présent, sera plus dur, mais le passé nous a déjà trempé et au présent nous nous forgeons.
Trempons nos âmes dans la révolution, ce sont les seules flammes capables de nous forger. Nous avons besoin d’un optimisme élevé, qui a une raison d’être : nous sommes ceux qui conduisent ceux qui façonnent l’avenir, nous sommes des guides, l’état major du triomphe invincible de la classe, pour cette raison nous sommes optimistes.
Nous possédons l’enthousiasme, parce que nous nourrit l’idéologie de la classe : la marxisme-léninisme-pensée Mao Zedong. Nous vivons la vie de la classe, nous participons de sa geste héroïque, le sang de notre peuple nous remplit d’ardeur et bout dans nos cœurs.
Nous sommes ce sang puissant et palpitant, prenons ce fer et cet acier inflexible qu’est la classe et fusionnons-le avec la lumière immarcescible [= qui ne peut se flétrir] du marxisme-léninisme-pensée Mao Zedong.
L’enthousiasme, c’est participer de la force des dieux, c’est pour cela que nous débordons d’enthousiasme, parce que nous participons des divinités du monde actuel : la masse, la classe, le marxisme, la révolution.
Pour cette raison, notre enthousiasme est inépuisable, pour cette raison, nous sommes forts, optimistes, notre âme est vigoureuse et nous débordons d’enthousiasme.
Et qu’avons-nous vu ici? Des dirigeants, des militants orphelins d’optimisme, ayant perdu l’ébullition enthousiaste, des âmes éteintes, des volontés déchues, des passions en fuite. Inacceptable.
Nous en connaissons l’origine : ce qui les soutient, ce n’est pas le marxisme, la classe ni la masse, c’est l’individualisme corrosif; c’est la pourriture réactionnaire qui les fait s’effrayer, c’est d’avoir été moulé dans les cloaques du vieil ordre, c’est l’expression d’un monde qui se meurt, ce sont les gaz mortels qui s’échappent des barrages de la réaction ; à cause de cela, leurs énergies s’affaiblissent, leur cœur tremble, la pensée les abandonne, leurs nerfs se détruisent, leur action se trouble. »
Pense-t-on une seule seconde que les communistes tels qu’ils sont définis ici se « recrutent » ? Absolument pas, ils sont le produit de l’histoire, ils se forgent collectivement dans le Parti, ils correspondent à un certain état d’esprit qu’un dirigeant synthétise dans chaque pays.
C’est d’ailleurs pour cela que l’État ouest-allemand avait fait en sorte de liquider en prison Ulrike Meinhof en 1976, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe et Gudrun Ensslin en 1977. C’était le matériau humain que l’impérialisme voulait supprimer.
Car le capitalisme sent que même s’il supprime tout espace d’antagonisme, il est des porteurs de rébellion, qui trouvent les failles de par leur rupture subjective, qui choisissent de s’engager pour lever le drapeau de la révolution.
Le Parti consiste en ces porteurs ; il est leur maison, ce sont eux qui le forme et c’est lui qui les forge. Avoir une lecture formelle en cette question, c’est littéralement massacrer ce qu’est le Parti dans sa substance même, et cela d’autant plus de par le poids croissant de la subjectivité dans les métropoles impérialistes.