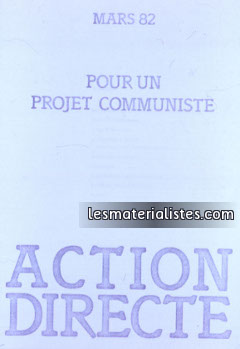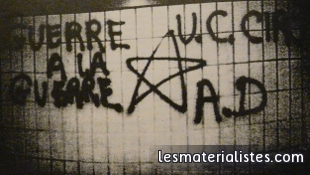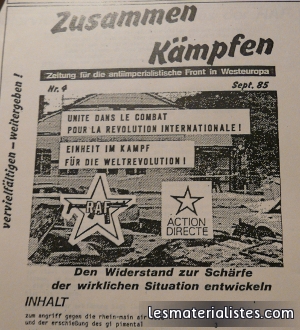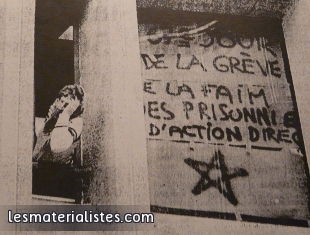Qui sommesnous ?
Nous n’avons plus rien à voir avec l’étiquette « maoïste » que la presse nous a collée si commodément.
S’il est vrai que d’anciens maos appartiennent aux NAPAP, ce n’est pas seulement à partir du bilan de la liquidation de la « Gauche Prolétarienne » ou de « Vive la Révolution » que nous nous sommes formés. De même que les éléments stratégiques de notre pratique ne s’appuient pas sur la théorie de la lutte armée comme une fin en soi.
Notre pratique part du bilan du « gauchisme » en général depuis 68, et sur une lecture précise des luttes révolutionnaires à travers l’Europe capitaliste. Le « gauchisme » depuis 68, c’est avant tout un constat d’échec flagrant au niveau stratégique, c’est-à-dire face à l’objectif numéro 1 qui motive son existence : bousiller cette société pourrie et contribuer à en construire une autre.
Pourtant, cet échec ne s’étend pas à toute l’Europe. Quand on compare les situations révolutionnaires de la France et de l’Italie sur la même période (et cela malgré des différences évidentes de contexte), on remarque que :
– d’un côté les gauchistes français se sont noyés dans d’innombrables querelles idéologiques stériles.
– de l’autre côté des Alpes, par contré, s’est développée au sein d’une certaine extrême-gauche, une expérience militante riche d’enseignements stratégiques.
Pour la première fois au sein du « gauchisme européen », le besoin d’une véritable stratégie anticapitaliste l’emportait sur le radotage idéologique classique.
Ainsi, la « stratégie du P.38 » se comprend mieux dans sa finalité par la double défaite historique du PCI (à travers les grèves sauvages ; anticompromis historique d’autornne 76 et le saccage du Séguy italien, Lama, de l’Université de Roma par les étudiants), que par le raccourci simplet : durs/pas durs, violents/non; violents.
Cette référence à l’Italie n’est pas pour nous le second piège à cons du « pays grandTimonier », comme la Chine en joua le rôle ici entre 66 et 72.
Ce qui nous frappe et nous intéresse dans l’exemple italien, ce sont les victoires réelles de forces populaires révolutionnaires dans leur façon de penser, d’agir, mais aussi de vivre en 1977.
Loin de tomber dans les souricières de boutique ou babacool, ces forces populaires ont mis sur pied en quinze ans une dynamique dont la direction incombe aux gens eux-mêmes (et non plus à des bureaucrates de partis ou de groupuscules).
En France, le règne des groupuscules, de 1966 à 1977, a contribué à mettre en pièces tout apport et antisoupe PS/PCF des luttes de masse.
La liste serait longue à faire des espoirs déçus par les conneries répétées des gauchistes idéologiques français: la liquidation des foyers autonomes d’usines, dos groupes locaux de Secours Rouge, du mouvement des immigrés qui lança la grève nationale de septembre 73, des nombreuses expériences depuis 1968 au sein de ta jeunesse, des activités offensives des paysanstravailleurs réduites souvent à néant par des querelles de chapelles, etc., toute cette liquidation laborieuse est à mettre au lourd passif du gauchisme.
En lisant ce bilan, on a l’impression que les chefs de file de la Révolution promise depuis le choc de 68 ont fait plus confiance à leurs livres de bibliothèque et à leurs carnets de voyage lointains qu’à l’expression de l’autonomie populaire : en dehors des restes du gauchisme culturel encore « à la mode », l’extrême-gauche traditionnelle n’a rien d’autre à proposer de « vivant » qu’un soutien critique pour 1978 à la gauche unie.
Quant aux frustrés du Grand Soir, on leur glisse naïvement un « On verra après, peutêtre qu’on débordera », entamant encore plus le potentiel (déjà rare) de confiance populaire les soutenant. Mais il serait absurde de résumer la lutte révolutionnaire, en France, aux bruits de chiottes des groupuscules gauchistes.
En effet, il existe aujourd’hui des noyaux d’usines qui ont commencé à réfléchir à ce qui les attend face aux chemins sinueux et aventuristes proposés par les saints patrons de l’avenir « du peuple de France» (sociauxdémocrates du PS, eurocommunistes du PCF).
La lutte des SONACOTRA, malgré l’isolement volontaire dans lequel les contiennent les réfor mistes de gauche et d’extrême-gauche, a montré que la nouvelle classe ouvrière immigrée peut s’exprimer en toute autonomie.
Et de plus qu’elle ne se limite plus seulement à des luttes minoritaires de secteur.
Il en est de même pour les Lip ou les paysans du Larzac ou les viticulteurs qui passent progressivement de la révolte à une réflexion constructive et originale sur là lutte à mener contre le capitalisme dans tous sas aspects.
Il est évident que cette force populaire est encore très faible. Elle à du mal à panser les coups pris dans la gueule depuis 1871 de la part des trahisons (réformistes très variées et des déboires du gauchisme.
Mais c’est ayant tout à partir de sa réalité que nous, NAPAP, nous avons décidé d’exister et de nous battre. Que signifie notre forme d’organisation pour lutter ?
II ast clair que nous ne sommet ni le parti combattant de quoi que ce soit, encore moins une nouvelle « Bande à Baader. » Nous avons tiré le bilan de pratiques politico-militaires étrangères qui mènent des combattants « spécialistes » à une lutte solitaire et suicidaire face à l’appareil d’Etat moderne.
Nôtre pratique s’inscrit dans l’édification de l’autonomie ouvrière organisée au sein du mouvement populaire. Notre but n’est pas d’appeler à la formation de 1, 10, 100 NAPAP régis par une direction centrale, style étatmajor de la violence populaire potentielle.
Nous abordons une autre étape qui consiste à nous fondre dans là dynamique du mouvement et non pas à chercher à en prendre la tête d’une façon officielle ou magouillarde.
Cela pour réaffirmer nôtre volonté de ne plus être des délégués de l’action violente qu’elle, soit applaudie ou sifflée comme ce fut le cas de la Nouvelle Résistance Populaire ou d’autres groupes similaires.
Pourquoi en priorité l’autonomie ouvrière ?
Parce qu’en dépit des bavardages philosophiques de salon marginal, la lutte des classes et la dynamique des couches révoltées du prolétariat restent la clé stratégique majeure pour foutre en l’air ce système social. Il est évident que le patronat l’a compris.
Il suffit de lire les comptes rendus patronaux et gouvernementaux de la CEE pour découvrir que la convention européenne sur le terrorisme vise les degrés croissants de violence populaire et leur maturité politique.
Mais le terrorisme d’Etat ne se manifeste pas seulement au cœur des usines.
Toutes les formes de vie, de comportement sont touchées par les lourdeursrépressives de la société Carnivore.
Au niveau de l’habitat, on ne compte plus les expulsions arbitraires, les opérations quasicriminelles des promoteurs qui saccagent les vieux quartiers pour y couler leur fleuve de béton macabre.
Pourtant, depuis l’expérience avortée de 1971 et des comités de mallogés, des groupes de squatters tentent de vivre dans des Îlots occupés.
Mais les flics ne leur laissent guère le temps d’en profiter. Et changer de plus en plus souvent d’endroits rend la vie dingue aux dits squatters. La solution pour eux estelle alors de se réfugier dans la drogue dure ou dans le pacifisme désespéré ?
Le cocktail Molotov reste parfois un argument plus convaincant que la résignation refoulée.
Pour ceux qui ont un logis, la situation n’est guère plus réjouissante: immeubles souvent insalubres et loyers en hausse constante.
Face à cet état de fait, la désobéissance civile est une pratique timide et mal connue en France.
Autoréduire son loyer, ses factures de gaz, d’électricité, s’attaquer au prix hiérarchisés des transports, des cinémas, des théâtres, demeure la seule riposte possible et vivable devant le pouvoir de l’argent.
Car, non contents de détruire l’individu par le travail, les patrons lui pompent ses dernières gouttes d’énergie à travers son loyer, ses impôts et sa consommation rassurante de « loisirpub qui rend con. »
Jeunes fumeurs de joints, vieux, condamnés à la mort lente dans les maisons de retraite « à bien voter », le terrorisme d’Etat se fout pas mal du soidisant fossé des générations. Réprimant de l’école au cercueil, le capitalisme casse la moindre liberté. Il se paie même le luxe d’imposer sa panoplie de drogues (alcoolisme, tiercé, loto) support moral du travail à la chaîne, pour contrer celles qui donnent envie de ne plus jamais se faire démolir la gueule «à l’atelier de peinture ou à la mise. »
Il est grand temps d’imposer sa manière de vivre autrement qu’en ayant pour seul recours le choix, d’un bon avocat.
Pour les jeunes fauchés, étudiants sans boulot, prolos anti-syndicat-ronron, immigrés en ghetto racial, jeunes braqueurs ou casseurs, il n’y aura jamais de « bon avocat », mais toujours de sales flics pour leur balancer une grenade à tir tendu ou une 367 magnum à la sortie d’une banque.
Le mal s’étend maintenant, à la nature ellemême, l’énergie nucléaire soutenue par la droite et la gauche réformiste (PS/PCF) est le dernier gadget des apprentissociers de la recherche capitaliste.
La lutta contre l’implantation des centrales nucléaires ne s’arrêtera pas grâce à un rassemblement nonviolent, si chouette soit-il, ou à un recours au Conseil d’Etat.
II est clair que, pris dans les contradictions de la crise de l’énergie, le capitalisme européen et ses alliés sociaux-démocrates veulent imposer le choix nucléaire (premier retour de manivelle pour les anciens pays colonialistes qui doivent aujourd’hui assumer au grand jour leur pillage du Tiersmonde depuis des siècles…).
Il est donc vital que le débat sur les ripostes efficaces à apporter contre le terrorisme d’Etat s’étende aussi bien dans l’usine qu’en dehors, y compris en nousmêmes, car il serait aberrant de lutter, même les armes à la main, sans combattre 1es germes que l’idéologie dominante nous a collés dans la tête (passivité forcée des « femmes soumises», phallocratie, racisme…).
Pourquoi la lutte armée ? Pourquoi Tramoni ?
L’affaire Tramoni a dévoilé le clivage créé par la mort de Pierre Overney.
Dans l’histoire du mouvement révolutionnaire en France, on connaissait jusqu’à maintenant, le vieux fossé réformistes/« révolutionnaires. »
Il faudrait maintenant être plus précis sur les subdivisions. Une nouvelle catégorie de penseurs est née : celle des dandies de la « révolution humainement possible » (cf déclaration de Geismar, Victor, le Dantec)
Il est certain que, planqué derrière un bureau universitaire ou une maison d’édition, on ne craint pas trop lais aléas de la restructuration industrielle, ni les coups de flingue ou de tournevis de la CFT.
Il est étonnant que ces «anciens» na s’en souviennent plus. Ce courant de parleurs à vide se cacha derrière un discours réquisitoire très juste sur l’histoire du socialisme/Bunker aux vingt millions de morts (ses propres victimes) et sur les absurdités des militantisme» gauchistes.
D’où son impact passager depuis 1972.
Mais lorsqu’on aborde les recettes proposées, on se rend compte de leur aspect fantomatique classable dans la rubrique «Soldes» sous le titre « Humanisme au rabais. »
Nous avons abattu Tramoni, non pas comme des vengeurs, mais parce qu’il était le symbole du terrorisme patronal impuni. Parce que baisser les bras devant ce symbole équivaut à en créer d’autres, mais victimes ceuxlà, du nom d’Overney ou de Maître. Pour combattre ce style de « paix sociale », il faut répondre au terrorisme d’Etat par des moyens aussi convaincants que les siens.
L’utilisation du fusil ou du « P.38 » n’est pas un mythe pour Français en mal d’Italie ou d’Amérique du Sud.
Elle demeure la seule argumentation de résistance et d’attaque que les multinationales et les patrons ne pourront jamais récupérer dans leurs bureaux d’études.
l’exécution du flic privé A. Tramoni ;
la tentative de destruction du stock de véhicules anti-grève bouchon de de Renault- Flins.
le plasticage du siège de la CFT
les coups de feu tirés sur le siège administratif de Citroën
l’attentat contre l’un des bureaux d’embauche de SimcaChrysler.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un même schéma.
1. Nier les thèses légalistes et soidisant démocratiques des syndicats et de l’Union de la gauche, comme quoi ces gens une fois au pouvoir, tout s’arrangera pour le mieux avec les patrons et leurs nervis. Mais les patrons seront toujours là, même si l’usine passe sous le contrôle de l’Etat. Et il y aura toujours des Tramoni et des Lecompte à leur service (même s’ils changent de syndicat entretemps).
2. Nier qu’une pétition pour exiger la dissolution d’une milice patronale comme la CFT ait quelque utilité sinon endormir la colère populaire. Idem pour le recours à la justice bourgeoise comme garant neutre des libertés. A ce propos, l’affaire du viol d’Issy-les-Moulineaux en 1972 par un commando CFT dans l’enceinte de l’usine Citroën-Balard est révélatrice de l’impuissance du légalisme.
Depuis cinq ans d’instruction, aucun procès n’a eu lieu, malgré l’identification des coupables et la perquisition du juge au local CFT de l’usine à Balard, dans laquelle on retrouva trente barres de fer servant, aux dires de la CFT et de la direction Citroën, à casser les vitres en cas d’incendie.
L’intervention des juges progressistes sur le secteur des accidents de travail ou des magouilles fiscales et financières de la part des compagnies pétrolières s’est soldée par un échec retentissant (coupables bénéficiant de nonlieux ou de petites peines de prison avec sursis).
Sans récuser le caractère positif des juges progressistes, il est évident que si leur travail n’est pas relayé par des actions illégales, il ne sert à rien (comme l’on fait les camarades qui ont rossé Paul Gardent, directeur des Charbonnages, au sujet de l’affaire de Liévin).
C’est pourquoi nous avons décidé de sortir de la légalité bourgeoise ou réformiste et de pratiquer la lutte armée afin d’instaurer un autre type de vie et de rapports humains entre les gens.
De ce fait, les NAPAP n’auront pas d’attitude « critique » face aux irresponsables du Programme commun s’ils dirigeaient le gouvernement en 1978.
Leur voie légaliste, et au contenu politique plus que douteux les amènera dans le même culdesac que leurs collègues italiens du PCI : soit faire payer la crise aux plus pauvres et appliquer ainsi la même politique que; Giscard-Chirac, soit tenter l’aventure démocratique socialiste à la chilienne ou à la portugaise sous le regard amusé de Carter, Chirac et autres Bigeard.
Dans le second cas, ce sera toujours les mêmes qui paieront l’addition.
Du fait que fondamentalement le Programme commun ne change rienà l’exploitation de l’homme par l’homme ou de la femme par l’homme, les NAPAP combattront les gérants futurs d’un capitalisme d’Etat avec les mêmes armes que celles que nous utilisons contre lu capitalisme libéral de Giscard.
=>Retour au dossier PCMLF, PCR(ml), VLR, UCF-ML,
Nouvelle Cause du Peuple, NAPAP, Action Directe