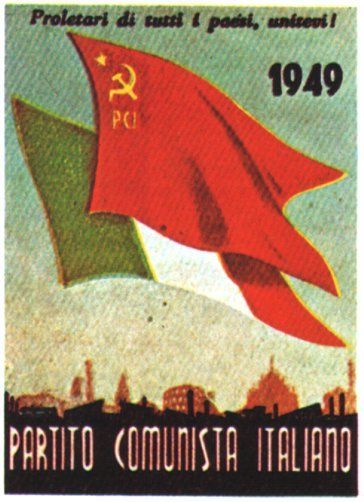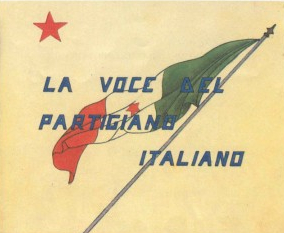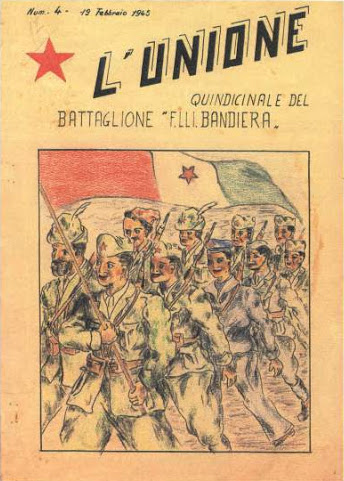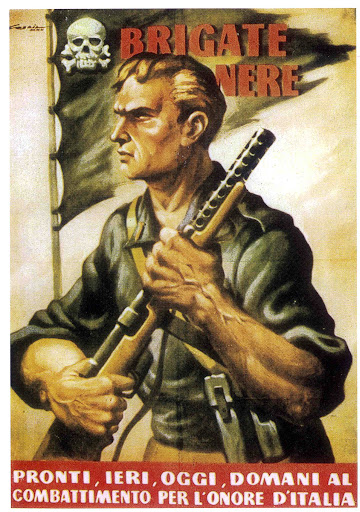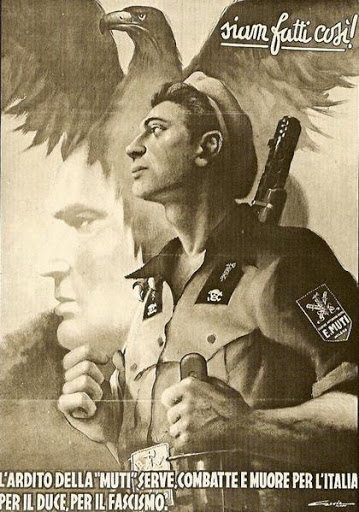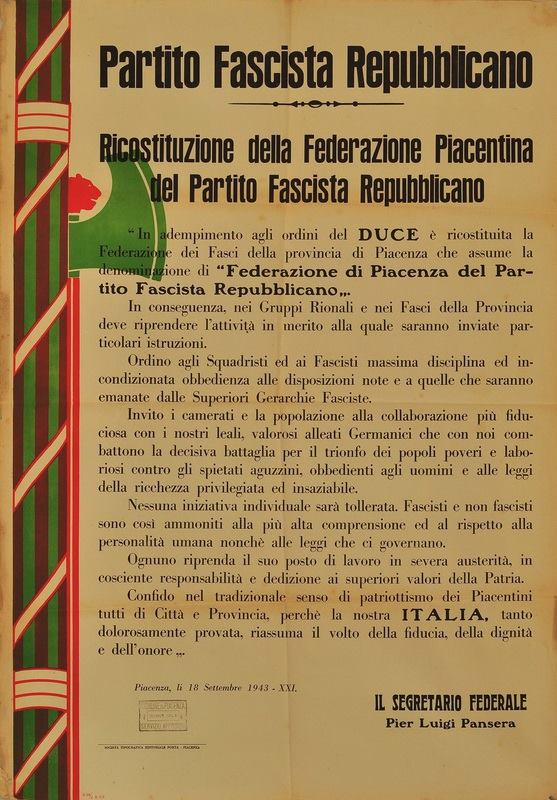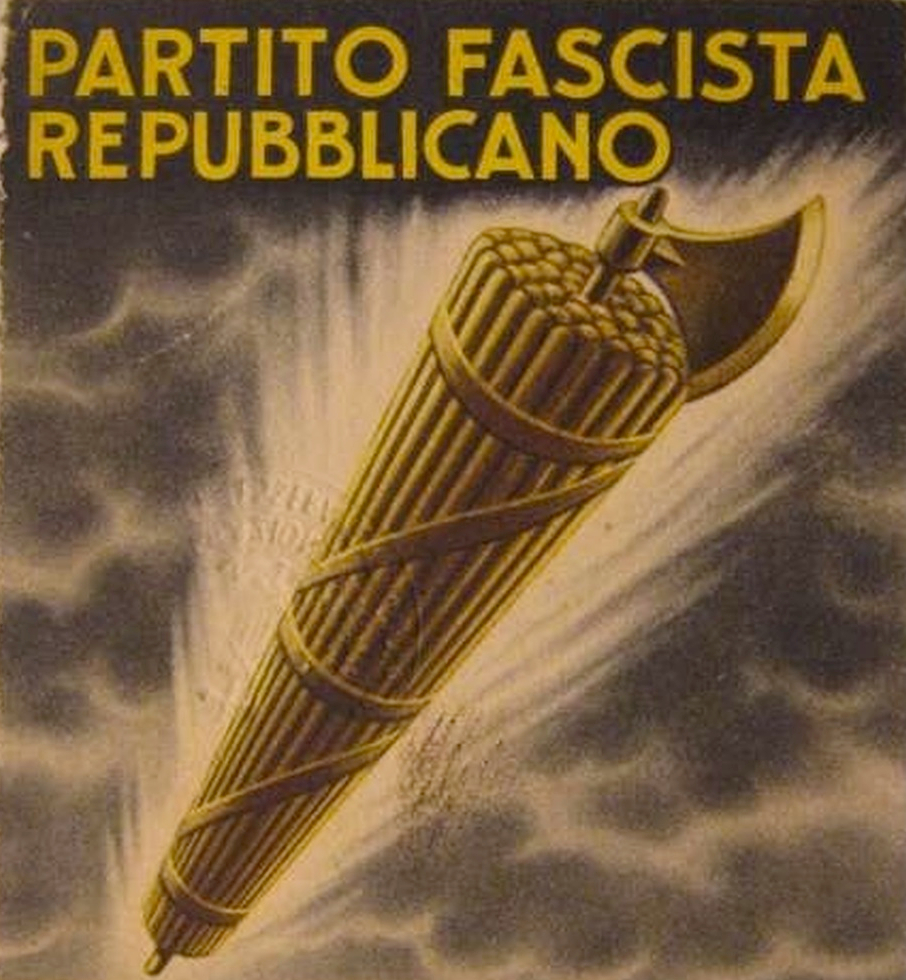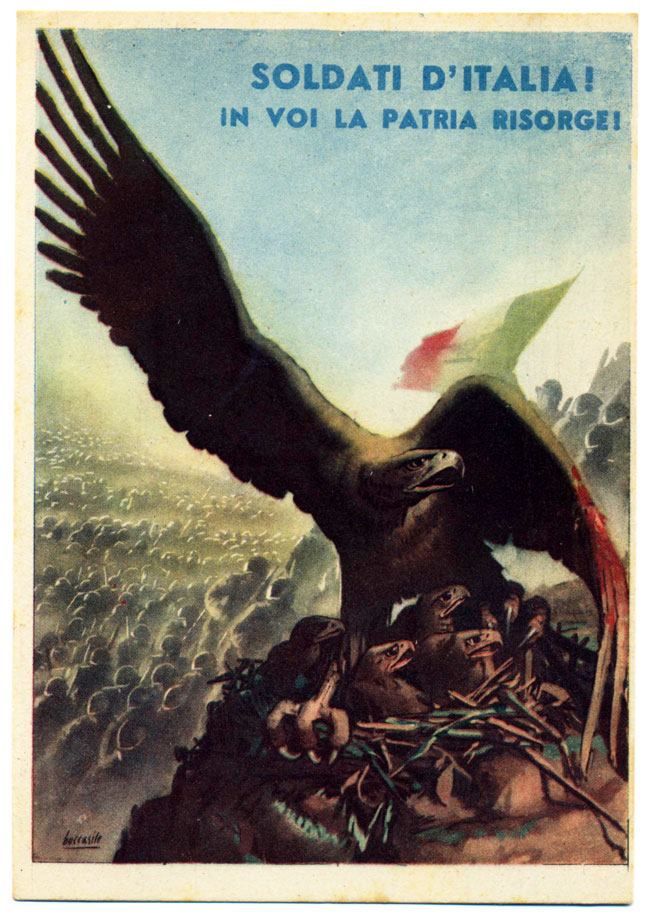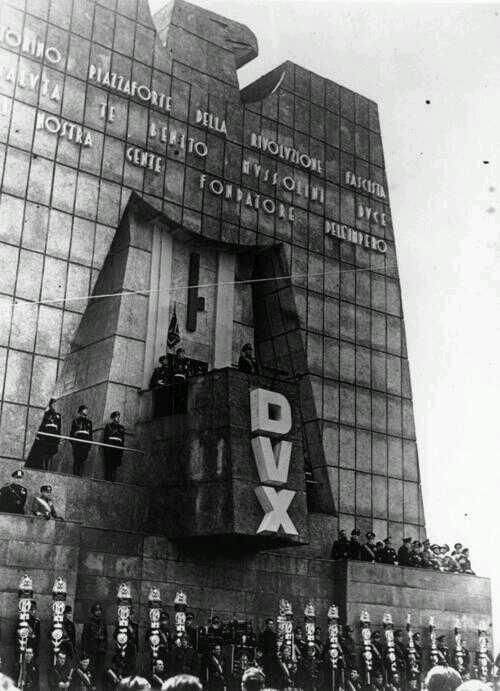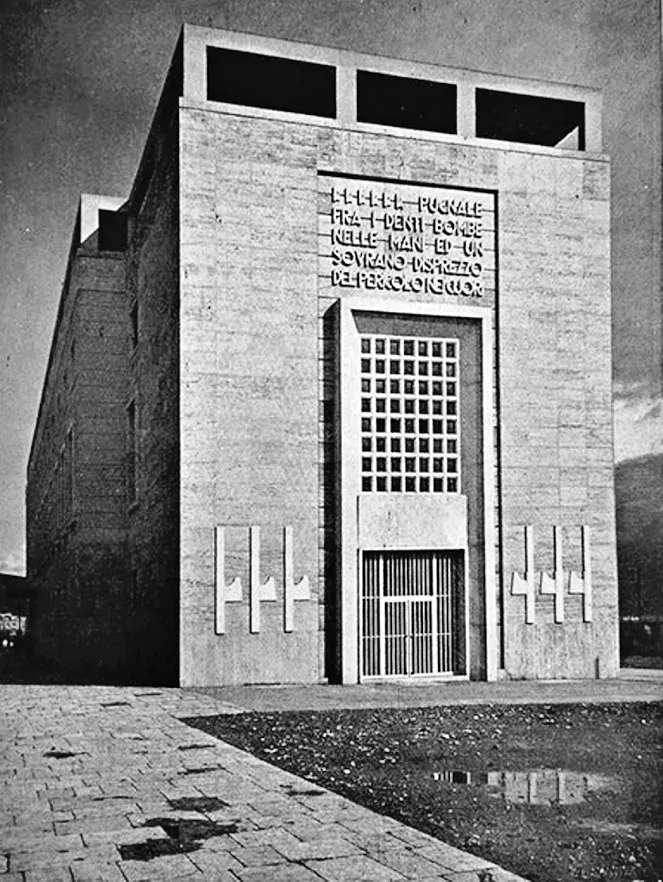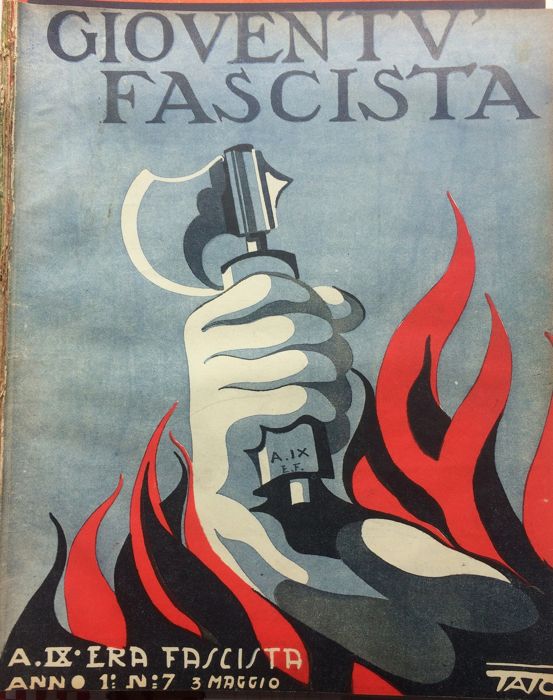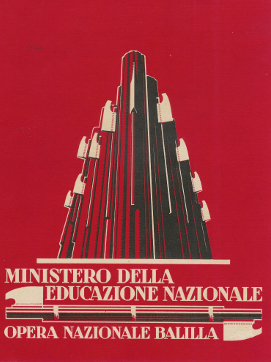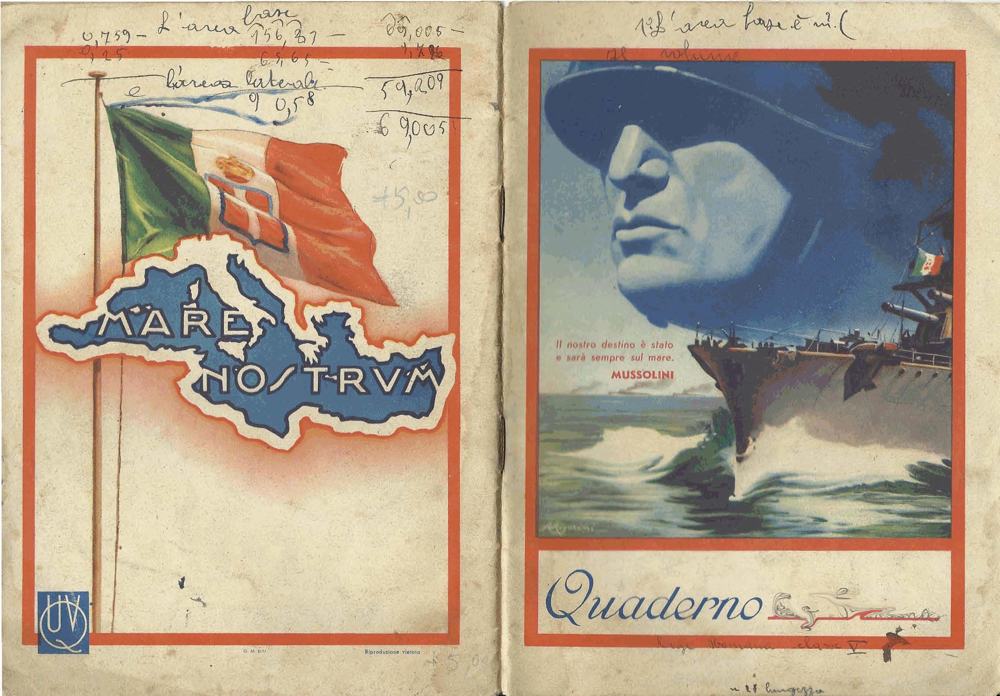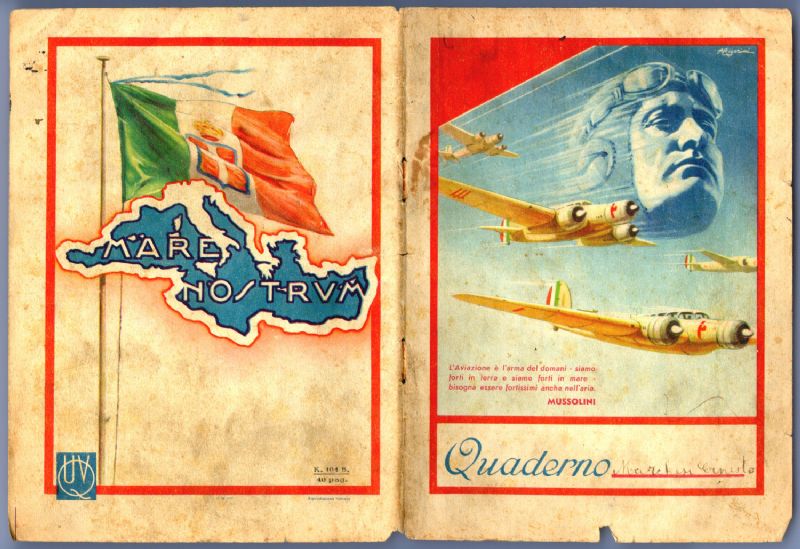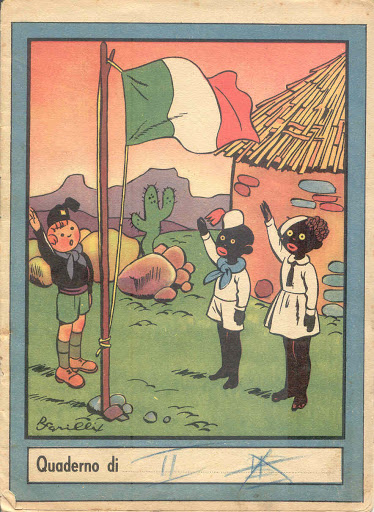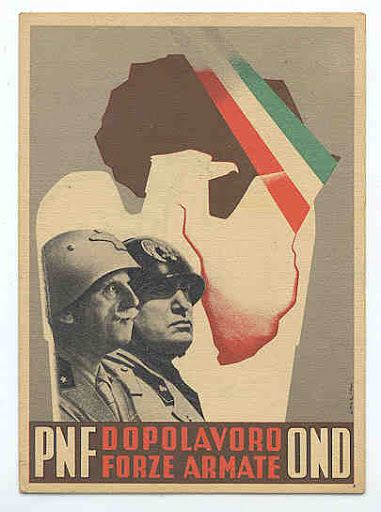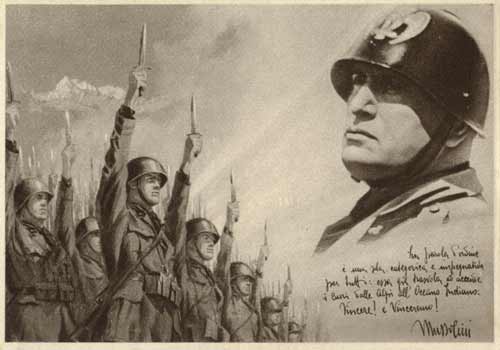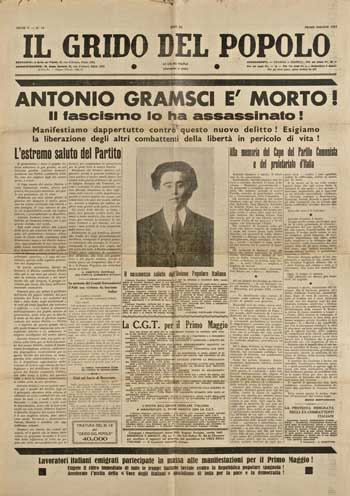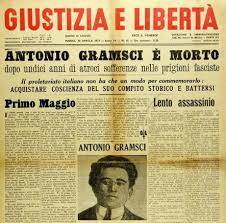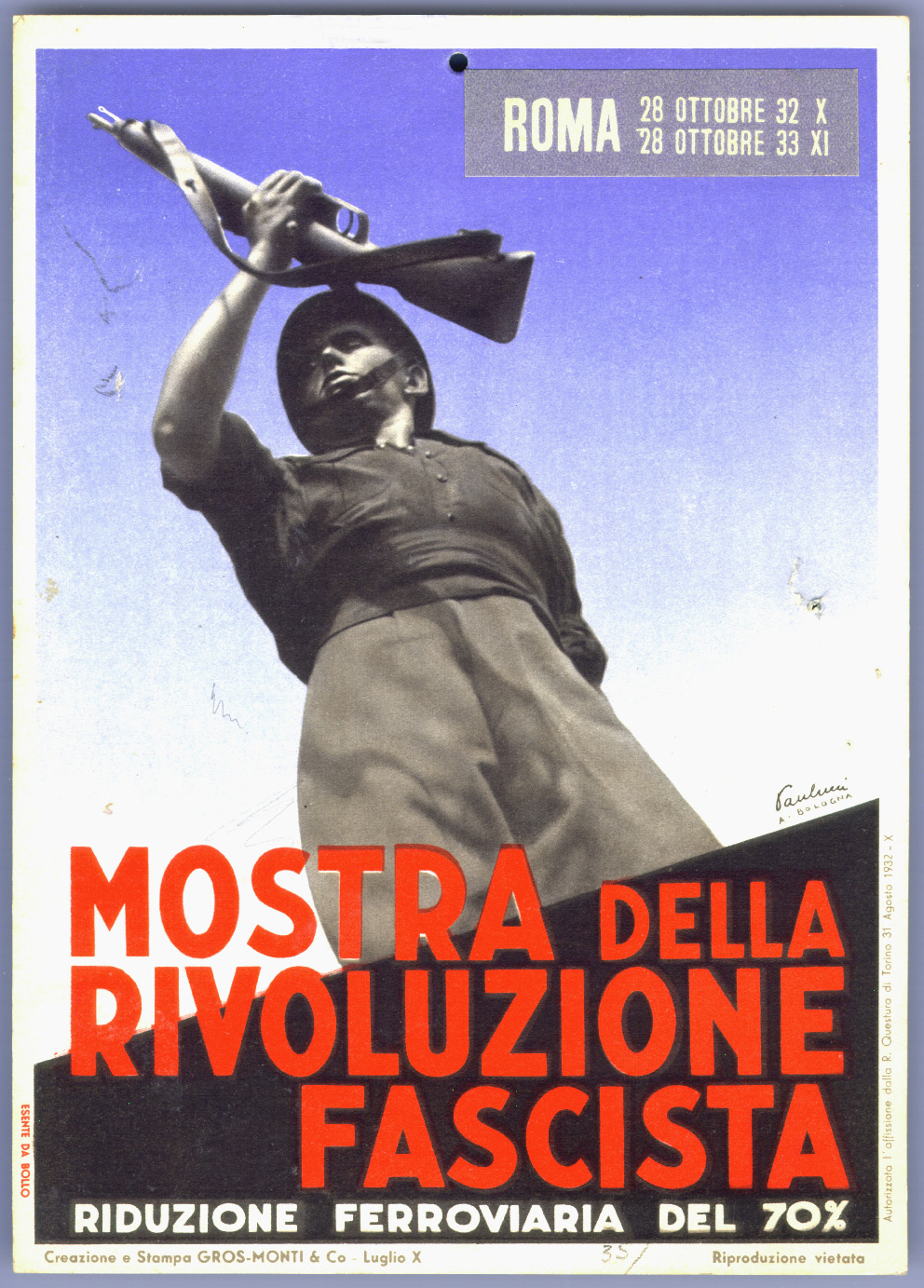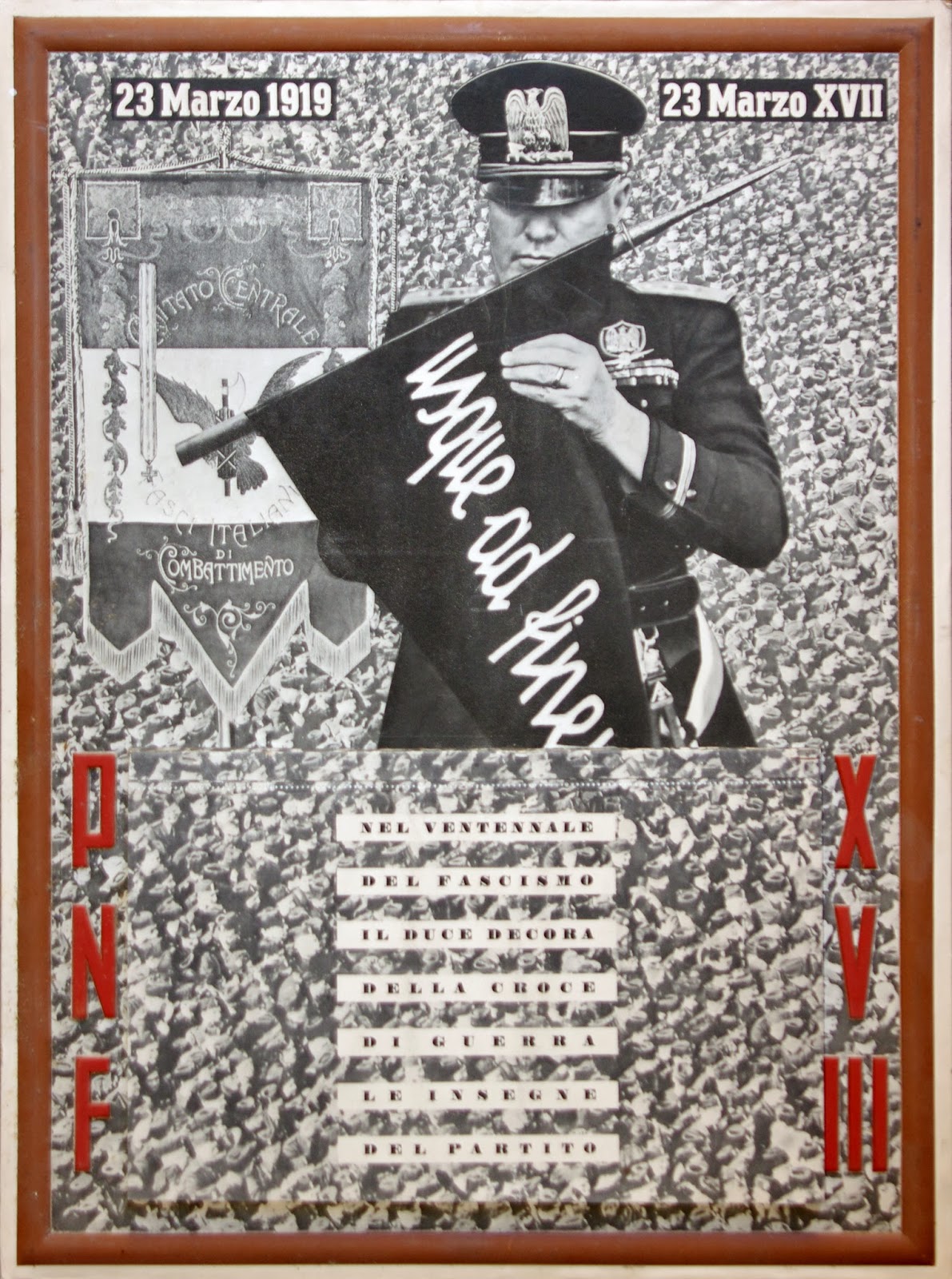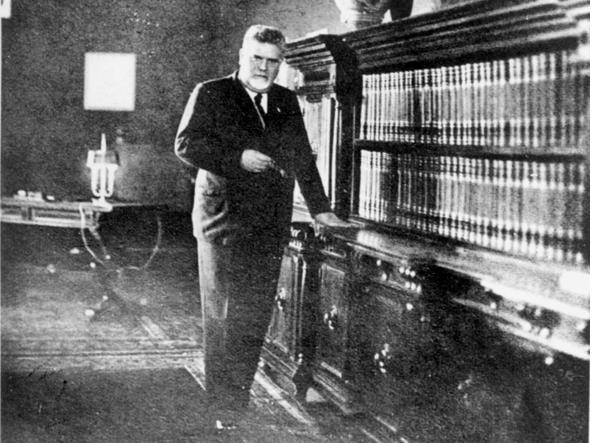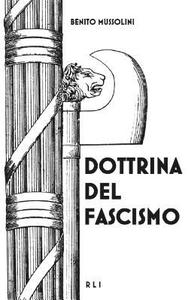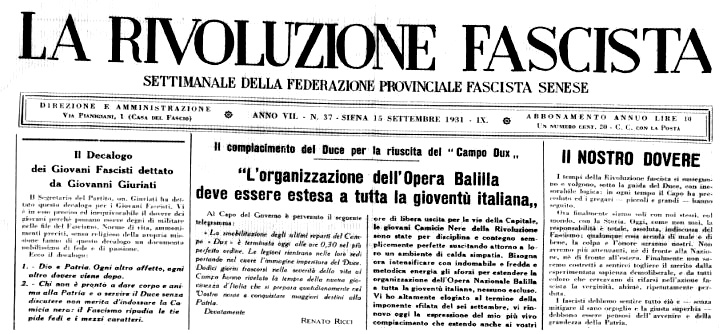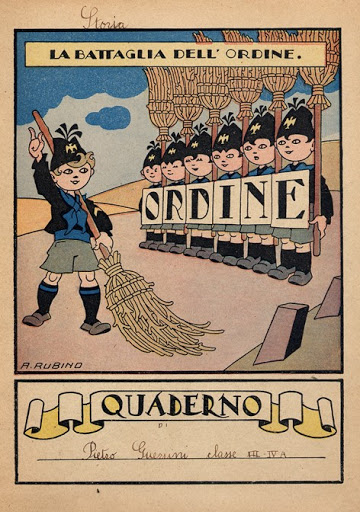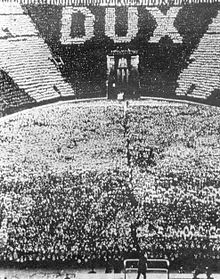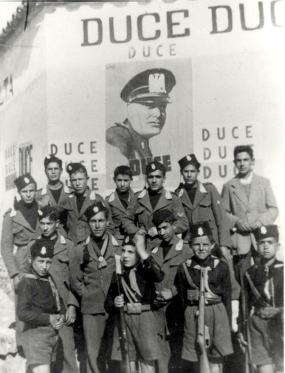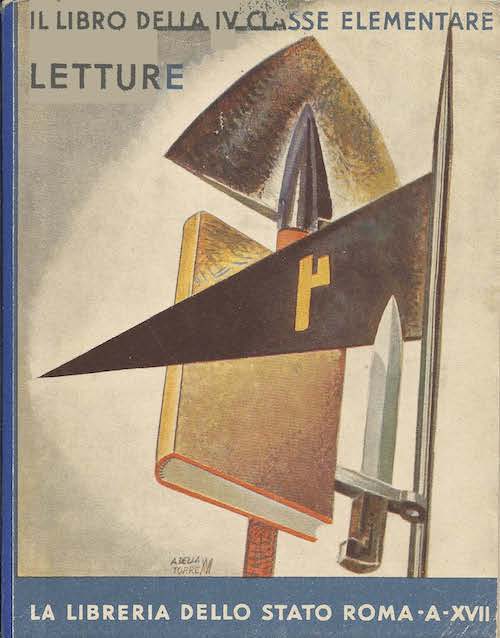Il Soviet, janvier-février 1920.
I (« Il Soviet », IIIème année, n° 1 du 4-1-1920)
A propos des propositions et des initiatives prises pour la constitution des Soviets en Italie, nous avons recueilli du matériel que nous voulons exposer dans l’ordre. Pour l’instant nous ferons quelques considérations d’ordre général, considérations que nous avons déjà exposé dans les numéros précédents.
Le système de représentation prolétarien, qui a été introduit pour la première fois en Russie, exerce des fonctions de deux ordres politique et économique.
Les fonctions politiques consistent dans la lutte contre la bourgeoisie jusqu’à son élimination totale. Les fonctions économiques consistent dans la création de tout le nouveau mécanisme de la production communiste.
Avec le développement de la révolution, avec l’élimination graduelle des classes parasitaires, les fonctions politiques deviennent toujours moins importantes par rapport aux fonctions économiques mais dans un premier temps, et surtout lorsqu’il s’agit encore de lutter contre le pouvoir bourgeois, l’activité politique est au premier plan.
Le véritable instrument de la lutte de libération du prolétariat, et avant tout de la conquête du pouvoir politique, c’est le parti de classe communiste.
Sous le pouvoir bourgeois, les conseils ouvriers ne peuvent être que des organismes dans lesquels travaille le parti communiste, moteur de la révolution. Dire qu’ils sont les organes de libération du prolétariat sans parler de la fonction du parti, comme dans le programme approuvé par le Congrès de Bologne, nous semble une erreur. Soutenir, comme le font les camarades de « l’Ordine Nuovo » de Turin, qu’avant même la chute de la bourgeoisie les conseils ouvriers sont déjà des organes non seulement de lutte politique mais aussi de préparation économico-technique du système communiste, est un pur et simple retour au gradualisme socialiste celui-ci, qu’il s’appelle réformisme ou syndicalisme, est défini par l’idée fausse que le prolétariat peut s’émanciper en gagnant du terrain dans les rapports économiques alors que le capitalisme détient encore, avec l’Etat, le pouvoir politique.
Nous développerons la critique des deux conceptions que nous avons indiquées.
Le système prolétarien de représentation doit adhérer à tout le processus technique de production.
Ce critère est exact, mais correspond au stade où le prolétariat, déjà au pouvoir, organise la nouvelle économie. Transposez-le tout bonnement en régime bourgeois, et vous n’aurez rien fait de révolutionnaire.
Même dans la période dans laquelle se trouve la Russie, la représentation politique soviétique — c’est-à-dire l’échafaudage qui culmine dans le gouvernement des commissaires du peuple — ne prend pas son départ dans les équipes de travail ou les ateliers des usines, mais dans le Soviet administratif local, élu directement par les travailleurs (regroupés, si possible, par communautés de travail).
Pour fixer les idées, le Soviet de Moscou est élu par les prolétaires de Moscou, à raison de un délégué pour 1.000 ouvriers. Entre ceux-ci et le délégué il n’y a aucun organe intermédiaire. De cette première désignation partent les suivantes, jusqu’au Congrès des Soviets, au Comité Exécutif, au Gouvernement des Commissaires.
Le conseil d’usine prend place dans un engrenage bien différent : celui du contrôle ouvrier de la production.
Par conséquent, le conseil d’usine, formé d’un représentant par atelier, ne désigne pas de représentant de l’usine au Soviet communal, politico-administratif ce représentant est élu directement et indépendamment.
En Russie, les conseils d’usine sont le point de départ d’un autre système de représentation, toujours subordonné au réseau politique des Soviets : celui du contrôle ouvrier de l’économie populaire. La fonction de contrôle dans l’usine n’a une valeur révolutionnaire et expropriatrice qu’une fois le pouvoir central passé dans les mains du prolétariat. Quand la protection étatique bourgeoise est encore debout, le conseil d’usine ne contrôle rien ; les rares fonctions qu’il accomplit sont le résultat de la pratique traditionnelle
a) du réformisme parlementaire,
b) de l’action syndicale de résistance, qui reste un gradualisme réformiste.
En conclusion nous ne nous opposons pas à la constitution des conseils internes d’usine si leur personnel ou ses organisations le demandent. Mais nous affirmons que l’activité du Parti Communiste doit s’orienter suivant un axe différent la lutte pour la conquête du pouvoir politique.
Cette lutte peut trouver un terrain favorable dans la création d’une représentation ouvrière : mais celle-ci doit consister dans les conseils ouvriers de ville ou de district rural, directement élus par les masses pour être prêts à remplacer les conseils municipaux et les organes locaux du pouvoir étatique au moment de la chute des forces bourgeoises. […]
II (« Il Soviet », IIIème année, n° 2 du 11-1-1920)
Avant de commencer çà discuter du problème pratique de la constitution des Conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats, et après les considérations générales de l’article du numéro précédent, nous voulons examiner les lignes programmatiques du système des Soviets telles qu’elles ressortent des documents de la révolution russe, et des déclarations de principe de quelques courants maximalistes italiens, comme le programme approuvé au Congrès de Bologne, la motion présentée à ce Congrès par Leone et d’autres camarades, les publications de « l’Ordine Nuovo » au sujet du mouvement turinois des Conseils d’usine.
Les conseils et le programme bolchevique
Dans les documents de la IIIème Internationale et du Parti Communiste Russe, dans les exposés magistraux de ces formidables théoriciens que sont les chefs du mouvement révolutionnaire russe, Lénine, Zinoviev, Radek, Boukharine, on retrouve l’idée que la révolution n’a pas inventé des formes nouvelles et imprévues, mais a confirmé les prévisions du processus révolutionnaire par la théorie marxiste.
Ce qui est essentiel dans le grandiose développement de la révolution russe, c’est la conquête du pouvoir politique par les masses ouvrières à travers une véritable guerre de classe, et l’instauration de leur dictature.
Les Soviets — faut-il rappeler que le mot soviet signifie simplement conseil, et peut être utilisé pour désigner n’importe quel corps représentatif — sont, c’est là leur signification historique, le système de représentation de classe du prolétariat parvenu à la possession du pouvoir.
Ce sont les organes qui remplacent le parlement et les assemblées administratives bourgeoises, et se substituent progressivement à tous les autres engrenages de l’Etat.
Pour employer les termes du dernier congrès communiste russe, cités par le camarade Zinoviev, les Soviets sont les organisations d’Etat de la classe ouvrière et des paysans pauvres, qui réalisent la dictature du prolétariat durant la phase dans laquelle s’éteignent toutes les vieilles formes d’Etat.
Le système de ces organisations d’Etat tend à donner la représentation à tous les producteurs en tant que membres de la classe ouvrière, mais non en tant que participants à une branche d’industrie ou une catégorie professionnelle : selon le récent manifeste de la IIIème Internationale, les Soviets sont un nouveau type d’organisation vaste, qui embrasse toutes les masses ouvrières indépendamment de leur métier et du degré de leur culture politique. Le réseau administratif des Soviets a comme organismes de base les conseils de ville ou de district rural, et culmine dans le gouvernement des commissaires.
Il est certes vrai que d’autres organes surgissent à côté de ce système dans la phase de la transformation économique, tel le système du contrôle ouvrier de l’économie populaire ; il est vrai aussi, nous l’avons souvent répété, que ce système tendra à absorber le système politique quand l’expropriation de la bourgeoisie sera complète et que cessera la nécessité d’un pouvoir étatique.
Mais dans la période révolutionnaire, comme il résulte de tous les documents des Russes, le problème essentiel est de subordonner dans l’espace et dans le temps, les exigences et les intérêts locaux et de catégorie à l’intérêt général du mouvement révolutionnaire.
Quand la fusion des deux organismes sera advenue, alors le réseau de la production sera complètement communiste et alors le critère — dont on exagère, nous semble-t-il, l’importance — d’une parfaite articulation de la représentation avec tous les mécanismes du système productif se réalisera.
Mais auparavant, quand la bourgeoisie résiste encore, et surtout quand elle est encore au pouvoir, le problème est d’avoir une représentation dans laquelle prévale le critère de l’intérêt général ; et quand l’économie est encore celle de l’individualisme et de la concurrence la seule forme dans laquelle l’intérêt collectif supérieur peut se manifester est une forme de représentation politique dans laquelle agit le parti politique communiste.
En reparlant de cette question nous montrerons que trop vouloir concrétiser et techniciser la représentation soviétique, surtout là où la bourgeoisie est encore au pouvoir, revient à mettre la charrue avant les bœufs et à retomber dans les vieilles erreurs du syndicalisme et du réformisme.
Pour l’instant, citons les paroles sans équivoque de Zinoviev : Le parti communiste regroupe cette avant-garde du prolétariat qui lutte en connaissance de cause pour la réalisation pratique du programme communiste. Il s’efforce en particulier d’introduire son programme dans les organisations d’Etat, les Soviets, et d’y obtenir une complète domination.
En conclusion, la république soviétique russe est dirigée par les Soviets qui regroupent en leur sein dix millions de travailleurs, sur quelque quatre-vingt millions d’habitants. Mais, substantiellement, les désignations pour les comités exécutifs des Soviets locaux et centraux se font dans les sections et dans les congrès du grand parti communiste qui domine dans les Soviets. Ceci correspond à la vibrante défense des fonctions révolutionnaires des minorités, faite par Radek. Il sera bon de ne pas créer un fétichisme ouvriériste-majoritaire, qui serait tout à l’avantage du réformisme et de la bourgeoisie.
Le parti est, dans la révolution, en première ligne, puisqu’il est potentiellement constitué d’hommes qui pensent et agissent comme membres de la future humanité travailleuse dans laquelle tous seront des producteurs harmonieusement insérés dans un engrenage de fonctions et de représentations.
Le Programme de Bologne et les Conseils
Il est regrettable que dans le programme actuel du parti [voir chap. III point 6] on ne reprenne pas l’affirmation marxiste selon laquelle le parti de classe est l’instrument de l’émancipation prolétarienne. Et qu’il n’y ait que l’anodin codicille : « décide (qui ? Même la grammaire n’a pas été sauvée dans la hâte de délibérer en faveur… des élections) d’informer l’organisation du Parti Socialiste italien à ses principes ».
Mais nous sommes encore plus en désaccord avec le programme quand il dit que les nouveaux organes prolétariens fonctionneront d’abord, sous la domination bourgeoise, comme instruments de la lutte violente de libération, et deviendront ensuite des organismes de transformation sociale et économique, puisqu’on inclut parmi ces organes non seulement les conseils de paysans travailleurs et de soldats, mais jusqu’aux conseils de l’économie publique, organes inconcevables en régime bourgeois.
Les conseils politiques ouvriers eux-mêmes doivent être considérés plutôt comme des institutions au sein desquelles se développe l’action des communistes pour la libération du prolétariat.
Mais récemment encore, le camarade Serrati a déprécié, à la barbe de Marx et de Lénine, le rôle du parti de classe dans la révolution.
« Avec les masses ouvrières – dit Lénine – le parti politique, marxiste, centralisé, avant-garde du prolétariat, guidera le peuple sur la juste voie, pour la victoire de la dictature du prolétariat, pour la démocratie prolétarienne à la place de la démocratie bourgeoise, pour le pouvoir des conseils, pour l’ordre socialiste. »
L’actuel programme du parti se ressent de scrupules libertaires et d’impréparation doctrinale.
Les Conseils et la motion Leone
Cette motion se résume en quatre points, exposés dans le style suggestif de son auteur.
Le premier de ces points est admirablement inspiré par la constatation que la lutte de classe est le moteur réel de l’histoire, et qu’elle a brisé les unions social-nationales.
Mais ensuite, la motion exalte dans les Soviets les organes de la synthèse révolutionnaire, qu’ils auraient la vertu de faire naître presque par le mécanisme même de leur constitution, et affirme que seuls les Soviets peuvent faire triompher les grandes initiatives historiques, par-delà les écoles, les partis, les corporations.
Cette conception de Leone, et des nombreux camarades qui ont signé sa motion, est très différente de la nôtre, déduite du marxisme et des directives de la révolution russe. On surestime ici une forme au lieu d’une force, tout comme les syndicalistes le font pour le syndicat, en attribuant à sa pratique minimaliste la vertu miraculeuse de se fondre dans la révolution sociale.
De même que le syndicalisme a été démoli d’abord par la critique des marxistes véritables, puis par l’expérience des mouvements syndicaux qui, partout, ont collaboré avec le monde bourgeois et lui ont fourni des instruments de conservation, la conception de Leone s’écroule face à l’expérience des conseils ouvriers sociaux-démocrates contre-révolutionnaires, qui sont précisément ceux dans lesquels il n’y a pas eu une pénétration victorieuse du programme politique communiste.
Seul le parti peut condenser en son sein les énergies dynamiques révolutionnaires de la classe. Inutile d’objecter que les partis socialistes ont, eux aussi, transigé, car nous n’exaltons pas la vertu de la forme parti, mais celle du contenu dynamique qui réside dans le seul parti communiste.
Chaque parti est défini par son programme, et ses fonctions n’ont pas de dénominateur commun avec celles des autres partis ; tandis que leurs fonctions rapprochent nécessairement tous les syndicats et, dans le sens technique, tous les conseils ouvriers aussi.
Le malheur des partis social-réformistes ne fut pas d’être des partis, mais de ne pas être communistes et révolutionnaires.
Ces partis ont dirigé la contre-révolution, tandis que les partis communistes, en les combattant, dirigent et nourrissent l’action révolutionnaire.
Il n’existe donc pas d’organismes qui seraient révolutionnaires grâce à leur forme ; seules existent des forces sociales qui sont révolutionnaires de par la direction dans laquelle elles agissent, et ces forces s’ordonnent dans un parti qui lutte avec un programme.
Les Conseils et l’initiative de l’« Ordine Nuovo » de Turin
D’après nous, les camarades de « l’Ordine Nuovo » vont encore plus loin. Même la formulation du programme du parti ne les satisfait pas, parce qu’ils prétendent que les Soviets, y compris ceux de nature technico-économique (les conseils d’usine) non seulement existent et sont dans le régime bourgeois les organes de la lutte de libération prolétarienne, mais qu’ils sont déjà les organes de la reconstruction de l’économie communiste.
Ils citent en effet un passage du programme du parti en omettant certains mots, de façon à tirer le sens vers leur point de vue :
« Il faut leur opposer de nouveaux organes prolétariens (conseils d’ouvriers, paysans et soldats, conseils de l’économie publique, etc.)… organismes de transformation sociale et économique et de reconstruction du nouvel ordre communiste ».
Mais l’article est déjà long et nous renvoyons au prochain numéro l’exposé de notre profond désaccord avec ce critère, qui à notre avis présente le danger de se résoudre en une simple expérience réformiste par la modification de certaines fonctions des syndicats et peut-être la promulgation d’une loi bourgeoise instituant les conseils ouvriers.
III (« Il Soviet », IIIème année, n° 4 du 1-2-1920)
En conclusion du second article sur la Constitution des Soviets en Italie, nous avons évoqué le mouvement turinois pour la constitution des conseils d’usine.
Nous ne partageons pas le point de vue qui inspire les camarades de « l’Ordine Nuovo » et, tout en appréciant leur travail tenace pour une meilleure conscience des points fondamentaux du communisme, nous pensons qu’ils sont tombés dans des erreurs de principe et de tactique qui n’ont rien de bénin.
Selon eux, le fait essentiel de la révolution réside précisément dans la constitution des nouveaux organes prolétariens de représentation, destinés à la gestion directe de la production, et dont le caractère fondamental réside dans l’adhésion étroite au processus productif.
Nous avons déjà dit qu’à notre avis on insiste trop sur cette idée de la coïncidence formelle entre les représentations de la classe ouvrière et les divers agrégats du système technico-économique de production. Cette coïncidence tendra à se réaliser à un stade très avancé de la révolution communiste, lorsque la production sera socialisée et que toutes les activités particulières qu’elle comprend seront harmonieusement subordonnées aux intérêts généraux et collectifs, et inspirées par eux.
Auparavant, et pendant la période de transition de l’économie capitaliste à l’économie communiste, les regroupements de producteurs traversent une période de transformation permanente, et leurs intérêts peuvent heurter les intérêts généraux collectifs du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
Celui-ci trouvera son véritable instrument dans une représentation de la classe ouvrière dans laquelle chacun entre en tant que membre de cette classe, intéressé à un changement radical des rapports sociaux, et non en tant que composante d’une catégorie professionnelle, d’une usine ou d’un quelconque groupe local.
Tant que le pouvoir politique se trouve encore dans les mains de la classe capitaliste, on ne peut obtenir une représentation des intérêts généraux révolutionnaires du prolétariat que sur le terrain politique, dans un parti de classe auquel adhèrent individuellement ceux qui, pour se vouer à la cause de la révolution, ont dépassé la vision étroite de leur intérêt égoïste, de leur intérêt de catégorie, et parfois même de leur intérêt de classe, ce qui signifie que le parti admet aussi dans ses rangs les déserteurs de la classe bourgeoise qui revendiquent le programme communiste.
C’est une grave erreur de croire qu’en transplantant dans l’ambiance prolétarienne actuelle, parmi les salariés du capital, les structures formelles dont on pense qu’elles pourront se former pour la gestion de la production communiste, on crée des forces révolutionnaires par elles-mêmes et par vertu intrinsèque.
Ce fut l’erreur des syndicalistes, et c’est aussi l’erreur des zélateurs trop ardents des conseils d’usine.
Le camarade C. Niccolini a fort opportunément rappelé dans un article de « Comunismo » qu’en Russie, même après le passage du pouvoir au prolétariat, les conseils d’usine ont souvent fait obstacle aux mesures révolutionnaires, opposant encore davantage que les syndicats la pression d’intérêts limités au développement du processus communiste.
Les conseils d’usine ne sont même pas les gérants principaux de la production dans le système de l’économie communiste.
Parmi les organes qui participent à cette tâche (Conseils de l’économie populaire) la représentation des conseils d’usine a moins de poids que celle des syndicats professionnels et que celle, prédominante, du pouvoir étatique prolétarien qui, avec son organisation politique centralisée, est l’instrument et l’agent principal de la révolution, non seulement en ce qui concerne la lutte contre la résistance politique de la classe bourgeoise, mais aussi en ce qui concerne le processus de socialisation de la richesse.
Au stade où nous en sommes, c’est-à-dire quand l’Etat du prolétariat est encore une aspiration programmatique, le problème fondamental est celui de la conquête du pouvoir par le prolétariat ou mieux encore, par le prolétariat communiste, c’est-à-dire par les travailleurs organisés en parti politique de classe et décidés à réaliser la forme historique du pouvoir révolutionnaire, la dictature du prolétariat.
Le camarade A. Tasca lui-même expose clairement son désaccord avec le programme de la majorité maximaliste du Congrès de Bologne, et plus encore avec nous, abstentionnistes, dans le numéro 22 de « l’Ordine Nuovo », dont le passage suivant vaut la peine d’être reproduit :
« Un autre point du nouveau programme du parti mérite d’être examiné : les nouveaux organes prolétariens (conseils d’ouvriers, paysans et soldats, conseils de l’économie publique, etc.) fonctionnant d’abord (sous la domination bourgeoise) comme instruments de la lutte violente de libération, deviennent ensuite des organes de transformation sociale et économique, de reconstruction du nouvel ordre communiste.
Nous avions insisté en commission sur l’erreur d’une telle formulation, qui confie aux nouveaux organes des fonctions différentes suivant un d’abord et un ensuite, séparés par la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Gennari avait promis de corriger en « d’abord essentiellement comme instruments… », mais on voit qu’ensuite il y a renoncé ; et comme, pour des raisons de force majeure, j’ai été absent à la séance finale, je n’ai pas pu le lui faire remettre.
Il y a pourtant dans cette formulation un véritable point de divergence qui, s’il rapproche Gennari, Bombacci, etc., des abstentionnistes, les éloigne de ceux qui croient que les nouveaux organes prolétariens ne peuvent être « instruments de la lutte violente de libération » que dans la mesure où ils sont tout de suite (en non ensuite) des « organes de transformation sociale et économique ».
La libération du prolétariat se réalise précisément à travers le développement de sa capacité à gérer de façon autonome et originale les fonctions de la société créée par lui et pour lui : la libération réside dans la création d’organes tels que, s’ils vivent et fonctionnent, ils provoquent par là même la transformation sociale et économique qui constitue leur but.
Il ne s’agit pas là d’une question de forme, mais d’une question essentielle de contenu. Dans la formulation actuelle, redisons-le, les rédacteurs en arrivent à adhérer à la conception de Bordiga, qui donne plus d’importance à la conquête du pouvoir qu’à la formation des Soviets, auxquels il reconnaît pour l’instant une fonction davantage « politique » stricto sensu, plutôt qu’une fonction organique de « transformation économique et sociale ».
De même que Bordiga considère que le Soviet intégral ne sera créé que durant la période de la dictature du prolétariat, Gennari, Bombacci, etc., considèrent que seule la conquête du pouvoir (qui prend donc un caractère politique, ce qui nous ramène aux « pouvoirs publics », déjà dépassés) peut donner aux Soviets leur fonction véritable et entière.
Selon nous c’est précisément là le point central qui devra conduire, tôt ou tard, à une nouvelle révision du programme voté récemment ».
Selon Tasca, la classe ouvrière peut donc construire les étapes de sa libération avant même d’arracher le pouvoir politique à la bourgeoisie.
Plus loin, Tasca laisse entendre que cette conquête pourra même avoir lieu sans violence, quand le prolétariat aura développé cette œuvre de préparation technique et d’éducation sociale qu’est censée représenter précisément la méthode révolutionnaire concrète préconisée par les camarades de « l’Ordine Nuovo ».
Nous ne nous étendrons pas sur la démonstration du fait que cette conception tend vers celle du réformisme, et s’éloigne des points fondamentaux du marxisme révolutionnaire pour qui la révolution n’est pas déterminée par l’éducation, la culture, la capacité technique du prolétariat, mais par les crises inhérentes au système capitaliste de production.
Tout comme Enrico Leone, Tasca et ses amis surestiment l’apparition dans la révolution russe d’une nouvelle représentation sociale, le Soviet, censé constituer, par la vertu même de sa formation, une solution historique originale de la lutte de classe prolétarienne contre le capital.
Mais les Soviets — fort bien définis par le camarade Zinoviev comme les organisations d’Etat de la classe ouvrière — ne sont rien d’autre que les organes du pouvoir prolétarien qui exercent la dictature révolutionnaire de la classe ouvrière, pivot du système marxiste, dont la première expérience positive fut la Commune de Paris de 1871.
Les Soviets sont la forme, non la cause de la révolution.
En dehors de cette divergence, un autre point nous sépare des camarades turinois.
Les Soviets, organes d’Etat du prolétariat victorieux, sont bien autre chose que les conseils d’usine, et ces derniers ne constituent pas le premier échelon du système politique soviétique. En réalité, cette équivoque se retrouve dans la déclaration de principe votée à la première assemblée des Commissaires d’atelier des usines turinoises, qui commence ainsi :
« Les commissaires d’usine sont les seuls et véritables représentants sociaux (économiques et politiques) de toute la classe prolétarienne, parce que élus au suffrage universel par tous les travailleurs sur le lieu même du travail.
Aux divers échelons de leurs constitution, les commissaires représentent l’union de tous les travailleurs telle qu’elle se réalise dans les organismes de production (équipe – atelier – usine – union des usines d’une industrie donnée – union des entreprises de production de l’industrie mécanique et agricole d’un district, d’une province, d’une nation, du monde) dont les conseils et le système des conseils représentent le pouvoir et la direction sociale ».
Cette déclaration est inacceptable, puisque le pouvoir prolétarien se forme directement dans les Soviets municipaux des villes et des campagnes, sans passer par l’intermédiaire des conseils et comités d’usine, ainsi que nous l’avons dit à plusieurs reprises, et comme cela ressort de la claire présentation du système soviétique russe publiée par « l’Ordine Nuovo » lui-même.
Les Conseils d’usine sont des organismes destinés à représenter les intérêts de groupes d’ouvriers pendant la période de la transformation révolutionnaire de la production, et ils représentent non seulement l’aspiration de tel ou tel groupe à se libérer du capitaliste privé par la socialisation de la production, mais également la préoccupation sur la manière dont les intérêts de ce groupe se feront valoir lors du processus de socialisation, discipliné par la volonté organisée de toute la collectivité des travailleurs.
Les intérêts des travailleurs, pendant la période où le système capitaliste est stable et ou il ne s’agit que de pousser à des améliorations salariales, ont été représentés par les syndicats de métiers. Ils continuent à exister pendant la période révolutionnaire, et il est naturel qu’ils se confrontent aux conseils d’usine qui surgissent lorsque se rapproche l’abolition du capitalisme privé, comme c’est advenu à Turin.
Ce n’est donc pas une question de principes révolutionnaires que de savoir si les ouvriers non organisés doivent ou non participer aux élections.
Si il est logique que ceux ci y participent, étant donné la nature même des conseils d’usine, il ne sous parait pas logique de mélanger, comme on l’a fait à Turin, les organisations et fonctions des syndicats et des conseils, en imposant aux sections de Turin de la Fédération de la métallurgie d’élire leur propre conseil de direction des assemblées des commissaires d’ateliers.
De toute manière, les rapports entre conseils et syndicats, qui sont les représentants d’intérêts particuliers de groupes d’ouvriers, continueront à être complexes. Nous ne pourrons les harmoniser qu’à une étape très avancée de l’économie communiste, lorsque la possibilité d’opposition entre les intérêts d’un groupe de producteurs et l’intérêt général de la marche de la production sera fortement réduite.
Ce qu’il nous importe d’établir, c’est que la révolution communiste est conduite et dirigée par une représentation politique de la classe ouvrière, qui, avant le renversement du pouvoir bourgeois, est un parti politique ; ensuite, c’est le réseau du système des Soviets politiques, élus directement par les masses auxquelles on propose de désigner des représentants ayant un programme politique général bien défini, au lieu d’exprimer les intérêts limités d’une catégorie ou d’une usine.
Le système russe est arrangé de façon à former le Soviet municipal d’une ville avec un délégué pour chaque regroupement de prolétaires qui votent pour un seul nom. Mais ces délégués sont proposés aux électeurs par le parti politique, et il en va de même pour les représentants du deuxième et troisième échelon dans les organismes supérieurs du système étatique.
C’est donc toujours un parti politique — le parti communiste — qui sollicite et obtient des électeurs le mandat d’administrer le pouvoir.
Nous ne disons certes pas que les schémas russes doivent être adoptés tels quels partout, mais nous pensons qu il faut tendre à se rapprocher, plus même qu’en Russie, du principe directeur de la représentation révolutionnaire : le dépassement des intérêts égoïstes et particuliers dans l’intérêt collectif.
Peut-il être opportun pour la lutte révolutionnaire de constituer dès à présent les rouages d’une représentation politique de la classe ouvrière ? C’est le problème que nous aborderons dans le prochain article, en discutant du projet élaboré par la direction du parti à ce propos, restant bien clair qu’ainsi qu’on le reconnaît partiellement dans ce projet, cette représentation serait bien autre chose que le système des conseils et comités d’entreprises qui ont commencé à se former à Turin.
IV (« Il Soviet », IIIème année, n° 5 du 8-2-1920)
Nous croyons avoir suffisamment insisté sur la différence entre Conseils d’usine et Conseils politico-administratifs des ouvriers et paysans. Le Conseil d’usine est la représentation des intérêts des ouvriers limités au cercle restreint d’une entreprise. En régime communiste, c’est le point de départ du système du « contrôle ouvrier » qui représente une partie du système des « Conseils de l’économie » destinés à la direction technique et économique de la production.
Mais les Conseils d’usine n’ont aucune influence sur le système des Soviets politiques, dépositaires du pouvoir prolétarien.
En régime bourgeois, on ne peut donc voir dans le conseil d’usine — pas plus qu’on ne peut le voir dans le syndicat professionnel — un organe pour la conquête du pouvoir politique.
Si on veut y voir un organe tendant à émanciper le prolétariat par une autre voie que celle de la conquête révolutionnaire du pouvoir, on retombe dans l’erreur syndicaliste — et les camarades de « l’Ordine Nuovo » n’ont guère de raisons pour soutenir, dans leur polémique avec « Guerra di Classe », que le mouvement des Conseils d’usine tel qu’ils le théorisent n’est pas en un certain sens du syndicalisme.
Le marxisme se caractérise par la répartition anticipée de la lutte d’émancipation du prolétariat en grandes phases historiques, dans lesquelles les activités politique et économique ont respectivement des poids extrêmement différents lutte pour le pouvoir – exercice du pouvoir (dictature du prolétariat) dans la transformation de l’économie – société sans classes et sans Etat politique.
Vouloir faire coïncider dans la fonction des organes de libération du prolétariat les moments du processus politique avec ceux du processus économique, c’est ajouter foi à cette caricature petite-bourgeoise du marxisme qu’on peut appeler économisme, et qui relève du réformisme et du syndicalisme — et la surestimation du Conseil d’usine n’est qu’une autre incarnation de cette vieille erreur qui rattache le petit-bourgeois Proudhon aux nombreux révisionnistes qui ont cru dépasser Marx.
En régime bourgeois, le Conseil d’usine est donc un représentant des intérêts des ouvriers d’une entreprise, tout comme il le sera en régime communiste. Il surgit lorsque les circonstances l’exigent, à travers les modifications de l’organisation économique prolétarienne. Mais, peut-être encore plus que le syndicat, il prête le flanc aux diversions du réformisme.
La vieille tendance minimaliste à l’arbitrage obligatoire, à l’intéressement des ouvriers aux profits du capital, et donc à leur intervention dans la direction et l’administration de l’usine, pourrait trouver dans les Conseils d’usine une base pour l’élaboration d’une législation sociale anti-révolutionnaire.
C’est ce qui se produit actuellement en Allemagne malgré l’opposition des Indépendants, qui ne contestent cependant pas le principe mais seulement des modalités de cette loi — à l’inverse des communistes, pour qui le régime démocratique ne peut donner vie à un quelconque contrôle du prolétariat sur les fonctions capitalistes.
Il reste donc clair qu’il est insensé de parler de contrôle ouvrier tant que le pouvoir politique n’est pas dans les mains de l’Etat prolétarien, au nom et par la force duquel un tel contrôle pourra être exercé, comme prélude à la socialisation des entreprises et à leur administration par les organes adéquats de la collectivité.
Les Conseils de travailleurs – ouvriers, paysans et, lorsque c’est le cas, soldats – sont, c’est bien clair, les organes politiques du prolétariat, les bases de l’Etat prolétarien.
Les Conseils locaux de ville et de campagne prennent la place des conseils municipaux du régime bourgeois. Les Soviets provinciaux et régionaux prennent la place des conseils régionaux actuels, à la différence que les premiers sont désignés par des élections de second degré des Soviets locaux. Le Congrès des Soviets d’un Etat et le Comité Exécutif Central se substituent au parlement bourgeois mais sont élus par des élections de troisième et quatrième degré, et non directement.
Il n’est pas question d’insister ici sur les autres différences, dont une des principales est le droit de révocation des délégués par les électeurs à tout moment.
La nécessité d’avoir un mécanisme facile pour ces révocations fait que les élections ne sont pas des élections de liste mais l’élection d’un délégué par un groupe d’électeurs vivant, si possible, réunis par leurs conditions de travail.
Mais la caractéristique fondamentale de tout le système ne réside pas dans cette modalité, qui n’a pas de vertu miraculeuse, mais dans le critère établissant le droit électoral, actif et passif, aux seuls travailleurs, et le niant aux bourgeois.
En ce qui concerne la formation des Soviets municipaux, on tombe souvent dans deux erreurs.
L’une, c’est de penser que les délégués à ces Soviets doivent être élus par les conseils d’usine ou les comités d’usine (commissions exécutives des commissaires d’ateliers) alors qu’au contraire (c’est volontairement que nous répétons certains points) ces délégués sont élus directement par la masse des électeurs. Cette erreur se retrouve dans le projet de Bombacci pour la constitution des Soviets en Italie au paragraphe 6.
L’autre erreur, c’est de penser que le Soviet est un organisme constitué avec des représentants désignés tout simplement par le Parti socialiste, par les syndicats et les conseils d’entreprise. Les propositions du camarade Ambrosini, par exemple, tombent dans cette erreur.
Une telle méthode peut à la rigueur servir à former rapidement et provisoirement les Soviets, si c’est nécessaire, mais ne correspond pas à leur structure définitive.
En Russie, un petit pourcentage de délégués aux Soviets vient ainsi s’ajouter à ceux élus directement par les prolétaires électeurs.
Mais en réalité, le Parti Communiste et d’autres partis obtiennent leurs représentants en proposant aux électeurs des membres éprouvés de leurs organisations et en agitant face aux électeurs leur programme.
Un Soviet, selon nous, n’est révolutionnaire que lorsque la majorité de ses membres est inscrite au Parti Communiste.
Tout ceci, bien entendu, se réfère à la période de la dictature prolétarienne. Et surgit donc la question : quelle utilité, quelles fonctions, quels caractéristiques doivent avoir les conseils ouvriers, alors qu’existe encore la dictature de la bourgeoisie ?
En Europe centrale, les Conseils ouvriers coexistent actuellement avec l’Etat démocratique bourgeois, d’autant plus contre-révolutionnaire qu’il est républicain et social-démocrate. Quelle valeur a cette représentation du prolétariat, quand elle n’est pas le dépositaire du pouvoir et la base de l’Etat ? Agit-elle au moins comme un organe de lutte efficace pour la réalisation de la dictature prolétarienne ?
Un article du camarade autrichien Otto Maschl dans « Nouvelle Internationale » de Genève répond à cette question.
Il affirme qu’en Autriche les Conseils se sont paralysés eux-mêmes, qu’ils ont abdiqué et remis le pouvoir dans les mains de l’assemblée nationale bourgeoise.
En Allemagne, au contraire, après que, selon Maschl, les majoritaires et les indépendants en soient sortis, ceux-ci devinrent de véritables centres de bataille pour l’émancipation prolétarienne, et Noske dut les écraser pour que la social-démocratie puisse gouverner.
En Autriche, toujours selon Maschl, l’existence des Conseils au milieu de la démocratie, ou plutôt l’existence de la démocratie malgré les conseils, prouve que ces Conseils ouvriers sont loin d’être ce qui, en Russie, s’appelle Soviet. Et il émet des doutes sur la possibilité de surgissement, au moment de la révolution, de Soviets véritablement révolutionnaires, qui deviennent les dépositaires du pouvoir prolétarien, à la place des conseils actuels domestiqués.
Le programme du Parti approuvé à Bologne déclare que les Soviets doivent être constitués en Italie comme organes de la lutte révo1utionnaire. Le projet Bombacci tend à développer cette proposition de formation des Soviets de façon concrète.
Avant de nous occuper des aspects particuliers, nous discuterons les concepts généraux dont le camarade Bombacci s’est inspiré.
Tout d’abord, nous demandons — et qu’on ne nous traite pas de pédants — un éclaircissement. Dans la phrase : « c’est seulement une institution nationale plus large des Soviets qui pourra canaliser la période actuelle vers la lutte révolutionnaire finale contre le régime bourgeois et sa fausse illusion démocratique : le parlementarisme », faut-il comprendre que le parlementarisme est cette institution plus large, ou cette illusion démocratique ?
Nous craignons que la première interprétation soit à retenir, car elle correspond au chapitre traitant du programme d’action des Soviets, qui est un étrange mélange des fonctions de ceux-ci avec l’activité parlementaire du Parti.
Si c’est sur ce terrain équivoque que les Conseils à constituer doivent agir, il vaut certainement mieux ne rien constituer du tout.
Que les Soviets servent à élaborer des projets de législation socialiste et révolutionnaire que les députés socialistes proposeront à l’Etat bourgeois, voilà en effet une proposition qui fait la paire avec celle relative au soviétisme communalo-électoraliste de notre D.L.
Pour l’instant, nous nous bornons à rappeler à nos camarades, auteurs de tels projets, une des conclusions de Lénine qui figure dans la déclaration approuvée au Congrès de Moscou : « Il faut rompre avec ceux qui trompent le prolétariat en proclamant qu’il peut réaliser ses conquêtes dans le cadre bourgeois, ou en proposant une combinaison ou une collaboration entre les instruments de domination de la bourgeoisie et les nouveaux organes prolétariens ».
Si les premiers visés sont les sociaux-démocrates — qui ont encore droit de cité dans notre parti — ne faut-il pas reconnaître dans les seconds les maximalistes électoralistes, préoccupés de justifier l’activité parlementaire et municipale par de monstrueux projets pseudo-soviétistes ?
Nos camarades de la fraction qui l’a emporté à Bologne ne voient-ils pas qu’ils sont bien en dehors même de cet électoralisme communiste qu’on pourrait opposer — avec les arguments de Lénine et de certains communistes allemands — à notre irréductible abstentionnisme de principe ?
V (Il Soviet, IIIème année, n° 7 du 22-2-1920)
Avec cet article nous voulons conclure notre exposé, quitte à reprendre la discussion lors de polémiques avec les camarades qui, sur d’autres journaux, ont effectué des observations sur notre point de vue.
La discussion s’est désormais généralisée à toute la presse socialiste. Ce que nous avons lu de meilleur sont les articles de C. Niccolini sur l’ » Avanti ! », écrits avec une grande clarté et pourvus d’une véritable conception communiste, et avec lesquels nous sommes parfaitement d’accord.
Les Soviets, les conseils d’ouvriers, paysans (et soldats), sont la forme que prend la représentation du prolétariat dans l’exercice du pouvoir après le renversement de l’Etat capitaliste.
Avant la conquête du pouvoir, quand la bourgeoisie domine encore politiquement, il peut arriver que certaines conditions historiques, qui correspondent probablement à de sérieuses convulsions de l’organisation institutionnelle de l’Etat bourgeois et de la société, provoquent l’apparition des Soviets, et il peut être tout à fait opportun que les communistes poussent et aident à la naissance de ces nouveaux organes du prolétariat.
Il doit cependant rester bien clair que leur formation ne peut pas résulter d’un procédé artificiel ou de l’application d’une recette — et que de toute façon, le fait que les conseils ouvriers, qui seront la forme de la révolution prolétarienne, se soient constitués ne signifie pas que le problème de la révolution ait été résolu, ni même que les conditions infaillibles de la révolution aient été réalisées. Elle peut faillir — nous en donnerons des exemples — même là où les conseils existent, s’ils ne sont pas imprégnés de la conscience politique et historique communiste, condensés, dirais-je, dans le parti politique communiste.
Le problème fondamental de la révolution est donc celui de la tendance du prolétariat à abattre l’Etat bourgeois et à prendre en main le pouvoir. Cette tendance existe dans les vastes masses de la classe ouvrière en tant que résultat direct des rapports économiques d’exploitation par le capital qui détermine, pour le prolétariat, une situation intolérable, et le poussent à dépasser les formes sociales existantes.
Mais le but des communistes est de diriger cette violente réaction des foules et de lui donner une meilleure efficacité. Les communistes – comme le disait déjà le « Manifeste » – connaissent mieux que le reste du prolétariat les conditions de la lutte des classes et de l’émancipation du prolétariat ; la critique qu’ils font de l’histoire et de la constitution de la société leur donnent la possibilité de prévoir avec une assez grande exactitude le développement du processus révolutionnaire.
C’est pourquoi les communistes construisent le parti politique de classe qui se propose l’unification des forces prolétariennes, l’organisation du prolétariat en classe dominante à travers la conquête révolutionnaire du pouvoir.
Quand la révolution est proche et que dans la réalité de la vie sociale ses conditions sont mûres, il faut qu’existe un fort parti communiste, qui doit avoir une conscience extrêmement précise des événements qui se préparent.
Les organes révolutionnaires qui, après la chute de la bourgeoisie, exercent le pouvoir prolétarien et représentent les bases de l’Etat révolutionnaire, sont ce qu’ils doivent être dans la mesure où ils sont dirigés par les travailleurs conscients de la nécessité de la dictature de leur classe — c’est-à-dire par les travailleurs communistes. Là où cela ne serait pas le cas, ces organes cèderaient le pouvoir conquis et la contre-révolution triompherait.
Voilà pourquoi, si ces organes doivent surgir et si les communistes doivent à un moment donné s’occuper de leur formation, il ne faut pas croire qu’ils constituent un moyen de contourner les positions de la bourgeoisie et de venir à bout facilement, presque automatiquement, de sa résistance et de sa défense du pouvoir.
Les soviets, organes d’Etat du prolétariat victorieux, peuvent-ils être des organes de la lutte révolutionnaire du prolétariat lorsque le capitalisme domine encore dans l’Etat ? Oui, mais au sens qu’ils peuvent constituer, à un certain stade, un terrain adéquat pour la lutte révolutionnaire que mène le parti. Et à ce stade, le parti tend à se constituer ce terrain, ce regroupement de forces.
En sommes-nous, aujourd’hui en Italie, à ce stade de la lutte ?
Nous pensons que nous en sommes très proches, mais qu’il y a un stade préalable qu’il faut dépasser d’abord.
Le parti communiste, qui devrait agir dans les Soviets, n’existe pas encore, Nous ne disons pas que les Soviets l’attendront pour surgir : il pourra se faire que les événements se présentent autrement. Mais alors, un grave danger se dessinera : l’immaturité du parti fera tomber ces organismes dans les mains des réformistes, des complices de la bourgeoisie, des saboteurs ou des falsificateurs de la révolution.
Et alors nous pensons que le problème de constituer en Italie un véritable parti communiste est beaucoup plus urgent que celui de créer les Soviets.
On peut également accepter d’étudier ensemble ces deux problèmes, et poser les conditions pour les affronter ensemble sans retard, mais sans fixer une date schématique pour une inauguration quasi officielle des Soviets en Italie.
Déterminer la formation d’un parti véritablement communiste signifie sélectionner les communistes, les séparer des réformistes et sociaux-démocrates. Certains camarades pensent que la proposition même de former les Soviets peut offrir le terrain de cette sélection. Nous ne le croyons pas — précisément parce que le Soviet n’est pas, d’après nous, un organe révolutionnaire par essence.
De toute façon, si la naissance des soviets doit être une source de clarification politique, nous ne voyons pas comment on pourrait y arriver sur la base d’une entente — comme dans le projet Bombacci — entre réformistes, maximalistes, syndicalistes et anarchistes.
Par contre, le fait de mettre au premier plan de nouveaux organismes anticipant sur les formes futures, tels les conseils d’usine, ou les Soviets, ne pourra jamais créer un mouvement révolutionnaire sain et efficace en Italie ; c’est une tentative aussi illusoire que celle de soustraire l’esprit révolutionnaire au réformisme en le transportant dans les syndicats, considérés comme noyaux de la société future.
Cette sélection, nous ne la réaliserons pas grâce à une nouvelle recette, qui ne fait peur à personne, mais bien par l’abandon des vieilles « recettes », des méthodes pernicieuses et fatales. Pour les raisons bien connues, nous pensons que cette méthode à abandonner, en faisant en sorte qu’avec elle les non-communistes soient éliminés de nos rangs, c’est la méthode électorale — nous ne voyons pas d’autre voie pour la naissance d’un parti communiste digne d’adhérer à Moscou.
Travaillons dans ce sens — en commençant, comme dit très justement Niccolini, par élaborer une conscience, une culture politique parmi les chefs, à travers une étude sérieuse des problèmes de la révolution, non entravée par la bâtarde activité électorale, parlementaire, minimaliste.
Travaillons dans ce sens-là — faisons davantage de propagande pour la conquête du pouvoir, pour la conscience de ce que sera la révolution, de ce que seront ses organes, de l’action véritable des Soviets — et nous aurons véritablement travaillé pour constituer les conseils du prolétariat et conquérir en eux la direction révolutionnaire qui ouvrira les voies lumineuses du communisme.