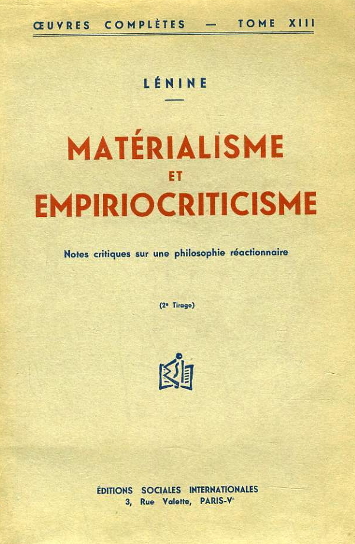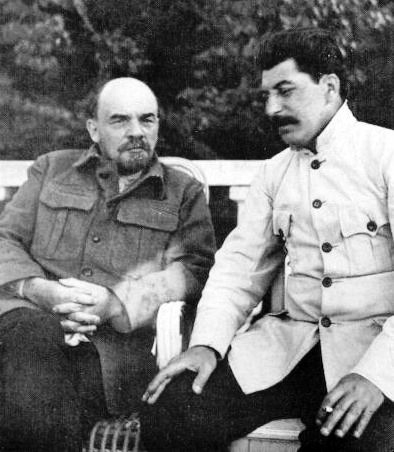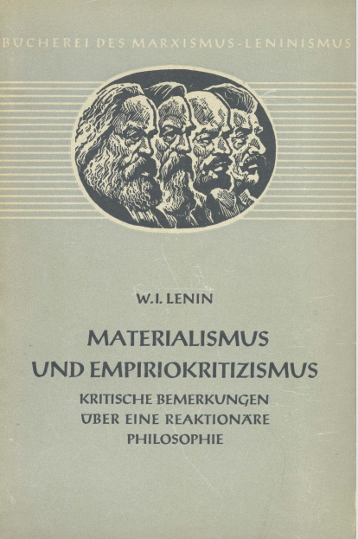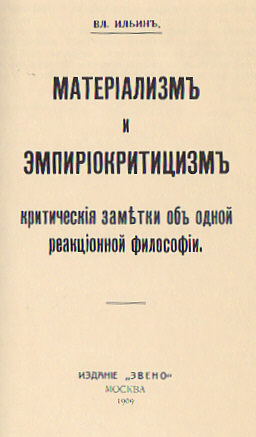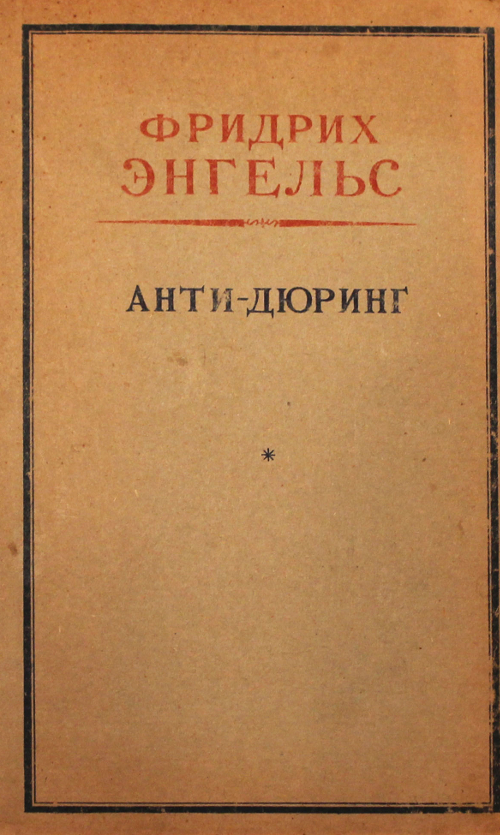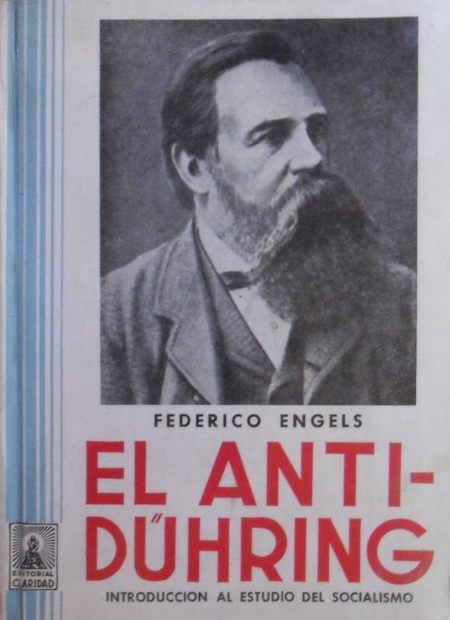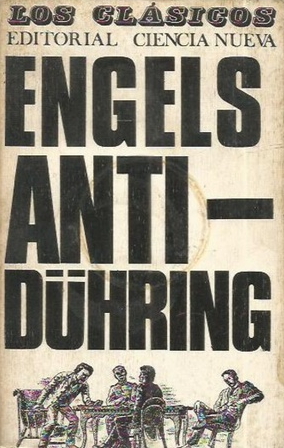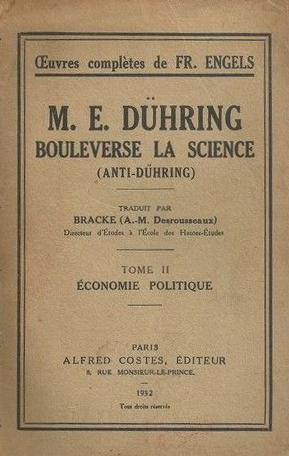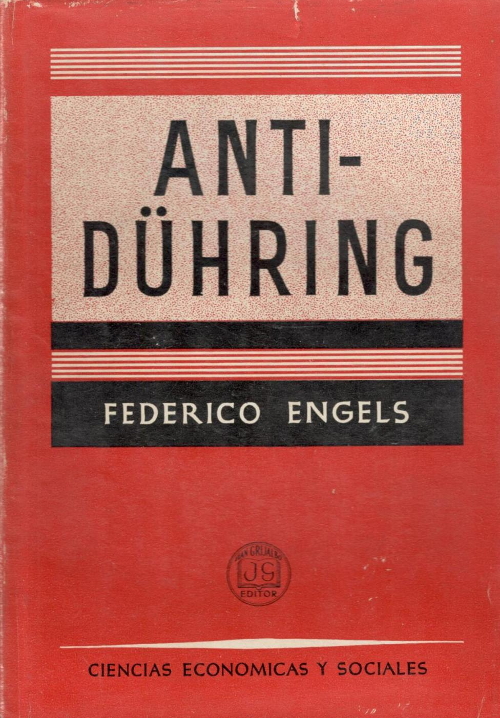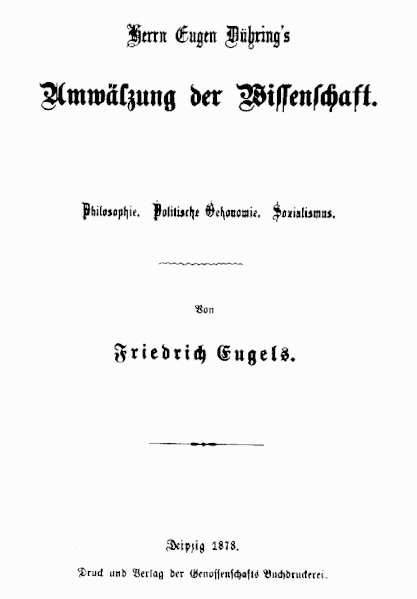On comprend que Matérialisme et empirio-criticisme soit une œuvre d’une grande richesse, tout en étant très complexe.
Lénine passe en revue les points de vue des pseudo-marxistes adoptant l’empirio-criticisme, et de cette négation de la négation du marxisme, il propose une définition correcte du marxisme.
La reconnaissance des sens contre l’idéalisme, oui, mais uniquement avec la reconnaissance de la conscience comme reflet, et avec la pratique comme véritable élément permettant d’assumer la réalité en tant que telle.
Lénine souligne ainsi :
« La pratique est la meilleure réfutation de l’agnosticisme de Kant et de Hume, comme du reste de tous les autres subterfuges (Schrullen) philosophiques, répète Engels.
« Le résultat de notre action démontre la conformité (übereinstimmung) de nos perceptions avec la nature objective des objets perçus », réplique Engels aux agnostiques. »
L’empirio-criticisme n’est ainsi qu’une forme intermédiaire – ce qui est impossible – entre idéalisme et matérialisme, sur la base de l’existence d’un « troisième élément ».
Lénine affirme ainsi :
« Le génie de Marx et d’Engels s’est manifesté entre autres par leur dédain du jeu pédantesque des mots nouveaux, des termes compliqués, des « ismes » subtils, et par leur simple et franc langage : il y a en philosophie une tendance matérialiste et une tendance idéaliste et, entre elles, diverses nuances d’agnosticisme.
Les efforts tentés pour trouver un « nouveau » point de vue en philosophie révèlent la même indigence intellectuelle que les tentatives laborieuses faites pour créer une « nouvelle » théorie de la valeur, une « nouvelle » théorie de la rente, etc.
Carstanjen, élève d’Avenarius, relate que ce dernier a dit une fois au cours d’un entretien privé : « Je ne connais ni le physique ni le psychique ; je ne connais qu’un troisième élément. »
Répondant à un écrivain qui avait fait observer qu’Avenarius ne définissait pas ce troisième élément, Petzoldt a dit : « Nous savons pourquoi il n’a pas pu formuler cette conception. C’est parce que le troisième élément n’a pas de contre‑terme (Gegenbegriff, notion corrélative)…
La question : Qu’est‑ce que le troisième élément ? manque de logique » (Einführung in die Philosophie der reinen Erfahrung, t. II, p. 329).
Que cette dernière conception ne puisse être définie, Petzoldt le comprend.
Mais il ne comprend pas que la référence au « troisième élément » n’est qu’un simple subterfuge, chacun de nous sachant fort bien ce que c’est que le physique et le psychique, mais nul de nous ne sait encore ce que c’est que le « troisième élément ».
Avenarius n’use de ce subterfuge que pour brouiller la piste ; il déclare en fait que le Moi est la donnée première (terme central), et la nature (le milieu) la donnée seconde (contre‑terme). »
Il y a une conséquence essentielle qui découle de l’existence d’un « troisième terme » : c’est la considération selon laquelle la nature n’est qu’un chaos, l’ordre qu’on y retrouve n’étant vu que par l’être humain dans la mesure où il a un rapport avec ce chaos, dans la mesure où la mesure y voit des « lois » qui lui sont utiles.
La science, pour l’empirio-criticisme, n’est qu’un langage symbolique au moyen duquel l’humanité voit des espaces organisés arbitraires, qu’il a lui-même décidé, dans un chaos total :
« Nous sommes en présence d’un idéaliste subjectif, pour lequel le monde extérieur, la nature, ses lois, ne sont que les symboles de notre connaissance ; mais il a revêtu l’habit d’arlequin d’une terminologie « moderne » bigarrée et criarde.
Le torrent du donné est dépourvu de raison, d’ordre, de tout ce qui est conforme aux lois : notre connaissance y introduit la raison.
Les corps célestes, la terre y comprise, sont des symboles de la connaissance humaine.
Si les sciences de la nature nous enseignent que la terre existait bien avant que la matière organique et l’homme aient pu faire leur apparition, nous avons cependant changé tout cela !
Nous mettons de l’ordre dans le mouvement des planètes, c’est là un produit de notre connaissance. »
Lénine se moque de cette logique, qui amène les saisons à ne pas exister naturellement, mais comme « choix » arbitraire de l’humanité :
« Ainsi, la loi d’après laquelle l’hiver suit l’automne et le printemps l’hiver, ne nous est pas donnée par l’expérience ; elle est créée par la pensée, comme un moyen d’organiser, d’harmoniser, d’agencer… quoi et avec quoi, camarade Bogdanov ?
« L’empiriomonisme n’est possible que parce que la connaissance harmonise activement l’expérience, en en éliminant les innombrables contradictions, en lui créant des formes organisatrices universelles, en substituant au monde chaotique primitif des éléments un monde dérivé, ordonné de rapports » (p. 57).
C’est faux.
L’idée que la connaissance peut « créer » des formes universelles, substituer l’ordre au chaos primitif, etc., appartient à la philosophie idéaliste.
L’univers est un mouvement de la matière, régi par des lois, et notre connaissance, produit supérieur de la nature, ne peut que refléter ces lois.
Il s’ensuit que nos disciples de Mach, ayant une confiance aveugle dans les professeurs réactionnaires « modernes », répètent sur le problème de la causalité les erreurs de l’agnosticisme de Kant et de Hume, sans s’apercevoir de la contradiction absolue de cet enseignement avec le marxisme, c’est‑à‑dire avec le matérialisme, ni du fait qu’ils glissent sur un plan incliné vers l’idéalisme. »
>Sommaire du dossier sur
Lénine : Le matérialisme contre l’empirio-criticisme