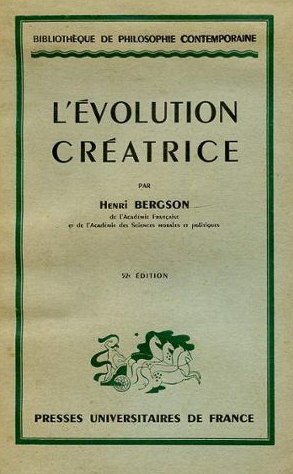Georges Politzer (1903-1942), d’origine juive hongroise, a été le grand penseur se consacrant au matérialisme dialectique en France, mais ses limites sont patentes. Dans le plus pur style français, Georges Politzer considère que le matérialisme est un prolongement de la pensée de René Descartes, et que le matérialisme dialectique est un matérialisme amélioré au moyen d’une « méthode » (qui serait la dialectique).
Si ses exposés sur le matérialisme dialectique sont clairs et concis, ils n’ont pas d’âme et de fait le Parti Communiste français, dont il formait les cadres en ce domaine, fut d’une extrême faiblesse.
Il y a une autre aspect important concernant Georges Politzer. En 1928, il publia « Critique des fondements de la psychologie ». Or, selon le thorézien de gauche Louis Althusser, cette œuvre a aidé le bergsonisme. Louis Althusser considère ainsi que :
« La Critique est un texte génial, mais faux, et profondément idéaliste.
Son génie est d’avoir compris l’importance décisive de Freud à un moment où presque personne en France ne la soupçonnait, — son erreur est d’en avoir donné une exposition à 100 % idéaliste, et très précisément existentialiste.
Ce n’est pas par une mauvaise lecture de Georges Politzer que Sartre et Merleau en ont tiré le parti que nous savons : c’est malheureusement par une lecture fidèle de Georges Politzer : le seul maître de Sartre est Georges Politzer, son seul vrai maître (avec… aussi paradoxal que cela paraisse, Bergson !
L’influence de Husserl est beaucoup plus superficielle chez lui, malgré les nombreux emprunts terminologiques qu’il lui a faits). »
Lettre de Louis Althusser à Guy Besse, 23 juin 1965
De fait, Georges Politzer fut le fondateur de la Revue de psychologie concrète, et il a formulé un marxisme qui consistait pratiquement, justement, en cette « psychologique concrète ». C’est là une déviation « psychologique » du marxisme typiquement française.
Dans Critique des fondements de la psychologie, Georges Politzer tente ainsi de replacer la psychanalyse dans son contexte, affirmant qu’il s’agit d’en étudier les aspects pouvant servir à une psychologie authentique. A ses yeux, la psychanalyse assume le réel, contre la psychologie bourgeoise, elle est d’« inspiration nouvelle, contraire à celle de la psychologie classique ».
Georges Politzer rejette donc l’aspect idéaliste marqué de Sigmund Freud, mais pense qu’il y a une voie à suivre, au-delà de la psychanalyse. En quelque sorte, Georges Politzer avait compris qu’il fallait fermer la porte à la psychanalyse en tant que telle, mais il pensait qu’il y avait des éléments intéressants ; Louis Althusser s’ouvrira quant à lui justement à la psychanalyse et devait donc rejeter Georges Politzer.
La critique de la psychanalyse par Georges Politzer était suffisante, et elle fut repris positivement par d’autres qui l’ont découvert notamment à travers lui. Par la suite, Georges Politzer ne cessera d’accentuer sa lutte contre la psychanalyse ; en 1933 il constate dans Psychanalyse et Marxisme, Un faux contre-révolutionnaire, le ‘Freudo-Marxisme’ :
« Jamais à aucun moment, il (Freud) n’a dépassé les limites de la culture bourgeoise littéraire et médicale, contrairement, par exemple à Marx et Engels. Ainsi il n’a pas la moindre idée de la méthode dialectique. »
Il critique la psychanalyse de la manière suivante, l’accusant de nier les classes au profit d’une vision des individus conduit par leur libido :
« Le matérialiste marxiste montre derrière la vertu du bourgeois ‘’ la convoitise, l’avarice, la cupidité, la chasse aux profits et les manœuvres à la Bourse ‘’- derrière la philanthropie patronale, les tentatives de corruption.
Mais le psychanalyste ramène tout cela à la libido. Et comme il y ramène aussi l’avarice, la cupidité, la chasse aux profits et les manœuvres à la Bourse, le bourgeois se trouve absous de son humiliation.
Et la seule chose qui pourrait encore l’inquiéter et qui l’a, en fait, inquiété dans les débuts de la psychanalyse, le rappel du génital dans la libido, les psychanalystes l’ont supprimé au milieu des contorsions les plus compliquées !
Que de fois n’ont-ils répété qu’il ne fallait pas confondre « sexuel » et « génital », que « libido » ne signifie pas « érotisme génital (…)
Mais il est clair que les contorsions psychanalytiques étaient destinées à calmer les bourgeois.
Les psychanalystes qui parlent tant de la peur devant la morale bourgeoise se sont eux-mêmes dégonflés devant elle lamentablement.
Pour calmer ‘’l’idéalisme’’ philistin, ils ont castré la libido et en ont fait l’énergie sexuelle des eunuques. Par ce procédé, ils l’ont calmé effectivement. La psychanalyse ne fait plus scandale (…).
Ici, encore, les psychanalystes se sont rencontrés avec un courant idéologique réactionnaire. L’irrationnel, l’inconscient sont donc la loi de la vie de l’âme.
Le passage du point de vue théorique au point de vue normatif fut accompli aisément : puisqu’en fait la vie mentale est basée sur l’inconscient dynamique, pourquoi lutter contre l’inconscient au lieu de se plonger en lui ?
Ainsi la psychanalyse qui est apparue tout d’abord comme donnant des mystiques sacrées des explications profanes et qu’on a accusées même d’être profanatrices – a fini par appuyer la mystique sous toutes ses formes.
Les contacts multiples établis entre la religion et la psychanalyse, la fréquence des thèmes psychanalytiques chez les obscurantistes de toute sortes, y compris les nazis, le prouvent suffisamment (…).
La voie des découvertes réelles et de la science effective de l’homme ne passe pas par les ‘raccourcis’ sensationnels de la psychanalyse. Elle passe par l’étude précise des faits physiologiques et historiques, à la lumière de cette conception dont l’ensemble des sciences modernes de la nature garantit la solidité (…).
La psychanalyse a incontestablement enrichi l’arsenal idéologique de la contre-révolution. »
A la fin de l’année 1939, il dit ainsi dans La fin de la psychanalyse :
« Il suffit de feuilleter n’importe quel ouvrage psychanalytique pour se rendre compte à quelles puérilités peut aboutir la ‘sociologie freudienne’. Indiquons seulement qu’en fait Freud et ses disciples ont été amenés à proposer les ‘complexes’ à la place des forces motrices réelles de l’histoire. La ‘sociologie’ à laquelle ils ont abouti ainsi fait apparaître à la surface l’idéalisme que la doctrine contient à la base.
Par cet aspect des théories psychanalytiques, le mouvement issu de Freud a rejoint, par-delà la réaction philosophique, la réaction sociale et politique ».
Georges Politzer a donc compris la psychanalyse, mais il n’a pas su la réfuter autrement que politiquement : il en est allé de même avec Henri Bergson.
En 1929, Georges Politzer publia en effet Une imposture philosophique : le bergsonisme. Dans la logique des choses, il devrait s’agit d’une critique matérialiste dialectique de l’approche de Henri Bergson.
Or, comme dans la critique de la psychanalyse, Georges Politzer reste seulement sur le terrain du « matérialisme » : il dénonce l’idéalisme, reproche le manque de concret, mais il n’utilise aucun concept matérialiste dialectique. La théorie du reflet est absolument inconnu et on est très loin du niveau atteint par l’Afghan Akram Yari ou encore le Bangladeshi Siraj Sikder.
Pour Georges Politzer, le bergsonisme est un « artifice scandaleux » : comme aux yeux de Georges Politzer, Henri Bergson n’est pas matérialiste, sa conception est considérée comme fausse. Or, ce n’est pas du tout ainsi qu’il faut les choses : il aurait fallu considérer le bergsonisme comme un système très élaboré et faisant face au matérialisme dialectique.
Sauf que pour Georges Politzer, il n’y a pas non plus de matérialisme dialectique comme système, mais seulement une approche matérialiste. Il ne peut donc pas voir la substance réelle du bergsonisme, seulement les défauts en série, les oppositions au matérialisme.
Georges Politzer constate donc, de manière correcte au sujet de Henri Bergson, que :
ce qu’il veut, ce n’est pas abandonner le réalisme en général, mais remplacer le réalisme dans l’espace par le réalisme dans la « durée ».
Mais il en reste à une défense du « concret », s’orientant par rapport à « l’individu singulier ». Il ne connaît pas la théorie du reflet ; il ne traite pas de l’humanité en général, mais tente de percevoir une psychologie « concrète » individuelle, reprochant à Henri Bergson de ne pas s’installer réellement dans l’individuel, etc.
Voici un exemple de la critique idéaliste-individualiste de Georges Politzer :
Les sons d’une cliche lointaine qu’on entend et que l’on ne compte pas, les pas qui résonnent dans la rue et qui s’organisent en mélodie suivant un rythme déterminé, voilà des données immédiates [il s’agit d’exemples pris par Bergson].
Mais ce que M. Bergson oublie, c’est que pour une psychologie vraiment concrète, ces « faits » ont tout juste autant d’importance qu’ils en ont dans la vie d’un individu concret (…). L’homme n’est jamais une ombre, mais il est précisément homme, c’est la vie actuelle qui est sa vie et celle-ci est une, de même qu’elle est unique.
C’est là une vision selon laquelle l’individu « pense », en contradiction complète avec la théorie du reflet, depuis Avicenne jusqu’à Karl Marx, en passant par Baruch Spinoza, pour qui la seule chose qui soit « une » est l’univers.
Georges Politzer oppose par conséquent, dans une perspective qui se veut « matérialiste » ou « rationaliste », le « concret » à l’abstrait ; il attaque Henri Bergson uniquement dans cette perspective :
« Si l’on conserve les démarches fondamentales de la psychologie classique, on voudra toujours saisir le concret en faisant subit au langage de la psychologie classique une modification de forme, mais comme on garde l’essentiel qui renferme l’abstraction, c’est à l’aide de l’abstrait qu’on veut trouver le concret. Tel est précisément le cas de M. Bergson. »
Georges Politzer dit même que « le bergsonisme n’est d’un bout à l’autre qu’une promesse non tenue » ; comme pour la psychanalyse, Georges Politzer dénonce l’idéalisme, mais il ne parvient pas à formuler le point de vue matérialiste dialectique. Il en reste au matérialisme, devant prétendument conduire au matérialisme dialectique. Georges Politzer résume cette perspective en disant :
« Le matérialisme avait lutté depuis le XIIIe siècle contre tout le système idéologique et sentimental destiné à détourner la majorité des hommes de tout ce qui est réel, afin que la minorité puisse profiter à la fois du réel et de ceux qui s’en détournent.
Engendré par la volonté de revenir à ce qui est et de vivre, il a réveillé dans l’homme la volonté du concret et de la vie. Cette volonté ne reçoit l’organisation dont elle a besoin pour se réaliser que du matérialisme dialectique. »
On est ici dans une psychologie existentialiste de gauche, dans la même perspective que Jean-Paul Sartre et Albert Camus, pas dans le cadre du matérialisme dialectique.