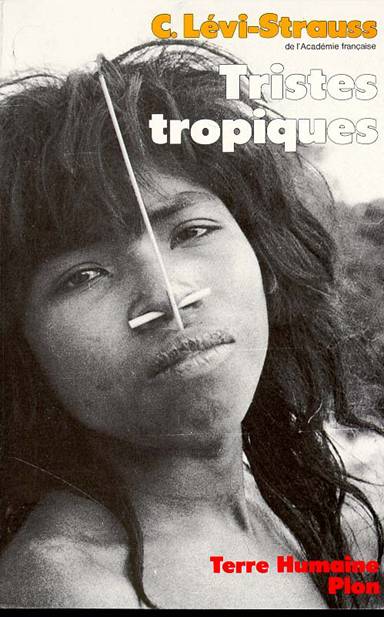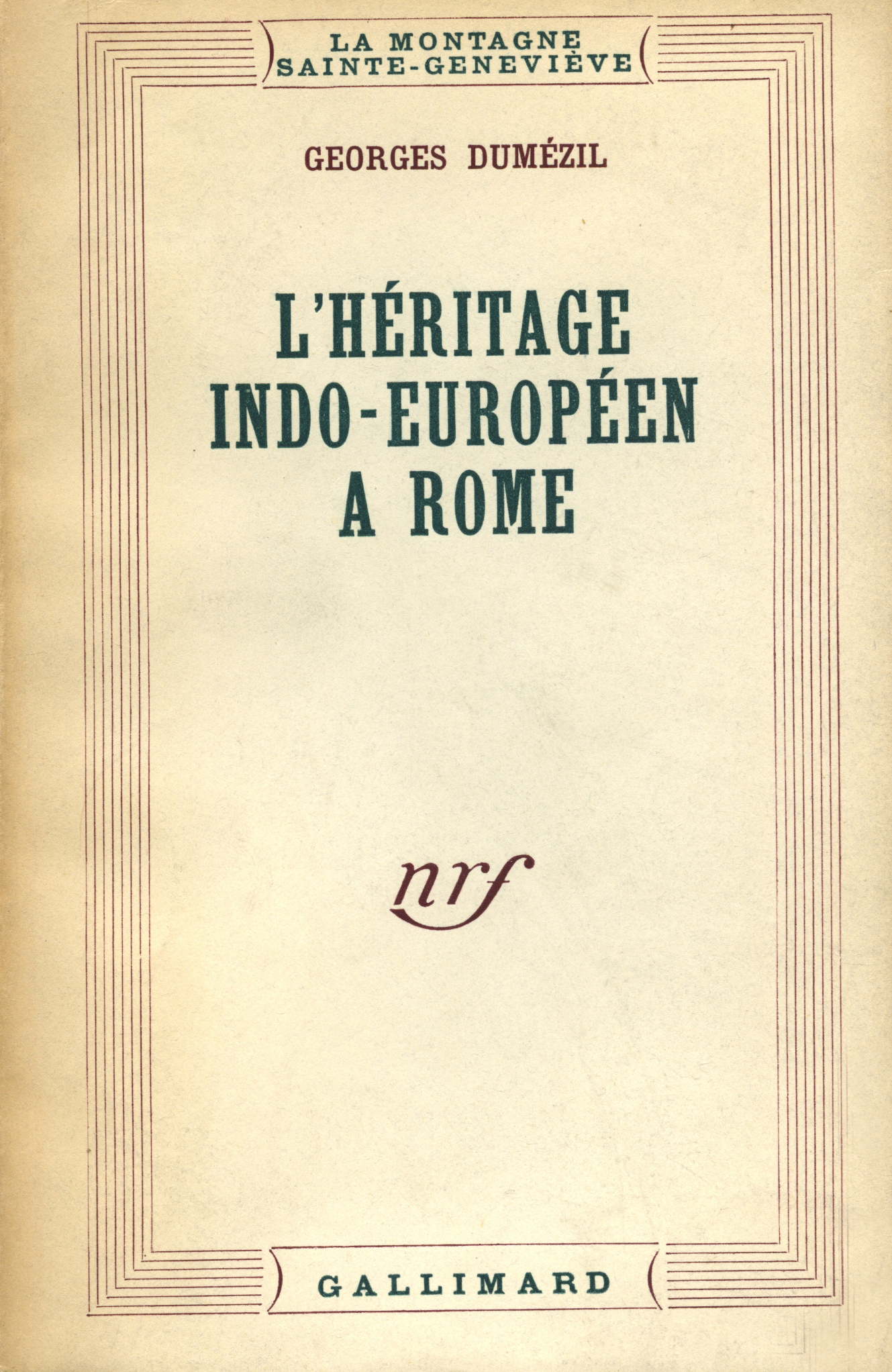Le structuralisme s’est, dès le départ, largement tourné vers la psychanalyse.
C’était inévitable, car il s’agit finalement d’un prolongement surtout de la phénoménologie d’Edmund Husserl, qui ramène tout phénomène à une saisie par la conscience.
Le structuralisme baigne dans une atmosphère psychologisante ; c’est là quelque chose de spécifiquement français, dont Henri Bergson est le produit le plus connu, mais on peut également penser aux romans de Georges Bernanos.
Les mots, dans leur rapport à la pensée, puis à la réalité, se voient attribuer une forme pratiquement magique.
Le structuralisme s’appuie directement sur la notion de langage comme forme partant dans tous les sens et ayant pourtant un sens.
La découverte de ce sens est la clef de ce que le structuraliste se donne comme tâche, s’appuyant sur un domaine particulier pour trouver une pseudo-dynamique, cependant il va de soi que la question de l’esprit était centrale.

Ce qui joue ici comme idéologie, ce n’est pas tant la psychanalyse d’ailleurs que le surréalisme et ses prédécesseurs symbolistes-décadentistes.
L’œuvre de Jacques Lacan puise dans Freud et la psychanalyse, mais de manière lyrique-délirante, avec de véritables shows où il s’agite en prononçant des phrases spectaculaires sans qu’un sens réel se dégage.
Grande figure du structuralisme, Jacques Lacan considère à la fois que « l’inconscient est structuré comme un langage », et en même temps que tout discours relève de l’inconscient, non pas comme sous-produit mais directement comme parallèle.
C’est là une vision en « double » tout à fait dans l’esprit du structuralisme, où la structure est « structurée » et en même temps « structurante ».
Il dit ainsi :
« Une œuvre écrite n’imite pas l’effet de l’inconscient.
Elle en pose l’équivalent, pas moins réel que lui, de le forger dans sa courbure ; l’œuvre littéraire n’existe que dans la courbure qui est celle même de la structure (…).
Elle en est le réel, et c’est en ce sens que l’œuvre n’imite rien.
Elle est en tant que fiction, structure véridique. »
Une œuvre d’art se voit, encore et toujours, comme avec Gérard Genette par exemple, attribuée une valeur transcendante, une valeur en soi, découplée de l’époque, de la société, de l’histoire, de la matière.
Ce qui compte encore et toujours, c’est la « structure » ; ici, chez Jacques Lacan, la psychanalyse permet de la découvrir et il devint, à ce titre, l’une des principales figures de la nouvelle psychanalyste, un courant portant directement son nom.
Et il existe un va-et-vient permanent : le langage est l’inconscient, l’inconscient est le langage lui-même.
Le psychanalyste n’est rien d’autre qu’un linguiste :
« Voyez les hiéroglyphes égyptiens : tant qu’on a cherché quel était le sens direct des vautours, des poulets, des bonshommes debout, assis, ou s’agitant, l’écriture est demeurée indéchiffrable.
C’est qu’à lui tout seul le petit signe “vautour” ne veut rien dire ; il ne trouve sa valeur signifiante que pris dans l’ensemble du système auquel il appartient.
Eh bien ! les phénomènes auxquels nous avons affaire dans l’analyse sont de cet ordre-là, ils sont d’un ordre langagier.
Le psychanalyste n’est pas un explorateur de continents inconnus ou de grands fonds, c’est un linguiste : il apprend à déchiffrer. »
Jacques Lacan se fonde d’ailleurs directement et ouvertement sur le structuralisme linguistique pour justifier sa propre approche :
« L’inconscient, à partir de Freud, est une chaîne de signifiants qui quelque part (sur une autre scène, écrit-il) se répète et insiste pour interférer dans les coupures que lui offre le discours effectif et la cogitation qu’il informe.
Dans cette formule, qui n’est nôtre que pour être conforme aussi bien au texte freudien qu’à l’expérience qu’il a ouverte, le terme crucial est le signifiant, ranimé de la rhétorique antique par la linguistique moderne, en une doctrine dont nous ne pouvons marquer ici les étapes, mais dont les noms de Ferdinand de Saussure et de Roman Jakobson indiqueront
l’aurore et l’actuelle culmination, en rappelant que la science
pilote du structuralisme en Occident a ses racines dans la Russie où a fleuri le formalisme.Genève 1910, Pétrograd 1920 disent assez pourquoi l’instrument en a manqué à Freud.
Mais ce défaut de l’histoire ne rend que plus instructif le fait que les mécanismes décrits par Freud comme ceux du processus primaire, où l’inconscient trouve son régime, recouvrent exactement les fonctions que cette école tient pour déterminer les versants les plus radicaux des effets du langage, nommément la métaphore et la métonymie, autrement dit les effets de substitution et de combinaison du signifiant dans les dimensions respectivement synchronique et diachronique où ils apparaissent dans le discours. »
Jacques Lacan, avec ce positionnement, va être une figure incontournable de la scène intellectuelle bourgeoise des grandes métropoles mondiales.