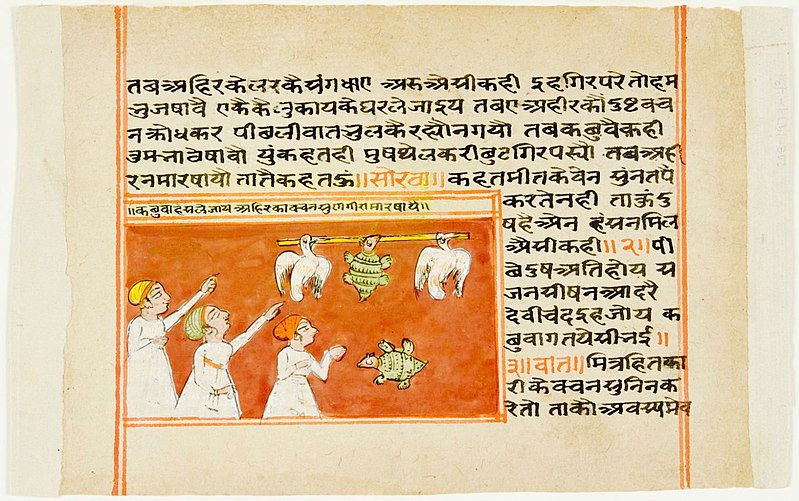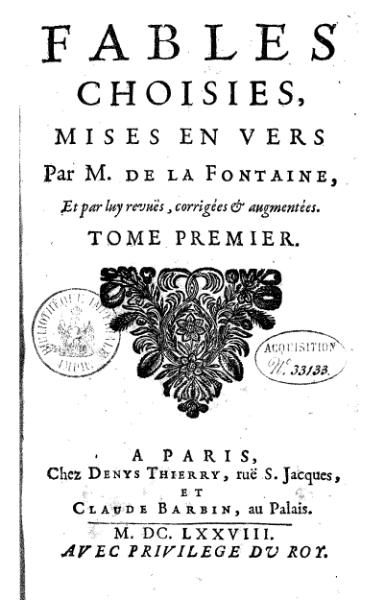Aux participants à la discussion économique.
Remarques
relatives aux questions économiques soulevées à la discussion de
novembre 1951
J’ai reçu tous les documents relatifs à la
discussion économique qui s’est déroulée autour de
l’appréciation du projet de manuel d’économie politique. J’ai
reçu notamment les « Propositions pour améliorer le projet de
manuel d’économie politique », les « Propositions pour
éliminer les erreurs et les imprécisions » du projet, ainsi
qu’un « Relevé des questions controversées ».
Pour tous ces matériaux, de même que pour le
projet de manuel, je tiens à faire les remarques suivantes.
1. À propos
du caractère des lois économiques
sous le socialisme
Certains camarades nient le caractère objectif
des lois de la science, notamment celui des lois de l’économie
politique sous le socialisme. Ils nient que les lois de l’économie
politique reflètent la régularité des processus qui se produisent
indépendamment de la volonté humaine.
Ils estiment que, étant donné le rôle
particulier que l’histoire réserve à l’État soviétique,
celui-ci, ses dirigeants, peuvent abolir les lois existantes de
l’économie politique, peuvent « former », « créer »
des lois nouvelles.
Ces camarades se trompent gravement. Ils
confondent visiblement les lois de la science reflétant les
processus objectifs dans la nature ou dans la société, qui
s’opèrent indépendamment de la volonté humaine, avec les lois
édictées par les gouvernements, créées par la volonté des hommes
et n’ayant qu’une force juridique. Mais il n’est point permis
de les confondre.
Le marxisme conçoit les lois de la science, —
qu’il s’agisse des lois de la nature ou des lois de l’économie
politique, — comme le reflet des processus objectifs qui s’opèrent
indépendamment de la volonté humaine. Ces lois, on peut les
découvrir, les connaître, les étudier, en tenir compte dans ses
actes, les exploiter dans l’intérêt de la société, mais on ne
peut les modifier ou les abolir.
À plus forte raison ne peut-on former ou créer
de nouvelles lois de la science.
Est-ce à dire, par exemple, que les résultats de
l’action des lois de la nature, des forces de la nature sont, en
général, inéluctables ; que l’action destructive des forces
de la nature se produit toujours et partout avec une spontanéité
inexorable, qui ne se prête pas à l’action des hommes ?
Évidemment non. Si l’on fait abstraction des
processus astronomiques, géologiques et quelques autres analogues,
où les hommes, même s’ils connaissent les lois de leur
développement, sont véritablement impuissants à agir sur eux ;
ils sont en maintes occasions loin d’être impuissants quant à la
possibilité d’agir sur les processus de la nature.
Dans toutes ces circonstances, les hommes, en
apprenant à connaître les lois de la nature, en en tenant compte et
en s’appuyant sur elles, en les appliquant avec habileté et en les
exploitant, peuvent limiter la sphère de leur action, imprimer aux
forces destructives de la nature une autre direction, les faire
servir à la société.
Prenons un exemple parmi tant d’autres. Aux
temps anciens, on considérait les débordements des grands fleuves,
les inondations, la destruction des habitats et des superficies
cultivées, comme un fléau contre lequel les hommes étaient
impuissants.
Mais avec le temps, avec le progrès des
connaissances humaines, les hommes ayant appris à construire des
barrages et des stations hydrauliques, on a trouvé moyen de
détourner de la société les inondations qui paraissaient autrefois
inéluctables.
Bien plus : on a appris à museler les forces
destructives de la nature, à les dompter pour ainsi dire, à faire
servir la puissance des eaux à la société et à l’exploiter pour
irriguer les champs, pour obtenir l’énergie électrique.
Est-ce à dire que l’on ait par là même aboli
les lois de la nature, les lois de la science, que l’on ait créé
de nouvelles lois de la nature, de nouvelles lois de la science ?
Évidemment non. La vérité est que toute cette
opération tendant à prévenir l’action des forces destructives de
l’eau et à l’exploiter dans l’intérêt de la société,
s’effectue sans que les lois de la science soient le moins du monde
violées, changées ou abolies, sans que de nouvelles lois de la
science soient créées. Au contraire, toute cette opération se fait
sur la base exacte des lois de la nature, des lois de la science, car
une violation quelconque des lois de la nature, la moindre atteinte à
ces lois amènerait la désorganisation, l’échec de cette
opération.
Il faut en dire autant des lois du développement
économique, des lois de l’économie politique, — qu’il
s’agisse de la période du capitalisme ou de la période du
socialisme. Là aussi, comme dans les sciences de la nature, les lois
du développement économique sont des lois objectives reflétant les
processus du développement économique qui se produisent
indépendamment de la volonté des hommes.
On peut découvrir ces lois, les connaître et,
s’appuyant sur elles, les exploiter dans l’intérêt de la
société, imprimer une autre direction à l’action destructive de
certaines lois, limiter la sphère de leur action, laisser le champ
libre aux autres lois qui se fraient un chemin, mais on ne peut les
détruire ou créer de nouvelles lois économiques.
Un des traits particuliers de l’économie
politique est que ses lois, à la différence des lois de la nature,
ne sont pas durables ; qu’elles agissent, du moins la plupart
d’entre elles, au cours d’une certaine période historique, après
quoi elles cèdent la place à d’autres lois.
Elles ne sont pas détruites, mais elles perdent
leur force par suite de nouvelles conditions économiques et quittent
la scène pour céder la place à de nouvelles lois qui ne sont pas
créées par la volonté des hommes, mais surgissent sur la base de
nouvelles conditions économiques.
On se réfère à l’Anti-Dühring
d’Engels, à sa formule selon laquelle l’abolition du capitalisme
et la socialisation des moyens de production permettront aux hommes
d’exercer leur pouvoir sur les moyens de production, de se libérer
du joug des rapports économiques et sociaux, de devenir les
« maîtres » de leur vie sociale. Engels appelle cette
liberté la « nécessité comprise ».
Et que peut vouloir dire la « nécessité
comprise » ? Cela veut dire que les hommes, après avoir
compris les lois objectives (la « nécessité »), les
appliqueront en toute conscience, dans l’intérêt de la société.
C’est pourquoi Engels y dit que :
Les
lois de leur propre pratique sociale, qui, jusqu’ici, se dressaient
devant eux comme des lois naturelles, étrangères et dominatrices,
sont dès lors appliquées par les hommes en pleine connaissance de
cause et par là dominées. (Anti-Dühring, Éditions
sociales, Paris, 1950, p. 322.)
Comme on voit, la formule d’Engels ne parle
nullement en faveur de ceux qui pensent que l’on peut abolir, sous
le socialisme, les lois économiques existantes et en créer de
nouvelles. Au contraire, elle ne demande pas leur abolition, mais la
connaissance des lois économiques et leur application judicieuse.
On dit que les lois économiques revêtent un
caractère spontané ; que l’action de ces lois est
inéluctable ; que la société est impuissante devant elles.
C’est faux.
C’est fétichiser les lois, se faire l’esclave
de ces lois. Il est prouvé que la société n’est pas impuissante
devant les lois ; qu’elle peut, en connaissant les lois
économiques et en s’appuyant sur elles, limiter la sphère de leur
action, les exploiter dans l’intérêt de la société et les
« dompter », comme cela se passe à l’égard des forces
de la nature et de leurs lois, comme le montre l’exemple cité plus
haut sur le débordement des grands fleuves.
On se réfère au rôle particulier que le pouvoir
des Soviets joue dans la construction du socialisme, et qui lui
permettrait de détruire les lois existantes du développement
économique et d’en « former » de nouvelles. Cela est
également faux.
Le rôle particulier du pouvoir des Soviets
s’explique par deux faits ; en premier lieu, le pouvoir des
Soviets ne devait pas remplacer une forme de l’exploitation par une
autre, comme ce fut le cas dans les vieilles révolutions, mais
liquider toute exploitation ; en second lieu, vu l’absence
dans le pays de germes tout prêts de l’économie socialiste, il
devait créer, pour ainsi dire, sur un « terrain vague »,
des formes nouvelles, socialistes, de l’économie.
Tâche assurément difficile et complexe, et qui
n’a pas de précédent. Néanmoins, le pouvoir des Soviets a rempli
ce devoir avec honneur. Non point parce qu’il a aboli soi- disant
les lois économiques existantes et en a « formé » de
nouvelles, mais uniquement parce qu’il s’appuyait sur la loi
économique de correspondance nécessaire entre les rapports de
production et le caractère des forces productives. Les forces
productives de notre pays, notamment dans l’industrie, portaient un
caractère social ; la forme de propriété était privée,
capitaliste.
Fort de la loi économique de correspondance
nécessaire entre les rapports de production et le caractère des
forces productives, le pouvoir des Soviets a socialisé les moyens de
production, en a fait la propriété du peuple entier, a aboli par là
le système d’exploitation et créé des formes d’économie
socialistes. Sans cette loi et sans s’appuyer sur elle, le pouvoir
des Soviets n’aurait pas pu s’acquitter de sa tâche.
La loi économique de correspondance nécessaire
entre les rapports de production et le caractère des forces
productives se fraie depuis longtemps la voie dans les pays
capitalistes. Si elle ne l’a pas encore fait pour se donner libre
cours, c’est qu’elle rencontre la résistance la plus énergique
des forces déclinantes de la société.
Ici nous nous heurtons à une autre particularité
des lois économiques. Alors que dans le domaine de la nature, la
découverte et l’application d’une nouvelle loi se poursuivent
plus ou moins sans entrave, dans le domaine économique la découverte
et l’application d’une nouvelle loi qui porte atteinte aux
intérêts des forces déclinantes de la société, rencontrent la
résistance la plus énergique de ces forces.
Il faut donc une force, une force sociale capable
de vaincre cette résistance. Cette force s’est trouvée dans notre
pays sous la forme de l’alliance de la classe ouvrière et de la
paysannerie constituant l’immense majorité de la société. Cette
force ne s’est pas encore trouvée dans les autres pays, dans les
pays capitalistes. C’est ce qui explique pourquoi le pouvoir des
Soviets a pu briser les forces anciennes de la société, et pourquoi
la loi économique de correspondance nécessaire entre les rapports
de production et le caractère des forces productives a été
appliquée avec une telle ampleur.
On dit que la nécessité d’un développement
harmonieux (proportionnel) de notre économie nationale permet au
pouvoir des Soviets d’abolir les lois économiques existantes et
d’en créer de nouvelles. Cela est absolument faux.
Il ne faut pas confondre nos plans annuels et nos
plans quinquennaux avec la loi économique objective du développement
harmonieux, proportionnel de l’économie nationale.
La loi du développement harmonieux de l’économie
nationale a surgi en contrepoids à la loi de concurrence et
d’anarchie de la production sous le capitalisme. Elle a surgi sur
la base de la socialisation des moyens de production, après que la
loi de concurrence et d’anarchie de la production a perdu sa force.
Elle est entrée en vigueur parce que l’économie socialiste d’un
pays ne peut être réalisée que sur la base de la loi du
développement harmonieux de l’économie nationale. C’est dire
que la loi du développement harmonieux de l’économie nationale
offre à nos organismes de planification la possibilité de planifier
correctement la production sociale. Mais on ne doit pas confondre la
possibilité avec la réalité.
Ce sont deux choses différentes. Pour transformer
cette possibilité en réalité, il faut étudier cette loi
économique, s’en rendre maître, il faut apprendre à l’appliquer
en pleine connaissance de cause ; il faut dresser des plans qui
reflètent pleinement les dispositions de cette loi. On ne saurait
dire que nos plans annuels et nos plans quinquennaux reflètent
pleinement les dispositions de cette loi économique.
On dit que certaines lois économiques, y compris
la loi de la valeur, qui fonctionnent chez nous, sous le socialisme,
sont des lois « transformées » ou même « foncièrement
transformées » sur la base de l’économie planifiée. Cela
est également faux.
On ne peut « transformer » des lois ;
et encore moins « foncièrement ». Si on peut les
transformer, on peut aussi les abolir, en y substituant des lois
nouvelles. La thèse de la « transformation » des lois
est une survivance de la fausse formule sur l’ « abolition »
et la « formation » des lois.
Bien que la formule de la transformation des lois
économiques soit depuis longtemps chose courante chez nous, force
nous sera d’y renoncer, pour être plus exact. On peut limiter la
sphère d’action de telles ou telles lois économiques, on peut
prévenir leur action destructive, si tant est qu’elle s’exerce,
mais on ne saurait les « transformer » ou les « abolir ».
Par conséquent, quand on parle de « conquérir »
les forces de la nature ou les forces économiques, de les
« dominer », etc., on ne veut nullement dire par là
qu’on peut « abolir » les lois de la science ou les
« former ».
Au contraire, on veut seulement dire par là que
l’on peut découvrir des lois, les connaître, les assimiler,
apprendre à les appliquer en pleine connaissance de cause, à les
exploiter dans l’intérêt de la société et les conquérir par ce
moyen, les soumettre à sa domination.
Ainsi, les lois de l’économie politique sous le
socialisme sont des lois objectives qui reflètent la régularité
des processus intervenant dans la vie économique indépendamment de
notre volonté. Nier cette thèse, c’est au fond nier la science ;
or nier la science, c’est nier la possibilité de toute prévision,
— c’est donc nier la possibilité de diriger la vie économique.
On pourrait dire que ce qui vient d’être avancé
est juste, universellement connu, mais qu’il n’y a là rien de
nouveau et que, par suite, on perdrait son temps à répéter des
vérités universellement connues. Sans doute, il n’y a là
vraiment rien de nouveau, mais on aurait tort de croire qu’on
perdrait son temps à répéter certaines vérités connues de nous.
C’est que, chaque année, des milliers de
nouveaux jeunes cadres viennent à nous, qui sommes le noyau
dirigeant ; ils brûlent de nous aider, de se faire valoir, mais
ils n’ont pas une éducation marxiste suffisante, ils ignorent
beaucoup de vérités bien connues de nous, et sont obligés d’errer
dans les ténèbres. Ils sont frappés par les prodigieuses
réalisations du pouvoir des Soviets, les succès peu communs du
régime soviétique leur tournent la tête, et les voilà qui
s’imaginent que le pouvoir soviétique « peut tout »,
que « rien ne l’embarrasse », qu’il peut abolir les
lois de la science, former des lois nouvelles.
Comment faire avec ces camarades ? Comment
les éduquer dans l’esprit du marxisme-léninisme ?
Je pense que la répétition systématique des
vérités dites « universellement connues », que leur
explication patiente est un des meilleurs moyens pour éduquer ces
camarades dans le marxisme.
2. De la
production marchande sous le socialisme
Certains camarades soutiennent que le Parti a
conservé à tort la production marchande après avoir pris le
pouvoir et nationalisé les moyens de production dans notre pays. Ils
estiment que le Parti aurait dû à ce moment éliminer la production
marchande. Ce faisant, ils se réfèrent à Engels, qui dit :
Par la
prise de possession sociale des moyens de production, la production
des marchandises cesse et par là même la domination du produit sur
le producteur. (F. Engels : Anti-Dühring, Éditions
sociales, Paris, 1950, p. 322.)
Ces camarades se trompent gravement.
Analysons la formule d’Engels. On ne peut la
considérer comme parfaitement claire et précise, puisqu’elle
n’indique pas s’il s’agit de la prise de possession, par la
société, de tous les moyens de production ou d’une partie
seulement, c’est-à-dire si tous les moyens de production ont été
remis en possession du peuple ou seulement une partie. Donc, la
formule d’Engels peut être comprise de deux manières.
Dans un autre passage de son Anti-Dühring,
Engels parle de la prise de possession de « tous les moyens de
production », « de la totalité des moyens de
production ».
Engels entend donc dans sa formule la
nationalisation non pas d’une partie, mais de la totalité des
moyens de production, c’est-à-dire la remise en possession du
peuple des moyens de production non seulement dans l’industrie,
mais aussi dans l’agriculture.
Par conséquent, Engels a en vue les pays où le
capitalisme et la concentration de la production sont suffisamment
développés non seulement dans l’industrie, mais aussi dans
l’agriculture, pour rendre possible l’expropriation de tous les
moyens de production du pays, et en faire la propriété du peuple.
Engels estime donc que dans ces pays, il
conviendrait, parallèlement à la socialisation de tous les moyens
de production, d’éliminer la production marchande. Cela est, bien
entendu, très juste.
À la fin du siècle dernier, à l’époque de la
publication de l’Anti-Dühring, seule l’Angleterre était
ce pays, où le développement du capitalisme et la concentration de
la production, tant dans l’industrie que dans l’agriculture,
avaient atteint un degré tel que la possibilité s’offrait, en cas
de prise du pouvoir par le prolétariat, de remettre tous les moyens
de production du pays en possession du peuple et d’éliminer la
production marchande.
Je fais abstraction ici de l’importance qu’a
pour l’Angleterre le commerce extérieur avec sa part énorme dans
l’économie nationale britannique. Je pense que c’est seulement
après avoir étudié la question qu’on pourrait définitivement
décider du sort de la production marchande en Grande-Bretagne au
lendemain de la prise du pouvoir par le prolétariat et de la
nationalisation de tous les moyens de production.
Du reste, non seulement à la fin du siècle
dernier, mais aujourd’hui encore, aucun pays n’a atteint le degré
de développement du capitalisme et de concentration de la production
agricole, que nous observons en Angleterre.
Pour les autres pays, malgré le développement du
capitalisme à la campagne, il y a là encore une classe assez
nombreuse de petits et moyens propriétaires-producteurs, dont il
importerait de déterminer le sort au cas où le prolétariat
accéderait au pouvoir.
Mais la question se pose : que doivent faire
le prolétariat et son parti si dans tel ou tel pays, y compris le
notre, les conditions sont favorables à la prise du pouvoir par le
prolétariat et au renversement du capitalisme ; où le
capitalisme dans l’industrie a concentré les moyens de production
au point qu’on peut les exproprier et les remettre en possession de
la société, mais où l’agriculture, malgré le progrès du
capitalisme, est émiettée entre les nombreux petits et moyens
propriétaires-producteurs au point que la possibilité ne se
présente pas d’envisager l’expropriation de ces producteurs ?
À cette question la formule d’Engels ne répond
pas. Du reste, elle ne doit pas y répondre, puisqu’elle a surgi
sur la base d’une autre question, celle de savoir quel doit être
le sort de la production marchande après que tous les moyens de
production auront été socialisés.
Ainsi, comment faire si tous les moyens de
production n’ont pas été socialisés, mais seulement une partie,
et ni les conditions favorables à la prise du pouvoir par le
prolétariat sont réunies, — faut-il que le prolétariat prenne le
pouvoir et faut-il aussitôt après détruire la production
marchande ?
On ne peut certes pas qualifier de réponse
l’opinion de certains pseudo-marxistes qui considèrent que, dans
ces conditions, il conviendrait de renoncer à la prise du pouvoir et
d’attendre que le capitalisme ait pris le temps de ruiner les
millions de petits et moyens producteurs, de les transformer en
salariés agricoles et de concentrer les moyens de production dans
l’agriculture ; qu’après cela seulement on pourrait poser
la question de la prise du pouvoir par le prolétariat et de la
socialisation de tous les moyens de production. On comprend que les
marxistes ne peuvent accepter pareille « solution » sans
risquer de se déshonorer à fond.
On ne peut pas non plus considérer comme une
réponse l’opinion d’autres pseudo-marxistes qui pensent qu’il
conviendrait peut-être de prendre le pouvoir, de procéder à
l’expropriation des petits et moyens producteurs à la campagne et
de socialiser leurs moyens de production.
Les marxistes ne peuvent pas non plus s’engager
dans cette voie insensée et criminelle qui enlèverait à la
révolution prolétarienne toute possibilité de victoire et
rejetterait pour longtemps la paysannerie dans le camp des ennemis du
prolétariat.
Lénine a répondu à cette question dans ses
ouvrages sur « l’impôt en nature » et dans son fameux
« plan coopératif ».
La réponse de Lénine se ramène brièvement à
ceci :
a) ne pas laisser échapper les conditions
favorables à la prise du pouvoir ; le prolétariat prendra le
pouvoir sans attendre le moment où le capitalisme sera en mesure de
ruiner les millions de petits et moyens producteurs individuels ;
b) exproprier les moyens de production dans
l’industrie et les remettre en possession du peuple ;
c) pour les petits et moyens producteurs
individuels, on les groupera progressivement en des coopératives de
production, c’est-à-dire en de grosses entreprises agricoles, les
kolkhozes ;
d) développer par tous les moyens l’industrie
et assigner aux kolkhozes une base technique moderne, celle de la
grande production ; ne pas les exproprier mais, au contraire,
les fournir abondamment de tracteurs et autres machines de premier
ordre ;
e) pour assurer l’alliance économique de la
ville et des campagnes, de l’industrie et de l’agriculture, on
maintiendra pour un temps la production marchande (échange par achat
et vente), comme la forme la seule acceptable — pour les paysans —
des relations économiques avec la ville, et on développera à fond
le commerce soviétique, le commerce d’État et le commerce
coopératif et kolkhozien, en éliminant du commerce tous les
capitalistes.
L’histoire de notre édification socialiste
montre que cette voie de développement, tracée par Lénine, s’est
entièrement vérifiée.
Il ne peut faire de doute que pour tous les pays
capitalistes qui possèdent une classe plus on moins nombreuse de
petits et moyens producteurs, cette voie de développement est la
seule possible et rationnelle pour la victoire du socialisme.
On dit que la production marchande doit néanmoins,
en toutes circonstances, aboutir et aboutira absolument au
capitalisme. Cela est faux. Pas toujours ni en toutes circonstances !
On ne peut identifier la production marchande à la production
capitaliste.
Ce sont deux choses différentes. La production
capitaliste est la forme supérieure de la production marchande.
La production marchande ne conduit au capitalisme
que si la propriété privée des moyens de production existe ;
que si la force de travail apparaît sur le marché comme une
marchandise que le capitaliste peut acheter et exploiter pour la
production ; que si, par conséquent, il existe au pays un
système d’exploitation des ouvriers salariés par les
capitalistes.
La production capitaliste commence là où les
moyens de production sont détenus par des particuliers, tandis que
les ouvriers, dépourvus des moyens de production, sont obligés de
vendre leur force de travail comme une marchandise. Sans cela, il n’y
a pas de production capitaliste.
Eh bien, si ces conditions ne sont pas réunies,
qui transforment la production marchande en production capitaliste,
si les moyens de production ne sont plus une propriété privée,
mais la propriété socialiste, si le salariat n’existe pas et la
force de travail n’est plus une marchandise, si le système
d’exploitation a été depuis longtemps aboli, comment faire
alors : peut-on considérer que la production marchande aboutira
quand même au capitalisme ? Évidemment non. Or, notre société
est précisément une société où la propriété privée des moyens
de production, le salariat et l’exploitation n’existent plus
depuis longtemps.
On ne peut pas considérer la production marchande
comme une chose se suffisant à elle-même, indépendante de
l’ambiance économique.
La production marchande est plus vieille que la
production capitaliste. Elle existait sous le régime d’esclavage
et le servait, mais n’a pas abouti au capitalisme. Elle existait
sous le féodalisme et le servait, sans toutefois aboutir au
capitalisme, bien qu’elle ait préparé certaines conditions pour
la production capitaliste.
La question se pose : pourquoi la production
marchande ne peut- elle pas de même, pour un temps, servir notre
société socialiste sans aboutir au capitalisme, si l’on tient
compte que la production marchande n’a pas chez nous une diffusion
aussi illimitée et universelle que dans les conditions
capitalistes ; qu’elle est placée chez nous dans un cadre
rigoureux grâce à des conditions économiques décisives comme la
propriété sociale des moyens de production, la liquidation du
salariat et du système d’exploitation ?
On dit qu’après que la propriété sociale des
moyens de production s’est installée dans notre pays et que le
salariat et l’exploitation ont été liquidés, la production
marchande n’a plus de sens, qu’il faudrait pas conséquent
l’éliminer.
Cela est également faux. À l’heure actuelle,
il existe chez nous deux formes essentielles de production
socialiste : celle de l’État, c’est-à-dire du peuple
entier, et la forme kolkhozienne, que l’on ne peut pas appeler
commune au peuple entier. Dans les entreprises d’État, les moyens
de production et les objets fabriqués constituent la propriété du
peuple entier.
Dans les entreprises kolkhoziennes, bien que les
moyens de production (la terre, les machines) appartiennent à
l’État, les produits obtenus sont la propriété des différents
kolkhozes qui fournissent le travail de même que les semences ;
les kolkhozes disposent pratiquement de la terre qui leur a été
remise à perpétuité comme de leur bien propre, quoiqu’ils ne
puissent pas la vendre, l’acheter, la donner à bail ou la mettre
en gage.
L’État ne peut donc disposer que de la
production des entreprises d’État, les kolkhozes bénéficiant de
leur production comme de leur bien propre.
Mais les kolkhozes ne veulent pas aliéner leurs
produits autrement que sous la forme de marchandises, en échange de
celles dont ils ont besoin. Les kolkhozes n’acceptent pas
aujourd’hui d’autres relations économiques avec la ville que
celles intervenant dans les échanges par achat et vente de
marchandises.
Aussi la production marchande et les échanges
sont-ils chez nous, à l’heure actuelle, une nécessité pareille à
celle d’il y a trente ans, par exemple, époque à laquelle Lénine
proclamait la nécessité de développer par tous les moyens les
échanges.
Certes, lorsqu’au lieu de deux principaux
secteurs de production, État et kolkhozes, il se formera un seul
secteur universel investi du droit de disposer de tous les produits
de consommation du pays, la circulation des marchandises avec son
« économie monétaire » aura disparu comme un élément
inutile de l’économie nationale.
D’ici là, aussi longtemps que les deux
principaux secteurs de production existeront, la production marchande
et la circulation des marchandises resteront en vigueur comme un
élément nécessaire et très utile dans le système de notre
économie nationale. Comment sera-t-il procédé à la formation d’un
seul secteur universel ?
Par simple absorption du secteur kolkhozien dans
le secteur d’État, ce qui est peu probable (ceci pouvant être
considéré comme une expropriation des kolkhozes), ou par la
constitution d’un seul organisme économique national (avec des
représentants de l’industrie d’État et des kolkhozes), ayant le
droit d’abord de recenser tous les produits de consommation du pays
et, avec le temps, de répartir la production, par exemple, sous
forme d’échange des produits ? C’est là une autre question
qui demande un examen à part.
Par conséquent, notre production marchande n’est
pas une production marchande ordinaire, elle est d’un genre
spécial, une production marchande sans capitalistes, qui se
préoccupe pour l’essentiel des marchandises appartenant à des
producteurs socialistes associés (État, kolkhozes, coopératives),
et dont la sphère d’action est limitée à des articles de
consommation personnelle, qui ne peut évidemment pas se développer
pour devenir une production capitaliste et doit aider, avec son
« économie monétaire », au développement et à
l’affermissement de la production socialiste.
Aussi ont-ils absolument tort, ceux qui déclarent
que, du moment que la société socialiste maintient les formes
marchandes de la production, il y a lieu, soi-disant, de rétablir
chez nous toutes les catégories économiques propres au
capitalisme : la force de travail comme marchandise, la
plus-value, le capital, le profit du capital, le taux moyen du
profit, etc.
Ces camarades confondent la production marchande
avec la production capitaliste et estiment que, du moment qu’il y a
production marchande, il doit y avoir aussi production capitaliste.
Ils ne comprennent pas que notre production marchande se distingue
foncièrement de la production marchande sous le capitalisme.
Bien plus, je pense qu’il faut renoncer à
certaines autres notions empruntées au Capital, où Marx se
livrait à l’analyse du capitalisme, — et artificiellement
accolées à nos rapports socialistes. Je veux parler entre autres de
notions telles que le travail « nécessaire » et le
« surtravail », le produit « nécessaire » et
le « surproduit », le temps « nécessaire »
et le « temps extra ».
Marx a analysé le capitalisme afin d’établir
l’origine de l’exploitation de la classe ouvrière, la
plus-value, et de fournir à la classe ouvrière privée des moyens
de production une arme spirituelle pour renverser le capitalisme.
On comprend que Marx se sert ici de notions
(catégories) qui répondent parfaitement aux rapports capitalistes.
Mais il serait plus qu’étrange de se servir
actuellement de ces notions, alors que la classe ouvrière, loin
d’être privée du pouvoir et des moyens de production, détient au
contraire le pouvoir et possède les moyens de production.
Les propos sur la force de travail comme
marchandise et sur le « salariat » des ouvriers sonnent
d’une façon assez absurde sous notre régime : comme si la
classe ouvrière, possédant les moyens de production, se salariait
elle-même et se vendait à elle-même sa force de travail.
Il n’est pas moins étrange de parler
aujourd’hui de travail « nécessaire » et de
« surtravail » : comme si dans nos conditions, le
travail des ouvriers donné à la société en vue d’élargir la
production, de développer l’instruction, la santé publique,
d’organiser la défense nationale, etc., n’était pas aussi
nécessaire à la classe ouvrière, aujourd’hui au pouvoir, que le
travail dépensé pour subvenir aux besoins personnels de l’ouvrier
et de sa famille.
Il est à noter que Marx dans sa Critique du
programme de Gotha, où il analyse non plus le capitalisme, mais
entre autres la première phase de la société communiste, reconnaît
que le travail consacré à la société pour élargir la production,
pour l’instruction, la santé publique, les frais d’administration,
la constitution de réserves, etc., est aussi nécessaire que le
travail dépensé pour subvenir aux besoins de consommation de la
classe ouvrière.
Je pense que nos économistes doivent en finir
avec ce défaut de concordance entre les vieilles notions et le
nouvel état de choses dans notre pays socialiste, en substituant aux
notions anciennes des notions appropriées à la nouvelle situation.
Nous avons pu tolérer ce défaut de concordance
un certain temps. Mais l’heure est venue où nous devons enfin
remédier à ce défaut.
3. La loi
de la valeur sous le socialisme
On demande parfois si la loi de la valeur existe
et fonctionne chez nous, sous notre régime socialiste.
Oui, elle existe et fonctionne. Là où il y a
marchandises et production marchande, la loi de la valeur existe
nécessairement.
La sphère d’action de la loi de la valeur
s’étend chez nous tout d’abord à la circulation des
marchandises, à l’échange des marchandises par achat et vente, à
l’échange surtout des marchandises d’usage personnel. Dans ce
domaine, la loi de la valeur conserve, bien entendu, dans certaines
limites, un rôle régulateur.
L’action de la loi de la valeur ne se borne pas
cependant à la sphère de la circulation des marchandises. Elle
s’étend de même à la production. Il est vrai que la loi de la
valeur ne joue pas un rôle régulateur dans notre production
socialiste.
Mais elle agit néanmoins sur la production, et il
faut nécessairement en faire état en dirigeant la production.
Le fait est que les produits de consommation,
nécessaires pour compenser les pertes en force de travail dans le
processus de la production, sont fabriqués chez nous et sont
réalisés en tant que marchandises soumises à l’action de la loi
de la valeur.
Là précisément, la loi de la valeur exerce son
action sur la production. Ceci étant, l’autonomie financière et
la rentabilité, le prix de revient, les prix, etc. ont aujourd’hui
une importance d’actualité dans nos entreprises.
C’est pourquoi nos entreprises ne peuvent ni ne
doivent se passer de la loi de la valeur.
Est-ce bien ? Ce n’est pas mal. Dans les
conditions où nous sommes aujourd’hui, cela n’est vraiment pas
mal, ceci ayant pour effet de former nos dirigeants de l’industrie
dans la conduite rationnelle de la production, et de les discipliner.
Ce n’est pas mal, puisque nos dirigeants de
l’industrie apprennent ainsi à évaluer le potentiel de
production, à l’évaluer avec exactitude et à tenir compte aussi
exactement des réalités de la production, au lieu de perdre leur
temps à bavarder sur des « chiffres estimatifs » pris au
hasard. Ce n’est pas mal, puisque nos dirigeants de l’industrie
apprennent ainsi à chercher, à trouver et à exploiter les réserves
latentes, tapies dans les profondeurs de la production, au lieu de
les fouler aux pieds.
Ce n’est pas mal, puisque nos dirigeants de
l’industrie apprennent ainsi à améliorer systématiquement les
méthodes de fabrication, à réduire le prix de revient, à
pratiquer l’autonomie financière et à réaliser la rentabilité
des entreprises. C’est là une bonne école pratique, qui hâtera
la montée de nos cadres de l’industrie pour en faire de vrais
dirigeants de la production socialiste à l’étape actuelle du
développement.
Le malheur n’est pas que la loi de la valeur
agisse chez nous sur la production. Le malheur est que les dirigeants
de notre industrie et nos spécialistes de la planification, à peu
d’exceptions près, connaissent mal l’action de la loi de la
valeur, ne l’étudient pas et ne savent pas en tenir compte dans
leurs calculs. C’est ce qui explique la confusion qui règne encore
chez nous dans la politique des prix. Voici un exemple entre tant
d’autres.
Il y a quelque temps on avait décidé de régler,
dans l’intérêt de la culture cotonnière, le rapport des prix du
coton et des céréales, de préciser le prix des céréales vendues
aux cultivateurs de coton et de relever les prix du coton livré à
l’État.
Dès lors, nos dirigeants de l’industrie et nos
spécialistes de la planification apportèrent une proposition qui ne
pouvait que surprendre les membres du Comité central, puisque cette
proposition fixait le prix d’une tonne de céréales à peu près
au même niveau que celui d’une tonne de coton ; au surplus,
le prix d’une tonne de céréales était le même que celui d’une
tonne de pain cuit.
Les membres du Comité central ayant fait
remarquer que le prix d’une tonne de pain cuit devait être
supérieur à celui d’une tonne de céréales, en raison des frais
supplémentaires nécessités par la mouture et la cuisson ; que
le coton en général coûtait bien plus cher que les céréales,
témoin les prix mondiaux du coton et des céréales, — les auteurs
de la proposition ne purent rien dire d’explicite.
Force fut au Comité central de prendre la chose
en mains propres, de diminuer les prix des céréales et de relever
ceux du coton. Que serait-il advenu si la proposition de ces
camarades avait reçu force légale ? Nous aurions ruiné les
cultivateurs et serions restés sans coton.
Est-ce à dire que la loi de la valeur s’exerce
chez nous avec la même ampleur que sous le capitalisme ;
qu’elle est chez nous régulatrice de la production ?
Évidemment non. En réalité, la loi de la
valeur, sous notre régime économique, exerce son action dans un
cadre strictement limité. On a déjà dit que la production
marchande, sous notre régime, exerce son action dans un cadre
limité.
On peut en dire autant de l’action exercée par
la loi de la valeur. Il est certain que l’absence de propriété
privée des moyens de production et leur socialisation à la ville
comme à la campagne ne peuvent que limiter la sphère d’action de
la loi de la valeur et le degré de sa réaction sur la production.
C’est dans le même sens qu’intervient dans
l’économie nationale la loi du développement harmonieux
(proportionnel), qui a remplacé la loi de concurrence et d’anarchie
de la production.
C’est dans le même sens qu’interviennent nos
plans annuels et quinquennaux et, en général, toute notre politique
économique qui s’appuie sur les dispositions de la loi du
développement harmonieux de l’économie nationale.
Tous ces faits pris ensemble font que la sphère
d’action de la loi de la valeur est strictement limitée chez nous,
et que la loi de la valeur ne peut, sous notre régime, jouer un rôle
régulateur dans la production.
C’est ce qui explique d’ailleurs ce fait
« stupéfiant » que, malgré la montée incessante et
impétueuse de notre production socialiste, la loi de la valeur
n’aboutit pas chez nous aux crises de surproduction, alors que la
même loi de la valeur, qui a une large sphère d’action sous le
capitalisme, malgré les faibles rythmes de croissance de la
production dans les pays capitalistes, aboutit à des crises
périodiques de surproduction.
On dit que la loi de la valeur est une loi
constante, obligatoire pour toutes les périodes d’évolution
historique ; que si la loi de la valeur perd sa force comme
régulatrice des rapports d’échange dans la seconde phase de la
société communiste, elle maintiendra dans cette phase de
développement sa force comme régulatrice des rapports entre les
diverses branches de la production, comme régulatrice de la
répartition du travail entre les branches de la production.
Cela est tout à fait faux. La valeur, ainsi que
la loi de la valeur, est une catégorie historique liée à
l’existence de la production marchande. Avec la disparition de
cette dernière, disparaîtront aussi la valeur avec ses formes et la
loi de la valeur.
Dans la seconde phase de la société communiste,
la quantité de travail dépensé pour fabriquer les produits, ne se
mesurera plus par des voies détournées, au moyen de la valeur et de
ses formes, comme c’est le cas pour la production marchande, mais
directement et immédiatement par la quantité de temps, la quantité
d’heures dépensées pour fabriquer les produits.
En ce qui concerne la répartition du travail,
celle-ci ne se réglera pas entre les branches de production par la
loi de la valeur qui aura perdu sa force vers ce temps, mais par
l’accroissement des besoins de la société en produits.
Ce sera une société où la production se réglera
par les besoins de la société, et le recensement des besoins de la
société acquerra une importance de premier ordre pour les
organismes de planification.
Il est de même absolument faux d’affirmer que,
dans notre régime économique actuel, à la première phase du
développement de la société communiste, la loi de la valeur règle
soi-disant les « proportions » de la répartition du
travail entre les diverses branches de production.
Si cela était juste, pourquoi ne développerait-on
pas à fond nos industries légères comme étant les plus rentables,
de préférence à l’industrie lourde qui est souvent moins
rentable et qui parfois ne l’est pas du tout ?
Si cela était juste, pourquoi ne fermerait-on pas
chez nous les entreprises pour l’instant non rentables de
l’industrie lourde, où le travail des ouvriers ne produit pas
« l’effet voulu », et pourquoi n’ouvrirait-on pas de
nouvelles entreprises de l’industrie légère assurément rentable,
où le travail des ouvriers pourrait produire un « plus grand
effet » ?
Si cela était juste, pourquoi ne transférerait-on
pas chez nous les ouvriers des entreprises peu rentables, bien que
très nécessaires à l’économie nationale, vers les entreprises
plus rentables, selon la loi de la valeur qui règle soi-disant les
« proportions » de la répartition de travail entre les
branches de production ?
Sans doute qu’en suivant à la trace ces
camarades, il nous faudrait renoncer au primat de la production des
moyens de production sur la production des moyens de consommation. Et
que signifie renoncer au primat de la production des moyens de
production ?
C’est rendre impossible la croissance incessante
de notre économie nationale, car on ne saurait réaliser la
croissance incessante de l’économie nationale, sans réaliser en
même temps le primat de la production des moyens de production.
Ces camarades oublient que la loi de la valeur ne
peut être la régulatrice de la production que sous le capitalisme,
alors qu’existent la propriété privée des moyens de production,
la concurrence, l’anarchie de la production, les crises de
surproduction.
Ils oublient que la sphère d’action de la loi
de la valeur est limitée chez nous par la propriété sociale des
moyens de production, par l’action de la loi du développement
harmonieux de l’économie nationale, — elle est donc limitée
aussi par nos plans annuels et quinquennaux qui sont le reflet
approximatif des dispositions de cette loi.
Certains camarades tirent de là cette conclusion
que la loi du développement harmonieux de l’économie nationale et
la planification de celle-ci suppriment le principe de la
rentabilité. Cela est absolument faux. Il en va tout autrement.
Si l’on considère la rentabilité, non pas du
point de vue des différentes entreprises ou branches de production
ni au cours d’une seule année, mais du point de vue de l’ensemble
de l’économie nationale et au cours de dix à quinze ans par
exemple, — ce qui serait le seul moyen d’aborder la question
correctement, — la rentabilité momentanée et précaire des
différentes entreprises ou branches de production ne peut soutenir
aucune comparaison avec la forme supérieure d’une rentabilité
solide et constante ; celle que nous donnent l’action de la
loi du développement harmonieux de l’économie nationale et la
planification de cette dernière, en nous débarrassant des crises
économiques périodiques, destructrices de l’économie nationale
qui apportent à la société un immense dommage matériel, et en
nous assurant le progrès continu de l’économie nationale avec ses
rythmes élevés.
Bref, il n’est pas douteux que dans nos
conditions socialistes actuelles de la production, la loi de la
valeur ne peut être « régulatrice des proportions »
dans la répartition du travail entre les diverses branches de
production.
4. De la
suppression de l’opposition entre la ville et la campagne,
entre
le travail intellectuel et le travail manuel,
et de la liquidation
des différences entre eux
Ce titre a trait à plusieurs problèmes qui se
distinguent essentiellement les uns des autres ; je les réunis
cependant dans un seul chapitre, non pas pour les mêler, mais
exclusivement en vue d’abréger mon exposé.
La suppression de l’opposition entre la ville et
la campagne, entre l’industrie et l’agriculture constitue un
problème connu, depuis longtemps soulevé par Marx et Engels.
La base économique de cette opposition est
l’exploitation de la campagne par la ville, l’expropriation de la
paysannerie et la ruine de la majeure partie de la population rurale,
dues au développement de l’industrie, du commerce, du système de
crédits en régime capitaliste.
Aussi faut-il considérer l’opposition entre la
ville et la campagne sous le capitalisme comme une opposition
d’intérêts. C’est sur ce terrain qu’a surgi cette attitude
d’hostilité de la campagne à l’égard de la ville et en général
à l’égard des « citadins ».
Il est certain qu’avec l’abolition du
capitalisme et du système d’exploitation, avec le renforcement du
régime socialiste dans notre pays, devait disparaître l’opposition
des intérêts entre la ville et la campagne, entre l’industrie et
l’agriculture.
C’est ce qui advint. L’aide efficace apportée
à notre paysannerie par la ville socialiste, par notre classe
ouvrière, pour liquider les grands propriétaires fonciers et les
koulaks, a consolidé le terrain en vue de l’alliance de la classe
ouvrière et de la paysannerie ; d’autre part,
l’approvisionnement systématique de la paysannerie et de ses
kolkhozes en tracteurs et machines de premier ordre a fait que
l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie s’est
transformée en amitié entre elles.
Sans doute, les ouvriers et la paysannerie
kolkhozienne forment cependant deux classes qui se distinguent l’une
de l’autre par leur situation respective.
Mais cette distinction n’affaiblit en aucune
manière leur amitié. Au contraire, leurs intérêts se situent sur
le même plan, celui de la consolidation du régime socialiste et de
la victoire du communisme. Il n’est donc pas étonnant qu’il ne
reste plus trace de la méfiance d’autrefois et, à plus forte
raison, de la haine de la campagne pour la ville.
Tout cela signifie que le terrain propice à
l’opposition entre la ville et la campagne, entre l’industrie et
l’agriculture est d’ores et déjà liquidé par notre régime
socialiste actuel.
Cela ne veut point dire, bien entendu, que la
suppression de l’opposition entre la ville et la campagne doive
amener la « mort des grandes villes » (voir Engels :
Anti- Dühring).
Non seulement les grandes villes ne périront pas,
mais il en surgira encore de nouvelles, qui seront des centres de
grande culture intellectuelle, centres non seulement de la grande
industrie, mais aussi de la transformation des produits agricoles et
d’un puissant développement de toutes les branches de l’industrie
alimentaire.
C’est ce qui contribuera à l’épanouissement
culturel du pays et conduira au nivellement des conditions
d’existence dans les villes et les campagnes.
Il en va de même de la suppression de
l’opposition entre le travail intellectuel et manuel. C’est là
aussi un problème connu, depuis longtemps posé par Marx et Engels.
La base économique de l’opposition entre le
travail intellectuel et manuel, c’est l’exploitation des
travailleurs manuels par les représentants du travail intellectuel.
Tout le monde connaît l’écart qui existait sous le capitalisme
entre les travailleurs manuels dans les entreprises et le personnel
dirigeant. On sait que cet écart a donné lieu à une attitude
hostile des ouvriers envers le directeur, le contremaître,
l’ingénieur et autres représentants du personnel technique,
qu’ils considéraient comme leurs ennemis.
On comprend qu’avec l’abolition du capitalisme
et du système d’exploitation devait disparaître l’opposition
des intérêts entre le travail manuel et le travail intellectuel.
Elle a effectivement disparu sous notre régime socialiste.
Maintenant, travailleurs manuels et personnel dirigeant ne sont pas
des ennemis, mais des camarades et des amis, membres d’une seule
collectivité de producteurs, vivement intéressés au progrès et à
l’amélioration de la production. De l’ancienne animosité, il ne
reste plus trace.
Le problème de la disparition des différences
entre la ville (l’industrie) et la campagne (l’agriculture),
entre le travail intellectuel et le travail manuel, revêt un tout
autre caractère. Ce problème n’a pas été posé par les
classiques du marxisme. C’est un problème nouveau, posé par la
pratique de notre édification socialiste.
Ce problème n’a-t-il pas été imaginé de
toutes pièces ? a-t-il pour nous une importance pratique ou
théorique ? Non, on ne peut pas dire que ce problème ait été
imaginé de toutes pièces. Au contraire, il est pour nous un
problème sérieux au plus haut point.
Si l’on considère, par exemple, la différence
entre l’apiculture et l’industrie, elle consiste chez nous non
seulement en ce que les conditions de travail dans l’agriculture
diffèrent des conditions de travail dans l’industrie, mais avant
tout et principalement en ce que dans notre industrie les moyens de
production et les objets produits appartiennent au peuple, tandis que
dans l’agriculture la propriété n’est pas celle du peuple
entier mais celle d’un groupe, du kolkhoze.
Ce fait, on l’a déjà dit, aboutit au maintien
de la circulation des marchandises, et ce n’est qu’avec la
disparition de cette différence entre l’industrie et l’agriculture
que peut disparaître la production marchande avec toutes les
conséquences qui en découlent. Par conséquent, on ne peut nier que
la disparition de cette différence essentielle entre l’agriculture
et l’industrie doive avoir pour nous une importance de premier
plan.
Il faut en dire autant de la suppression de la
différence essentielle entre le travail intellectuel et le travail
manuel. Ce problème a également pour nous une importance
primordiale. Avant que l’émulation socialiste de masse ait pris de
l’ampleur, notre industrie montait en grinçant, et nombre de
camarades préconisaient même des rythmes ralentis du développement
industriel.
Cela s’explique surtout par le fait que le
niveau culturel et technique des ouvriers était trop bas et
retardait de beaucoup sur le niveau du personnel technique. Les
choses ont pourtant changé radicalement depuis que l’émulation
socialiste a pris chez nous un caractère de masse. Dès lors,
l’industrie a fait des progrès rapides. Pourquoi l’émulation
socialiste a-t-elle pris un caractère de masse ?
Parce qu’il s’est trouvé parmi les ouvriers
des groupes de camarades qui, non seulement s’étaient assimilé un
minimum de connaissances techniques, mais sont allés au delà et ont
atteint le niveau du personnel technique ; ils ont commencé à
corriger les techniciens et les ingénieurs, à renverser les normes
existantes comme périmées, à introduire des normes nouvelles, plus
modernes, etc. Que serait-il advenu si, au lieu de groupes
d’ouvriers, la majorité des ouvriers avaient élevé leur niveau
culturel et technique jusqu’au niveau des ingénieurs et des
techniciens ?
Notre industrie aurait été portée à une
hauteur inaccessible pour l’industrie des autres pays. On ne doit
donc pas nier que la suppression de la différence essentielle entre
le travail intellectuel et le travail manuel, en élevant le niveau
culturel et technique des ouvriers au niveau du personnel technique,
ne peut pas ne pas avoir pour nous une importance de premier plan.
Certains camarades soutiennent qu’avec le temps
disparaîtra non seulement la différence essentielle entre
l’industrie et l’agriculture, entre le travail manuel et le
travail intellectuel, mais aussi toutes les différences entre eux.
Cela est faux.
La suppression de la différence essentielle entre
l’industrie et l’agriculture ne peut pas aboutir à la
suppression de toutes les différences entre elles. Une certaine
différence, fût-elle insignifiante, demeurera assurément par suite
des conditions différentes de travail dans l’industrie et dans
l’agriculture.
Même dans l’industrie, si l’on tient compte
de ses diverses branches, les conditions de travail ne sont pas
partout les mêmes : les conditions de travail des mineurs, par
exemple, diffèrent de celles des ouvriers d’une fabrique mécanisée
de chaussures ; les conditions de travail des mineurs de
minerais diffèrent de celles des ouvriers occupés dans l’industrie
mécanique. Si cela est juste, une certaine différence subsistera
surtout entre l’industrie et l’agriculture.
Il faut en dire autant de la différence entre le
travail intellectuel et le travail manuel. La différence essentielle
entre eux, quant au niveau culturel et technique, disparaîtra
assurément. Mais une certaine différence, fût-elle insignifiante,
demeurera pourtant, ne serait-ce que parce que les conditions de
travail du personnel dirigeant des entreprises ne sont pas identiques
aux conditions de travail des ouvriers.
Ceux de mes camarades qui affirment le contraire
s’appuient sans doute sur une formulation de certaines de mes
interventions où il est question de la suppression de la différence
entre l’industrie et l’agriculture, entre le travail intellectuel
et le travail manuel, sans qu’il soit spécifié qu’il est
question de supprimer la différence essentielle, et non pas toutes
les différences. C’est bien ainsi que les camarades ont compris ma
formulation, en supposant qu’elle signifie la suppression de toutes
les différences.
C’est que la formulation était inexacte,
insuffisante. Il faut la rejeter, la remplacer par une autre,
affirmant la suppression des différences essentielles et le maintien
des distinctions non essentielles entre l’industrie et
l’agriculture, entre le travail intellectuel et le travail manuel.
5. De la
désagrégation du marché mondial unique
et de l’aggravation de
la crise du système capitaliste mondial
Le résultat économique le plus important de la
deuxième guerre mondiale et de ses conséquences pour l’économie
a été la désagrégation du marché mondial unique, universel. Ce
qui a déterminé l’aggravation ultérieure de la crise générale
du système capitaliste mondial.
La deuxième guerre mondiale a été elle-même
engendrée par cette crise. Chacune des deux coalitions capitalistes
engagées dans le conflit, espérait pouvoir battre l’adversaire et
asseoir sa domination sur le monde. C’est en cela qu’elles
cherchaient une issue à la crise.
Les États-Unis d’Amérique comptaient mettre
hors de combat leurs concurrents les plus dangereux, l’Allemagne et
le Japon, s’emparer des marchés étrangers, des ressources
mondiales de matières premières et asseoir leur domination sur le
monde.
La guerre cependant n’a pas donné raison à
leurs espoirs. Il est vrai que l’Allemagne et le Japon ont été
mis hors de combat eu tant que concurrents des trois principaux pays
capitalistes : U.S.A., Grande-Bretagne, France. Mais on a vu
d’autre part se détacher du système capitaliste la Chine et les
pays de démocratie populaire en Europe, pour former avec l’Union
soviétique un seul et vaste camp socialiste, opposé au camp du
capitalisme.
Le résultat économique de l’existence des deux
camps opposés fut que le marché unique, universel s’est
désagrégé, ce qui fait que nous avons maintenant deux marchés
mondiaux parallèles qui eux aussi s’opposent l’un à l’autre.
Notons que les U.S.A. et la Grande-Bretagne avec
la France ont contribué eux- mêmes, bien entendu, indépendamment
de leur volonté, à former et à consolider un nouveau marché
mondial parallèle.
Ils ont soumis au blocus économique l’U.R.S.S.,
la Chine et les pays de démocratie populaire en Europe, qui ne
faisaient pas partie du « plan Marshall », croyant ainsi
pouvoir les étrangler. En réalité, loin d’être étranglé, le
marché mondial nouveau a été consolidé.
L’essentiel pourtant ne consiste pas ici dans le
blocus économique, mais en ce que, dans l’après-guerre, ces pays
se sont associés économiquement et ont organisé la collaboration
et l’entraide économiques. L’expérience de cette coopération
montre qu’aucun pays capitaliste n’aurait pu prêter aux pays de
démocratie populaire une aide aussi efficace et techniquement
qualifiée que celle qu’ils reçoivent de l’Union soviétique.
Il ne s’agit pas seulement du fait que cette
aide est très peu dispendieuse et de premier ordre au point de vue
technique. Il s’agit avant tout qu’à la base de cette
collaboration se trouve le désir sincère de s’entraider et de
réaliser un essor économique général.
Résultat : nous enregistrons des rythmes de
développement élevés dans ces pays. On peut dire avec assurance
qu’avec de tels rythmes de développement de l’industrie, ces
pays n’auront bientôt plus besoin d’importer des marchandises
provenant des pays capitalistes, mais éprouveront eux-mêmes la
nécessité de vendre à l’étranger les excédents de leur
production.
Mais il s’ensuit que la sphère d’application
des forces des principaux pays capitalistes (U.S.A., Grande-Bretagne,
France) aux ressources mondiales, ne s’étendra pas mais
diminuera ; que les conditions, quant aux débouchés mondiaux,
s’aggraveront pour ces pays, et que la sous-production des
entreprises y augmentera.
C’est en cela que consiste proprement
l’aggravation de la crise générale du système capitaliste
universel, à la suite de la désagrégation du marché mondial.
C’est ce que les capitalistes comprennent fort
bien, car il est difficile de ne pas ressentir la perte de marchés
tels que l’U.R.S.S., la Chine. Ils s’attachent à remédier à
ces difficultés par le « plan Marshall », par la guerre
en Corée, par la course aux armements, par la militarisation de
l’industrie. Mais cela ressemble fort au noyé qui s’accroche à
un brin de paille.
Devant cette situation deux problèmes se posent
aux économistes :
a) Peut-on affirmer que la thèse bien connue de
Staline sur la stabilité relative des marchés en période de crise
générale du capitalisme, thèse formulée avant la deuxième guerre
mondiale, — reste toujours en vigueur ?
b) Peut-on affirmer que la thèse bien connue,
formulée par Lénine au printemps de 1916, selon laquelle, malgré
sa putréfaction « dans l’ensemble le capitalisme se
développe infiniment plus vite que naguère », — reste
toujours en vigueur ?
Je pense qu’on ne saurait l’affirmer. Etant
donné les nouvelles conditions dues à la deuxième guerre mondiale,
il faut considérer ces deux thèses comme périmées.
6. De
l’inévitabilité des guerres entre pays capitalistes
Certains camarades affirment qu’étant donné
les nouvelles conditions internationales, après la deuxième guerre
mondiale, les guerres entre pays capitalistes ne sont plus
inévitables.
Ils estiment que les contradictions entre le camp
du socialisme et celui du capitalisme sont plus fortes que les
contradictions entre pays capitalistes ; que les États-Unis
d’Amérique se sont suffisamment soumis les autres pays
capitalistes pour les empêcher de se faire la guerre et de
s’affaiblir mutuellement ; que les hommes avancés du
capitalisme sont assez instruits par l’expérience des deux guerres
mondiales, qui ont porté un sérieux préjudice à l’ensemble du
monde capitaliste, pour se permettre d’entraîner à nouveau les
pays capitalistes dans une guerre entre eux ; que, de ce fait,
les guerres entre pays capitalistes ne sont plus inévitables.
Ces camarades se trompent. Ils voient les
phénomènes extérieurs affleurant à la surface, mais ils
n’aperçoivent pas les forces profondes qui, bien qu’agissant
momentanément de façon invisible, n’en détermineront pas moins
le cours des événements.
En apparence, la « sérénité » règne
partout : les États-Unis d’Amérique ont réduit à la
portion congrue l’Europe occidentale, le Japon et les autres pays
capitalistes ; l’Allemagne (de l’Ouest), la Grande-Bretagne,
la France, l’Italie, le Japon, tombés dans les griffes des U.S.A.,
exécutent docilement leurs injonctions.
Mais on aurait tort de croire que cette
« sérénité » puisse se maintenir « pour
l’éternité » ; que ces pays supporteront sans fin la
domination et le joug des États-Unis d’Amérique ; qu’ils
n’essaieront pas de s’arracher du joug américain pour s’engager
sur le chemin de l’indépendance.
Considérons d’abord l’Angleterre et la
France. Il est certain que ce sont des pays impérialistes.
Il est certain que les matières premières à bon
marché et les débouchés assurés ont pour eux une importance de
premier plan. Peut-on imaginer qu’ils supporteront sans fin la
situation actuelle, quand les Américains, à la faveur d’une
« aide » prêtée au titre du « plan Marshall »,
s’installent dans le système économique de la Grande- Bretagne et
de la France, système dont ils veulent faire un appendice de
l’économie américaine ; quand le capital américain s’empare
des matières premières et des débouchés dans les colonies
anglo-françaises, préparant ainsi la catastrophe pour les profits
exorbitants des capitalistes anglo-français ?
N’est-il pas plus exact de dire que l’Angleterre
capitaliste et, à sa suite, la France capitaliste seront finalement
obligées de s’arracher à l’étreinte des U.S.A. et d’entrer
en conflit avec eux pour s’assurer une situation indépendante et,
bien entendu, des profits exorbitants ?
Passons aux principaux pays vaincus, à
l’Allemagne (occidentale), au Japon. Ces pays mènent aujourd’hui
une existence lamentable sous la botte de l’impérialisme
américain.
Leur industrie et leur agriculture, leur commerce,
leur politique extérieure et intérieure, toute leur existence sont
enchaînés par le « régime » d’occupation américain.
Dire qu’hier encore c’étaient de grandes
puissances impérialistes qui ébranlaient les assises de la
domination de la Grande-Bretagne, des U.S.A., de la France en Europe
et en Asie. Penser que ces pays n’essaieront pas de se relever, de
briser le « régime » des U.S.A. et de s’engager sur le
chemin de l’indépendance, c’est croire au miracle.
On dit que les contradictions entre capitalisme et
socialisme sont plus fortes que celles existant entre les pays
capitalistes. Théoriquement, c’est juste, bien sûr. Ce n’est
pas seulement juste aujourd’hui, cela l’était aussi avant la
deuxième guerre mondiale.
C’est ce que comprenaient plus ou moins les
dirigeants des pays capitalistes. Et cependant, la deuxième guerre
mondiale n’a pas commencé par la guerre contre l’U.R.S.S., mais
par une guerre entre paya capitalistes.
Pourquoi ? Parce que, d’abord, la guerre
contre l’U.R.S.S., pays du socialisme, est plus dangereuse pour le
capitalisme que la guerre entre pays capitalistes. Car si la guerre
entre pays capitalistes pose seulement le problème de la domination
de tels pays capitalistes sur tels autres, la guerre contre
l’U.R.S.S. doit nécessairement poser la question de l’existence
même du capitalisme.
Parce que, en second lieu, les capitalistes, bien
qu’ils proclament, aux fins de « propagande »,
l’agressivité de l’Union soviétique, n’y croient pas
eux-mêmes, puisqu’ils tiennent compte de la politique de paix de
l’Union soviétique et savent que l’U.R.S.S. n’attaquera pas
d’elle-même les pays capitalistes.
Au lendemain de la première guerre mondiale, on
considérait aussi que l’Allemagne avait été définitivement mise
hors de combat, de même que le sont aujourd’hui, selon certains
camarades, le Japon et l’Allemagne. À ce moment, on disait aussi
et on proclamait dans la presse que les États-Unis d’Amérique
avaient réduit l’Europe à la portion congrue ; que
l’Allemagne ne pourrait plus se relever ; qu’il ne devait
plus y avoir de guerre entre pays capitalistes.
Mais, malgré cela, l’Allemagne s’est remise
debout comme une grande puissance quinze à vingt ans après sa
défaite ; elle s’est évadée de sa captivité et engagée
sur le chemin de l’indépendance. Chose caractéristique, c’est
que la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique ont aidé
eux- mêmes l’Allemagne à se relever économiquement et à
rétablir son potentiel économique et militaire.
Sans doute qu’en aidant l’Allemagne à se
relever économiquement, les U.S.A. et la Grande-Bretagne entendaient
diriger l’Allemagne, une fois relevée, contre l’Union
soviétique, l’utiliser contre le pays du socialisme. L’Allemagne
cependant a dirigé ses forces, en premier lieu, contre le bloc
anglo-franco-américain.
Et lorsque l’Allemagne hitlérienne eut déclaré
la guerre à l’Union soviétique, le bloc anglo-franco-américain,
loin de se rallier à l’Allemagne hitlérienne, fut obligée, au
contraire, de se coaliser avec l’U.R.S.S. contre l’Allemagne
hitlérienne.
Par conséquent, la lutte des pays capitalistes
pour la possession des marchés et le désir de noyer leurs
concurrents se sont pratiquement révélés plus forts que les
contradictions entre le camp du capitalisme et celui du socialisme.
On se demande : où est la garantie que
l’Allemagne et le Japon ne se relèveront pas et ne tenteront pas
de s’évader de la captivité américaine pour commencer une vie
propre, indépendante ? Je pense que cette garantie n’existe
pas.
Il s’ensuit donc que l’inévitabilité des
guerres entre pays capitalistes reste entière.
On dit qu’il faut considérer comme périmée la
thèse de Lénine selon laquelle l’impérialisme engendre
inévitablement les guerres, puisque de puissantes forces populaires
ont surgi maintenant, qui défendent la paix contre une nouvelle
guerre mondiale. Cela est faux.
Le mouvement actuel pour la paix se propose
d’entraîner les masses populaires dans la lutte pour le maintien
de la paix, pour conjurer une nouvelle guerre mondiale. Par
conséquent, il ne vise pas à renverser le capitalisme et à
instaurer le socialisme, — il se borne à des buts démocratiques
de lutte pour le maintien de la paix. À cet égard, le mouvement
actuel pour le maintien de la paix se distingue de celui qui existait
lors de la première guerre mondiale, et qui, visant à transformer
la guerre impérialiste en guerre civile, allait plus loin et
poursuivait des buts socialistes.
Il se peut que, les circonstances aidant, la lutte
pour la paix évolue çà et là vers la lutte pour le socialisme,
mais ce ne sera plus le mouvement actuel en faveur de la paix, mais
un mouvement pour renverser le capitalisme.
Le plus probable, c’est que le mouvement actuel
en faveur de la paix, en tant que mouvement pour le maintien de la
paix, contribuera, en cas de succès, à conjurer une guerre donnée,
à l’ajourner temporairement, à maintenir temporairement une paix
donnée, à faire démissionner le gouvernement belliciste et à y
substituer un autre gouvernement, disposé à maintenir
provisoirement la paix.
Cela est bien, naturellement. C’est même très
bien. Mais cela ne suffit cependant pas pour supprimer
l’inévitabilité des guerres, en général, entre pays
capitalistes. Cela ne suffit pas, car malgré tous ces succès du
mouvement de la paix, l’impérialisme demeure debout, reste en
vigueur. Par suite, l’inévitabilité des guerres reste également
entière.
Pour supprimer l’inévitabilité des guerres, il
faut détruire l’impérialisme.
7.
Des lois économiques fondamentales du capitalisme actuel et du
socialisme
On sait que la question des lois économiques
fondamentales du capitalisme et du socialisme a été plusieurs fois
soulevée au cours des discussions.
Différentes opinions ont été émises à ce
sujet, allant même jusqu’aux plus fantaisistes. Il est vrai que la
plupart des participants à la discussion ont réagi mollement, et
qu’aucune décision n’a été prise sur ce point. Toutefois,
aucun des participants à la discussion n’a nié l’existence de
ces lois.
Une loi économique fondamentale du capitalisme
existe-t-elle ? Oui, elle existe. Qu’est-ce que cette loi,
quels sont ses traits caractéristiques ?
La loi économique fondamentale du capitalisme est
celle qui définit, non pas un aspect particulier ou des processus
particuliers du développement de la production capitaliste, mais
tous les principaux aspects et tous les principaux processus de ce
développement ; elle définit donc l’essence de la production
capitaliste, sa nature.
La loi de la valeur n’est-elle pas la loi
économique fondamentale du capitalisme ? Non. Elle est avant
tout celle de la production marchande.
Elle existait avant le capitalisme et continue
d’exister, ainsi que la production marchande, après le
renversement du capitalisme, par exemple, dans notre pays, avec, il
est vrai, une sphère d’action limitée.
Certes, la loi de la valeur, qui comporte une
large sphère d’action dans le cadre du capitalisme, joue un grand
rôle dans le développement de la production capitaliste ; mais
elle ne définit pas l’essence de la production capitaliste et les
bases du profit capitaliste ; bien plus : elle ne pose même
pas ces problèmes. Elle ne peut donc pas être la loi économique
fondamentale du capitalisme actuel.
Pour les mêmes raisons, la loi de la concurrence
et de l’anarchie de la production, ou la loi du développement
inégal du capitalisme dans les différents pays ne peut être la loi
économique fondamentale du capitalisme.
On soutient que la loi du taux moyen du profit est
la loi économique fondamentale du capitalisme actuel.
Cela est faux. Le capitalisme actuel, le
capitalisme de monopole, ne peut se contenter du taux moyen qui, au
surplus, a tendance à diminuer par suite du relèvement de la
composition organique du capital.
L’actuel capitalisme de monopole ne demande pas
le profit moyen, mais le maximum de profit, nécessaire pour réaliser
plus ou moins régulièrement la reproduction élargie.
La loi qui convient le mieux à la notion de loi
économique fondamentale du capitalisme, est celle de la plus-value,
celle de la naissance et de l’accroissement du profit capitaliste.
En effet, elle détermine les traits essentiels de la production
capitaliste.
Mais la loi de la plus-value est une loi d’ordre
trop général, qui ne touche pas aux problèmes du taux maximum du
profit, dont la garantie est la condition du développement du
capitalisme monopoliste. Pour combler cette lacune, il faut
concrétiser la loi de la plus-value et la développer, en accord
avec les conditions du capitalisme de monopole, en tenant compte que
ce dernier ne réclame pas n’importe quel profit, mais le maximum
de profit. C’est cela la loi économique fondamentale du
capitalisme actuel.
Les traits principaux et les dispositions de la
loi économique fondamentale du capitalisme actuel pourraient être
formulés à peu près ainsi : assurer le maximum de profit
capitaliste en exploitant, en ruinant, en appauvrissant la majeure
partie de la population d’un pays donné ; en asservissant et
en dépouillant de façon systématique les peuples des autres pays,
notamment ceux des pays arriérés ; enfin, en déclenchant des
guerres et en militarisant l’économie nationale en vue d’assurer
le maximum de profits.
On dit que le profit moyen pourrait néanmoins,
dans les conditions actuelles, amplement suffire au développement
capitaliste.
C’est faux. Le profit moyen, c’est la limite
inférieure de la rentabilité, au-dessous de laquelle la production
capitaliste devient impossible. Mais il serait ridicule de penser que
les brasseurs d’affaires de l’actuel capitalisme monopoliste, en
s’emparant des colonies, en asservissant les peuples et on
déclenchant des guerres, entendent ne s’assurer qu’un profit
moyen.
Non, ce n’est pas le profit moyen, ni le
surprofit qui ne représente en règle générale qu’une certaine
majoration du profit moyen, mais le maximum de profit qui constitue
la force motrice du capitalisme de monopole.
C’est la nécessité de réaliser le maximum de
profits qui pousse le capitalisme de monopole à des actes hasardeux
comme l’asservissement et le pillage systématique des colonies et
des autres pays arriérés, la transformation des pays indépendants
en pays dépendants, l’organisation de nouvelles guerres qui sont
pour les brasseurs d’affaires du capitalisme actuel le meilleur
« business » leur permettant de tirer le maximum de
profit ; enfin, les efforts tentés pour conquérir la
domination économique mondiale.
La portée de la loi économique fondamentale du
capitalisme consiste entre autres en ceci : en définissant tous
les phénomènes importants dans le développement du mode de
production capitaliste, ses essors et ses crises, ses victoires et
ses défaites, ses mérites et ses défauts, — tout le processus de
son développement contradictoire, — elle permet de les comprendre
et de les expliquer.
Voici un exemple « frappant » entre
tant d’autres.
Tout le monde connaît les faits tirés de
l’histoire et de la pratique du capitalisme, qui montrent l’essor
impétueux de la technique sous le capitalisme, alors que les
capitalistes s’affirment des champions de la technique avancée,
des révolutionnaires dans le développement de la technique de la
production.
Mais on connaît également des faits d’un autre
genre qui montrent que le développement de la technique subit des
arrêts sous le capitalisme, quand les capitalistes font figure de
réactionnaires par rapport au progrès technique et reviennent
souvent au travail manuel.
Comment expliquer cette contradiction flagrante ?
On ne peut l’expliquer que par la loi économique fondamentale du
capitalisme actuel, c’est-à-dire par la nécessité de réaliser
le maximum de profits. Le capitalisme est pour la technique nouvelle,
quand elle lui fait entrevoir les plus grands profits. Il est contre
la nouvelle technique et pour le retour au travail manuel, lorsque la
nouvelle technique ne lui fait plus entrevoir les profits les plus
élevés.
Il en est ainsi de la loi économique fondamentale
du capitalisme actuel.
Existe-t-il une loi économique fondamentale du
socialisme ? Oui, elle existe. Quels sont les traits essentiels
et les dispositions de cette loi ?
Les traits essentiels et les dispositions de la
loi économique fondamentale du socialisme pourraient être formulés
à peu près ainsi : assurer au maximum la satisfaction des
besoins matériels et culturels sans cesse accrus de toute la
société, en augmentant et en perfectionnant toujours la production
socialiste sur la base d’une technique supérieure.
Par conséquent : au lieu que soit assuré le
maximum de profits, c’est la satisfaction au maximum des besoins
matériels et culturels de la société ; au lieu que la
production se développe avec des temps d’arrêt — de l’essor à
la crise, de la crise à l’essor, — c’est une croissance
ininterrompue de la production ; au lieu de temps d’arrêt
périodiques qui s’opèrent dans le progrès technique et
s’accompagnent de la destruction des forces productives de la
société, c’est un perfectionnement ininterrompu de la production
sur la base d’une technique supérieure.
On dit que la loi économique fondamentale du
socialisme est celle d’un développement harmonieux, proportionnel
de l’économie nationale. Cela est faux. Le développement
harmonieux de l’économie nationale et, par suite, sa
planification, qui constitue le reflet plus ou moins fidèle de cette
loi, ne peuvent rien donner par eux- mêmes, si on ignore au nom de
quels objectifs se fait le développement planifié de l’économie
nationale, ou bien si la tâche n’est pas claire.
La loi du développement harmonieux de l’économie
nationale, ne peut donner l’effet voulu que dans le cas où il y a
une tâche au nom de laquelle ce développement se poursuit. Cette
tâche ne peut être fournie par la loi même du développement
harmonieux de l’économie nationale. À plus forte raison ne
peut-elle pas être fournie par la planification de l’économie
nationale.
Cette tâche est contenue dans la loi économique
fondamentale du socialisme sous la forme des dispositions exposées
plus haut.
Aussi, la loi du développement harmonieux de
l’économie nationale ne peut-elle exercer à fond son action que
si cette action s’appuie sur la loi économique fondamentale du
socialisme.
En ce qui concerne la planification de l’économie
nationale, elle ne peut obtenir de résultats positifs qu’en
observant deux conditions : a) si elle reflète
correctement les dispositions de la loi du développement harmonieux
de l’économie nationale ; b) si elle tient compte
partout des dispositions de la loi économique fondamentale du
socialisme.
8. Autres
problèmes
1) La question de la contrainte extra-économique
sous le féodalisme.
Sans doute, la contrainte extra-économique a
contribué à consolider le pouvoir économique des féodaux, sans
constituer toutefois la base du féodalisme ; c’était la
propriété féodale de la terre qui en était le fondement.
2) La question de la propriété personnelle du
foyer kolkhozien.
On aurait tort de dire dans le projet de manuel
que « chaque foyer kolkhozien dispose personnellement d’une
vache, de menu bétail et de volaille ». On sait qu’en
réalité la vache, le menu bétail, la volaille, etc., ne sont pas
un objet de jouissance personnelle, mais la propriété personnelle
du foyer kolkhozien. L’expression « jouissance personnelle »
a été empruntée sans doute au Statut-type de l’artel agricole.
Mais il y a là une erreur. La Constitution de l’U.R.S.S., élaborée
avec plus de soin, dit autre chose, à savoir :
Chaque
foyer kolkhozien… sur ce terrain possède en propre une économie
auxiliaire, une maison d’habitation, le bétail de production, la
volaille et le menu matériel agricole. (Constitution de
l’U.R.S.S., p. 4, Éditions sociales, Paris, 1945.)
C’est exact, bien entendu.
Il faudrait, en outre, dire avec plus de détail
que chaque kolkhozien possède en propre d’une à tant de vaches,
selon les conditions locales, tant de moutons, de chèvres, de porcs
(en nombre à déterminer suivant les conditions locales) et un
nombre illimité de volailles (canards, oies, poules, dindes).
Ces détails ont une grande importance pour nos
camarades à l’étranger, qui veulent savoir exactement ce qui
reste proprement au foyer kolkhozien à titre de propriété
personnelle, après que la collectivisation agricole a été réalisée
chez nous.
3) La question des fermages que les paysans
devaient aux propriétaires fonciers, de même que les dépenses
nécessitées par l’achat de terre.
Il est dit dans le projet de manuel qu’à la
suite de la nationalisation du sol « la paysannerie s’est
libérée des fermages qu’elle payait aux propriétaires fonciers —
près de 500 millions de roubles par an » (ajoutons : « en
or »). Il importerait de préciser ce chiffre, car il établit,
ce me semble, le fermage payé non pas dans toute la Russie, mais
dans la plupart des provinces russes.
Il ne faut pas perdre de vue que sur certains
confins de la Russie, le fermage se payait en nature, ce dont les
auteurs du projet de manuel n’ont sans doute pas tenu compte. En
outre, il ne faut pas oublier que la paysannerie s’est libérée
des fermages, mais aussi des dépenses annuelles nécessitées par
les achats de terre. En a-t-on tenu compte dans le projet de manuel ?
Il me semble que non ; or, il faudrait en tenir compte.
4) Le problème de l’intégration des monopoles
à l’appareil d’État.
Le mot « intégration » est employé
ici improprement. Terme qui exprime superficiellement et sous forme
descriptive le rapprochement des monopoles et de l’État, mais sans
dégager le sens économique de ce rapprochement qui n’entraîne
pas simplement l’intégration, mais la soumission de l’appareil
d’État aux monopoles. Il faudrait donc rejeter le mot
« intégration », et y substituer les mots « soumission
de l’appareil d’État aux monopoles ».
5) De l’emploi des machines en U.R.S.S.
Il est dit dans le projet de manuel qu’ « en
U.R.S.S., les machines sont employées toutes les fois qu’elles
économisent le travail à la société ». Ce n’est pas du
tout ce qu’il faudrait dire.
D’abord, les machines en U.R.S.S. économisent
toujours le travail à la société, ce qui fait que nous ne
connaissons pas d’exemple de machines qui, en U.R.S.S., n’aient
pas économisé le travail à la société. En second lieu, les
machines n’économisent pas uniquement le travail, elles facilitent
le labeur des hommes, ce qui fait que dans nos conditions,
contrairement à celles du capitalisme, les ouvriers emploient très
volontiers les machines dans leur travail.
Il faudrait donc dire que nulle part les machines
ne sont employées aussi volontiers qu’en U.R.S.S., puisqu’elles
économisent le travail à la société et facilitent la peine des
hommes. Et comme le chômage n’existe pas en U.R.S.S., les ouvriers
emploient très volontiers les machines dans l’économie nationale.
6) De la situation matérielle de la classe
ouvrière dans les pays capitalistes.
Quand on parle de la situation matérielle de la
classe ouvrière, on pense d’habitude aux ouvriers occupés, et
l’on ne tient pas compte de la situation matérielle de ce qu’on
appelle l’armée de réserve, l’armée des chômeurs.
Une telle façon de traiter de la situation
matérielle de la classe ouvrière est-elle juste ? Je pense que
non. Si les chômeurs forment une armée de réserve, dont les
membres n’ont pas de quoi vivre, sinon de la vente de leur force de
travail, les chômeurs doivent forcément faire partie de la classe
ouvrière ; mais alors leur situation misérable ne peut
qu’influer sur la situation matérielle des ouvriers occupés.
Je pense donc qu’en définissant la situation
matérielle de la classe ouvrière dans les pays capitalistes, il
faudrait tenir compte aussi de la situation de l’armée de réserve
des sans-travail.
7) La question du revenu national.
Je pense qu’il faudrait inclure absolument dans
le projet de manuel un nouveau chapitre sur le revenu national.
8) En ce qui concerne le chapitre spécial du
manuel sur Lénine et Staline, créateurs de l’économie politique
du socialisme.
Je pense que le chapitre « La doctrine
marxiste du socialisme. La création par Lénine et Staline d’une
économie politique du socialisme » doit être supprimé. Il
est absolument inutile dans ce manuel, puisqu’il n’apporte rien
de nouveau et ne fait que répéter faiblement ce qui a été dit
avec plus de détails dans les chapitres précédents.
En ce qui concerne les autres problèmes, je n’ai
pas d’observations à ajouter aux « propositions » des
camarades Ostrovitianov, Léontiev, Chépilov, Gatovski et autres.
9. La portée
internationale d’un manuel marxiste d’économie politique
Je pense que les camarades ne tiennent pas
suffisamment compte de la portée d’un manuel marxiste d’économie
politique.
Ce manuel n’est pas seulement nécessaire à
notre jeunesse soviétique. Il l’est surtout aux communistes de
tous les pays et à ceux qui sympathisent avec eux.
Nos camarades à l’étranger veulent savoir
comment nous avons fait pour secouer le joug capitaliste, réorganiser
l’économie du pays dans l’esprit du socialisme, pour gagner
l’amitié de la paysannerie ; comment nous avons fait pour
qu’un pays hier encore misérable et faible se transforme en pays
riche, puissant ; ce que sont les kolkhozes ; pourquoi,
malgré la socialisation des moyens de production, nous maintenons la
production marchande, l’argent, le commerce, etc.
Ils veulent savoir tout cela et bien d’autres
choses, non point par simple curiosité, mais pour apprendre de nous
et utiliser notre expérience dans leur propre pays. Aussi la
publication d’un bon manuel marxiste d’économie politique
a-t-elle une importance non seulement nationale, mais encore une
immense portée internationale.
Il faut donc un manuel pouvant servir de livre de
chevet à la jeunesse révolutionnaire non seulement à l’intérieur
du pays, maie aussi au delà de ses frontières.
Il ne doit pas être trop volumineux, sinon il ne
pourra par être un livre de chevet, et l’on aura de la peine à se
l’assimiler, à en venir à bout. Mais il doit contenir toutes les
choses essentielles concernant aussi bien l’économie de notre pays
que celle du capitalisme et du système colonial.
Certains camarades ont proposé, au cours des
débats, d’inclure dans le manuel plusieurs nouveaux chapitres, les
historiens : sur l’histoire, les hommes politiques : sur
la politique, les philosophes : sur la philosophie, les
économistes : sur l’économie.
Mais cela aurait fait prendre au manuel des
proportions illimitées. Naturellement, il ne faut pas le faire. Le
manuel utilise la méthode historique pour illustrer les problèmes
d’économie politique, mais cela ne veut pas encore dire que nous
devions faire du manuel d’économie politique une histoire des
rapports économiques.
Il nous faut, un manuel de 500, de 600 pages au
plus. Ce sera un livre de chevet en matière d’économie politique
marxiste, un excellent cadeau aux jeunes communistes de tous les
pays.
Du reste, étant donné le niveau insuffisant de
la formation marxiste de la plupart des Partis communistes étrangers,
ce manuel pourrait être d’une grande utilité aussi pour les
cadres communistes plus âgés de ces pays.
10. Les
moyens d’améliorer le projet de manuel d’économie politique
Certains camarades se sont attachés, au cours de
la discussion, à « démolir » avec zèle le projet de
manuel ; ils ont critiqué ses auteurs pour leurs fautes et
leurs insuffisances, et affirmé que le projet n’est pas réussi.
Cela n’est pas juste.
Sans doute, il y a des erreurs et des
insuffisances dans le manuel, — il y en a presque toujours dans un
travail important. De toute façon, l’immense majorité des
participants à la discussion ont reconnu pourtant que le projet de
manuel pouvait servir de base au futur manuel et n’a besoin que de
certaines rectifications et de certaines adjonctions.
En effet, il suffit de comparer le projet aux
manuels d’économie politique en librairie, pour conclure qu’il
est sensiblement supérieur aux manuels existants. C’est là un
grand mérite des auteurs de ce projet.
Je pense que pour l’améliorer, il faudrait
nommer une commission à effectif réduit, en y comprenant non
seulement les auteurs du manuel et les partisans de la majorité de
ceux qui ont pris part à la discussion, mais aussi les adversaires
de la majorité, les critiques zélés du projet de manuel.
On ferait bien d’inclure dans la commission un
statisticien averti qui vérifierait les chiffres et introduirait
dans le projet de nouvelles statistiques, de même qu’un juriste
expérimenté pour vérifier le texte des formules.
Il faudrait exempter temporairement les membres de
la commission de tout autre travail, en les pourvoyant pleinement
sous le rapport matériel, afin qu’ils puissent se donner tout
entier à ce travail.
En outre, il faudrait nommer un comité de
rédaction, trois personnes, par exemple, qui seraient chargées de
la mise au point définitive du manuel. Ce qui est nécessaire aussi
pour réaliser l’unité de style dont, malheureusement, le projet
de manuel est dépourvu.
Les délais de présentation du manuel mis au
point au Comité central : un an.
1er février 1952.
Réponse au
camarade
Alexandre Ilitch Notkine
Camarade Notkine,
Je ne vous ai pas répondu aussitôt, parce que je
ne juge pas urgentes les questions que vous posez. D’autant plus
qu’il est d’autres questions ayant un caractère d’urgence et
qui, naturellement, retiennent l’attention et la détournent de
votre lettre.
Je réponds point par point.
Premier point.
Dans mes « Remarques » figure la thèse
selon laquelle la société n’est pas impuissante devant les lois
de la science, que les hommes, en connaissant les lois économiques,
peuvent les utiliser dans l’intérêt de la société.
Vous prétendez que cette thèse ne peut être
étendue aux autres formations de la société, qu’elle n’est
valable que pour le socialisme et le communisme, que le caractère
spontané des processus économiques, par exemple, sous le
capitalisme ne permet pas à la société d’utiliser les lois
économiques dans son intérêt.
C’est faux. À l’époque de la révolution
bourgeoise, par exemple en France, la bourgeoisie a utilisé centre
le féodalisme la loi de correspondance nécessaire entre les
rapports de production et le caractère des forces productives, elle
a renversé les rapports de production féodaux, elle a créé des
rapports de production nouveaux, bourgeois, et les a fait concorder
avec le caractère des forces productives, formées au sein du régime
féodal.
La bourgeoisie l’a fait non pas en vertu de ses
talents particuliers, mais parce qu’elle y était vivement
intéressée. Les féodaux s’y opposaient non par stupidité, mais
parce qu’ils étaient vivement intéressés à empêcher
l’application de cette loi.
Il faut en dire autant de la Révolution
socialiste dans notre pays. La classe ouvrière a utilisé la loi de
correspondance nécessaire entre les rapports de production et le
caractère des forces productives, elle a renversé les rapports de
production bourgeois, elle a créé des rapports de production
nouveaux, socialistes, et les a fait concorder avec le caractère des
forces productives.
Elle a pu le faire, non en vertu de ses talents
particuliers, mais parce qu’elle y était vivement intéressée. La
bourgeoisie qui, de force d’avant-garde à l’aube de la
révolution bourgeoise, avait eu le temps de se transformer en une
force contre-révolutionnaire, a résisté par tous les moyens à
l’application de cette loi, — résisté non point par manque
d’organisation ni parce que le caractère spontané des processus
économiques la poussait à la résistance, mais principalement parce
qu’elle était vivement intéressée à la non-application de cette
loi.
Par conséquent :
1o L’utilisation des processus économiques, des
lois économiques dans l’intérêt de la société a lieu, dans
telle ou telle mesure, non seulement sous le socialisme et le
communisme, mais aussi sous d’autres formations ;
2o L’utilisation des lois économiques dans une
société de classe, a toujours et partout des mobiles de classe, et
le promoteur de l’utilisation des lois économiques dans l’intérêt
de la société, est toujours et partout la classe d’avant-garde,
tandis que les classes déclinantes s’y opposent.
En l’occurrence, la différence entre le
prolétariat, d’une part, et les autres classes qui accomplirent
jadis, au cours de l’histoire, des révolutions dans les rapports
de production, d’autre part, c’est que les intérêts de classe
du prolétariat se fondent avec les intérêts de l’immense
majorité de la société, car la révolution du prolétariat ne
signifie pas la suppression de telle ou telle forme d’exploitation,
mais la suppression de toute exploitation, tandis que les révolutions
des autres classes, en supprimant simplement telle ou telle forme
d’exploitation, n’allaient pas au delà de leurs intérêts de
classe étroits, qui se trouvaient en contradiction avec les intérêts
de la majorité de la société.
Les « Remarques » parlent des mobiles
de classe qui font que les lois économiques sont utilisées dans
l’intérêt de la société. Il y est dit :
Alors
que dans le domaine de la nature, la découverte et l’application
d’une nouvelle loi se poursuivent plus ou moins sans entrave, dans
le domaine économique la découverte et l’application d’une
nouvelle loi, qui porte atteinte aux intérêts des forces
déclinantes de la société, rencontrent la résistance la plus
énergique de ces forces.
Or vous n’avez prêté aucune attention à ce
passage.
Deuxième point.
Vous prétendez que l’entière correspondance
entre les rapports de production et le caractère des forces
productives, ne peut être obtenue que sous le socialisme et le
communisme, et que sous les autres formations on ne peut réaliser
qu’une correspondance incomplète.
C’est faux. Dans l’époque qui a suivi la
révolution bourgeoise, lorsque la bourgeoisie a détruit les
rapports de production féodaux et instauré des rapports de
production bourgeois, il y a eu incontestablement des périodes où
les rapports de production bourgeois ont été entièrement conformes
au caractère des forces productives.
Autrement, le capitalisme n’aurait pas pu se
développer aussi rapidement qu’il l’a fait après la révolution
bourgeoise.
Ensuite. On ne peut pas prendre dans leur
acception absolue les mots « entière correspondance ».
On ne peut pas les interpréter en ce sens que,
sous le socialisme, les rapports de production ne marqueraient aucun
retard sur l’accroissement des forces productives. Les forces
productives sont les forces les plus mobiles et les plus
révolutionnaires de la production. Elles devancent, sans conteste,
les rapports de production, en régime socialiste également. Ce
n’est qu’au bout d’un certain temps que les rapports de
production s’adaptent au caractère des forces productives.
Dès lors, comment faut-il comprendre les mots
« entière correspondance » ? Il faut les comprendre
en ce sens que d’une façon générale, sous le socialisme, les
choses n’aboutissent pas à un conflit entre les rapports de
production et les forces productives, que la société a la
possibilité d’assurer en temps utile la correspondance entre les
rapports de production retardataires et le caractère des forces
productives.
La société socialiste a la possibilité de le
faire parce qu’elle n’a pas, dans son sein, de classes
déclinantes pouvant organiser la résistance. Certes, sous le
socialisme également, il y aura des forces d’inertie
retardataires, ne comprenant pas la nécessité de modifier les
rapports de production, mais il sera, évidemment, facile d’en
venir à bout, sans pousser les choses jusqu’à un conflit.
Troisième point.
Il ressort de vos raisonnements que vous
considérez comme une marchandise les moyens de production et, tout
d’abord, les instruments de production fabriqués par nos
entreprises nationalisées.
Peut-on considérer les moyens de production, dans
notre régime socialiste, comme une marchandise ? Selon moi, on
ne le peut en aucune façon.
La marchandise est un produit de la production,
qui se vend à tout acheteur ; au moment de la vente, le
propriétaire de la marchandise perd son droit de propriété, tandis
que l’acheteur devient propriétaire de la marchandise ; il
peut la revendre, la mettre en gage, la laisser pourrir. Cette
définition convient-elle pour les moyens de production ?
Il est clair que non. D’abord, les moyens de
production ne « se vendent » pas à tout acheteur, ils ne
« se vendent » pas même aux kolkhozes ; ils sont
simplement répartis par l’État entre ses entreprises. En second
lieu, le propriétaire des moyens de production, l’État, lorsqu’il
les remet à telle ou telle entreprise ne perd aucunement le droit de
propriété sur les moyens de production, mais, au contraire, le
conserve intégralement.
Troisièmement, les directeurs d’entreprises,
qui ont reçu de l’État des moyens de production, non seulement
n’en deviennent pas les propriétaires, mais, au contraire, sont
les fondés de pouvoir de l’État soviétique pour l’utilisation
des moyens de production, en accord avec les plans fixés par l’État.
Comme on le voit, les moyens de production, sous
notre régime, ne sauraient aucunement être classés dans la
catégorie des marchandises.
Pourquoi alors parle-t-on de la valeur des moyens
de production, de leur prix de revient, de leur prix de vente, etc. ?
Pour deux raisons.
Premièrement, cela est nécessaire pour les
calculs, pour les règlements de comptes, pour établir la
rentabilité ou la non-rentabilité des entreprises, pour vérifier
et contrôler ces dernières. Mais ce n’est là que le côté
formel de la question.
Deuxièmement, cela est nécessaire pour pouvoir,
dans l’intérêt du commerce extérieur, vendre des moyens de
production aux États étrangers. Ici, dans le domaine du commerce
extérieur, mais seulement dans ce domaine, nos moyens de production
sont effectivement des marchandises et se vendent effectivement (sans
guillemets).
Ainsi donc, dans le domaine du commerce extérieur,
les moyens de production fabriqués par nos entreprises conservent
les propriétés de marchandises tant pour le fond que pour la forme,
tandis que dans les échanges économiques à l’intérieur du pays,
les moyens de production perdent les propriétés des marchandises,
cessent d’être des marchandises, sortent de la sphère d’action
de la loi de la valeur et ne conservent que l’apparence extérieure
de marchandises (calculs, etc.)
Comment expliquer cette particularité ?
C’est que dans nos conditions socialistes le
développement économique se fait non par révolutions, mais par
modifications graduelles, lorsque l’ancien n’est pas purement et
simplement aboli, mais change de nature pour s’adapter au nouveau,
et ne conserve que sa forme ; le nouveau, pour sa part, ne
supprime pas purement et simplement l’ancien, mais le pénètre,
modifie sa nature, ses fonctions, n’en brise pas la forme mais
l’utilise pour le développement du nouveau.
Il en est ainsi des marchandises, mais aussi de la
monnaie dans nos échanges économiques, il en va de même en ce qui
concerne les banques qui, en perdant leurs anciennes fonctions et en
en acquérant de nouvelles, conservent leur forme ancienne, utilisée
par le régime socialiste.
Si l’on envisage la question du point de vue
formel, du point de vue des processus qui s’opèrent à la surface
des événements, on en arrive à cette fausse conclusion que les
catégories du capitalisme conservent soi-disant leur vigueur dans
notre économie.
Mais si l’on analyse la question du point de vue
marxiste, qui distingue strictement entre le contenu du processus
économique et sa forme, entre les processus profonds de
développement et les phénomènes superficiels, — on ne petit
arriver qu’à cette conclusion, la seule juste : c’est que
chez nous se sont principalement conservés la forme, l’aspect
extérieur des anciennes catégories du capitalisme ; quant au
fond, ces catégories ont changé radicalement, selon les nécessités
du développement de l’économie nationale, de l’économie
socialiste.
Quatrième point.
Vous prétendez que la loi de la valeur exerce une
action régulatrice sur les prix des « moyens de production »
produits par l’agriculture et livrée à l’État aux prix de
stockage. Ce disant, vous avez en vue des « moyens de
production » comme les matières premières, par exemple, le
coton. Vous auriez pu ajouter le lin, la laine et autres matières
premières agricoles.
Notons tout d’abord qu’en l’occurrence
l’agriculture ne produit pas les « moyens de production »,
mais un des moyens de production : les matières premières. On
ne doit pas jouer sur les mots « moyens de production ».
Lorsque les marxistes parlent de la production des
moyens de production, ils entendent tout d’abord la production des
instruments de production, ce que Marx appelle les « moyens
mécaniques de travail, dont l’ensemble peut être appelé
l’ossature et la musculature de la production », système qui
constitue les « indices distinctifs caractéristiques d’une
époque donnée de la production sociale ».
Mettre sur le même plan une partie des moyens de
production (matières premières) et les moyens de production, y
compris les instruments de production, c’est pécher contre le
marxisme, qui part du rôle déterminant des instruments de
production par rapport à tous les autres moyens de production.
Chacun sait que les matières premières par
elles-mêmes ne peuvent produire des instruments de production, bien
que certaines variétés de matières premières soient
indispensables à la fabrication des instruments de production,
tandis qu’aucune matière première ne peut être produite sans
instruments de production.
Poursuivons. L’action que la loi de la valeur
exerce sur le prix des matières premières produites dans
l’agriculture, est-elle une action régulatrice, comme vous le
prétendez, camarade Notkine ?
Elle serait régulatrice si le « libre »
jeu des prix des matières premières agricoles existait chez nous,
si la loi de concurrence et d’anarchie de la production s’exerçait
chez nous, si nous n’avions pas d’économie planifiée, si la
production des matières premières n’était pas réglée par un
plan. Mais étant donné que tous ces « si » sont
inexistants dans notre système d’économie nationale, l’action
de la loi de la valeur sur les prix des matières premières
agricoles ne peut en aucune façon être régulatrice.
Premièrement, les prix qui existent chez nous sur
les matières premières agricoles sont stables, établis par un
plan, et non « libres ».
Deuxièmement, le volume de la production des
matières premières agricoles n’est pas établi spontanément, ni
par des éléments fortuits, mais par un plan. Troisièmement, les
instruments de production nécessaires à la production des matières
premières agricoles, ne sont pas concentrées entre les mains
d’individus, ou de groupes d’individus, mais entre les mains de
l’État.
Que reste-t-il après cela du rôle régulateur de
la loi de la valeur ? On voit qu’elle-même est réglée par
les faits indiqués plus haut, inhérente à la production
socialiste.
Par conséquent, on ne peut nier que la loi de la
valeur agit sur la formation des prix des matières premières
agricoles, qu’elle en est un des facteurs. À plus forte raison ne
doit-on nier le fait que cette action n’est, ni ne peut être
régulatrice.
Cinquième point.
En parlant de la rentabilité de l’économie
nationale, de l’économie socialiste, j’ai élevé des objections
dans mes « Remarques » contre certains camarades qui
prétendent que, étant donné que notre économie nationale
planifiée n’accorde pas une préférence marquée aux entreprises
rentables et admet, à côté de celles-ci, des entreprises non
rentables, notre économie tue soi-disant le principe même de la
rentabilité dans l’économie.
Dans mes « Remarques », il est dit que
la rentabilité des différentes entreprises et branches de
production, ne saurait aucunement être comparée à la rentabilité
supérieure que nous donne la production socialiste, qui nous
prémunit contre les crises de surproduction et nous garantit une
augmentation incessante de la production.
Mais on aurait tort d’en tirer la conclusion que
la rentabilité des différentes entreprises et branches de
production n’a pas de valeur particulière et ne mérite pas une
sérieuse attention. Évidemment, c’est faux.
La rentabilité des différentes entreprises et
branches de production a une importance énorme pour le développement
de notre production. On doit en tenir compte en planifiant la
construction aussi bien que la production. C’est l’abc de notre
activité économique au stade de développement actuel.
Sixième point.
On ne sait pas au juste comment il faut comprendre
ce que vous dites à propos du capitalisme : « la
production élargie sous un aspect sensiblement déformé ».
Pareilles productions, et encore élargies, n’existent pas dans la
réalité.
Après que le marché mondial s’est scindé et
que la sphère d’application des forces des principaux pays
capitalistes (États-Unis, Grande-Bretagne, France) aux ressources
mondiales a commencé à se rétrécir, il est évident que le
caractère cyclique du développement du capitalisme —
accroissement et réduction de la production — doit cependant
persister.
Toutefois, l’accroissement de la production dans
ces pays se fera sur une base restreinte, car le volume de la
production ira diminuant dans ces pays.
Septième point.
La crise générale du système capitaliste
mondial a commencé pendant la première guerre mondiale, notamment
du fait que l’Union soviétique s’est détachée du système
capitaliste. Ce fut la première étape de la crise générale.
Pendant la deuxième guerre mondiale, la deuxième
étape de la crise générale s’est développée, surtout après
que se sont détachés du système capitaliste les pays de démocratie
populaire en Europe et en Asie.
La première crise à l’époque de la première
guerre mondiale et la seconde crise à l’époque de la seconde
guerre mondiale, ne doivent pas être considérées comme des crises
distinctes, indépendantes, coupées l’une de l’autre, mais comme
des étapes de développement de la crise générale du système
capitaliste mondial.
Cette crise générale du capitalisme mondial
est-elle une crise uniquement politique ou uniquement économique ?
Ni l’un ni l’autre.
Elle est générale, c’est-à-dire une crise
généralisée du système capitaliste mondial, englobant l’économie
aussi bien que la politique. On conçoit qu’à la base de cette
crise se trouvent la décomposition toujours plus accentuée du
système économique capitaliste mondial, d’une part, et la
puissance économique grandissante des pays qui se sont détachés du
capitalisme : l’U.R.S.S., la Chine et les autres pays de
démocratie populaire, d’autre part.
21 avril 1952.
Des
erreurs du camarade L. Iarochenko
Le camarade Iarochenko a fait tenir dernièrement
aux membres du Bureau politique du Comité central du P.C. (b) de
l’U.R.S.S. une lettre datée du 20 mars, portant sur un certain
nombre de problèmes économiques débattus en novembre à la
discussion que l’on sait. L’auteur de cette lettre se plaint que
ni les principaux documents qui font le point de la discussion, ni
les « Remarques » du camarade Staline « ne tiennent
aucun compte du point de vue » du camarade Iarochenko.
Dans sa missive, le camarade Iarochenko propose en
outre qu’on l’autorise à écrire une « Économie politique
du socialisme », en un an ou dix-huit mois, et qu’on lui
adjoigne à cet effet deux assistants.
Je crois qu’il faudra examiner quant au fond les
doléances du camarade Iarochenko aussi bien que sa proposition.
Commençons par les doléances.
En quoi consiste donc le « point de vue »
du camarade Iarochenko, dont il n’a été tenu aucun compte dans
les documents précités ?
I —
L’erreur principale du camarade Iarochenko
Si l’on veut en deux mots caractériser le point
de vue du camarade Iarochenko, on doit dire qu’il n’est pas
marxiste et, par suite, qu’il est profondément erroné.
L’erreur principale du camarade Iarochenko,
c’est qu’il s’écarte du marxisme quant au rôle des forces
productives et des rapports de production dans le développement de
la société ; qu’il exagère à l’extrême le rôle des
forces productives et minimise pour autant celui des rapports de
production, pour finir par déclarer que sous le socialisme les
rapports de production font partie des forces productives.
Le camarade Iarochenko veut bien admettre que les
rapports de production jouent un certain rôle quand existent des
« contradictions de classes antagonistes », attendu que
dans ces conditions les rapports de production « contrarient le
développement des forces productives ». Mais ce rôle, il le
réduit à un rôle négatif, au rôle de facteur entravant le
développement des forces productives, paralysant ce développement.
Aux yeux du camarade Iarochenko, les rapports de
production n’ont point d’autres fonctions, n’ont point de
fonctions positives.
Pour ce qui est du régime socialiste où les
« contradictions de classes antagonistes » ont disparu et
où les rapports de production « ne contrarient plus le
développement des forces productives », le camarade Iarochenko
estime qu’ici tout rôle indépendant, quel qu’il soit, des
rapports de production, est exclu ; les rapports de production
cessent d’être un facteur important du développement et sont
absorbés par les forces productives, comme la partie dans le tout.
Sous le socialisme,
les
rapports de production entre les hommes, dit le camarade Iarochenko,
font partie de l’organisation des forces productives en tant que
moyen, en tant qu’élément de cette organisation. (Voir la lettre
du camarade Iarochenko au Bureau politique du Comité central.)
Quelle est donc, dans ce cas, la principale tâche
de l’économie politique du socialisme ? Le camarade
Iarochenko répond :
Le
principal problème de l’économie politique du socialisme n’est
donc pas d’étudier les rapports de production entre les hommes de
la société socialiste, mais d’élaborer et de développer une
théorie scientifique de l’organisation des forces productives dans
la production sociale, une théorie de la planification du
développement de l’économie nationale. (Voir le discours du
camarade Iarochenko à l’Assemblée plénière de la discussion.)
C’est ce qui explique proprement que le camarade
Iarochenko ne s’intéresse pas à des problèmes économiques du
régime socialiste tels que l’existence de formes différentes de
propriété dans notre économie, la circulation des marchandises, la
loi de la valeur, etc., car il estime que ce sont des problèmes de
second ordre, propres à susciter uniquement des controverses
scolastiques. Il déclare expressément que dans son économie
politique du socialisme
les
controverses sur le rôle de telle ou telle catégorie de l’économie
politique du socialisme — valeur, marchandise, argent, crédit,
etc., — qui souvent revêtent chez nous un caractère scolastique,
sont remplacées par de saines considérations sur une organisation
rationnelle des forces productives dans la production sociale, sur
l’élaboration des principes scientifiques qui seront à la base de
cette organisation. (Voir le discours du camarade Iarochenko à la
section de l’Assemblée plénière de la discussion.)
Donc, une économie politique sans problèmes
économiques.
Le camarade Iarochenko croit qu’il suffit
d’ « une organisation rationnelle des forces
productives » pour passer du socialisme au communisme sans
grandes difficultés. Il estime que c’est parfaitement suffisant
pour passer au communisme. Il déclare expressément que
sous
le socialisme, la lutte pour l’édification d’une société
communiste se réduit essentiellement à la lutte pour une
organisation judicieuse des forces productives et leur utilisation
rationnelle dans la production sociale. (Voir le discours à
l’Assemblée plénière de la discussion.)
Le camarade Iarochenko proclame triomphalement que
le
communisme est la forme la plus haute d’organisation scientifique
des forces productives dans la production sociale.
Ainsi, le régime communiste ne serait au fond
qu’ « une organisation rationnelle des forces
productives ».
De tout ceci, le camarade Iarochenko conclut qu’il
ne peut exister une économie politique commune à toutes les
formations sociales ; qu’il doit exister deux économies
politiques : l’une pour les formations sociales
présocialistes, dont l’objet est l’étude des rapports de
production entre les hommes ; l’autre pour le régime
socialiste, dont l’objet doit être non pas l’étude des rapports
de production, c’est-à-dire économiques, mais celle des problèmes
de l’organisation rationnelle des forces productives.
Tel est le point de vue du camarade Iarochenko.
Que peut-on dire de ce point de vue ?
Il est faux tout d’abord que le rôle des
rapports de production dans l’histoire de la société se borne à
celui d’entrave paralysant le développement des forces
productives.
Quand les marxistes disent que les rapports de
production jouent le rôle d’entrave, ils n’envisagent pas tous
les rapports de production, mais seulement les rapports de production
anciens, qui ne correspondent plus à la croissance des forces
productives, et, par suite, entravent leur développement. Mais outre
les anciens rapports de production, il en existe, on le sait, de
nouveaux, qui remplacent les anciens.
Peut-on dire que le rôle des nouveaux rapports de
production se réduit à celui d’entrave des forces productives ?
Évidemment non. Les nouveaux rapports de production sont au
contraire la force principale et décisive qui détermine, à
proprement parler, le développement continu et vigoureux des forces
productives ; et sans eux les forces productives sont condamnées
à végéter, comme c’est le cas aujourd’hui dans les pays
capitalistes.
Nul ne peut nier le développement prodigieux des
forces productives de notre industrie soviétique au cours des
quinquennats. Mais ce développement ne se serait pas produit si, en
Octobre 1917, nous n’avions substitué aux rapports de production
anciens, capitalistes, des rapports de production nouveaux,
socialistes.
Sans cette révolution dans les rapports de
production, dans les rapports économiques de notre pays, les forces
productives végéteraient chez nous comme elles végètent à
présent dans les pays capitalistes.
Nul ne peut nier le développement prodigieux des
forces productives de notre agriculture depuis 20-25 ans. Mais ce
développement ne se serait pas produit si, aux années 30, nous
n’avions substitué aux rapports de production anciens,
capitalistes, des rapports de production nouveaux, collectivistes,
dans les campagnes. Sans cette révolution dans la production, les
forces productives de notre agriculture végéteraient comme elles
végètent à présent dans les pays capitalistes.
Certes, les nouveaux rapports de production ne
peuvent rester ni ne restent éternellement nouveaux ; ils
commencent à vieillir et entrent en contradiction avec le
développement ultérieur des forces productives ; ils perdent
peu à peu leur rôle de principal moteur des forces productives pour
lesquelles ils deviennent une entrave. Alors, à la place de ces
rapports de production périmés, apparaissent de nouveaux rapports
de production dont le rôle est d’être le principal moteur du
développement ultérieur des forces productives.
Cette particularité du développement des
rapports de production, — passant du rôle d’entrave des forces
productives à celui de principal moteur qui les pousse en avant, et
du rôle de principal moteur à celui d’entrave des forces
productives, — constitue un des principaux éléments de la
dialectique matérialiste marxiste. C’est ce que savent aujourd’hui
tous les primaires du marxisme. C’est ce qu’ignore, paraît-il,
le camarade Iarochenko.
Il est faux, ensuite, que le rôle indépendant
des rapports de production, c’est-à- dire économiques,
disparaisse sous le socialisme ; que les rapports de production
soient absorbés par les forces productives ; que la production
sociale, sous le socialisme, se ramène à l’organisation des
forces productives.
Le marxisme considère la production sociale comme
un tout présentant deux aspects indissociables : les forces
productives de la société (rapports entre la société et les
forces de la nature contre lesquelles celle-là lutte pour s’assurer
les biens matériels qui lui sont indispensables), et les rapports de
production (rapports des hommes entre eux dans le processus de la
production).
Ce sont deux aspects différents de la production
sociale, bien qu’ils soient indissolublement liés entre eux. Et
c’est parce qu’ils constituent deux aspects différents de la
production sociale qu’ils peuvent exercer une action réciproque.
Affirmer que l’un de ces aspects peut être absorbé par l’autre
et devenir partie intégrante de celui-ci, c’est pécher de la
manière la plus grave contre le marxisme.
Marx dit :
Dans
la production, les hommes n’agissent pas seulement sur la nature,
mais aussi les uns sur les autres. Ils ne produisent qu’en
collaborant d’une manière déterminée et en échangeant entre eux
leurs activités.
Pour
produire, ils entrent en relations et en rapports déterminés les
une avec les autres, et ce n’est que dans les limites de ces
relations et de ces rapports sociaux que s’établit leur action sur
la nature, la production. (Karl Marx, Travail salarié et
capital, suivi de Salaire, prix et profit, p. 39,
Éditions sociales, Paris, 1941.)
Il suit de là que la production sociale présente
deux aspects qui, bien qu’indissolublement liés entre eux, n’en
traduisent pas moins deux catégories de rapports différents :
les rapports des hommes avec la nature (forces productives) et les
rapports des hommes entre eux dans le processus de la production
(rapports de production).
Seule l’existence simultanée de ces deux
aspects de la production nous donne la production sociale, qu’il
s’agisse du régime socialiste ou d’autres formations sociales.
Apparemment, le camarade Iarochenko n’est pas
tout à fait d’accord avec Marx. Il estime que cette thèse de Marx
n’est pas applicable au régime socialiste.
C’est bien pourquoi il réduit la tâche de
l’économie politique du socialisme à l’organisation rationnelle
des forces productives, en faisant table rase des rapports de
production, c’est- à-dire des rapports économiques, et en isolant
de ceux-ci les forces productives.
Il s’ensuit qu’au lieu d’une économie
politique marxiste, le camarade Iarochenko nous propose quelque chose
dans le genre de la « science générale de l’organisation »
de Bogdanov.
Ainsi donc, parti de cette idée juste que les
forces productives sont les forces les plus mobiles et les plus
révolutionnaires de la production, le camarade Iarochenko réduit
cette idée à l’absurde, aboutit à la négation du rôle des
rapports de production, des rapports économiques, sous le
socialisme ; au lieu d’une production sociale au sens complet
du mot, il nous propose une technologie de la production chétive et
unilatérale, quelque chose dans le genre de la « technique de
l’organisation sociale » de Boukharine.
Marx dit :
Dans
la production sociale de leur existence [c’est-à-dire dans la
production des biens matériels nécessaires à leur vie — J. S.],
les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires,
indépendants de leur volonté, rapports de production qui
correspondent à un degré de développement déterminé de leurs
forces productives matérielles.
L’ensemble
de ces rapports de production constitue la structure économique de
la société, la hase concrète sur quoi s’élève une
superstructure juridique et politique, et à laquelle correspondent
des formes de conscience sociales déterminées. (Voir la Préface
à la Contribution à la critique de l’économie politique.)
Autrement dit, chaque formation sociale, la
société socialiste y comprise, a sa base économique constituée
par l’ensemble des rapports de production entre les hommes.
La question se pose : que devient, aux yeux
du camarade Iarochenko, la base économique du régime socialiste ?
Le camarade Iarochenko, on le sait, a déjà
liquidé les rapports de production sous le socialisme en tant que
domaine plus ou moins indépendant, faisant entrer le peu qui en
subsistait dans l’organisation des forces productives.
Le régime socialiste a-t-il sa base économique ?
se demandera-t-on. Il est évident que les rapports de production
ayant disparu, sous le socialisme, comme force plus ou moins
indépendante, le régime socialiste reste sans base économique
propre.
Donc, un régime socialiste qui n’a pas de base
économique. N’est-ce pas plutôt comique ?…
Peut-il exister un régime social qui n’ait pas
de base économique ? Le camarade Iarochenko, apparemment,
estime que oui. Mais le marxisme, lui, estime que de pareils régimes
sociaux n’existent pas.
Il est faux, enfin, que le communisme soit
l’organisation rationnelle des forces productives ; que le
régime communiste se réduise essentiellement à l’organisation
rationnelle des forces productives ; qu’il suffise d’organiser
rationnellement les forces productives pour passer au communisme sans
grandes difficultés.
Il existe dans notre littérature une autre
définition, une autre formule du communisme, la formule de Lénine :
« Le communisme, c’est le pouvoir des Soviets plus
l’électrification de tout le pays. ». Apparemment, la
formule de Lénine ne plaît pas au camarade Iarochenko, et il lui
substitue une formule de son cru : « Le communisme est la
forme la plus haute d’organisation scientifique des forces
productives dans la production sociale. »
D’abord, nul ne sait ce qu’est au juste cette
« forme la plus haute d’organisation scientifique », ou
organisation « rationnelle » des forces productives,
prônée par le camarade Iarochenko, quel en est le contenu précis.
Le camarade Iarochenko répète des dizaines de
fois cette formule mythique dans ses discours à l’Assemblée
plénière, aux sections de la discussion, dans sa lettre aux membres
du Bureau politique ; mais nulle part il ne dit un seul mot pour
tenter d’expliquer comment comprendre proprement cette
« organisation rationnelle » des forces productives à
laquelle se réduirait essentiellement le régime communiste.
Ensuite, si l’on a à choisir entre les deux
formules, ce n’est pas la formule de Lénine, la seule juste, qu’il
faut rejeter, mais la pseudo-formule du camarade Iarochenko,
manifestement tirée par les cheveux et non marxiste, empruntée à
l’arsenal de Bogdanov, à la « science générale de
l’organisation ».
Le camarade Iarochenko croit qu’il suffit
d’arriver à organiser rationnellement les forces productives pour
obtenir l’abondance des produits et passer au communisme, passer de
la formule : « à chacun selon son travail » à la
formule : « à chacun selon ses besoins ».
C’est une grave erreur qui dénote une
incompréhension totale des lois du développement économique du
socialisme. Le camarade Iarochenko se représente de façon
simpliste, puérilement simpliste, les conditions pour passer du
socialisme au communisme.
Le camarade Iarochenko ne comprend pas qu’on ne
saurait ni obtenir une abondance de produits susceptible de
satisfaire tous les besoins de la société, ni passer à la formule
« à chacun selon ses besoins », en laissant subsister
des faits économiques comme la propriété collective kolkhozienne,
la circulation des marchandises, etc.
Le camarade Iarochenko ne comprend pas qu’avant
de passer à la formule : « à chacun selon ses besoins »,
la société doit faire sa rééducation économique et culturelle en
passant par une série d’étapes au cours desquelles le travail,
qui n’était qu’un moyen d’assurer son existence, deviendra aux
yeux de la société le premier besoin vital, et la propriété
sociale la base immuable et intangible de l’existence de la
société.
Pour préparer le passage au communisme, passage
réel et non purement déclaratif, on doit réaliser pour le moins
trois conditions préalables, essentielles.
1o Il faut, premièrement, assurer solidement non
pas une « organisation rationnelle » mythique des forces
productives, mais la croissance ininterrompue de toute la production
sociale, en donnant la priorité à la production des moyens de
production.
Le développement prioritaire de la production des
moyens de production est indispensable non seulement parce qu’elle
doit permettre d’outiller ses propres entreprises aussi bien que
celles de toutes les autres branches de l’économie nationale, mais
encore parce que sans elle il est absolument impossible de réaliser
la production élargie.
2o Il faut, deuxièmement, par étapes
successives, réalisées de façon que les kolkhozes et, par suite,
l’ensemble de la société y trouvent leur avantage, élever la
propriété kolkhozienne au niveau de la propriété nationale et
substituer, également par étapes successives, le système de
l’échange des produits à la circulation des marchandises, afin
que l’activité du pouvoir central ou de quelque autre organisme
économique central de la société puisse embrasser l’ensemble de
la production sociale dans l’intérêt de la société.
Le camarade Iarochenko se trompe quand il soutient
que sous le socialisme il n’existe aucune contradiction entre les
rapports de production et les forces productives de la société.
Certes, nos rapports de production connaissent actuellement une
période où ils correspondent pleinement à la croissance des forces
productives et les fout progresser à pas de géant.
Mais ce serait une erreur de se tranquilliser et
de croire qu’il n’existe aucune contradiction entre nos forces
productives et les rapports de production.
Des contradictions, il y en a et il y en aura
certainement, puisque le développement des rapports de production
retarde et retardera sur le développement des forces productives. Si
les organismes dirigeants appliquent une politique juste, ces
contradictions ne peuvent dégénérer en antagonisme, et elles
n’aboutiront pas à un conflit entre les rapports de production et
les forces productives de la société.
Il en ira autrement si nous faisons une politique
erronée comme celle que recommande le camarade Iarochenko. Un
conflit sera alors inévitable, et nos rapports de production peuvent
devenir une très sérieuse entrave au développement des forces
productives.
Aussi les organismes dirigeants ont-ils pour tâche
de noter en temps utile les contradictions qui mûrissent et de
prendre à temps des mesures pour les surmonter en adaptant les
rapports de production à la croissance des forces productives.
Cela est vrai avant tout de faits économiques
comme la propriété collective kolkhozienne, la circulation des
marchandises. Certes, à l’heure actuelle, nous utilisons ces faits
avec succès pour développer l’économie socialiste, et ils
rendent à notre société d’incontestables services.
Il n’est pas douteux qu’ils en rendront encore
dans un avenir immédiat. Mais ce serait faire preuve d’une
impardonnable cécité que de ne pas voir que, par ailleurs, ces
faits commencent, dès aujourd’hui, à entraver le vigoureux
développement de nos forces productives, en empêchant l’État de
planifier entièrement l’économie nationale, et notamment
l’agriculture.
Il est hors de doute que plus nous irons et plus
ces faits entraveront la croissance des forces productives de notre
pays. Il s’agit donc de liquider ces contradictions en transformant
progressivement la propriété kolkhozienne en propriété nationale
et en substituant, aussi par étapes successives, l’échange des
produits à la circulation des marchandises.
3o Il faut, troisièmement, assurer un progrès
culturel de la société qui permette à tous ses membres de
développer harmonieusement leurs aptitudes physiques et
intellectuelles, afin qu’ils puissent recevoir une instruction
suffisante et devenir des artisans actifs du développement social ;
qu’ils puissent choisir librement une profession sans être rivés
pour toujours, en raison de la division existante du travail, à une
profession déterminée.
Que faut-il pour cela ?
Il serait erroné de croire qu’un progrès
culturel aussi important des membres de la société est possible
sans de sérieuses modifications dans la situation actuelle du
travail. Pour cela, il faut avant tout réduire la journée de
travail au moins à 6 heures, puis à 5.
Ceci est indispensable afin que tous les membres
de la société aient les loisirs nécessaires pour recevoir une
instruction complète. Il faut, pour cela, introduire ensuite
l’enseignement polytechnique obligatoire, indispensable pour que
les membres de la société puissent choisir librement une profession
et ne soient pas rivés pour toujours à une profession déterminée.
Pour cela, il faut encore améliorer radicalement
les conditions de logement et augmenter le salaire réel des ouvriers
et des employés au minimum du double, sinon davantage, d’une part
en relevant directement le salaire en espèces, d’autre part et
surtout, en pratiquant la baisse systématique du prix des objets de
grande consommation.
Telles sont les conditions essentielles qui
prépareront le passage au communisme.
C’est seulement lorsque toutes ces conditions
préalables, prises dans leur ensemble, auront été réalisées,
qu’on pourra espérer qu’aux yeux des membres de la société le
travail a cessé d’être une corvée, pour devenir « le
premier besoin de l’existence » (Marx) ; que « le
travail, au lieu d’être un fardeau, sera une joie »
(Engels) ; que la propriété sociale sera considérée par tous
les membres de la société comme la base immuable et intangible de
l’existence de la société.
C’est seulement lorsque toutes ces conditions
préalables, prises dans leur ensemble, auront été réalisées,
qu’on pourra passer de la formule socialiste : « de
chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail », à
la formule communiste : « de chacun selon ses capacités,
à chacun selon ses besoins ».
Ce sera le passage intégral d’une économie,
économie du socialisme, à une autre économie, économie
supérieure, l’économie du communisme.
On voit que le passage du socialisme au communisme
n’est pas une chose aussi simple que l’imagine le camarade
Iarochenko.
Vouloir ramener cette tâche complexe et multiple,
qui demande des changements d’ordre économique extrêmement
profonds, à une « organisation rationnelle des forces
productives », comme le fait le camarade Iarochenko, c’est
substituer le bogdanovisme au marxisme.
II —
Autres erreurs du camarade Iarochenko
1o Parti d’un point de vue erroné, le camarade
Iarochenko en tire des conclusions erronées sur le caractère et
l’objet de l’économie politique.
Le camarade Iarochenko, partant du fait que chaque
formation sociale a ses lois économiques spécifiques, nie la
nécessité d’une économie politique valable pour toutes les
formations sociales. Mais il est complètement dans l’erreur, et il
est ici en désaccord avec des marxistes comme Engels, comme Lénine.
Engels dit que l’économie politique est
la
science des conditions et des formes dans lesquelles les diverses
sociétés humaines ont produit et échangé et dans lesquelles en
conséquence, les produits se sont chaque fois répartis.
(Anti-Dühring, p. 182.)
Il suit de là que l’économie politique étudie
les lois du développement économique non d’une formation
particulière, mais des différentes formations sociales.
Cette manière de voir était, on le sait,
entièrement partagée par Lénine qui, dans ses remarques critiques
au sujet du livre de Boukharine: l’Économie de la période de
transition, a dit que Boukharine avait tort de borner la sphère de
l’économie politique à la production des marchandises, et avant
tout à la production capitaliste ; et il notait que Boukharine
faisait ici « un pas en arrière par rapport à Engels ».
À cette manière de voir répond entièrement la
définition de l’économie politique donnée dans le projet de
manuel d’économie politique, où il est dit que l’économie
politique est la science qui étudie
les
lois de la production sociale et de la répartition des biens
matériels aux différents degrés du développement de la société
humaine.
Et cela se conçoit. Les différentes formations
sociales, dans leur développement économique, obéissent à leurs
lois économiques spécifiques, mais aussi aux lois économiques
communes à toutes les formations ; par exemple, à des lois
comme celle de l’unité des forces productives et des rapports de
production dans une même production sociale ; celle des
relations entre les forces productives et les rapports de production
dans le processus du développement de toutes les formations
sociales.
Par conséquent, les formations sociales ne sont
pas seulement séparées l’une de l’autre par leurs lois
spécifiques ; elles sont aussi reliées l’une à l’autre
par les lois économiques qui leur sont communes à toutes.
Engels avait parfaitement raison de dire :
Pour
mener jusqu’au bout cotte critique de l’économie bourgeoise, il
ne suffisait pas de connaître la forme capitaliste de production,
d’échange et de répartition. Les formes qui l’ont précédée
ou qui existent encore à côté d’elle dans des pays moins
évolués, devaient également être étudiées, tout au moins dans
leurs traits essentiels, et servir de points de comparaison.
(Anti-Dühring, p. 182- 183.)
Il est évident qu’ici, dans cette question, le
camarade Iarochenko fait écho à Boukharine.
Poursuivons. Le camarade Iarochenko affirme que
dans son « Économie politique du socialisme » « les
catégories de l’économie politique : valeur, marchandise,
argent, crédit, etc., sont remplacées par de saines considérations
sur une organisation rationnelle des forces productives dans la
production sociale » ; que, par suite, cette économie
politique a pour objet non pas les rapports de production du
socialisme, mais « l’élaboration et le développement d’une
théorie scientifique de l’organisation des forces productives,
d’une théorie de la planification de l’économie nationale,
etc. », que sous le socialisme, les rapports de production
perdent toute importance propre et sont absorbés par les forces
productives dont ils deviennent partie intégrante.
Je dois dire que jamais encore « marxiste »
fourvoyé n’avait débité chez nous pareil charabia. En effet,
qu’est-ce qu’une économie politique du socialisme sans problèmes
économiques, sans problèmes de production ?
Peut-il exister une économie politique de ce
genre ? Que signifie remplacer, dans l’économie politique du
socialisme, les problèmes économiques par les problèmes de
l’organisation des forces productives ? Cela revient à abolir
l’économie politique du socialisme. Et c’est ce que fait le
camarade Iarochenko : il abolit l’économie politique du
socialisme.
En l’occurrence, il rejoint en tous points
Boukharine. Boukharine disait qu’après la suppression du
capitalisme, on doit supprimer l’économie politique. Le camarade
Iarochenko ne le dit pas, mais il le fait, quand il liquide
l’économie politique du socialisme.
Il est vrai qu’il fait mine de ne pas être tout
à fait d’accord avec Boukharine, mais ce n’est là qu’une
ruse, et une ruse à bon marché. En réalité, il fait ce que
prêchait Boukharine et contre quoi s’élevait Lénine. Le camarade
Iarochenko marche sur les traces de Boukharine.
Poursuivons. Le camarade Iarochenko ramène les
problèmes de l’économie politique du socialisme aux problèmes de
l’organisation rationnelle des forces productives, aux problèmes
de la planification de l’économie nationale, etc.
Mais il se trompe gravement. Les problèmes de
l’organisation rationnelle des forces productives, de la
planification de l’économie nationale, etc., sont l’objet non
pas de l’économie politique, mais de la politique économique des
organismes dirigeants. Ce sont deux domaines différents qu’on ne
doit pas confondre.
Le camarade Iarochenko a brouillé ces deux choses
différentes, et le voilà en bien fâcheuse posture !
L’économie politique étudie les lois du développement des
rapports de production entre les hommes. La politique économique en
tire des conclusions pratiques, les concrétise et s’en inspire
dans son activité quotidienne. Encombrer l’économie politique des
problèmes de la politique économique, c’est la tuer en tant que
science.
L’objet de l’économie politique, ce sont les
rapports de production, les rapports économiques entre les hommes.
Ils englobent : a) les formes que revêt la propriété des
moyens de production ; b) la situation des différents
groupes sociaux dans la production et leurs relations réciproques
ou, pour reprendre l’expression de Marx, « l’échange de
leurs activités », qui découlent de ces formes ; c) les
formes de répartition de produits, qui en dépendent entièrement.
C’est tout cela qui, dans son ensemble, est
l’objet de l’économie politique.
Le mot « échange », qui figure dans
la définition d’Engels, manque dans cette définition. Cela, parce
que beaucoup entendent d’ordinaire par « échange »
l’échange de marchandises, qui est le propre non pas de toutes les
formations sociales, mais seulement de certaines d’entre elles,
d’où parfois un malentendu, bien que par le mot « échange »
Engels n’entende pas uniquement l’échange de marchandises.
Or, on voit que ce qu’Engels entendait par le
mot « échange » a trouvé place dans la définition
précitée dont il est partie intégrante. Il s’ensuit que par son
contenu cette définition de l’objet de l’économie politique
coïncide entièrement avec celle d’Engels.
2o Quant on parle de la loi économique
fondamentale de telle ou telle formation sociale, on sous-entend
habituellement que cette dernière ne peut avoir plusieurs lois
économiques fondamentales, qu’elle ne saurait avoir qu’une loi
économique fondamentale, précisément parce qu’elle est
fondamentale. Sinon, nous aurions plusieurs lois économiques
fondamentales pour chaque formation sociale, ce qui est en
contradiction avec la notion même de loi fondamentale.
Pourtant, le camarade Iarochenko est d’un autre
avis. Il estime qu’il peut exister non pas une, mais plusieurs lois
économiques fondamentales du socialisme. C’est incroyable, mais
c’est un fait. Dans son discours à l’Assemblée plénière de la
discussion, il dit :
Le
volume des fonds matériels de la production et de la reproduction
sociales, et la relation qui existe entre eux, sont déterminés par
la quantité et la perspective d’accroissement de la force de
travail entraînée dans la production sociale. C’est la loi
économique fondamentale de la société socialiste, qui conditionne
la structure de la production et de la reproduction sociales sous le
socialisme.
C’est la première loi économique fondamentale
du socialisme.
Dans ce même discours, le camarade Iarochenko
déclare :
La
relation qui existe entre les sections I et II est conditionnée dans
la société socialiste par le besoin de produire des moyens de
production dans les proportions nécessaires pour entraîner dans la
production sociale toute la population apte au travail. C’est la
loi économique fondamentale du socialisme, en même temps qu’une
stipulation de notre Constitution, qui découle du droit au travail
des citoyens soviétiques.
C’est, pour ainsi dire, la seconde loi
économique fondamentale du socialisme.
Enfin, dans sa lettre aux membres du Bureau
politique, le camarade Iarochenko déclare :
Partant
de là, on pourrait, ce me semble, formuler à peu près comme suit
les traits et les dispositions essentiels de la loi économique
fondamentale du socialisme : production toujours croissante et
se perfectionnant sans cesse des conditions de vie matérielle et
culturelle de la société.
C’est déjà là une troisième loi économique
fondamentale du socialisme.
Toutes ces lois sont-elles des lois économiques
fondamentales du socialisme ; ou seulement l’une d’entre
elles, et laquelle ? À ces questions, le camarade Iarochenko ne
donne aucune réponse dans sa dernière lettre aux membres du Bureau
politique.
Quand il formulait dans sa lettre aux membres du
Bureau politique la loi économique fondamentale du socialisme, il
avait sans doute « oublié » que dans son discours à
l’Assemblée plénière de la discussion, trois mois auparavant, il
avait déjà formulé deux autres lois économiques fondamentales du
socialisme, croyant apparemment que cette combinaison plus que
douteuse passerait inaperçue.
Mais, on le voit, cet espoir ne s’est pas
justifié.
Admettons que les deux premières lois économiques
fondamentales du socialisme formulées par le camarade Iarochenko
soient nulles et non avenues ; que désormais le camarade
Iarochenko considère comme loi économique fondamentale du
socialisme la troisième formule, qu’il a exposée dans sa lettre
aux membres du Bureau politique. Consultons la lettre du camarade
Iarochenko.
Le camarade Iarochenko y dit qu’il n’est pas
d’accord avec la définition de la loi économique fondamentale du
socialisme donnée dans les « Remarques » du camarade
Staline. Il déclare :
Le
principal, dans cette définition, c’est « assurer au maximum
la satisfaction… des besoins de toute la société ». La
production est présentée ici comme un moyen d’atteindre ce but
principal : satisfaire les besoins. Cette définition donne tout
lieu de croire que la loi économique fondamentale du socialisme
formulée par vous part non du primat de la production, mais du
primat de la consommation.
Il est évident que la camarade Iarochenko n’a
rien compris au fond du problème, et qu’il ne voit pas que ses
propos sur le primat de la consommation ou de la production n’ont
absolument rien à voir ici. Quand on parle du primat de tel ou tel
processus social sur un autre processus, on sous-entend d’ordinaire
que ces deux processus sont plus ou moins de même nature.
On peut et on doit parler du primat de la
production des moyens de production sur la production des moyens de
consommation, car dans les deux cas il s’agit de production, donc
de choses qui sont plus ou moins de même nature.
Mais on ne saurait parler, il serait faux de
parler du primat de la consommation sur la production, ou de la
production sur la consommation, car la production et la consommation
sont deux domaines absolument distincts, liés entre eux il est vrai,
mais cependant distincts.
Le camarade Iarochenko ne comprend sans doute pas
qu’il s’agit ici non du primat de la consommation ou de la
production mais du but que pose la société devant la production
sociale, de la tâche à laquelle elle subordonne la production
sociale, par exemple, sous le socialisme. Le camarade Iarochenko sort
donc, une fois de plus, tout à fait du sujet quand il dit que « la
base de la vie de la société socialiste, comme de toute autre
société, c’est la production ».
Le camarade Iarochenko oublie que les hommes
produisent non pour produire, mais pour satisfaire leurs besoins. Il
oublie que si elle ne satisfait pas les besoins de la société, la
production s’étiole et meurt.
Peut-on, d’une façon générale, parler du but
que poursuit la production capitaliste ou socialiste, des tâches
auxquelles est subordonnée la production capitaliste ou socialiste ?
J’estime qu’on le peut et qu’on le doit.
Marx dit :
Le but
immédiat de la production capitaliste n’est pas la production des
marchandises, mais de la plus-value ou du profit sous sa forme
développée ; non pas du produit, mais du produit net. De ce
point de vue le travail lui-même n’est productif qu’autant qu’il
crée le profit ou le produit net pour le capital.
Si
l’ouvrier ne le crée pas, son travail est improductif. La masse du
travail productif employé n’intéresse donc le capital que dans la
mesure où grâce à elle — ou en relation avec elle, — croît la
quantité du travail extra ; pour autant est nécessaire ce que
nous avons appelé temps de travail nécessaire. Si le travail ne
donne pas ce résultat, il est superflu et doit être arrêté.
Le but
de la production capitaliste consiste toujours à créer le maximum
de plus-value ou le maximum de produit net avec un minimum de capital
avancé ; si ce résultat n’est pas atteint par un travail
excessif des ouvriers, le capital a tendance à produire ce produit
avec le minimum de frais possible, à économiser la force de travail
et les dépenses…
Les
ouvriers eux-mêmes se présentent ainsi, tels qu’ils sont dans la
production capitaliste : uniquement des moyens de production et
non un but en soi ni le but de la production (voir Théorie de la
plus-value, t. II, deuxième partie).
Ces paroles de Marx sont remarquables non
seulement parce qu’elles définissent brièvement et exactement le
but de la production capitaliste, mais encore parce qu’elles
indiquent le but fondamental, la tâche principale qui doit être
posée devant la production socialiste.
Donc, le but de la production capitaliste, c’est
le profit. Quant à la consommation, elle n’est nécessaire au
capitalisme qu’autant qu’elle assure le profit. Hors de là, la
question de la consommation n’intéresse pas le capitalisme.
Celui-ci perd de vue l’homme et ses besoins.
Quel est donc le but de la production socialiste,
quelle est la tâche principale, à l’exécution de laquelle doit
être subordonnée la production sociale sous le socialisme ?
Le but de la production socialiste n’est pas le
profit, mais l’homme et ses besoins, c’est-à-dire la
satisfaction de ses besoins matériels et culturels. Le but de la
production socialiste, ainsi qu’il est dit dans les « Remarques »
du camarade Staline, est d’ « assurer au maximum la
satisfaction des besoins matériels et culturels sans cesse accrus de
toute la société ».
Le camarade Iarochenko pense qu’il s’agit ici
du « primat » de la consommation sur la production.
C’est là, bien entendu, un manque de réflexion
de sa part. En réalité, il s’agit ici non du primat de la
consommation, mais de la subordination de la production socialiste à
son but fondamental : assurer au maximum la satisfaction des
besoins matériels et culturels sans cesse croissants de toute la
société.
Donc, assurer au maximum la satisfaction des
besoins matériels et culturels sans cesse croissants de toute la
société : voilà le but de la production socialiste :
accroître et perfectionner constamment la production socialiste sur
la base d’une technique supérieure : voilà le moyen
d’atteindre ce but.
Telle est la loi économique fondamentale du
socialisme.
Voulant conserver le « primat » de la
production sur la consommation, le camarade Iarochenko affirme que la
« loi économique fondamentale du socialisme », c’est
d’ « accroître et de perfectionner constamment la
production des conditions matérielles et culturelles de la
société ».
Cela est tout à fait faux. Le camarade Iarochenko
mutile grossièrement et gâche la formule exposée dans les
« Remarques » du camarade Staline.
Chez lui la production, de moyen qu’elle était,
devient le but, et il n’est plus besoin d’assurer au maximum la
satisfaction des besoins matériels et culturels sans cesse accrus de
la société. On a donc un accroissement de la production pour
l’accroissement de la production, la production comme but en soi,
et le camarade Iarochenko perd de vue l’homme et ses besoins.
Aussi rien d’étonnant si, en même temps que
l’homme, considéré comme but de la production socialiste,
disparaissent dans la « conception » du camarade
Iarochenko les derniers vestiges du marxisme.
Par conséquent, ce qu’on trouve en définitive
chez le camarade Iarochenko, ce n’est pas le « primat »
de la production sur la consommation, mais quelque chose comme le
« primat » de l’idéologie bourgeoise sur l’idéologie
marxiste.
3o Une question se pose à part : celle de la
théorie de la reproduction de Marx. Le camarade Iarochenko affirme
que la théorie de la reproduction de Marx n’est applicable qu’à
la reproduction capitaliste, qu’elle ne renferme rien qui soit
valable pour les autres formations sociales, la formation sociale
socialiste y compris. Il dit :
Transporter
dans la production sociale socialiste le schéma de la reproduction
que Marx a élaboré pour l’économie capitaliste, c’est se faire
une conception dogmatique de la doctrine de Marx et se mettre en
contradiction avec l’essence de sa doctrine. (Voir le discours du
camarade Iarochenko à l’Assemblée plénière de la discussion.)
Il affirme ensuite que
le
schéma de la reproduction de Marx ne correspond pas aux lois
économiques de la société socialiste et ne peut servir de base à
l’étude de la reproduction socialiste (ibid.)
Parlant de la théorie de la reproduction simple
de Marx, qui établit une relation définie entre la production des
moyens de production (section I) et celle des moyens de
consommation (section II), le camarade Iarochenko dit :
La
relation existant entre les sections I et II n’est pas
conditionnée, en société socialiste, par la formule de Marx V+P de
la section I et C de la section II. Dans les conditions du
socialisme, ce rapport d’interdépendance dans le développement
entre les sections I et II ne doit pas être (ibid.)
Il affirme, que
la
théorie, élaborée par Marx, de la relation existant entre les
sections I et II, est inacceptable dans nos conditions
socialistes, car la théorie de Marx a pour base l’économie
capitaliste et ses lois. (Voir la lettre du camarade Iarochenko aux
membres du Bureau politique.)
C’est ainsi que le camarade Iarochenko exécute
la théorie de la reproduction de Marx.
Certes, la théorie de la reproduction, que Marx a
élaborée après avoir étudié les lois de la production
capitaliste, reflète les traits spécifiques de la production
capitaliste et revêt naturellement la forme des rapports de valeur
propres à la production marchande capitaliste.
Il ne pouvait en être autrement. Mais ne voir
dans la théorie de la reproduction de Marx que cette forme, et ne
pas apercevoir sa base, ne pas apercevoir son contenu fondamental,
qui n’est pas valable uniquement pour la formation sociale
capitaliste, c’est ne rien comprendre à cette théorie.
Si le camarade Iarochenko comprenait quoi que ce
soit en la matière, il aurait aussi compris cette vérité évidente
que les schémas de la reproduction de Marx ne se bornent nullement à
refléter les traits spécifiques de la reproduction capitaliste,
qu’ils renferment aussi nombre de thèses fondamentales relatives à
la reproduction, qui restent valables pour toutes les formations
sociales, y compris et notamment la formation sociale socialiste.
Des thèses fondamentales de la théorie de la
reproduction de Marx, comme celle de la division de la production
sociale en production des moyens de production et en production des
moyens de consommation ; celle de la priorité donnée à la
production des moyens de production lors de la reproduction élargie ;
celle de la relation existant entre les sections I et II ; celle
du produit net considéré comme source unique de l’accumulation ;
celle de la formation et du rôle des fonds sociaux ; celle de
l’accumulation considérée comme source unique de la reproduction
élargie, — toutes ces thèses fondamentales de la théorie de la
reproduction de Marx ne sont pas valables seulement pour la formation
capitaliste, et aucune société socialiste ne peut s’abstenir de
les appliquer pour planifier l’économie nationale. Fait
significatif : le camarade Iarochenko, qui le prend de si haut
avec les « schémas de la reproduction » de Marx, est
lui-même obligé d’y recourir à tout moment lorsqu’il traite
des problèmes de la reproduction socialiste.
Mais qu’en pensait Lénine, qu’en pensait
Marx ?
Chacun connaît les remarques critiques de Lénine
sur le livre de Boukharine : l’Économie de la période de
transition. Dans ces remarques, on le sait, Lénine reconnaissait que
la formule donnée par Marx de la relation existant entre les
sections I et II, contre laquelle le camarade Iarochenko part en
guerre, reste valable et pour le socialisme, et pour le « communisme
pur », c’est-à-dire pour la seconde phase du communisme.
Quant à Marx, on le sait, il n’aimait pas à se
distraire de l’étude des lois de la production capitaliste, et il
ne s’est pas préoccupé, dans son Capital, de savoir si
ses schémas de la reproduction seraient ou non applicables au
socialisme.
Pourtant, au chapitre 20 du second tome du
Capital, dans la rubrique « Le capital constant de la
section I », où il traite de l’échange des produits de la
section I à l’intérieur de cette section, Marx note, pour ainsi
dire en passant, que l’échange des produits dans cette section se
déroulerait sous le socialisme de façon aussi constante que sous le
régime de la production capitaliste. Il dit :
Si la
production était sociale, au lieu d’être capitaliste, ces
produits de la section I seraient tout aussi bien répartis de
nouveau comme moyens de production dans les branches de production de
cette section en vue de la reproduction ; une partie resterait
directement dans la sphère de production où elle est née comme
produit, une autre partie passerait dans d’autres branches de
production. Il y aurait donc un va-et-vient continuel. (K. Marx,
Le Capital, tome VIII, p. 42, Édit. Costes,
Paris, 1932.)
Il s’ensuit que Marx ne pensait nullement que sa
théorie de la reproduction n’était valable que pour la production
capitaliste, bien qu’il s’occupât alors de l’étude des lois
de la production capitaliste. On voit qu’au contraire il estimait
sa théorie de la reproduction également valable pour la production
socialiste.
Notons que Marx, analysant dans sa Critique du
programme de Gotha l’économie du socialisme et de la période
de transition au communisme, s’appuie sur les thèses fondamentales
de sa théorie de la reproduction, qu’il considère manifestement
comme obligatoires pour un régime communiste.
Notons aussi que, dans son Anti-Dühring,
Engels, critiquant le « système socialitaire » de
Dühring et définissant l’économie du régime socialiste,
s’appuie, lui aussi, sur les thèses fondamentales de la théorie
de la reproduction de Marx qu’il considère comme obligatoires pour
un régime communiste.
Tels sont les faits.
Il s’ensuit que là encore, dans la question de
la reproduction, le camarade Iarochenko, malgré son ton dégagé à
l’égard des « schémas » de Marx, s’est retrouvé
sur un banc de sable.
4o Le camarade Iarochenko termine sa lettre aux
membres du Bureau politique en proposant qu’on le charge d’écrire
l’Économie politique du socialisme. Il déclare :
Partant
de la définition — exposée par moi à la séance plénière, à
la section et dans la présente lettre, — de l’objet de cette
science qu’est l’économie politique du socialisme, et appliquant
la méthode dialectique marxiste, je puis en un an, dix-huit mois au
plus, et avec l’aide de deux assistants, élaborer les solutions
théoriques des problèmes fondamentaux de l’économie politique du
socialisme ; exposer la théorie, marxiste,
léniniste-stalinienne de l’économie politique du socialisme,
théorie qui fera de cette science une arme efficace dans la lutte du
peuple pour le communisme.
Il faut avouer que le camarade Iarochenko ne
souffre pas d’un excès de modestie. Bien plus : on pourrait
dire, pour user du style de certains hommes de lettres, que c’est
« même juste le contraire ».
Nous avons déjà dit que le camarade Iarochenko
confond l’économie politique du socialisme avec la politique
économique des organismes dirigeants.
Ce qu’il considère comme l’objet de
l’économie politique du socialisme — organisation rationnelle
des forces productives, planification de l’économie nationale,
constitution de fonds sociaux, etc. — regarde non l’économie
politique du socialisme, mais la politique économique des organismes
dirigeants.
Cela, sans préjudice du fait que les graves
erreurs commises par le camarade Iarochenko et son « point de
vue » non marxiste n’engagent guère à confier pareille
tâche au camarade Iarochenko.
Conclusions :
1) Les doléances du camarade Iarochenko à
l’adresse des dirigeants de la discussion sont sans objet, car les
dirigeants de la discussion, qui étaient des marxistes, ne pouvaient
tenir compte, dans les documents qui font le point de la discussion,
du « point de vue » non marxiste du camarade Iarochenko
;
2) La demande du camarade Iarochenko, — qu’il
soit chargé d’écrire l’Économie politique du socialisme — ne
peut être prise au sérieux, ne serait-ce que pour la raison qu’elle
sent son Khlestakov [personnage principal de la pièce de Gogol :
Révizor, N. Éd.] à plein nez.
22 mai 1952.
Réponse
aux camarades A. V. Sanina et V. C. Venger
J’ai reçu vos lettres. Les auteurs de ces
lettres, on le voit, étudient à fond et sérieusement les problèmes
économiques de notre pays. Ces lettres renferment bon nombre de
formules justes et d’idées intéressantes. Cependant, on y trouve
aussi de graves erreurs théoriques. Dans ma réponse, je tiens à
m’arrêter précisément sur ces erreurs.
1. Du
caractère des lois économiques du socialisme
Les camarades Sanina et Venger affirment que :
c’est
seulement grâce à l’activité consciente des hommes soviétiques,
occupés à la production matérielle, que surgissent les lois
économiques du socialisme.
Cette thèse est absolument fausse.
Les lois du développement économique
existent-elles objectivement, en dehors de nous, indépendamment de
la volonté et de la conscience des hommes ? Le marxisme répond
à cette question par l’affirmative. Le marxisme estime que les
lois de l’économie politique du socialisme sont le reflet, dans
les cerveaux des hommes, des lois objectives, existant en dehors de
nous.
Or, la formule des camarades Sanina et Venger
donne une réponse négative à cette question. C’est donc que ces
camarades se placent au point de vue d’une théorie fausse,
prétendant que les lois du développement économique sous le
socialisme sont « créées », « transformées »
par les organismes dirigeants de la société. Autrement dit, ils
rompent avec le marxisme et s’engagent dans la voie d’un
idéalisme subjectif.
Sans doute, les hommes peuvent découvrir ces lois
objectives, les connaître et, en se basant sur elles, les utiliser
dans l’intérêt de la société. Mais ils ne peuvent ni les
« créer », ni les « transformer ».
Admettons un instant que nous nous soyons placés
au point de vue de la théorie fausse qui nie l’existence des lois
objectives dans la vie économique sous le socialisme et proclame la
possibilité de « créer », de « transformer »
les lois économiques.
Qu’en résulterait-il ? Il en résulterait
que nous serions plongés dans le chaos et les hasards ; nous
serions les esclaves de ces hasards, nous n’aurions plus la
possibilité non seulement de comprendre, mais simplement de démêler
ce chaos de hasards.
Il en résulterait que nous supprimerions
l’économie politique comme science, car la science ne peut exister
ni se développer sans reconnaître les lois objectives, sans les
étudier. Or, la science une fois supprimée, nous n’aurions plus
la possibilité de prévoir le cours des événements dans la vie
économique du pays, c’est-à-dire que nous n’aurions plus la
possibilité d’organiser la direction économique même la plus
élémentaire.
En fin de compte, nous nous trouverions soumis à
l’arbitraire d’aventuriers « économiques », prêts à
« supprimer » les lois du développement économique et à
« créer » de nouvelles lois, sans comprendre les lois
objectives, ni en faire état.
Tout le monde connaît la formule classique de la
position marxiste dans cette question, donnée par Engels dans
l’Anti-Dühring.
Les
forces socialement agissantes, agissent tout à fait comme les forces
de la nature : aveugles, violentes, destructrices tant que nous
ne les connaissons pas et ne comptons pas avec elles.
Mais
une fois que nous les avons reconnues, que nous en avons saisi
l’activité, la direction, les effets, il ne dépend plus que de
nous les soumettre de plus en plus à notre volonté et d’atteindre
nos buts grâce à elles. Et cela est particulièrement vrai des
énormes forces productives actuelles.
Tant
que nous refusons obstinément à en comprendre la nature et le
caractère, — et c’est contre cette compréhension que regimbent
le mode de production capitaliste et ses défenseurs, — ces forces
produisent tout leur effet malgré nous, contre nous, elles nous
dominent, comme nous l’avons exposé dans le détail.
Mais
une fois saisies dans leur nature, elles peuvent, dans les mains des
producteurs associés, se transformer de maîtresses démoniaques en
servantes dociles.
C’est
là, la différence qu’il y a entre la force destructrice de
l’électricité dans l’éclair de l’orage et l’électricité
domptée du télégraphe et de l’arc électrique, la différence
entre l’incendie et le feu agissant au service de l’homme.
En
traitant de la même façon les forces productives actuelles après
avoir enfin reconnu leur nature, on voit l’anarchie sociale de la
production remplacée par une réglementation socialement planifiée
de la production, selon les besoins de la communauté comme de chaque
individu ; ainsi, le mode capitaliste d’appropriation, dans
lequel le produit asservit d’abord le producteur, puis
l’appropriateur lui-même, est remplacé, par le mode
d’appropriation des produits fondé sur la nature des moyens
modernes de production eux-mêmes ; d’une part appropriation
sociale directe comme moyen d’entretenir et de développer la
production, d’autre part appropriation individuelle directe comme
moyen d’existence et de jouissance. (Anti-Dühring,
pp. 318-319.)
2. Des
mesures à prendre pour élever la propriété kolkhozienne au niveau
de propriété nationale
Quelles mesures sont nécessaires pour élever la
propriété kolkhozienne qui n’est évidemment pas une propriété
du peuple, au niveau de propriété nationale ?
Certains camarades pensent qu’il faut simplement
nationaliser la propriété kolkhozienne, la proclamer propriété du
peuple, comme on l’a fait en son temps, pour la propriété
capitaliste. Cette proposition est tout à fait erronée et
absolument inacceptable. La propriété kolkhozienne est une
propriété socialiste, et nous ne pouvons en aucune façon en user
avec elle comme avec la propriété capitaliste.
Du fait que la propriété kolkhozienne n’est
pas la propriété de tout le peuple, il ne suit pas du tout que la
propriété kolkhozienne n’est pas une propriété socialiste.
Ces camarades supposent que la remise de la
propriété d’individus et de groupes d’individus en propre à
l’État est l’unique ou, en tout cas, la meilleure forme de
nationalisation.
C’est faux. En réalité, la remise en propre à
l’État n’est pas l’unique ni même la meilleure forme de
nationalisation, mais la forme initiale de nationalisation, comme
Engels le dit très justement dans l’Anti-Dühring. Il est
évident qu’aussi longtemps que l’État existe, la remise en
propre à l’État est la forme initiale de nationalisation la plus
compréhensible.
Mais l’État n’existera pas éternellement.
Avec l’extension de la sphère d’action du socialisme dans la
plupart des pays du monde, l’État dépérira, et il est évident
que, par suite, la question de la remise des biens des individus et
groupes en propre à l’État, ne se posera plus. L’État
disparaîtra, mais la société restera. Par conséquent, l’héritier
de la propriété nationale sera non plus l’État, qui aura
disparu, mais la société elle-même, en la personne de son
organisme économique dirigeant, central.
Que faut-il donc entreprendre, en ce cas, pour
élever la propriété kolkhozienne au niveau de propriété
nationale ?
Les camarades Sanina et Venger proposent, comme
mesure essentielle, de vendre en propre aux kolkhozes les principaux
instruments de production concentrés dans les stations de machines
et de tracteurs ; de décharger par ce moyen l’État de ses
investissements de capitaux dans l’agriculture et de faire assumer
aux kolkhozes la responsabilité de l’entretien et du développement
des stations de machines et de tracteurs. Ils disent :
Il
serait faux de croire que les investissements kolkhoziens doivent
être principalement affectés aux besoins culturels de la campagne
kolkhozienne, tandis que l’État doit fournir, comme précédemment,
la masse essentielle des investissements pour les besoins de la
production agricole.
Ne
serait-il pas plus juste d’exonérer l’État de ces charges,
puisque les kolkhozes sont parfaitement à même de les assumer ?
Il y aura suffisamment d’entreprises où l’État pourra investir
ses ressources, afin de créer dans le pays une abondance d’objets
de consommation.
Pour justifier leur proposition, les auteurs
avancent plusieurs arguments.
Premièrement. Se référant aux paroles de
Staline disant que les moyens de production ne se vendent pas même
aux kolkhozes, les auteurs de la proposition mettent en doute cette
thèse de Staline et déclarent que l’État vend cependant aux
kolkhozes des moyens de production, tels que le petit outillage comme
faux et faucilles, petits moteurs, etc.
Ils estiment que si l’État vend aux kolkhozes
ces moyens de production, il pourrait également leur vendre tous les
autres moyens de production, par exemple, les machines des S.M.T.
(Stations de machines et tracteurs, N. Éd.)
Cet argument ne tient pas. Certes, l’État vend
aux kolkhozes le petit outillage, comme cela se doit d’après les
Statuts de l’artel agricole et la Constitution. Mais peut-on mettre
sur le même plan le petit outillage et ces moyens essentiels de la
production agricole que sont les machines des S.M.T. ou, mettons, la
terre qui, elle aussi, est un des moyens essentiels de la production
dans l’agriculture.
Il est clair que non.
On ne peut pas le faire, le petit outillage ne
décidant en aucune mesure du sort de la production kolkhozienne,
tandis que les moyens de production tels que les machines des S.M.T.
et la terre décident pleinement du sort de l’agriculture dans nos
conditions actuelles.
Il est aisé de comprendre que lorsque Staline dit
que les moyens de production ne se vendent pas aux kolkhozes, il ne
pense pas au petit outillage, mais aux moyens essentiels de la
production agricole : les machines des S.M.T., la terre.
Les auteurs jouent sur les mots « moyens de
production » et confondent deux choses différentes sans
s’apercevoir qu’ils font fausse route.
Deuxièmement. Les camarades Sanina et Venger se
réfèrent ensuite au fait qu’au début du mouvement kolkhozien de
masse — fin de 1929 et début de 1930, — le Comité central du
P.C. (b) de l’U.R.S.S. était lui-même partisan de la remise des
stations de machines et de tracteurs en propre aux kolkhozes, ceux-ci
devant rembourser la valeur des S.M.T. dans un délai de trois ans.
Ils considèrent que, bien que cette initiative
ait alors échoué, « en raison de la pauvreté » des
kolkhozes, maintenant que les kolkhozes sont riches, on pourrait
revenir à cette politique, à la vente des S.M.T. aux kolkhozes.
Cet argument ne tient pas non plus.
Le Comité central du P. C. (b) de l’U.R.S.S.
avait effectivement pris une décision relative à la vente des
S.M.T. aux kolkhozes, au début de 1930. Cette décision avait été
prise sur la proposition d’un groupe de kolkhoziens de choc, à
titre d’expérience, à titre d’essai, pour revenir à bref
délai, sur cette question et l’examiner à nouveau.
Or, la première vérification a montré le
caractère irrationnel de cette décision et, au bout de quelques
mois, c’est-à-dire à la fin de 1930, cette décision fut
rapportée.
L’extension du mouvement kolkhozien et le
développement de l’édification des kolkhozes ont définitivement
convaincu les kolkhoziens de même que les travailleurs dirigeants,
que la concentration des principaux instruments de la production
agricole entre les mains de l’État, dans les stations de machines
et de tracteurs, est l’unique moyen d’assurer des rythmes élevés
d’accroissement de la production dans les kolkhozes.
Nous nous réjouissons tous de l’accroissement
intense de la production agricole dans notre pays, de la production
accrue des céréales, du coton, du lin, de la betterave, etc. Où
est la source de cet accroissement ? Elle est dans la technique
moderne, dans les nombreuses machines perfectionnées qui desservent
toutes ces branches de production.
Il ne s’agit pas seulement de la technique en
général ; il s’agit que la technique ne peut pas rester
immobile, qu’elle doit constamment s’améliorer ; la
technique ancienne doit être mise hors de service et remplacée par
une technique moderne qui, à son tour, cédera le pas à un matériel
encore plus parfait.
Sinon le progrès de notre agriculture socialiste
serait inconcevable, inconcevables les grandes récoltes, l’abondance
des produits agricoles. Mais que signifie mettre hors de service des
centaines de mille tracteurs à roues et les remplacer par des
tracteurs à chenilles, remplacer des dizaines de milliers de
moissonneuses-batteuses périmées par de nouvelles, créer de
nouvelles machines, par exemple, pour les cultures industrielles ?
Cela signifie engager des dépenses se chiffrant
par des milliards et qui ne pourront être récupérées que dans six
ou huit ans. Nos kolkhozes, même s’ils sont des
kolkhozes-millionnaires, peuvent-ils assumer ces dépenses ?
Non, ils ne le peuvent pas, car ils ne sont pas à même de dépenser
des milliards qui ne pourront être récupérés que dans six ou huit
ans.
L’État seul peut se charger de ces dépenses,
lui seul étant capable de supporter les pertes entraînées par la
mise hors de service des vieilles machines et leur remplacement par
de nouvelles, lui seul étant capable de supporter ces pertes pendant
six ou huit ans, et d’attendre l’expiration de ce délai pour
récupérer ses dépenses.
Que signifie, après tout cela, exiger que les
S.M.T. soient vendues en propre aux kolkhozes ? Cela signifie
faire subir aux kolkhozes des pertes énormes, les ruiner,
compromettre la mécanisation de l’agriculture, ralentir la cadence
de la production kolkhozienne.
D’où la conclusion : en proposant de
vendre les S.M.T. aux kolkhozes, les camarades Sanina et Venger font
un pas en arrière et essaient de faire tourner à rebours la roue de
l’histoire.
Admettons un instant que nous ayons accepté la
proposition des camarades Sanina et Venger, et commencé à vendre en
propre aux kolkhozes les principaux instruments de production, les
stations de machines et de tracteurs. Qu’en résulterait-il ?
Il en résulterait, premièrement, que les
kolkhozes deviendraient propriétaires des principaux instruments de
production, c’est-à-dire qu’ils se trouveraient placés dans une
situation exceptionnelle qui n’est celle d’aucune entreprise dans
notre pays, car, on le sait, les entreprises nationalisées
elles-mêmes ne sont pas chez nous propriétaires des instruments de
production. Comment pourrait-on justifier cette situation
exceptionnelle des kolkhozes, par quelles considérations de progrès,
de marche en avant ?
Peut-on dire que cette situation contribuerait à
élever la propriété kolkhozienne au niveau de propriété
nationale, qu’elle hâterait, le passage de notre société du
socialisme au communisme ? Ne serait-il pas plus juste de dire
que cette situation ne pourrait qu’éloigner la propriété
kolkhozienne de la propriété nationale et aboutirait à nous
éloigner du communisme, au lien de nous en rapprocher.
Il en résulterait, deuxièmement, un
élargissement de la sphère d’action de la circulation des
marchandises qui entraînerait dans son orbite une quantité énorme
d’instruments de production agricole. Qu’en pensent les camarades
Sanina et Venger ?
L’élargissement de la sphère de la circulation
des marchandises peut-il contribuer à notre avance vers le
communisme ? Ne sera-t-il pas plus juste de dire qu’il ne peut
que freiner notre avance vers le communisme ?
L’erreur essentielle des camarades Sanina et
Venger, c’est qu’ils ne comprennent pas le rôle et l’importance
de la circulation des marchandises en régime socialiste ; ils
ne comprennent pas que la circulation des marchandises est
incompatible avec la perspective de passer du socialisme au
communisme.
Ils pensent sans doute que l’on peut, même sous
le régime de la circulation des marchandises, passer du socialisme
au communisme, que la circulation des marchandises ne peut en
l’occurrence constituer un obstacle. C’est une grave erreur, qui
part d’une incompréhension du marxisme.
En critiquant la « commune économique »
de Dühring, fonctionnant dans les conditions de la circulation des
marchandises, Engels a montré, de façon probante, dans son
Anti-Dühring, que l’existence de la circulation des
marchandises doit amener inévitablement les « communes
économiques » de Dühring à la renaissance du capitalisme.
Évidemment, les camarades Sanina et Venger ne
sont pas de cet avis. Tant pis pour eux. Mais nous, marxistes, nous
partons de la thèse marxiste bien connue, selon laquelle le passage
du socialisme au communisme et le principe communiste de la
répartition des produits selon les besoins, excluent tout échange
de marchandises et, par suite, la transformation des produits en
marchandises et, en même temps, leur transformation en valeur.
Voilà ce qu’il en est de la proposition et des
arguments des camarades Sanina et Venger.
Que faut-il donc entreprendre, en fin de compte,
pour élever la propriété kolkhozienne au niveau de propriété
nationale ?
Le kolkhoze est une entreprise d’un genre
particulier. Il travaille sur la terre et cultive la terre qui n’est
plus depuis longtemps une propriété kolkhozienne, mais nationale.
Par conséquent, le kolkhoze ne possède pas en propre la terre qu’il
cultive.
Poursuivons. Le kolkhoze travaille à l’aide
d’instruments essentiels de production, qui ne sont pas propriété
kolkhozienne, mais nationale. Par conséquent, le kolkhoze ne possède
pas en propre les principaux instruments de production.
Ensuite. Le kolkhoze est une entreprise
coopérative, il utilise le travail de ses membres et répartit les
revenus parmi ses membres d’après les journées-travail fournies ;
en outre, le kolkhoze possède des réserves de semences qui sont
renouvelées chaque année et employés dans la production.
La question se pose : qu’est-ce donc que le
kolkhoze possède en propre, où est la propriété kolkhozienne dont
il peut disposer eu toute liberté, comme il l’entend ?
Cette propriété, c’est la production du
kolkhoze, le fruit de la production kolkhozienne : blé, viande,
beurre, légumes, coton, betterave, lin, etc., sans compter les
bâtiments et les exploitations personnelles des kolkhoziens dans
leurs enclos. Le fait est qu’une partie considérable de cette
production, les excédents de la production kolkhozienne arrivent sur
le marché et s’intègrent de cette façon au système de la
circulation des marchandises.
C’est ce qui empêcha actuellement d’élever
la propriété kolkhozienne au niveau de propriété nationale. C’est
donc de ce côté-là qu’il faut activer le travail pour élever la
propriété kolkhozienne au niveau de propriété nationale.
Pour élever la propriété kolkhozienne au niveau
de propriété nationale, il faut que les excédents de la production
kolkhozienne soient éliminés de la circulation des marchandises et
intégrés au système d’échange de produits entre l’industrie
d’État et les kolkhozes. Là est l’essentiel.
Nous n’avons pas encore de système développé
d’échange de produits, mais il existe des embryons de cet échange
sous forme de « paiement en marchandises » pour les
produits agricoles.
On sait que la production des kolkhozes cultivant
le coton, le lin, la betterave, etc., est depuis longtemps « payée
en marchandises » ; il est vrai que cela ne se fait que
partiellement, pas en totalité, mais cela se fait tout de même.
Remarquons en passant que le terme « paiements en
marchandises », n’est pas heureux, qu’il faudrait le
remplacer par « échange de produits ».
La tâche est d’organiser dans toutes les
branches de l’agriculture ces embryons d’échanges de produits et
de les développer pour en faire un vaste système d’échange, de
façon que les kolkhozes reçoivent pour leur production de l’argent,
mais surtout les articles dont ils ont besoin.
Ce système nécessitera un accroissement
considérable de la production livrée par la ville au village ;
il faudra donc l’introduire sans trop de précipitation au fur et à
mesure de l’accumulation des articles produits par la ville.
Mais il faut l’introduire méthodiquement, sans
hésiter, en restreignant pas à pas la sphère de la circulation des
marchandises et en élargissant la sphère des échanges de produits.
Ce système, en restreignant la sphère de la
circulation des marchandises, aidera à passer du socialisme au
communisme. En outre, il permettra d’inclure la propriété
essentielle des kolkhozes, la production kolkhozienne, dans le
système d’ensemble de la planification nationale.
Ceci sera un moyen réel et décisif pour élever
la propriété kolkhozienne au niveau de propriété nationale dans
nos conditions actuelles.
Ce système est-il avantageux pour la paysannerie
kolkhozienne ?
Il l’est incontestablement. Avantageux parce que
la paysannerie kolkhozienne recevra de l’État des produits en
quantité beaucoup plus grande et à des prix meilleur marché
qu’avec le système de circulation des marchandises.
Tout le monde sait que les kolkhozes qui ont passé
des contrats avec le Gouvernement pour des échanges de produits
(« paiement en marchandises ») bénéficient d’avantages
infiniment plus grands que les kolkhozes qui n’en ont pas conclu.
Si l’on étend le système d’échanges des produits à tous les
kolkhozes du pays, toute notre paysannerie kolkhozienne bénéficiera
de ces avantages.
28 septembre 1952.
=>Oeuvres de Staline