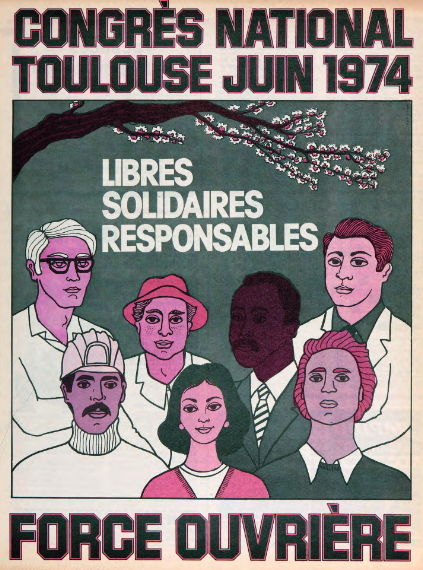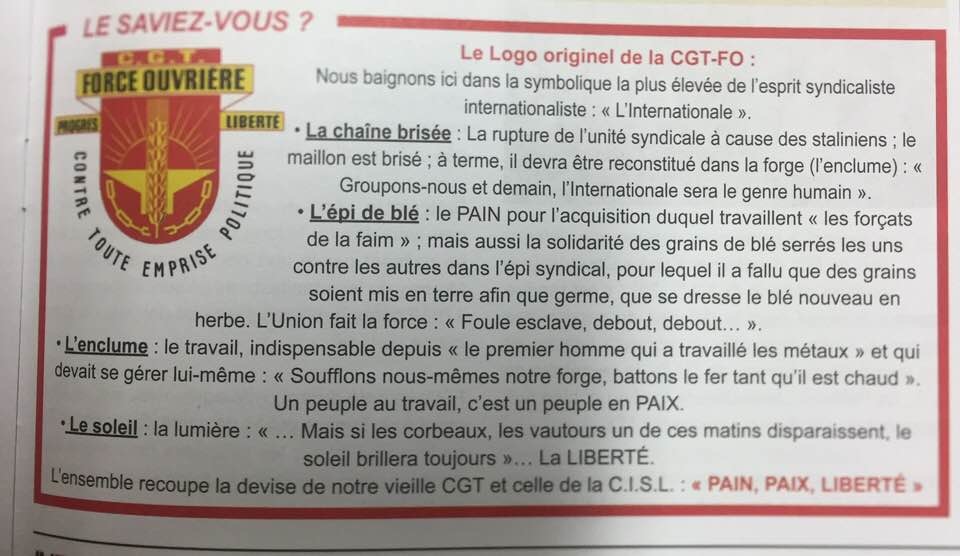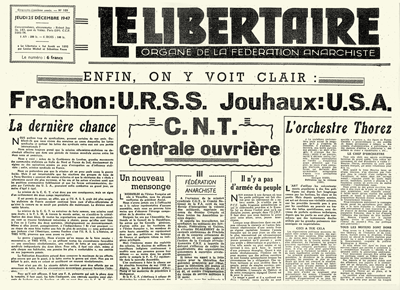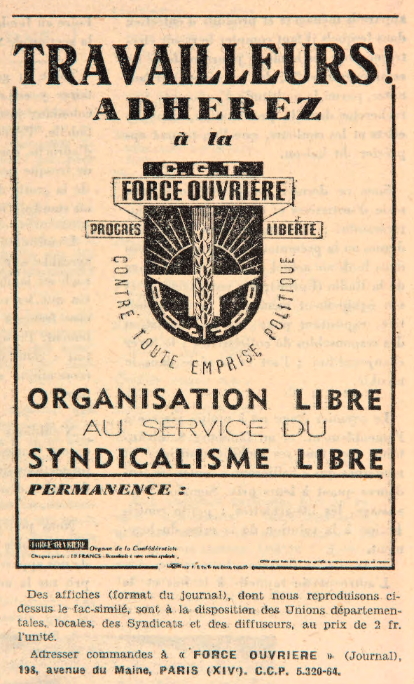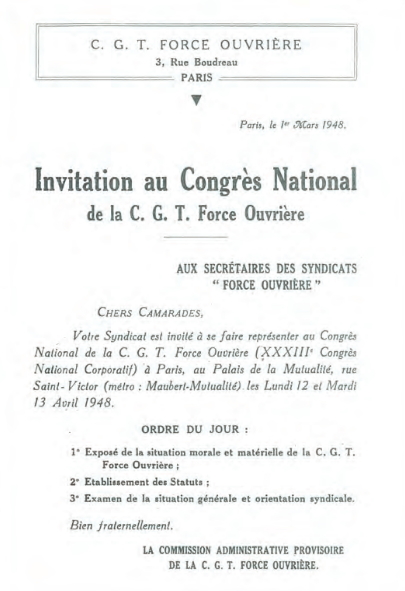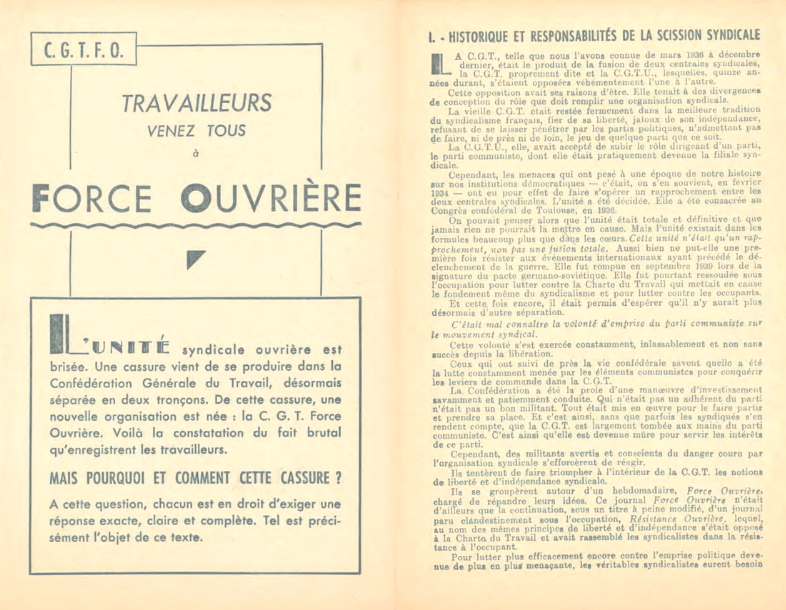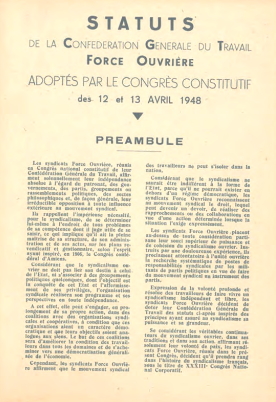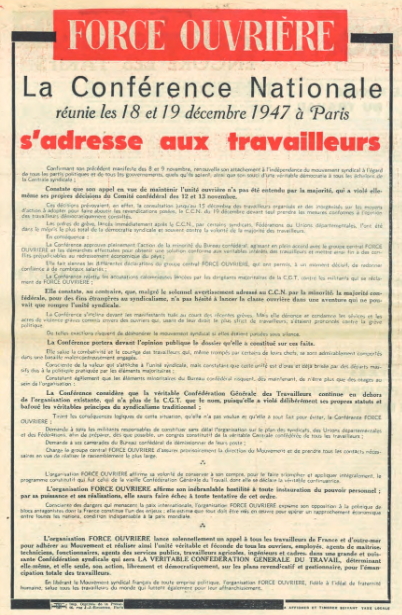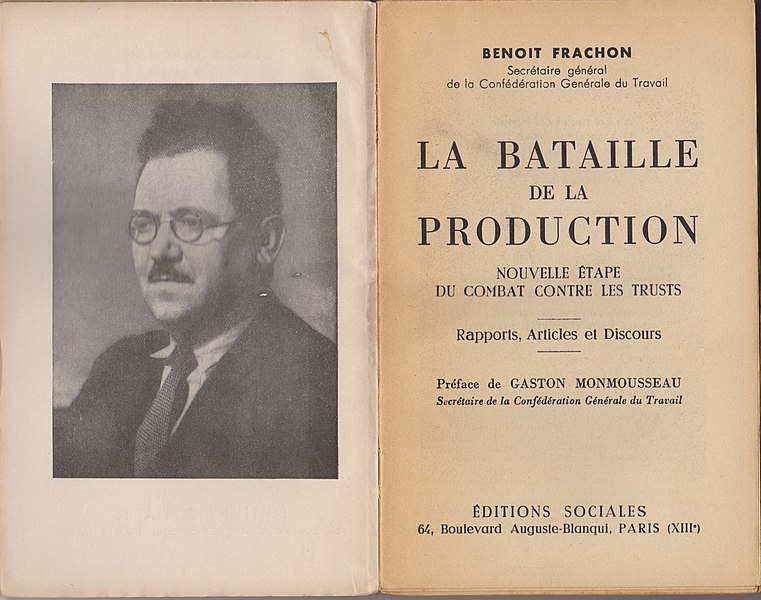Écrit au cours de l’automne 1895. Paru pour la première fois en brochure à Pétersbourg en 1895.
I
: Qu’est-ce que les amendes ?
Demandez
à un ouvrier s’il sait ce que sont les amendes ; il s’étonnera sans
doute d’une pareille question. Comment pourrait-il ne pas le savoir,
alors qu’il doit constamment en payer ? Y a-t-il là de quoi
s’interroger ?
C’est
pourtant une illusion de croire qu’il n’y a pas là de problème.
Car, en fait, la plupart des ouvriers ne se font pas une idée juste
de ce que sont les amendes.
On croit généralement que l’amende est un versement effectué au patron pour un dommage que l’ouvrier lui a causé. C’est faux. L’amende et le dédommagement sont deux choses différentes. Si un ouvrier a causé un dommage quelconque à un autre ouvrier, celui-ci peut exiger un dédommagement (pour du tissu abîmé, par exemple), mais il ne peut lui infliger une amende.
De même, si un fabricant fait du tort à un autre (en ne fournissant pas telle ou telle marchandise dans le délai fixé, par exemple), ce dernier peut exiger un dédommagement, mais il ne peut infliger une amende à l’autre fabricant.
On réclame un dédommagement à son égal, mais une amende ne peut être exigée que d’un subordonné. C’est pourquoi on réclame un dédommagement par voie de justice, tandis qu’une amende est fixée sans jugement par le patron. Il y a parfois amende alors qu’aucun dommage n’a été causé au patron : par exemple, l’amende pour avoir fumé. L’amende est une punition et non un dédommagement.
Si un ouvrier a, disons, laissé tomber une étincelle en fumant et brûlé du tissu appartenant au patron, celui-ci ne se contentera pas de le mettre à l’amende pour avoir fumé, mais retiendra en outre sur son salaire une certaine somme pour le tissu brûlé. Cet exemple montre clairement la différence qui existe entre l’amende et le dédommagement.
Le but des amendes n’est pas de compenser un dommage, mais de créer une discipline, c’est-à-dire de soumettre les ouvriers au patron, d’obliger les ouvriers à exécuter les ordres du patron et à lui obéir pendant les heures de travail. C’est, du reste, ce que déclare la loi sur les amendes : l’amende est » une sanction pécuniaire visant au maintien de la discipline et infligée de leur propre autorité par les chefs d’entreprise « .
Le montant de l’amende est donc fonction non pas de l’importance du dommage, mais du degré d’indiscipline de l’ouvrier : plus l’ouvrier se montre indiscipliné et récalcitrant, plus grave est son refus de se soumettre aux exigences du patron, et plus l’amende est élevée.
Il va de soi que quiconque accepte de travailler pour un patron cesse d’être un homme libre : il doit obéir au patron et le patron peut le punir. Les paysans serfs travaillaient pour les seigneurs et ceux-ci les punissaient. Les ouvriers travaillent pour les capitalistes et ceux-ci les punissent. Toute la différence, c’est qu’auparavant, on matait l’individu asservi par les coups et que maintenant on le mate par les sous.
A
cela on objectera peut-être que le travail en commun d’un grand
nombre d’ouvriers dans une usine ou une fabrique est impossible sans
une discipline : le bon ordre est indispensable dans le travail ; il
est indispensable d’y veiller et de punir les contrevenants. Aussi,
dira-t-on, si des amendes sont infligées, ce n’est pas parce que les
ouvriers sont des hommes asservis, mais parce que le travail en
commun exige le bon ordre.
Une telle objection est absolument injustifiée, bien qu’à première vue elle puisse induire en erreur. Elle est invoquée uniquement par ceux qui veulent cacher aux ouvriers leur état de dépendance. Le bon ordre est effectivement indispensable dans tout travail en commun.
Mais est-il vraiment indispensable que les travailleurs soient soumis à l’arbitraire des fabricants, c’est-à-dire d’hommes qui ne travaillent pas eux-mêmes et ne sont forts que parce qu’ils ont accaparé toutes les machines, tous les outils et toutes les matières premières ?
Le travail en commun ne peut se faire sans un certain ordre, sans que tous se soumettent à cet ordre ; mais il peut très bien se faire sans que les ouvriers soient soumis aux propriétaires des fabriques et des usines.
Le travail en commun exige effectivement une surveillance visant à maintenir l’ordre, mais il n’exige nullement que le pouvoir de surveiller les autres revienne toujours à qui ne travaille pas et vit du travail d’autrui.
Il s’ensuit que les amendes existent non pas parce que des hommes travaillent en commun, mais parce que, dans le régime capitaliste actuel, les travailleurs ne possèdent rien en propre : les machines, les outils, les matières premières, la terre, le blé appartiennent aux riches, à qui les ouvriers doivent se vendre pour ne pas mourir de faim. Et puisqu’ils se sont vendus, ils sont évidemment tenus de se soumettre aux riches et de subir les sanctions que ceux-ci leur infligent.
Voilà qui doit être clair pour tout ouvrier désireux de comprendre ce que sont les amendes. Il faut le savoir pour réfuter le raisonnement habituel (et des plus faux) selon lequel, sans amendes, le travail en commun serait impossible.
Il faut le savoir pour être en mesure d’expliquer à tout ouvrier en quoi l’amende diffère du dédommagement, et pourquoi les amendes sont le signe de la position dépendante de l’ouvrier, de son asservissement aux capitalistes.
II
: Comment infligeait-on les amendes auparavant et pourquoi a-t-on
fait les nouvelles lois sur les amendes ?
Les lois sur les amendes existent depuis peu : depuis neuf ans seulement. Avant 1886, il n’existait aucune législation à ce sujet.
Les fabricants pouvaient infliger autant d’amendes qu’ils voulaient et pour le motif qui leur plaisait. Scandaleusement élevées, ces amendes leur assuraient de gros revenus. Elles résultaient parfois d’une simple » décision du patron « , sans autre indication de motif. Leur montant pouvait atteindre la moitié du salaire , de sorte que pour un rouble de gain, l’ouvrier retournait au patron cinquante kopecks sous forme d’amendes.
Il arrivait même qu’en plus des amendes on prélevât aussi un dédit : par exemple, 10 roubles pour départ de l’usine. Quand les affaires du fabricant allaient mal, rien ne lui était plus facile que de réduire le salaire en dépit des conditions de l’embauche.
Il ordonnait à ses contremaîtres d’infliger plus d’amendes et d’envoyer davantage de produits au rebut, ce qui revenait à diminuer le salaire de l’ouvrier.
Longtemps, les ouvriers endurèrent toutes ces brimades ; mais à mesure que les grandes usines et les fabriques se développaient, en particulier dans le tissage, éliminant les petites entreprises et les tisserands travaillant à la main, leur indignation contre l’arbitraire et les vexations devint de plus en plus forte.
Il y a une dizaine d’années, les affaires des marchands et des fabricants connurent un ralentissement , autrement dit une crise : les marchandises ne trouvaient plus d’acheteurs ; aussi les fabricants se mirent-ils à multiplier les amendes.
Les ouvriers au salaire déjà misérable, ne purent supporter ces nouvelles brimades, et dans les provinces de Moscou, de Vladimir et de Iaroslavl éclatèrent en 1885-1886 des révoltes d’ouvriers. Poussés à bout, les ouvriers arrêtaient le travail et tiraient de leurs oppresseurs une terrible vengeance, détruisant et incendiant parfois les bâtiments et les machines, assommant les représentants de l’administration, etc.
La plus remarquable de toutes ces grèves se produisit à Nikolskoïé (près de la gare d’Orékhovo, sur la voie ferrée de Moscou à Nijni-Novgorod), à la manufacture bien connue de Timoféï Morozov.
Depuis 1882, Morozov ne cessait de réduire les salaires ; en 1884, il y avait déjà eu cinq diminutions. D’autre part les amendes se multipliaient : elles atteignaient presque le quart du salaire (24 kopecks d’amende pour un rouble de gain) pour l’ensemble de la fabrique, et même la moitié pour certains ouvriers.
Voici comment procédait l’administration, l’année qui précéda les troubles, pour dissimuler ces amendes scandaleuses : elle obligeait les ouvriers dont les amendes atteignaient la moitié de la paie à demander leur compte ; après quoi, le même jour s’ils le désiraient, ces ouvriers pouvaient se faire réembaucher et recevoir un nouveau carnet de paie.
De cette façon, les carnet s où étaient portées des amendes par trop élevées se trouvaient détruits.
Pour un jour d’absence injustifiée, on défalquait trois jours de salaire ; pour avoir été surpris à fumer, on devait payer une amende de 3, 4 ou 5 roubles. Le 7 janvier 1885, les ouvriers, poussés à bout, quittèrent le travail et mirent à sac pendant quelques jours l’appartement du contremaître Chorine, le magasin et d’autres bâtiments de la fabrique.
Cette révolte impressionnante d’une dizaine de milliers d’ouvriers (leur nombre atteignit 11000) épouvanta le gouvernement : on vit aussitôt arriver à Orékhovo-Zouïévo la troupe, le gouverneur, le procureur de Vladimir, le procureur de Moscou.
Au cours des pourparlers avec les grévistes, des hommes sortis de la foule remirent aux autorités les » conditions formulées par les ouvriers eux-mêmes » : remboursement des amendes infligées depuis Pâques 1884 ; taux maximum des amendes fixé à 5 % du salaire, c’est-à-dire pas plus de 5 kopecks par rouble de gain et, pour une absence injustifiée d’un jour, pas plus d’un rouble.
Les ouvriers exigeaient en outre le retour aux salaires de 1881-1882 ; ils demandaient que le patron payât les jours perdus par sa faute, que le licenciement comportât un préavis de 15 jours, que la marchandise fût réceptionnée en présence de témoins choisis parmi les ouvriers, etc.
Cette puissante grève produisit une très forte impression sur le gouvernement qui s’aperçut que les ouvriers, quand ils agissent d’un commun accord, constituent une force dangereuse, surtout lorsque cette masse d’ouvriers agissant conjointement présente directement ses revendications. Les fabricants sentirent eux aussi la force des ouvriers et devinrent un peu plus prudents.
Voici, par exemple, ce qu’on communiquait d’Orékhovo-Zouïévo dans le Novoïé Vrémia . » Les troubles de l’an dernier (c’est-à-dire les troubles de janvier 1885 chez Morozov) ont eu pour effet de changer d’un seul coup les vieilles méthodes en honneur dans les fabriques, aussi bien à Orékhovo-Zouïévo que dans les environs « .
Autrement dit, les patrons de la fabrique Morozov ne furent pas les seuls à devoir modifier leurs méthodes scandaleuses sur l’exigence unanime des ouvriers, mais les fabricants des environs firent également des concessions dans la crainte de troubles semblables chez eux. »
L’essentiel, écrivait ce même journal, c’est que l’on constate maintenant une attitude plus humaine à l’égard des ouvriers, ce qui n’était jusqu’à présent le fait que d’un petit nombre d’administrateurs de fabrique « .
Les Moskovskié
Viédomosti elles-mêmes
(journal qui prend toujours la défense des fabricants et rejette
tout sur les ouvriers) comprirent qu’il était impossible de
conserver les vieilles méthodes et durent reconnaître que les
amendes arbitraires étaient » un mal qui aboutit aux abus les
plus révoltants « , que les magasins de fabrique étaient »
un véritable brigandage « , qu’une loi et un règlement relatifs
aux amendes étaient par conséquent indispensables.
L’impression considérable produite par cette grève fut encore renforcée par le verdict rendu à l’égard des ouvriers. Trente-trois d’entre eux avaient été traduits en justice pour excès au cours de la grève et agression contre la garde militaire (une partie des ouvriers avaient été arrêtés pendant la grève et enfermés dans un bâtiment, mais ils avaient brisé la porte et s’étaient échappés).
Le jugement eut lieu à Vladimir en mai 1886. Les jurés acquittèrent tous les accusés, car les dépositions des témoins (au nombre desquels figuraient le propriétaire de la fabrique T. Morozov, le directeur Dianov et beaucoup d’ouvriers tisserands) mirent en lumière les brimades scandaleuses subies par les ouvriers. Ce verdict était la condamnation directe non seulement de Morozov et de son administration, mais aussi de toutes les anciennes méthodes en honneur dans les fabriques.
Les défenseurs des fabricants, alarmés, entrèrent en fureur. Ces mêmes Moskovskié Viédomosti qui, après les troubles, reconnaissaient le caractère révoltant des anciennes méthodes, changèrent de ton : » La manutacture de Nikolskoïé, dirent-elles, est parmi les meilleures. Les ouvriers n’y sont ni asservis ni retenus de force ; ils y viennent de leur plein gré et la quittent sans difficulté aucune.
Quant aux amendes, elles répondent dans les fabriques à une nécessité ; sans elles, il serait impossible de venir à bout des ouvriers ; il ne resterait plus qu’à fermer la fabrique. » Pour ce journal, les seuls fautifs sont les ouvriers, » indisciplinés, ivrognes et négligents « . Le verdict du tribunal ne peut que » pervertir les masses populaires [1] « .
» Mais il est dangereux de plaisanter avec les masses populaires, s’écriaient les Moskovskié Viédomosti .
Que peuvent penser les ouvriers après le verdict d’acquittement du tribunal de Vladimir?
La nouvelle a aussitôt fait le tour de toute cette région industrielle. Notre correspondant, qui a quitté Vladimir immédiatement après la lecture du verdict, en a déjà entendu parler dans toutes les gares… «
Les
fabricants cherchaient ainsi à effrayer le gouvernement : si l’on
cède aux ouvriers sur un point, disaient-ils, ils réclameront
demain autre chose.
Mais
les troubles ouvriers étaient plus redoutables encore et le
gouvernement dut céder.
En
juin 1886 fut promulguée la nouvelle loi sur les amendes, qui
indiqua les cas où il était permis de les infliger, en fixa le
montant maximum et établit que l’argent des amendes ne devait pas
aller dans la poche des fabricants, mais être consacré aux besoins
des ouvriers.
Beaucoup d’ouvriers ignorent cette loi, et ceux qui la connaissent croient que les atténuations apportées au régime des amendes sont venues du gouvernement, et que l’on doit en remercier les autorités. Nous avons vu que c’est faux.
Si révoltantes qu’aient été les vieilles méthodes en usage dans les fabriques, les autorités n’ont rigoureusement rien fait pour soulager les ouvriers tant que ceux-ci n’ont pas commencé à se révolter contre elles, tant que les ouvriers, poussés à bout, n’en sont pas venus à détruire fabriques et machines, à incendier marchandises et matériaux, à frapper les représentants de l’administration et les fabricants.
Alors seulement le gouvernement prit peur et céda. Les ouvriers doivent remercier de cet adoucissement non pas les autorités, mais leurs camarades qui ont exigé et obtenu la suppression de brimades scandaleuses.
L’histoire des troubles de 1885 nous montre quelle force énorme recèle une protestation en commun des ouvriers.
Ce qu’il faut, c’est qu’on fasse de cette force un usage plus conscient, qu’elle ne soit pas inutilement gaspillée à tirer vengeance de tel ou tel fabricant ou patron d’usine, ou à mettre à sac telle ou telle fabrique ou usine détestée ; que toute cette indignation et toute cette haine soient dirigées contre tous les fabricants et patrons pris ensemble, contre toute la classe des fabricants et patrons d’usine, et qu’elles soient toutes consacrées à une lutte ininterrompue, persévérante contre cette classe.
Voyons maintenant en détail nos lois sur les amendes. Pour bien les connaître, il nous faut examiner les questions suivantes :
1) Dans quels cas ou pour quels motifs la loi permet-elle d’infliger des amendes ?
2) Quel doit être, aux termes de la loi, le montant des amendes ?
3) Quel est, selon la loi, le mode d’imposition des amendes ? autrement dit, qui peut légalement infliger une amende ?
Peut-on faire appel ? Comment doit-on porter à l’avance le tableau des amendes à la connaissance de l’ouvrier ? Comment doit-on inscrire les amendes sur le carnet de paie ?
4) Où doit aller, selon la loi, l’argent des amendes ? Où le conserve-t-on ? Comment le dépense-t-on pour les besoins des ouvriers, et pour quels besoins ?
Enfin, dernière question :
5) La loi sur les amendes s’applique-t-elle à tous les ouvriers ?
Quand nous aurons examiné toutes ces questions, nous saurons ce qu’est une amende, mais aussi quels sont tous les règlements particuliers et toutes les dispositions détaillées des lois russes à ce sujet.
Or, il est indispensable aux ouvriers de savoir ces choses pour pouvoir agir en connaissance de cause lorsque les amendes sont injustifiées, pour être en mesure d’expliquer à ses camarades la raison de telle ou telle injustice, soit que la direction de la fabrique enfreigne la loi, soit encore que la loi elle-même comporte des dispositions iniques, et pour choisir en conséquence la forme de lutte la plus efficace contre les brimades.
III
: Pour quels motifs le fabricant peut-il infliger des amendes ?
La loi déclare que les motifs d’amende, c’est-à-dire les fautes pour lesquelles le patron de la fabrique ou de l’usine est en droit de mettre ses ouvriers à l’amende, peuvent être les suivants : 1) malfaçon ; 2) absence injustifiée ; 3) infraction à la discipline.
» Aucune sanction, est-il dit dans la loi, ne peut être infligée pour d’autres motifs. [La loi dont nous parlons est le Statut de l’industrie , qui entre dans la seconde partie du tome XI du Corps des lois russes. Elle comprend un certain nombre d’articles, qui sont numérotés. Les articles relatifs aux amendes portent les numéros 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, 151 et 152.] »
Examinons attentivement, l’un après l’autre, chacun de ces trois motifs.
Premier motif : malfaçon. Il est dit dans la loi : » Sont considérées comme malfaçons la fabrication de produits de mauvaise qualité, par suite de négligence de la part de l’ouvrier et la détérioration, au cours du travail, des matières premières, machines et autres moyens de production. » Il faut bien se rappeler ces mots : » par suite de négligence « . Ils sont très importants. L’amende ne peut donc être infligée que pour cette raison.
Si l’ouvrage se trouve être de mauvaise qualité sans que ce soit dû à la négligence de l’ouvrier, mais du tait, par exemple, que le patron a fourni de mauvais matériaux. le fabricant n’a pas le droit d’infliger une amende. Il faut que cela soit clair pour tous les ouvriers, et qu’ils élèvent une protestation au cas où on les mettrait à l’amende pour une malfaçon dont ils ne sont pas responsables, car en pareil cas l’amende est parfaitement illégale.
Prenons un autre exemple : un ouvrier d’usine travaille à sa machine près d’une ampoule électrique. Un morceau de fer saute, atteint l’ampoule et la casse. Le patron inflige une amende » pour détérioration de matériel « . En a-t-il le droit ? Non, car ce n’est pas par négligence que l’ouvrier a cassé l’ampoule : ce n’est pas sa faute si rien ne protégeait celle-ci contre les éclats de fer qui ne manquent jamais de se détacher pendant le travail [2] .
Cette loi protège-t-elle suffisamment l’ouvrier, le défend-elle contre l’arbitraire du patron et les amendes injustifiées ?
Non, évidemment, puisque le patron décide à sa guise de la bonne ou de la mauvaise qualité de l’ouvrage ; il est toujours possible de chicaner, il est toujours possible pour le patron d’aggraver les amendes pour mauvaise qualité de l’ouvrage et, par ce moyen, de soutirer plus de travail pour le même salaire. La loi laisse l’ouvrier sans défense, elle donne au patron la possibilité de brimer. Il est clair que la loi avantage les fabricants : elle est partiale et injuste.
Comment aurait-il fallu protéger l’ouvrier ? Les ouvriers l’ont montré depuis longtemps : lors de la grève de 1885, les tisserands de la fabrique Morozov à Nikolskoïé formulèrent, entre autres, la revendication suivante : » En cas de désaccord sur la qualité de la marchandise livrée par l’ouvrier, la question doit être tranchée en faisant appel au témoignage des ouvriers travaillant à proximité, le tout étant consigné sur le cahier de réception et de contrôle des marchandises. »
(Cette revendication figurait dans le cahier établi » d’un commun accord par les ouvriers » et remis au procureur, lors de la grève, par des hommes sortis de la foule. Il a été donné lecture de ce cahier au tribunal.)
Cette revendication est parfaitement justifiée, car le seul moyen de s’opposer à l’arbitraire patronal est de faire appel à des témoins quand un différend s’élève au sujet de la qualité de la marchandise, ces témoins devant être pris parmi les ouvriers : les contremaîtres et les employés n’oseraient jamais prendre position contre le patron.
Deuxième motif d’amende : absence injustifiée. Qu’est-ce que la loi appelle absence injustifiée ?. » L’absence injustifiée, y dit-on, à la différence de l’arrivée tardive au travail ou de l’abandon du travail sans autorisation, consiste à manquer au moins une demi-journée de travail. «
Aux termes de la loi, comme nous le verrons dans un instant, l’arrivée tardive ou l’abandon du travail sans autorisation constituent des » infractions à la discipline » et entraînent une amende moins élevée.
Si l’ouvrier arrive à l’usine avec quelques heures de retard, mais avant midi, ce sera seulement une infraction à la discipline, et non une absence injustifiée ; par contre, s’il n’est arrivé qu’à midi, c’est une absence injustifiée. De même, si un ouvrier quitte son travail de sa propre autorité, sans autorisation, après midi, c’est-à-dire, s’il s’absente quelques heures, ce sera une infraction à la discipline ; mais s’il part pour toute une demi-journée, ce sera une absence injustifiée.
La loi stipule que le fabricant a le droit de congédier un ouvrier pour une absence injustifiée de plus de trois jours d’affilée ou pour un total d’absences injustifiées dépassant six jours dans le mois. Une absence d’une demi-journée ou d’une journée est-elle toujours considérée comme une absence injustifiée ? Non.
Uniquement quand elle n’était pas valablement motivée. Les motifs valables d’absence sont énumérés par la loi.
Les voici : 1) » l’ouvrier ne peut disposer librement de sa personne. » Autrement dit, si l’ouvrier a, par exemple, été mis en état d’arrestation (sur ordre de la police ou par décision du juge de paix), le fabricant n’a pas le droit, quand il le paie, de le frapper d’une amende pour absence injustifiée ; 2) » ruine subite à la suite d’un accident » ; 3) » incendie » ; 4) » inondation « . Si, par exemple, lors du dégel, l’ouvrier n’a pu passer un cours d’eau, le fabricant n’a pas le droit de le frapper d’une amende ; 5) » maladie ne permettant pas à l’ouvrier de quitter son domicile « , et 6) » décès ou maladie grave des ascendants directs, du mari, de la femme ou des enfants « .
Dans ces six cas, l’absence de l’ouvrier est considérée comme motivée. Afin de ne pas être mis à l’amende pour absence injustifiée, l’ouvrier n’a qu’à faire la preuve de sa bonne foi : l’administration ne le croira pas sur parole s’il dit avoir été absent pour un motif valable.
Il doit avoir un certificat du docteur (dans le cas, par exemple, d’une maladie), ou de la police (dans le cas, par exemple, d’un incendie). S’il est impossible de se procurer le certificat sur-le-champ, il faut l’apporter plus tard et exiger, en vertu de la loi, que l’amende ne soit pas infligée, ou, si elle l’a déjà été, qu’elle soit annulée.
A propos de ces dispositions de la loi quant aux motifs valables d’absence, il est à noter qu’elles sont aussi sévères que si elles s’appliquaient à des soldats en caserne, et non à des hommes libres. Ces dispositions sont calquées sur celles qui définissent les raisons légales de non-comparution en justice : si quelqu’un est accusé d’un délit, le juge d’instruction le convoque et le prévenu est tenu de se présenter.
La non-comparution n’est autorisée que pour les raisons précises qui justifient l’absence de l’ouvrier [3] . C’est dire que la loi est aussi sévère pour les ouvriers que pour les filous, voleurs, etc. Chacun comprend pourquoi les dispositions relatives à la comparution en justice sont si sévères : la poursuite des délits concerne toute la société.
Mais qu’un ouvrier se présente ou non au travail, cela intéresse seulement un fabricant, et non toute la société ; de plus, il est facile de remplacer un ouvrier par un autre pour que le travail ne soit pas interrompu. Cette rigueur toute militaire de la législation ne s’imposait donc en aucune façon.
Mais les capitalistes ne se bornent pas à prendre à l’ouvrier tout son temps pour qu’il travaille à la fabrique ; ils veulent également lui enlever toute volonté, l’empêcher de s’intéresser ou de penser à quoi que ce soit en dehors de la fabrique. Ils traitent l’ouvrier en personne dépendante.
D’où ces règlements de caserne, bureaucratiques et tracassiers. Nous venons, par exemple, de voir que la loi reconnaît comme motif valable d’absence » la mort ou la maladie grave des ascendants directs, du mari, de la femme ou des enfants « .
C’est ce que dit la loi sur la comparution en justice. C’est exactement ce que dit aussi la loi sur la présence de l’ouvrier au travail. Donc, si l’ouvrier perd, par exemple, non pas sa femme mais sa sœur, il ne doit pas manquer une journée de travail, il ne doit pas perdre de temps pour l’enterrement : son temps ne lui appartient pas, il appartient au fabricant. Quant à l’enterrement, à quoi bon s’en inquiéter ? La police peut très bien s’en charger.
D’après la loi sur la comparution en justice, l’intérêt de la famille doit céder le pas aux intérêts de la société qui est tenue de poursuivre les délinquants. D’après la loi sur la présence au travail, les intérêts de la famille de l’ouvrier doivent céder le pas aux intérêts du fabricant qui est tenu, lui, de réaliser des bénéfices. Et ces messieurs si vertueux qui élaborent, appliquent et défendent de pareilles lois osent encore accuser les ouvriers de ne pas goûter la vie de famille !…
Voyons si la loi sur les amendes pour absence injustifiée est équitable. Si un ouvrier abandonne son travail pour un ou deux jours, son absence est considérée comme injustifiée, et cela lui vaut d’être puni ; si l’absence dure plus de trois jours, il peut même être licencié.
Supposons maintenant que le fabricant interrompe le travail (s’il manque de commandes, par exemple), ou ne donne du travail que cinq jours par semaine au lieu de six.
Si les travailleurs étaient effectivement égaux en droits aux fabricants, la loi devrait être pour le fabricant la même que pour l’ouvrier. L’ouvrier qui interrompt son travail perd son salaire et paye une amende. Le fabricant qui interrompt volontairement le travail devrait donc, d’abord, payer à l’ouvrier le salaire complet correspondant au temps chômé et, ensuite, encourir également une amende.
Mais la loi ne prévoit ni l’un ni l’autre. Cet exemple confirme bien ce que nous avons déjà dit des amendes, à savoir qu’elles marquent l’asservissement des ouvriers par le capitaliste, qu’elles indiquent que les ouvriers constituent une classe inférieure, dépendante, condamnée à travailler toute la vie pour les capitalistes et à les enrichir moyennant un salaire de misère qui ne suffit pas à leur assurer une vie tant soit peu supportable.
Que les fabricants paient une amende pour interruption volontaire du travail, il ne saurait en être question. Mais ils ne paient pas non plus leur salaire aux ouvriers lorsque l’arrêt du travail n’est pas imputable à ces derniers.
C’est là une injustice révoltante. La loi se borne à préciser que le contrat entre fabricant et ouvrier est rompu » au cas d’un arrêt de travail de plus de sept jours, à la fabrique ou à l’usine, par suite d’un incendie, d’une inondation, d’un éclatement de chaudière ou pour tout autre motif analogue « . Les ouvriers doivent s’attacher à obtenir qu’une disposition oblige les fabricants à verser le montant des salaires pendant toute la durée de l’interruption des travaux.
Cette revendication a déjà été présentée publiquement par les ouvriers russes le 11 janvier 1885, lors de la fameuse grève chez T. Morozov [Il est à remarquer qu’à cette époque (1884-1885), les cas d’arrêt de travail non imputables aux ouvriers étaient très fréquents dans les fabriques du fait de la crise qui sévissait alors dans le commerce et l’industrie : les fabricants n’arrivaient pas à écouler leurs marchandises et s’efforçaient de réduire la production.
En décembre 1884, par exemple, la grande manufacture Voznessensk (dans la province de Moscou, près de la gare de Talitsa. sur la voie ferrée de Moscou à Iaroslavl) réduisit le nombre des journées de travail à quatre par semaine. Les ouvriers, qui travaillaient aux pièces, ripostèrent par une grève qui se termina au début de janvier 1885 par la capitulation du fabricant.].
Dans le cahier des revendications figurait celle-ci : » La retenue pour absence injustifiée ne doit pas dépasser un rouble et le patron doit aussi payer les jours chômés par sa faute, à savoir, le temps d’arrêt et de réfection des machines, et qu’à cet effet chaque jour chômé soit inscrit dans le carnet de paie « .
La première revendication des ouvriers (l’amende pour absence injustifiée ne doit pas dépasser un rouble) a été satisfaite et inscrite dans la loi de 1886 sur les amendes. La seconde revendication (que le patron paye les jours chômés par sa faute) n’a pas été satisfaite, et les ouvriers auront encore à batailler pour qu’elle le soit.
La lutte en faveur de cette revendication ne pourra être couronnée de succès que si tous les ouvriers ont pris clairement conscience de l’iniquité de la loi et de ce qu’ils doivent exiger.
Chaque fois qu’une fabrique ou une usine s’arrête, et que les ouvriers ne sont pas payés, ils doivent protester contre l’injustice du procédé ; ils doivent insister pour que chaque journée leur soit payée tant que le contrat avec le fabricant n’aura pas été annulé, s’adresser à l’inspecteur dont les explications convaincront les ouvriers qu’effectivement la loi est muette là-dessus et les amèneront à discuter cette loi. Ils doivent, quand c’est possible, porter plainte et demander que le fabricant soit tenu de verser une somme correspondant à leur salaire et, enfin, formuler la revendication générale du paiement des salaires pendant les jours chômés.
Troisième motif d’amende : » infraction à la discipline « .
La loi considère qu’il y a infraction à la discipline dans les huit cas suivants :
1) » arrivée tardive au travail ou abandon du travail sans autorisation » (nous avons déjà dit en quoi ce point diffère de l’absence injustifiée) ;
2) » non-observation, dans les locaux de l’usine ou de la fabrique, des règles de sécurité contre l’incendie, au cas où le directeur de la fabrique ou de l’usine ne jugerait pas utile de dénoncer, en vertu de l’annexe 1 à l’article 105, le contrat d’embauchage conclu avec les ouvriers « .
Autrement dit, si un ouvrier enfreint les règles de sécurité contre l’incendie, la loi permet au fabricant soit de le frapper d’une amende, soit de le licencier ( » dénoncer le contrat d’embauchage « , pour reprendre les termes de la loi) ; 3) » non-observation des règlements visant à faire régner la propreté dans les locaux de l’usine ou de la fabrique » ; 4) » tapage, cris, injures, disputes ou rixes pendant le travail » ; 5) » désobéissance « .
Au sujet de ce dernier point, il convient de noter que le fabricant n’a le droit d’infliger une amende pour » désobéissance » que lorsque l’ouvrier n’a pas respecté une exigence légale, c’est-à-dire prévue par le contrat.
S’il s’agit d’une exigence arbitraire, non prévue par le contrat passé entre l’ouvrier et le patron, il ne saurait être question d’infliger une amende pour » désobéissance « . Par exemple, un ouvrier est occupé, conformément à son contrat, à un travail aux pièces. Le contremaître lui ordonne d’interrompre son travail et d’en commencer un autre.
L’ouvrier refuse. Dans ce cas, une amende pour désobéissance serait irrégulière, car l’ouvrier a été embauché par contrat pour un travail déterminé et, du fait qu’il travaille aux pièces, passer à un autre genre d’occupation équivaudrait pour lui à travailler pour rien ; 6) » arrivée au travail en état d’ébriété » ; 7) » jeux d’argent interdits (jeux de cartes, jeu à pile ou face, etc.) » et 8) » non-observation du règlement intérieur de la fabrique « . Ce règlement est établi par le patron de chaque fabrique ou usine, et sanctionné par l’inspecteur du travail.
Des extraits en sont reproduits dans les carnets de paie. Les ouvriers doivent lire ce règlement et le connaître afin de vérifier si les amendes qu’on leur inflige pour infraction au règlement intérieur sont justifiées ou non. Il faut distinguer entre ce règlement et la loi.
La loi est la même pour toutes les fabriques et usines ; les règlements intérieurs varient d’une fabrique à l’autre. La loi est ratifiée ou annulée par le souverain ; le règlement intérieur, par l’inspecteur du travail.
C’est pourquoi, si ce règlement est vexatoire pour les ouvriers, on peut en demander l’annulation à l’inspecteur (et, en cas de refus, porter plainte contre ce dernier au Bureau du Travail).
Afin de montrer la nécessité d’établir une distinction entre la loi et le règlement intérieur, prenons un exemple. Supposons qu’un ouvrier soit, à la demande du contremaître, puni d’une amende pour ne pas s’être présenté au travail un jour férié ou en dehors des heures réglementaires.
L’amende est-elle régulière ? Pour répondre à cette question, il faut connaître le règlement intérieur. Au cas où il n’y est pas spécifié que l’ouvrier, s’il en est requis, doit faire des heures supplémentaires, l’amende est illégale.
Mais au cas où il est stipulé dans le règlement que l’ouvrier, s’il en est requis par la direction, doit venir au travail les jours fériés ou en dehors des heures réglementaires, l’amende est légale.
Pour obtenir la suppression de cette obligation, les ouvriers doivent non pas protester contre les amendes, mais exiger la modification du règlement intérieur. Il faut que tous les ouvriers se mettent d’accord ; ils pourront alors, par une action unanime, obtenir l’annulation de ce règlement.
IV
: Quel peut être le montant de l’amende ?
Nous connaissons maintenant tous les cas où la loi permet d’infliger des amendes aux ouvriers. Voyons ce qu’elle dit de leur montant. La loi ne fixe pas un montant déterminé pour toutes les fabriques et usines. Elle indique seulement la limite à ne pas dépasser.
Cette limite est spécifiée pour chacun des trois motifs d’amende (malfaçon, absence injustifiée, infraction à la discipline).
Pour l’absence injustifiée, le montant maximum de l’amende est calculé de la façon suivante : si l’ouvrier est payé à la journée, l’amende (calculée en totalisant les amendes pour le mois entier) ne doit pas dépasser le salaire de six jours de travail, c’est-à-dire qu’on ne peut, en un mois, infliger pour motif d’absence injustifiée une amende supérieure au salaire de six jours [4] .
Mais dans le cas d’un salaire aux pièces, le montant maximum de l’amende pour absence injustifiée est de 1 rouble par jour et de 3 roubles par mois au plus. En outre, l’ouvrier qui s’absente sans raisons valables perd son salaire pour toute la durée de l’absence.
Quant aux amendes pour infraction à la discipline, elles sont limitées à un rouble pour chaque infraction. Enfin, en ce qui concerne les amendes pour malfaçon, la loi ne fixe aucune limite. Un maximum général est également fixé pour l’ensemble des trois sortes d’amendes, qu’elles sanctionnent des absences injustifiées, des infractions à la discipline ou des malfaçons.
Toutes ces retenues, prises ensemble, » ne doivent pas dépasser un tiers du salaire devant être effectivement versé à l’ouvrier au jour normalement prévu pour la paie « . C’est-à-dire que si l’ouvrier doit recevoir, disons, 15 roubles, la loi interdit de lui prendre plus de 5 roubles pour infractions, absences injustifiées et malfaçons.
Si le total des amendes dépasse ce maximum, le fabricant doit déduire le surplus. Mais alors la loi lui donne un autre droit : celui d’annuler le contrat si le montant des amendes de l’ouvrier dépasse le tiers de sa paie [5] .
De ces dispositions de la loi au sujet des montants maximum des amendes, il faut dire qu’elles sont trop sévères pour l’ouvrier et favorisent le seul fabricant au détriment de l’ouvrier. Tout d’abord, la loi admet un montant trop élevé des amendes : jusqu’à un tiers du salaire.
C’est un taux scandaleux. Comparons ce maximum à certains cas d’amendes particulièrement fortes. Un inspecteur du travail de la province de Vladimir, M. Mikouline (qui a écrit un livre sur la nouvelle loi de 1886), indique quel était le niveau des amendes dans les fabriques avant cette loi.
C’est dans les tissages qu’il était le plus élevé, les amendes les plus fortes y atteignant 10 % du salaire des ouvriers : un dixième du salaire . M. Peskov, inspecteur du travail de la province de Vladimir, signale dans son rapport [Premier rapport pour l’année 1885.
Seuls les premiers rapports des inspecteurs du travail furent imprimés. Le gouvernement en arrêta aussitôt la publication.
Elles devaient être jolies, les méthodes en honneur dans les fabriques, pour que l’on craigne ainsi d’en publier la description!] des exemples d’amendes particulièrement lourdes : la plus forte est de 5 roubles 31 kopecks pour un salaire de 32 roubles 31 kopecks, ou 16,4 % (16 kopecks par rouble), soit moins du sixième du salaire . Cette amende est qualifiée de lourde, appréciation qui n’émane pas d’un ouvrier, mais d’un inspecteur.
Or, la loi permet d’infliger des amendes deux fois plus fortes : d’un tiers du salaire , soit 33 kopecks 1/3 par rouble. Il est évident que, dans les fabriques qui se respectent, les amendes n’atteignaient pas le montant autorisé par nos lois. Voyons les chiffres relatifs aux amendes à la manufacture de T. Morozov, à Nikolskoïé, avant la grève du 7 janvier 1885. Au dire des témoins, elles étaient plus élevées que dans les fabriques des environs.
Elles étaient si révoltantes qu’elles poussèrent à bout 11000 personnes. Nous ne nous tromperons sûrement pas si nous considérons la manufacture Morozov comme le type de la fabrique où les amendes étaient scandaleusement élevées. Quel était le montant de ces dernières ?
Ainsi que nous l’avons déjà dit, le contremaître Chorine a déclaré au tribunal que les amendes atteignaient la moitié de la paie et variaient en général de 30 à 50 %, soit de 30 à 50 kopecks par rouble. Mais, d’abord, cette déposition ne s’appuie pas sur des chiffres précis et, ensuite, elle ne concerne que des cas isolés ou un seul atelier. Au procès des grévistes, on donna lecture de quelques chiffres concernant les amendes. On cita 17 exemples de paie (mensuelle) et d’amendes : le total des salaires est de 179 roubles 6 kopecks, et celui des amendes de 29 roubles 65 kopecks, soit 16 kopecks d’amende par rouble de salaire.
Parmi ces 17 cas, l’amende la plus forte atteignait 3 roubles 85 kopecks pour un salaire de 12 roubles 40 kopecks, ce qui fait 31 kopecks ½ par rouble, soit moins encore que ce que permet la loi. Mais le mieux est de prendre les chiffres pour toute la fabrique. En 1884, le montant des amendes fut supérieur à celui des années précédentes : 23 kopecks ¼ par rouble (c’est là le chiffre le plus élevé : il a varié de 20 3/4 à 23 ¼ %). Ainsi, dans une fabrique devenue célèbre par le taux scandaleux de ses amendes, celles-ci étaient néanmoins inférieures à celles qu’autorise la loi russe…. Cette loi protège bien les ouvriers, il n’y a pas à dire.
Voici ce qu’exigeaient les grévistes de chez Morozov : » Les amendes ne doivent pas dépasser 5 % par rouble de salaire : un avertissement doit être donné à l’ouvrier dont le travail est jugé mauvais et il ne doit pas être convoqué plus de deux fois par mois « . Les amendes autorisées par nos lois ne peuvent se comparer qu’aux intérêts exigés par les usuriers.
Il est douteux qu’un fabricant ose infliger des amendes aussi fortes ; la loi l’y autorise, mais les ouvriers ne le permettront pas [On ne saurait manquer de souligner à ce sujet que M. Mikhaïlovski, ex-inspecteur principal du travail dans le district de Pétersbourg, croit devoir qualifier cette loi de » réforme profondément humaine, qui fait le plus grand honneur à la sollicitude du gouvernement impérial de Russie pour les classes laborieuses « .
(Cette appréciation figure dans un livre sur l’industrie en Russie édité par le gouvernement russe à l’occasion de l’Exposition universelle de 1893 à Chicago). La voilà bien, la sollicitude, du gouvernement russe !!! Avant cette loi, et en l’absence de toute loi, il se trouvait encore parmi les fabricants des rapaces qui retenaient à l’ouvrier jusqu’à 23 kopecks par rouble.
Dans sa sollicitude pour les ouvriers la loi a décrété qu’il ne fallait pas retenir plus de 33 1/3 kopecks (trente-trois kopecks et un tiers) par rouble ! Mais on peut désormais, tout à fait légalement, retenir trente-trois kopecks sans le tiers. » Réforme profondément humaine « , en vérité!].
Nos lois relatives au montant des amendes ne se distinguent pas seulement par le fait qu’elles constituent une brimade scandaleuse, mais encore par leur injustice criante. Si l’amende est trop élevée (plus du tiers du salaire), le fabricant peut dénoncer le contrat, mais l’ouvrier ne se voit pas accorder le même droit, c’est-à-dire le droit de quitter la fabrique si on lui inflige tant d’amendes qu’elles dépassent le tiers du salaire.
Il est clair que la loi ne se soucie que du fabricant, comme si les amendes n’étaient imputables qu’à des fautes commises par l’ouvrier. Mais en fait, chacun sait que les fabricants et les patrons d’usine infligent fréquemment des amendes sans qu’il y ait faute de la part de l’ouvrier, par exemple pour l’obliger à fournir un effort plus intense.
La loi ne fait que protéger le fabricant contre la négligence de l’ouvrier, mais elle ne protège pas l’ouvrier contre l’avidité des fabricants. C’est dire qu’en l’occurrence, les ouvriers n’ont aucun recours. C’est à eux de prendre leur sort en mains et d’engager la lutte contre les fabricants.
V
: Quel est le mode d’imposition des amendes ?
Nous avons déjà dit qu’aux termes de la loi, les amendes sont infligées » de sa propre autorité » par le directeur de la fabrique ou de l’usine.
En ce qui concerne les plaintes qui pourraient être formées à ce sujet, la loi déclare : » Les décisions du directeur de la fabrique ou de l’usine relatives aux sanctions infligées à l’ouvrier sont sans appel. Toutefois si, lors de la visite de la fabrique ou de l’usine par des fonctionnaires de l’inspection du travail, il ressort des déclarations faites par les ouvriers que des retenues ont été opérées à leur détriment contrairement aux prescriptions de la loi, le directeur sera poursuivi « .
Cette disposition est, on le voit, très vague et contradictoire : d’une part, on dit à l’ouvrier qu’il lui est impossible de réclamer contre l’imposition d’une amende. Mais, d’autre part, on dit que les ouvriers peuvent » déclarer » à l’inspecteur que des amendes leur ont été infligées » contrairement aux prescriptions de la loi « .
Quiconque n’a pas eu l’occasion d’étudier les lois russes pourrait demander où est la différence entre » déclarer qu’une chose est illégale » et » se plaindre qu’une chose soit illégale « . Il n’y en a pas, mais le but de cette clause chicanière est très clair : la loi voudrait limiter le droit de l’ouvrier à se plaindre des fabricants qui infligent injustement et illégalement des amendes.
A présent, si un ouvrier vient à se plaindre à l’inspecteur d’avoir été mis illégalement à l’amende, l’inspecteur peut lui répondre. » La loi n’autorise aucune réclamation relative à l’imposition des amendes. » Se trouvera-t-il beaucoup d’ouvriers au courant des ruses de la loi pour rétorquer : » Je ne réclame pas, je me borne à faire une déclaration » ? Les inspecteurs sont chargés précisément de veiller à l’application des lois sur les rapports entre ouvriers et fabricants.
Ils sont tenus de recevoir toutes les réclamations relatives à l’inobservation de la loi. D’après le règlement (cf. les Instructions aux fonctionnaires de l’inspection du travail , approuvées par le ministre des Finances), un inspecteur doit avoir des jours de réception, à raison d’un jour au moins par semaine, pour donner des explications orales à tous ceux qui lui en demanderaient, et ces jours de réception doivent être affichés dans chaque fabrique.
De cette façon, si les ouvriers connaissent la loi et s’ils sont fermement décidés à ne tolérer aucune dérogation, les ruses de la loi dont il vient d’être question seront vaines et les ouvriers sauront la faire respecter.
Ont-ils le droit de se faire rembourser les amendes si celles-ci ont été infligées à tort ? Le bon sens exigerait naturellement que la réponse soit : oui. Il est, en effet, inadmissible que le fabricant puisse infliger une amende à tort et ne pas restituer l’argent retenu à tort.
Mais il se trouve que, lors de la discussion de cette loi au Conseil d’Etat, il fut décidé de passer intentionnellement la question sous silence. Les membres du Conseil d’Etat ont estimé qu’accorder aux ouvriers le droit d’exiger le remboursement des sommes indûment retenues » affaiblirait aux yeux des ouvriers l’autorité dévolue au directeur de fabrique pour faire régner la discipline parmi le personnel « .
Voilà comment raisonnent nos hommes d’Etat lorsqu’il s’agit des ouvriers. Si un fabricant a retenu indûment de l’argent à un ouvrier, celui-ci ne doit pas avoir le droit de réclamer que son argent lui soit rendu. Et pourquoi prendre son argent à l’ouvrier ? Parce que les réclamations » affaiblissent l’autorité du directeur « .
C’est dire assez que » l’autorité des directeurs » et » la discipline à la fabrique » ne reposent que sur l’ignorance où sont les ouvriers de leurs droits et sur le fait qu’ils » ne doivent pas oser » se plaindre de la direction de l’entreprise, même si elle enfreint la loi. C’est dire que nos hommes d’Etat craignent tout simplement que les ouvriers ne s’avisent de contrôler le bien-fondé des amendes. Les ouvriers doivent être reconnaissants aux membres du Conseil d’Etat de cette franchise qui leur montre ce qu’ils peuvent attendre du gouvernement.
Ils doivent montrer qu’ils se considèrent comme des hommes au même titre que les fabricants et qu’ils ne sont pas disposés à se laisser traiter comme du bétail. Ils doivent donc se faire un devoir de ne pas laisser sans réclamation une seule amende injustifiée, et d’en exiger le remboursement en s’adressant à l’inspecteur ou, si celui-ci refuse, en déposant une plainte eu justice.
Et même si les ouvriers n’obtiennent rien ni de l’inspecteur ni du tribunal, leurs efforts n’auront pas été vains : ils ouvriront les yeux aux ouvriers, leur montreront comment nos lois traitent leurs droits.
Nous savons donc à présent que les amendes sont infligées par les directeurs » de leur propre autorité « . Mais d’une fabrique à l’autre le taux des amendes peut différer (car la loi se contente de fixer le maximum), de même que le règlement intérieur.
C’est pourquoi la loi exige que toutes les infractions passibles d’amendes, ainsi que le montant de l’amende correspondant à chaque infraction, soient préalablement indiqués dans un tableau des sanctions .
Ce tableau est établi par chaque fabricant ou patron d’usine, et approuvé par l’inspecteur du travail. La loi exige qu’il soit affiché dans chaque atelier.
Pour qu’il soit possible de vérifier si les amendes ont été dûment infligées, et d’en contrôler le nombre, il est indispensable qu’elles soient, toutes sans exception, inscrites correctement. La loi exige que les amendes soient portées sur le carnet de paie de l’ouvrier » dans les trois jours « .
Cette inscription doit indiquer, tout d’abord, le motif précis de la sanction (c’est-à-dire la raison exacte de l’amende, qu’il s’agisse d’une malfaçon, d’une absence injustifiée, ou d’une infraction à la discipline) et, en second lieu, le montant de la retenue opérée sur le salaire.
L’inscription des amendes dans le carnet de paie est nécessaire pour que les ouvriers puissent vérifier si l’amende a été infligée dans des conditions régulières et formuler en temps utile une réclamation si une illégalité a été commise. Les amendes doivent ensuite être toutes consignées dans un registre spécialement coté et paraphé que toute fabrique ou usine doit posséder afin de permettre un contrôle lors des inspections.
A
ce propos, il n’est peut-être pas superflu de dire deux mots des
réclamations contre les fabricants et les inspecteurs, car la
plupart du temps les ouvriers ne savent pas comment et à qui les
adresser. D’après la loi, toute réclamation concernant urne
infraction à la loi, commise dans une usine ou une fabrique, doit
être présentée à l’inspecteur du travail.
Celui-ci est tenu de recevoir les réclamations, qu’elles soient présentées oralement ou par écrit. Si l’inspecteur du travail ne fait pas droit à la réclamation, on peut s’adresser à l’inspecteur principal qui est tenu, lui aussi, d’avoir ses jours de réception pour entendre les requêtes qui lui sont présentées.
En outre, le bureau de l’inspecteur principal doit être ouvert tous les jours à ceux qui ont besoin de renseignements ou d’explications, ou désirent établir une demande (cf. les Instructions aux fonctionnaires de l’inspection du travail , page 18). On peut faire appel de la décision de l’inspecteur devant le Bureau provincial du Travail [6].
La loi prévoit pour ses réclamations un délai d’un mois à compter du jour où l’ inspecteur a fait connaître sa décision. On peut ensuite, dans le même délai, faire appel de la décision du Bureau du Travail devant le ministre des Finances.
Vous voyez que la loi indique un très grand nombre de personnes à qui l’on peut adresser des réclamations. Et l’on notera que le fabricant et l’ouvrier ont ici exactement les mêmes droits. Le malheur, c’est que cette protection reste uniquement sur le papier.
Le fabricant a toute possibilité de formuler des réclamations : il a du temps libre, les moyens de prendre un avocat, etc. ; et c’est pourquoi les fabricants portent effectivement plainte contre les inspecteurs, vont jusqu’au ministre et se sont déjà assuré divers avantages. Alors que pour l’ouvrier, ce droit de porter plainte n’est qu’un vain mot. Avant tout, il n’a pas le temps d’aller trouver les inspecteurs et d’assiéger les bureaux. Car il travaille, et toute » absence injustifiée » lui vaut une amende. Il n’a pas d’argent pour prendre un avocat.
Il ignore la loi et ne peut par conséquent faire prévaloir son bon droit. Quant aux autorités, bien loin de vouloir faire connaître la loi aux ouvriers, elles s’efforcent de la leur cacher.
A qui en douterait nous citerons la disposition suivante des Instructions aux fonctionnaires de l’inspection du travail (ces instructions, approuvées par le ministre, indiquent quels sont les droits et les devoirs des inspecteurs du travail ) : » Toute explication donnée par l’inspecteur du travail au propriétaire ou au directeur d’un établissement industriel au sujet d’infractions à la loi et aux arrêtés d’application, doit être fournie hors de la présence de l’ouvrier [7] . »
Et voilà. Si le fabricant viole la loi, l’inspecteur ne doit pas lui en parler en présence des ouvriers : le ministre le lui interdit. Sinon, il pourrait se faire que les ouvriers apprennent à connaître la loi et qu’il leur prenne envie d’en exiger l’application. Ce n’est pas sans raison que les Moskovskié Viédomosti ont écrit que tout cela ne serait que » perversion » !
Tout ouvrier sait qu’il lui est presque im possible d’élever une réclamation, surtout contre l’inspecteur. Nous ne voulons évidemment pas dire que les ouvriers ne doivent pas déposer de réclamations : au contraire, il ne faut pas manquer de réclamer chaque fois qu’on en a la moindre possibilité, car c’est seulement ainsi que les ouvriers parviendront à connaître leurs droits et à comprendre dans l’intérêt de qui sont faites les lois ouvrières.
Nous voulons seulement dire qu’on ne peut, par des réclamations, obtenir une amélioration sérieuse et générale de la situation des ouvriers. Pour atteindre ce résultat, il n’est qu’un moyen : l’union des ouvriers pour défendre ensemble leurs droits, pour lutter contre les brimades patronales, pour obtenir un salaire plus décent et la réduction de la journée de travail.
VI
: Où doit aller, selon la loi, l’argent des amendes ?
Voyons à présent la dernière question relative aux amendes : comment cet argent doit-il être dépensé ? Nous avons déjà dit que, jusqu’en 1886, cet argent allait dans la poche des fabricants et des patrons d’usine. Mais il en est résulté tant d’abus et l’irritation des ouvriers a été si vive que les patrons eux-mêmes ont compris la nécessité d’abolir ce système. Dans certaines fabriques, l’usage s’est établi de verser l’argent des amendes aux ouvriers sous forme d’allocations.
Ainsi, chez Morozov, dont nous avons déjà parlé, il avait été décidé, dès avant la grève de 1885, que les amendes infligées aux fumeurs et aux ouvriers ayant introduit de l’eau-de-vie à l’usine, alimenteraient une caisse d’allocations aux mutilés du travail, alors que les amendes pour malfaçons iraient au patron.
La nouvelle loi de 1886 a institué comme règle générale que les amendes ne peuvent aller dans la poche du patron. Il y est dit : » Les sanctions pécuniaires infligées aux ouvriers servent à constituer dans chaque usine un fonds particulier géré par la direction de l’établissement.
Ce fonds ne peut être utilisé, avec l’autorisation de l’inspecteur, que pour satisfaire les besoins des ouvriers, conformément au règlement pris par le ministre des Finances en accord avec le ministre de l’Intérieur. » Ainsi, d’après la loi, les amendes ne doivent servir qu’à satisfaire les besoins des ouvriers. L’argent des amendes, prélevé sur le salaire des ouvriers, leur appartient.
Le règlement concernant l’usage de ces fonds, dont il est fait mention dans la loi, n’a été publié qu’en 1890 (4 décembre), c’est-à-dire trois ans et demi après la promulgation de la loi. Il y est dit que l’argent des amendes doit être consacré, en priorité , aux besoins suivants des ouvriers : » a) allocations aux ouvriers définitivement inaptes au travail ou temporairement dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie « . A l’heure actuelle, les accidentés du travail demeurent généralement sans aucun moyen d’existence.
Pour intenter un procès au fabricant, ils se mettent d’ordinaire à la charge de l’avocat qui s’occupe de leur affaire et qui, en échange des aumônes qu’il verse à l’ouvrier, s’attribue une part énorme du dédommagement accordé à ce dernier.
Mais si l’ouvrier ne peut s’attendre à recevoir en justice qu’une maigre indemnité, il ne trouvera même pas d’avocat. Il faut dans ce cas-là recourir à l’argent des amendes ; l’allocation versée par le fonds permettra à l’ouvrier de vivoter pendant quelque temps et de trouver un avocat pour s’occuper du procès qu’il a intenté au patron, sans qu’il soit obligé d’échanger le joug du patron contre celui de l’avocat. Les ouvriers qui ont perdu leur travail par suite de maladie doivent également bénéficier d’allocations du fonds des amendes [8] .
Dans un éclaircissement relatif à ce premier point du règlement, le Bureau du Travail de Saint-Pétersbourg a décidé que ces allocations devraient être attribuées sur la présentation d’un certificat médical et pour un montant ne dépassant pas la moitié du salaire antérieurement perçu. Notons entre parenthèses que le Bureau du Travail de Saint-Pétersbourg a pris cette décision à sa séance du 26 avril 1895.
L’éclaircissement en question est donc intervenu quatre ans et demi après la publication du règlement, lequel a été de trois ans et demi postérieur à la loi. Par conséquent, il a fallu huit ans au total rien que pour expliquer suffisamment la loi !! Combien faudra-t-il à présent d’années pour qu’elle soit connue de tous et effectivement appliquée ?
En
second lieu, le fonds des amendes attribue » b) des allocations
aux ouvrières se trouvant dans la dernière période de leur
grossesse et qui ont cessé de travailler deux semaines avant les
couches « . Le Bureau du Travail de Saint-Pétersbourg précise
que cette allocation ne doit être versée que pendant quatre
semaines (deux avant les couches et deux après) et ne peut dépasser
la moitié du salaire perçu antérieurement.
Troisièmement,
une allocation est versée » c) en cas de perte ou de
détérioration de biens par suite d’un incendie ou de quelque autre
sinistre « . Le Bureau du Travail de Saint-Pétersbourg précise
qu’une attestation de la police est alors exigée, et que le montant
de l’allocation ne doit pas être supérieur aux 2/3 du salaire
semestriel (c’est-à-dire à quatre mois de salaire).
Quatrièmement,
enfin, une allocation est attribuée » d) pour frais
d’enterrement « . Le Bureau du Travail de Saint-Pétersbourg
précise que cette allocation n’est délivrée que pour les ouvriers
qui ont travaillé à la fabrique jusqu’à leur mort, ainsi que pour
leurs père et mère ou pour leurs enfants. Le montant de cette
allocation varie de10 à 20 roubles.
Tels sont les quatre cas prévus par le règlement pour le versement d’allocations. Mais les ouvriers y ont droit aussi en d’autres occasions : le règlement stipule que des allocations sont versées » en priorité » dans ces quatre cas. Les ouvriers ont droit, à des allocations pour toutes sortes de besoins, et non seulement pour ceux qui viennent d’être énumérés.
Dans ses explications relatives au règlement sur les amendes (affichées dans les fabriques et usines), le Bureau de Saint-Pétersbourg déclare encore : » L’attribution d’allocations dans tous les autres cas a lieu avec l’autorisation du service d’inspection « , et il ajoute que les dépenses effectuées par la fabrique pour différents établissements (tels qu’écoles, hôpitaux, etc.) et à titre obligatoire (par exemple : entretien de locaux destinés aux ouvriers, assistance médicale, etc.) ne doivent pas être réduites pour autant.
Autrement dit, le versement d’allocations provenant du fonds des amendes n’autorise nullement le fabricant à considérer qu’il dépense son propre argent ; cette dépense n’est pas faite par lui, mais par les ouvriers. Les dépenses du fabricant doivent rester les mêmes.
Le Bureau de Saint-Pétersbourg a en outre institué la règle suivante : » Le total des allocations distribuées d’une façon permanente ne doit pas dépasser la moitié des rentrées annuelles fournies par les amendes. »
On distingue ici les allocations permanentes (versées pendant un certain temps, à un malade ou à un estropié, par exemple), des allocations forfaitaires (versées une seule fois, pour un enterrement, par exemple, ou à la suite d’un incendie). Pour réserver la possibilité de versements forfaitaires, le montant des versements permanents ne doit pas dépasser la moitié du total des amendes.
Comment
recevoir une allocation du fonds des amendes ? Les ouvriers doivent,
aux termes du règlement, adresser une demande d’allocation au
patron, et c’est ce dernier qui, avec l’agrément de l’inspecteur,
accorde un secours. Si le patron refuse, on s’adressera à
l’inspecteur qui peut, de sa propre autorité, fixer une allocation.
Le
Bureau du Travail peut autoriser les patrons dignes de confiance à
distribuer des secours d’un montant peu élevé (jusqu’à 15 roubles)
sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur.
Jusqu’à
100 roubles, l’argent des amendes reste chez le patron ; les sommes
supérieures sont déposées à la caisse d’épargne.
En cas de fermeture d’une fabrique ou d’une usine, le fonds des amendes est versé à la caisse ouvrière de la province. Le règlement est muet sur la façon dont sont utilisés les fonds de cette » caisse ouvrière » (dont les ouvriers ne savent rien ni ne peuvent rien savoir). Il faut, dit-il, garder ces fonds à la Banque d’Etat » jusqu’à une affectation particulière « .
S’il a fallu huit ans, même dans la capitale, pour mettre au point le règlement concernant l’utilisation du fonds des amendes dans les fabriques, on devra sans doute attendre des dizaines d’années avant que soit établi un règlement sur l’emploi des fonds de la » caisse ouvrière de la province « .
Tel est le règlement relatif à l’utilisation de l’argent des amendes. Comme vous le voyez, il se distingue par une complication et une confusion extraordinaires. Aussi ne doit-on pas s’étonner si, jusqu’à présent, les ouvriers ignorent presque totalement son existence.
Cette année (1895), ce règlement est affiché dans les fabriques et les usines de Saint-Pétersbourg [C’est donc en 1895 seulement qu’on s’est mis à appliquer à Saint-Pétersbourg la loi de 1886 sur les amendes. Or, l’inspecteur principal Mikhaïlovski, déjà cité, déclarait en 1893 que la loi de 1886 » était à présent appliquée à la lettre « .
Nous voyons par ce petit exemple l’impudent mensonge que M. l’inspecteur principal a écrit dans son livre destiné à informer les Américains du régime en vigueur dans les fabriques russes.].
Les ouvriers doivent s’attacher à faire en sorte que chacun d’eux connaisse ce règlement et voie très justement dans l’allocation versée par le fonds des amendes non pas une aumône du fabricant, une charité, mais leur propre argent, provenant de retenues effectuées sur leur salaire et qui ne doit être dépensé que pour subvenir à leurs besoins. Les ouvriers ont parfaitement le droit d’exiger que cet argent leur revienne.
A
propos de ce règlement, il est indispensable d’étudier, tout
d’abord, les modalités de son application, avec les inconvénients
et les abus qui en résultent. En second lieu, il faut voir si ce
règlement est équitable, s’il sauvegarde suffisamment les intérêts
des ouvriers.
Pour ce qui est de l’application du règlement, il convient avant tout d’attirer l’attention sur les précisions suivantes, données par le Bureau du Travail de Pétersbourg : » Si, à un moment donné, la caisse du fonds des amendes est vide… les ouvriers ne peuvent rien réclamer à la direction. » Mais comment les ouvriers sauront-ils s’il y a ou non de l’argent au fonds des amendes et, s’il y en a, quel est le montant de la somme ?
Le Bureau du Travail raisonne comme si les ouvriers étaient parfaitement informés à cet égard, alors qu’il ne s’est nullement soucié de leur faire connaître l’état du fonds des amendes, et qu’il n’a pas prévu l’obligation, pour les fabricants et patrons d’usine, d’afficher toutes les informations utiles relatives à ce fonds.
Le Bureau du Travail pense-t-il vraiment qu’il suffira aux ouvriers de s’informer auprès du patron, lequel aura le droit de mettre les solliciteurs à la porte quand la caisse du fonds des amendes sera vide ?
Ce serait scandaleux, car les ouvriers désirant bénéficier d »un secours seraient alors traités comme des mendiants par les patrons. Les ouvriers doivent insister pour que, dans chaque fabrique et usine, soient affichées tous les mois des informations sur l’état du fonds des amendes : combien il y a d’argent en caisse ; combien il a été reçu le mois précédent ; combien il a été dépensé, et » pour faire face à quels besoins » ?
Sinon, les ouvriers ne sauront pas combien ils peuvent recevoir ; ils ne sauront pas si le fonds des amendes est en mesure de pourvoir à toutes leurs demandes, ou seulement à une partie d’entre elles, auquel cas il serait normal de ne retenir que les besoins les plus urgents.
Certaines usines, parmi les mieux organisées, ont instauré d’elles-mêmes ce système d’affichage : à Saint-Pétersbourg, il semble que ce soit le cas à l’usine Siemens et Halske ainsi qu’à la Cartoucherie, usine d’Etat. Si, lors de chaque entretien avec l’inspecteur, les ouvriers insistent sur ce point et sur la nécessité d’afficher les informations à ce sujet, ils obtiendront certainement gain de cause.
Il serait, de plus, très pratique pour les ouvriers que l’on mît en circulation dans les fabriques et les usines des formules imprimées [9] de demandes de secours provenant du fonds des amendes. Des formulaires de ce genre existent notamment dans la province de Vladimir.
Il n’est pas facile à un ouvrier de rédiger lui-même sa requête, et en outre il ne saura pas apporter tous les renseignements nécessaires, tandis que dans le formulaire tout est indiqué, et l’intéressé n’a plus qu’à écrire quelques mots dans les blancs. En l’absence de formulaires, beaucoup d’ouvriers devront faire rédiger leurs demandes par quelque bureaucrate, ce qui entraînera des dépenses.
Certes, d’après le règlement, l’allocation peut être demandée oralement ; mais, premièrement, l’ouvrier doit de toutes façons, aux termes du règlement, se procurer une attestation écrite de la police ou du médecin (si la demande est rédigée sur un formulaire, l’attestation s’écrit directement sur ce dernier) ; et, deuxièmement, certains patrons peuvent fort bien ne pas répondre à une demande orale, alors qu’ils sont obligés de donner suite à une demande écrite.
Les formulaires imprimés que l’on dépose au bureau de la fabrique ou de l’usine enlèveront à la demande d’allocation le caractère de mendicité que les patrons s’efforcent de lui donner.
Beaucoup de fabricants et de patrons d’usine sont très mécontents que l’argent des amendes n’ aille pas dans leur poche mais soit, aux termes de la loi, consacré aux besoins des ouvriers. Aussi ont-ils eu recours à une foule de ruses et de subterfuges pour duper ouvriers et inspecteurs, et tourner la loi. Afin de mettre en garde les ouvriers, nous allons passer en revue quelques-uns de ces subterfuges.
Certains
fabricants portaient les amendes sur le registre des salaires non pas
comme amendes, mais comme argent remis à l’ouvrier. On inflige à un
ouvrier un rouble d’amende et l’on consigne dans le registre qu’il
lui a été versé un rouble. Ce rouble, défalqué lors de la paie,
reste dans la poche du patron. Ce n’est plus seulement tourner la
loi, c’est commettre ni plus ni moins qu’une fraude, une escroquerie.
D’autres fabricants, au lieu d’infliger des amendes pour absences injustifiées, n’inscrivaient pas toutes les journées de travail : si, par exemple, l’ouvrier avait été irrégulièrement absent un jour dans la semaine, on ne lui comptait pas cinq jours de travail, mais quatre : le salaire d’une journée (qui aurait dû constituer l’amende pour absence injustifiée et être versé au fonds des amendes) revenait ainsi au patron. C’est là encore une fraude grossière.
Notons à ce propos que les ouvriers sont absolument sans défense contre ce genre de fraudes [10] , du fait qu’ils ne sont pas tenus au courant de l’état du fonds des amendes. Ce n’est que si des avis mensuels détaillés (indiquant le nombre des amendes pour chaque semaine et dans chaque atelier) sont affichés, que les ouvriers pourront veiller à ce que les amendes soient effectivement versées au fonds approprié.
Qui, en effet, contrôlera l’inscription régulière des amendes, sinon les ouvriers eux-mêmes? Les inspecteurs du travail ? Mais comment l’inspecteur saurait-il que tel ou tel chiffre a été porté en fraude ? L’inspecteur du travail Mikouline, qui relate ces supercheries, fait remarquer :
» Dans tous les cas de ce genre, il était extrêmement difficile de découvrir les abus si l’on n’avait des indications directes sous forme de plaintes de la part des ouvriers. »
L’inspecteur lui-même reconnaît qu’il lui est impossible de découvrir une fraude si les ouvriers ne la lui signalent. Mais les ouvriers ne pourront rien indiquer tant que les fabricants ne seront pas obligés d’afficher les informations nécessaires concernant les amendes.
Une troisième catégorie de fabricants avaient imaginé des méthodes beaucoup plus commodes de tromper les ouvriers et de tourner la loi, méthodes si ingénieuses et retorses qu’il n’était pas facile de s’y attaquer.
Dans les tissages de coton de la province de Vladimir, de nombreux patrons faisaient sanctionner par l’inspecteur non pas un tarif, mais deux et même trois pour chaque sorte de tissu ; il était indiqué en note que les tisserands ayant livré une marchandise irréprochable étaient réglés au taux le plus élevé ; ceux qui avaient livré une marchandise de moins bonne qualité l’étaient suivant le second taux ; la marchandise considérée comme du rebut était payée au taux le plus bas [11].
On voit tout de suite dans quel but avait été imaginé ce subterfuge : la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur passait dans la poche du patron, alors qu’en fait elle représentait une amende pour malfaçon et devait, à ce titre, être versée au fonds correspondant. Il est clair que c’était là tourner grossièrement la loi, non seulement la loi sur les amendes, mais aussi la loi sur la validation du taux des salaires.
Ce taux doit être officiellement sanctionné pour que le patron ne puisse modifier le salaire à sa guise ; mais il est évident que l’existence de plusieurs taux au lieu d’un seul laisse le champ libre à l’arbitraire le plus absolu de la part du patron.
Les
inspecteurs du travail comprenaient bien que ces tarifications »
visaient évidemment à
tourner la loi » (tout cela est rapporté par ce même M.
Mikouline dans le livre cité plus haut) ; néanmoins, ils » ne
s’estimaient pas en droit »
de rien refuser à des hommes aussi respectables que » messieurs
» les fabricants.
Parbleu
! Ce n’est certes pas une petite affaire que d’opposer un refus à
des fabricants (car ce n’est pas un seul fabricant mais plusieurs qui
ont imaginé en même temps ce subterfuge !). Mais si c’étaient les
ouvriers et non » messieurs » les fabricants qui avaient
essayé de tourner la loi ? Aurait on trouvé alors dans tout
l’empire de Russie un seul inspecteur de fabrique qui » ne
se serait pas estimé en droit »
de refuser aux ouvriers l’autorisation de tourner la loi ?
Ainsi, ces tarifications à deux et trois échelons furent approuvées par l’inspection du travail et entrèrent en vigueur. Toutefois, il apparut que la question des taux de salaire n’intéressait pas seulement messieurs les fabricants, toujours à imaginer des moyens de tourner la loi, pas seulement messieurs les inspecteurs qui ne s’estiment pas en droit de gêner les fabricants dans leurs bons desseins, mais aussi… les ouvriers.
Ceux-ci n’ont pas fait preuve de cette même indulgence pour les filouteries de messieurs les fabricants, et ils » se sont estimés en droit » d’empêcher ces derniers de gruger les ouvriers.
Ces
tarifications, rapporte M. l’inspecteur Mikouline, » suscitèrent
un tel mécontentement parmi les ouvriers que ce fut là une des
principales causes des désordres accompagnés de violences qui
éclatèrent alors et rendirent nécessaire l’intervention de la
force armée « .
Ainsi vont les choses ! Pour commencer, on » ne s’est pas estimé en droit » d’empêcher messieurs les fabricants d’enfreindre la loi et de duper les ouvriers ; et quand ceux-ci, indignés des abus commis, se sont révoltés, il est devenu » nécessaire » de faire appel à la force armée !
Pourquoi a-t il donc été » nécessaire » de faire appel à la force armée contre les ouvriers qui défendaient leurs droits légaux, et non contre les fabricants, qui enfreignaient ouvertement la loi ? Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’après la révolte des ouvriers que, » par décision du gouverneur, ce genre de tarification fut aboli « .
Les ouvriers eurent gain de cause. La loi a été imposée non par messieurs les inspecteurs du travail, mais par les ouvriers eux-mêmes qui ont montré qu’ils ne permettraient pas qu’on se moquât d’eux et qu’ils sauraient défendre leurs droits. » Par la suite, dit M. Mikouline, l’inspection du travail s’est refusée à ratifier de pareilles tarifications. » C’est ainsi que les ouvriers ont appris aux inspecteurs à faire appliquer la loi.
Mais
la leçon n’a touché que les fabricants de Vladimir. Or, les
fabricants sont partout les mêmes, à Vladimir comme à Moscou et à
Saint-Pétersbourg. Les fabricants de Vladimir n’ont pas réussi à
tourner la loi, mais le moyen qu’ils ont imaginé est resté et a
même été perfectionné par un génial patron de Saint-Pétersbourg.
Quelle était la méthode des fabricants de Vladimir ? Elle consistait à ne pas employer le mot amende et à le remplacer par d’autres termes. Si je déclare qu’en cas de malfaçon l’ouvrier recevra un rouble de moins, ce sera une amende dont il faudra verser le montant au fonds des amendes.
Mais si je déclare que, pour malfaçon, l’ouvrier recevra un salaire au taux le plus bas, ce ne sera pas une amende et j’empocherai le rouble. Ainsi raisonnaient les fabricants de Vladimir, dont les ouvriers ont su réfuter les arguments. On peut aussi raisonner différemment.
On peut dire : en cas de malfaçon, l’ouvrier recevra son salaire sans les gratifications ; là encore, il n’y aura pas amende, et le patron empochera le rouble. C’est le raisonnement qu’a imaginé Iakovlev, l’astucieux patron d’une usine de mécanique de Saint-Pétersbourg.
Il déclare : vous recevrez un rouble par jour ; mais si contre vous n’est relevée aucune faute, absence injustifiée, grossièreté ou malfaçon, vous recevrez 20 kopecks de » gratification « . Par contre, s’il y a faute, le patron retient les 20 kopecks et les met naturellement dans sa poche : en effet, il ne s’agit pas d’une amende, mais d’une » gratification « .
Toutes les lois qui concernent les fautes pouvant motiver une retenue et fixent le montant de cette retenue, ainsi que la façon dont cet argent doit être dépensé pour les besoins des ouvriers, sont nulles et non avenues pour M. Iakovlev. Les lois traitent des » amendes « , alors que lui ne connaît que les » gratifications « .
L’astucieux patron réussit jusqu’à présent à rouler les ouvriers grâce à cette échappatoire. Sans doute l’inspecteur du travail de Saint-Pétersbourg ne s’est-il pas, lui non plus, » estimé en droit » de l’empêcher de tourner la loi. Espérons que les ouvriers de Pétersbourg ne resteront pas en arrière de ceux de Vladimir, et qu’ils apprendront tant à l’inspecteur qu’au patron à respecter la loi.
Afin
de montrer les sommes énormes constituées par les amendes, nous
citerons quelques chiffres relatifs aux fonds des amendes de la
province de Vladimir.
Le versement d’allocations y a commencé en février 1891. Avant octobre 1891, il en avait déjà été accordé à 3 665 personnes pour un montant de 25 458 roubles 59 kopecks. Le 1er octobre 1891, le fonds des amendes s’élevait à 470 052 roubles 45 kopecks.
Mentionnons à ce propos un autre emploi de l’argent des amendes. Dans une fabrique, le fonds des amendes s’élevait à 8 242 roubles 46 kopecks. Cette fabrique fit faillite et les ouvriers passèrent l’hiver sans pain et sans travail. Il fut alors distribué, par prélèvement sur ce fonds, 5 820 roubles de secours aux ouvriers, dont le nombre atteignait 800.
Du 1er octobre 1891 au 1er octobre 1892, on préleva 94 055 roubles 47 kopecks d’amendes, et on distribua en allocations 45 200 roubles 52 kopecks à 6 312 personnes.
Voici comment se répartissaient ces allocations : 208 personnes ont reçu des pensions mensuelles d’invalidité pour une somme de 6 198 r 20 k, soit une moyenne de 30 roubles par personne et par an (tels sont les secours misérables qu’on alloue alors que des dizaines de milliers de roubles provenant des amendes restent inemployés !).
En outre 1 037 personnes ont reçu 17 827 r 12 k, soit en moyenne 18 roubles par personne, pour perte de biens. Il a été distribué 10 641 r 81 k à 2 669 femmes enceintes, soit une moyenne de 4 roubles (ceci pour trois semaines : une avant les couches et deux après). 5 380 r 68 k ont été versés à 877 ouvriers pour cause de maladie, soit 6 roubles en moyenne. Les frais d’obsèques représentent 4 620 roubles d’allocations versés à 1 506 ouvriers (moyenne 3 roubles). Enfin, divers autres cas concernent 15 personnes, qui ont reçu 532 r 71 k.
Nous
connaissons à présent sur le bout du doigt le règlement relatif
aux amendes et son mode d’application. Voyons si ce règlement est
juste et s’il protège suffisamment les droits des ouvriers.
Nous
savons qu’aux termes de la loi, l’argent des amendes n’appartient pas
au patron et ne peut servir qu’à pourvoir aux besoins des ouvriers.
Le règlement relatif à l’emploi de ces fonds devait être approuvé
par les ministres.
A quoi ce règlement a-t il abouti ? L’argent est prélevé sur le salaire des ouvriers et consacré à la satisfaction de leurs besoins ; mais il n’est même pas dit dans le règlement que les patrons sont tenus de faire connaître aux ouvriers l’état du fonds des amendes.
Les ouvriers n’ont pas le droit d’élire des délégués qui veilleraient à ce que l’argent soit régulièrement versé au fonds des amendes, recueilleraient les demandes des ouvriers et répartiraient les allocations. Il était dit dans la loi que les allocations sont accordées » sur l’autorisation de l’inspecteur « , mais le règlement établi par les ministres stipule que la demande d’allocation doit être adressée au patron .
Pourquoi au patron ? Cet argent n’est pas le sien, il appartient aux ouvriers et a été constitué par des prélèvements sur leurs salaires. Le patron n’a pas le droit de toucher à cet argent : s’il le dépense, il peut être attaqué pour appropriation et dilapidation de fonds, tout comme s’il avait dépensé l’argent d’autrui.
Il est évident que si les ministres ont pris un tel règlement, c’est qu’ils désiraient rendre service aux patrons : actuellement, les ouvriers doivent demander une allocation au patron, comme s’il s’agissait d’une aumône.
Il est vrai que si le patron refuse, l’inspecteur peut attribuer lui-même l’allocation. Mais l’inspecteur n’est au courant de rien : si le patron lui dit que cet ouvrier est un bon à rien, qu’il ne mérite pas d’allocation, l’inspecteur le croira [12] . Et puis, se trouvera-t-il beaucoup d’ouvriers qui iront se plaindre à l’inspecteur, consentiront à perdre des heures de travail pour aller le trouver, écrire des requêtes et ainsi de suite ?
En réalité, le règlement ministériel ne fait qu’instaurer une nouvelle forme de dépendance des ouvriers à l’égard des patrons.
Ceux-ci reçoivent la possibilité de brimer les ouvriers dont ils sont mécontents, peut-être parce que ceux-ci ne se laissent pas tondre la laine sur le dos : en rejetant leurs demandes, les patrons leur susciteront à coup sûr bien des tracas supplémentaires et obtiendront peut-être même que l’allocation leur soit définitivement refusée.
Par contre, aux ouvriers qui leur font des courbettes, sont à plat ventre devant eux et mouchardent leurs camarades, les patrons peuvent accorder des allocations particulièrement élevées, même dans des cas où un autre ouvrier essuierait un refus.
Loin d’abolir la dépendance des ouvriers à l’égard des patrons en matière d’amendes, on aboutit à une nouvelle forme de dépendance qui contribue à diviser les ouvriers et à encourager la flagornerie et l’arrivisme.
Et puis, considérez cette scandaleuse procédure bureaucratique nécessaire, selon le règlement, à l’obtention d’une allocation : l’ouvrier doit chaque fois demander une attestation, tantôt au médecin, qui ne lui épargnera sans doute pas les rebuffades, tantôt à la police, qui ne fait rien sans qu’on lui graisse la patte.
Rien de tout cela, nous le répétons, ne figure dans la loi ; ces dispositions résultent d’un règlement ministériel, manifestement rédigé pour complaire aux fabricants et tendant ouvertement à placer sous la dépendance des fonctionnaires les ouvriers déjà dépendants des patrons, à écarter les ouvriers de toute participation à l’emploi, pour la satisfaction de leurs besoins, de l’argent des amendes prélevé sur leurs propres salaires, à engendrer un bureaucratisme absurde qui abrutit et démoralise [13] les ouvriers.
Laisser au patron le droit d’autoriser le versement d’allocations prélevées sur le fonds des amendes est une injustice criante. Les ouvriers doivent obtenir que la loi leur permette d’élire des députés (des délégués) qui veilleront à ce que les amendes soient versées au fonds correspondant, recueilleront et contrôleront les demandes d’allocation des ouvriers, rendront compte à ceux-ci de l’état du fonds des amendes et de son utilisation.
Dans les usines où il existe actuellement des délégués, ceux ci doivent porter leur attention sur le fonds des amendes et exiger que tous les renseignements relatifs aux amendes leur soient communiqués ; ils doivent recueillir les demandes des ouvriers et les transmettre eux-mêmes à l’administration.
VII
: Les lois sur les amendes s’étendent-elles à tous les ouvriers ?
Comme la plupart des lois russes, les lois sur les amendes ne s’étendent ni à toutes les fabriques et usines, ni à tous les ouvriers.
Quand il promulgue une loi, le gouvernement russe a toujours peur qu’elle n’offense messieurs les fabricants et patrons d’usine ; que les finasseries des règlements administratifs et les droits et devoirs des fonctionnaires ne viennent heurter d’autres règlements administratifs (qui sont chez nous innombrables), ou les droits et devoirs d’autres fonctionnaires qui se jugeront mortellement offensés si quelque nouveau fonctionnaire empiète sur leur domaine, et qui dépenseront des flots d’encre officielle et des rames de papier dans un échange de lettres sur » la délimitation des services de leur ressort « .
C’est pourquoi il est si rare qu’une loi entre en vigueur dans toute la Russie à la fois, sans comporter des exceptions, un timide échelonnement dans son application, ou la possibilité pour les ministres et autres fonctionnaires d’accorder des dérogations.
On
l’a bien vu pour la loi sur les amendes qui, nous l’avons dit,
suscita un tel mécontentement chez messieurs les capitalistes et ne
fut promulguée que sous la pression de redoutables révoltes
ouvrières.
Tout d’abord, la loi sur les amendes ne s’applique qu’à une petite partie de la Russie [14] . Cette loi a été promulguée, nous l’avons dit, le 3 juin 1886, et est entrée en vigueur le 1er octobre 1886 dans trois provinces seulement : celles de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Vladimir.
Cinq ans plus tard, elle était étendue aux provinces de Varsovie et de Pétrokov (11 juin 1891). Puis, après trois ans encore, à 13 autres provinces (celles de Tver, Kostroma, Iaroslavl, Nijni-Novgorod et Riazan, au centre ; celles d’Estonie et de Livonie dans les pays baltes ; celles de Grodno et de Kiev, à l’Ouest ; celles de Volhynie, de Podolie, de Kharkov et de Kherson au Sud), en vertu de la loi du 15 mars 1894. En 1892, les règlements relatifs aux amendes ont été étendus aux industries et exploitations minières privées.
Les
progrès rapides du capitalisme dans le Sud de la Russie et le
développement prodigieux de l’industrie minière y rassemblent
d’importantes masses ouvrières et obligent le gouvernement à se
hâter.
Le gouvernement, on le voit, est très lent à renoncer au régime antérieurement en vigueur dans les fabriques. Notons en outre qu’il n’y renonce que sous la pression des ouvriers : le renforcement du mouvement ouvrier et les grèves en Pologne ont entraîné l’extension de la loi aux provinces de Varsovie et de Pétrokov (dont fait partie la ville de Lodz).
La grande grève aux manufactures Khloudov (district de Iégorievsk, province de Riazan) a eu pour résultat immédiat l’extension de la loi à la province de Riazan. De toute évidence, le gouvernement, lui non plus, » ne s’estime pas en droit » d’ôter à messieurs les capitalistes le privilège d’infliger des amendes à leur guise et sans contrôle, tant que les ouvriers ne s’en sont pas mêlés.
En second lieu, la loi sur les amendes, comme d’ailleurs tous les règlements sur le contrôle des fabriques et usines, ne s’applique pas aux établissements de l’Etat et des institutions d’assistance gouvernementales.
Les usines de l’Etat ont déjà une administration » aux petits soins » pour l’ouvrier, que la loi ne veut pas gêner par un règlement sur les amendes. En effet, à quoi bon contrôler les usines de l’Etat quand le directeur est lui-même un fonctionnaire ? Les ouvriers peuvent se plaindre de lui à lui-même.
Quoi d’étonnant si, parmi ces directeurs des usines de l’Etat on compte des individus aussi odieux que M. Verkhovski, commandant du port de Pétersbourg?
En
troisième lieu, le règlement sur l’utilisation des fonds des
amendes pour les besoins de l’ouvrier ne s’étend pas aux ateliers de
chemins de fer lorsque la ligne qu’ils desservent possède des
caisses de retraite ou des caisses d’épargne et de secours mutuel.
L’argent des amendes est versé à ces caisses.
Toutes
ces dérogations ont semblé encore insuffisantes, et la loi a donné
aux ministres (des Finances et de l’Intérieur) le droit, d’une part,
de » dispenser de l’observation » de ce règlement »
les fabriques et usines peu importantes, en cas de réelle nécessité
« , et, d’autre part, d’étendre ce règlement aux exploitations
artisanales » importantes « .
Il ne suffit donc pas que la loi ait chargé un ministre de rédiger un règlement sur les amendes ; elle a encore donné le droit à des ministres de dispenser certains fabricants d’obéir à la loi ! Voilà jusqu’où va l’amabilité de nos lois à l’égard de messieurs les fabricants !
Une instruction ministérielle précise que les dispenses ne seront accordées qu’aux fabricants pour lesquels le Bureau du Travail » a l’assurance que le propriétaire de l’entreprise ne portera pas préjudice aux intérêts des ouvriers « . Les fabricants et les inspecteurs du travail sont si bons amis qu’ils se croient mutuellement sur parole. A quoi bon faire peser sur le fabricant la contrainte d’un règlement, quand il » donne l’assurance » qu’il ne portera pas préjudice aux intérêts des ouvriers ?
Et si l’ouvrier essayait de demander à l’inspecteur ou au ministre de le décharger du règlement en l’ » assurant » qu’il ne portera pas préjudice aux intérêts du fabricant ? On prendrait sans aucun doute cet ouvrier pour un fou. C’est ce qu’on appelle l’ » égalité en droits » des ouvriers et des fabricants.
Quant à l’extension du règlement sur les amendes aux entreprises artisanales importantes, elle n’a, jusqu’à présent (en 1893), pour autant qu’on le sache, concerné que les bureaux chargés de distribuer la chaîne aux tisserands travaillant à domicile. Les ministres ne sont nullement pressés d’étendre l’application du règlement sur les amendes.
Toute la masse des ouvriers qui travaillent à domicile pour des patrons, les grands magasins, etc., demeure complètement soumise à l’arbitraire des patrons. Il est plus difficile à ces ouvriers de se réunir, de se mettre d’accord pour revendiquer, d’organiser la lutte en commun contre les brimades des patrons ; aussi ne fait-on pas attention à eux.
VIII
: Conclusion
Nous
connaissons maintenant à fond nos lois et notre règlement sur les
amendes, tout ce système si compliqué qui rebute l’ouvrier par sa
sécheresse et son jargon administratif.
Nous
pouvons à présent revenir à la question posée au début, au fait
que les amendes sont le fruit du capitalisme, c’est-à-dire d’une
forme d’organisation de la société où le peuple se divise en deux
classes : les propriétaires de la terre, des machines, des fabriques
et des usines, des matières premières et des denrées, et ceux qui
ne possèdent rien en propre et doivent par conséquent se vendre aux
capitalistes et travailler pour eux.
Les
ouvriers travaillant pour un patron ont-ils été de tout temps
obligés de lui payer des amendes pour les malfaçons ?
Dans
les petites exploitations, par exemple chez les artisans des villes
et leurs ouvriers, il n’y a pas d’amendes. Ici, pas de coupure
complète entre l’ouvrier et le patron : ils vivent et travaillent
ensemble. L’idée ne peut venir au patron d’infliger des amendes,
puisqu’il veille lui-même au travail et peut toujours faire
rectifier ce qui ne lui plaît pas.
Mais les petites exploitations et les petits métiers de ce genre disparaissent graduellement. Ni les artisans ni les petits paysans ne peuvent soutenir la concurrence des grosses fabriques et usines, des gros patrons qui utilisent de meilleurs instruments et des machines, ainsi que l’effort conjoint de nombreux ouvriers.
Aussi voyons-nous les artisans et les petits paysans se ruiner de plus en plus, s’embaucher comme ouvrier dans les fabriques et les usines, déserter les villages et partir à la ville.
Dans les grosses fabriques et usines, les rapports entre patron et ouvriers ne sont plus du tout les mêmes que dans les petits ateliers. Le patron est tellement au dessus de l’ouvrier par sa richesse et par sa situation sociale, qu’un véritable abîme les sépare, que souvent ils ne se sont même jamais vus et n’ont rien qui les rapproche.
L’ouvrier n’a aucune possibilité de percer et de devenir patron : il est condamné à rester éternellement un non-possédant, travaillant pour des richards qu’il ne connaît pas.
Au lieu des deux ou trois ouvriers du petit patron, il y en a maintenant des quantités qui viennnent de différentes localités et se succèdent continuellement. Au lieu d’ordres particuliers donnés par le patron, un règlement général, obligatoire pour tous les ouvriers. Les anciens rapports permanents entre patron et ouvriers disparaissent : le patron ne fait aucun cas de l’ouvrier car il lui est toujours facile d’en trouver un autre dans la foule des chômeurs prêts à s’embaucher n’importe où. De la sorte le pouvoir du patron sur les ouvriers augmente.
Et le patron profite de ce pouvoir pour maintenir à coups d’amendes l’ouvrier dans le cadre strict du travail en usine. L’ouvrier a dû se résigner à cette nouvelle limitation de ses droits et de son salaire, car il est désormais impuissant en face du patron.
Les
amendes ont donc fait leur apparition il n’y a pas très longtemps,
en même temps que les grosses fabriques et usines, en même temps
que le grand capitalisme, en même temps que le fossé qui sépare
complètement les riches patrons et les ouvriers gueusards. Les
amendes ont été le résultat du développement intégral du
capitalisme et de l’asservissement intégral de l’ouvrier.
Mais ce développement des grosses fabriques et cette pression accrue de la part des patrons ont encore eu d’autres conséquences. Les ouvriers, complètement réduits à l’impuissance en face des fabricants, commencèrent à comprendre qu’ils étaient promis à une déchéance et à une misère totales s’ils demeuraient désunis.
Ils commencèrent à comprendre que, pour échapper à la famine et à la dégénérescence qui les guettent sous le capitalisme, il n’existe pour eux qu’un moyen : s’unir afin de lutter contre les fabricants, d’obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions d’existence.
Nous
avons vu quelles brimades révoltantes nos fabricants en étaient
venus à infliger aux ouvriers dans les années 80, et comment ils
ont fait des amendes un moyen d’abaisser les salaires, qui venait
s’ajouter à la réduction des tarifs. L’oppression des ouvriers par
les capitalistes était alors à son comble.
Mais
cette oppression a aussi provoqué une résistance de la part des
ouvriers, qui se sont dressés contre leurs oppresseurs et ont
vaincu. Pris de peur, le gouvernement a fait droit à leurs
revendications et s’est hâté de promulguer la loi réglementant les
amendes.
C’était
là une concession aux ouvriers. Le gouvernement croyait qu’en
promulguant des lois et un règlement sur les amendes, en instituant
des allocations prélevées sur le fonds des amendes, il donnerait du
même coup satisfaction aux ouvriers et les amènerait à oublier
leur cause commune, leur lutte contre les fabricants.
Mais ces espoirs d’un gouvernement désireux de passer pour le défenseur des ouvriers, seront déçus.
Nous avons vu combien la nouvelle loi est injuste pour les ouvriers, combien les concessions qui leur sont faites sont infimes si on les compare ne fût-ce qu’aux revendications formulées par les grévistes de chez Morozov ; nous avons vu comment on a laissé subsister partout des échappatoires à l’intention des fabricants désireux de violer la loi, et comment on a pris dans leur intérêt un règlement sur les allocations, qui à l’arbitraire des patrons ajoute celui des fonctionnaires.
Quand cette loi et ce règlement seront appliqués, quand les ouvriers apprendront à les connaître et se rendront compte, par leurs conflits avec la direction, à quel point la loi les opprime, ils prendront peu à peu conscience de leur état de dépendance.
Ils comprendront que seule la misère les a forcés à travailler pour les riches et à se contenter pour leur peine d’un salaire dérisoire. Ils comprendront que le gouvernement et ses fonctionnaires sont avec les fabricants, et que les lois sont faites pour que le patron puisse plus facilement serrer la vis à l’ouvrier.
Et
les ouvriers apprendront, enfin, que la loi ne fera rien pour
améliorer leur situation tant qu’ils dépendront des capitalistes,
car la loi sera toujours pour les fabricants capitalistes, car
ceux-ci trouveront toujours les moyens de tourner la loi.
Quand
ils l’auront compris, les ouvriers verront qu’il ne leur reste qu’un
moyen de se défendre : s’unir pour lutter contre les fabricants et
contre le régime d’injustice établi par la loi.
Notes
[1] Les fabricants et leurs défenseurs ont toujours estimé, et
estiment encore, que si les ouvriers se mettent à réfléchir à
leur condition, à faire respecter leurs droits et à s’opposer tous
ensemble aux abus et aux brimades des patrons, tout cela n’est que »
perversion « . Les patrons ont évidemment intérêt à ce que
les ouvriers ne réfléchissent pas à leur condition et ne
connaissent pas leurs droits. (note de l’auteur )
[2] Le cas s’est effectivement produit à Pétersbourg, dans les
ateliers du port (de la nouvelle Amirauté), dont le commandant,
Verkhovski, est bien connu pour ses brimades à l’égard des
ouvriers. Après une grève. il substitua aux amendes pour bris
d’ampoule des retenues sur le salaire, pour le même motif, mais
frappant tous les ouvriers de l’atelier. Il est évident que ces
retenues sur le salaire ne sont pas moins illégales que les amendes.
(note de l’auteur )
[3] A l’exception d’un seul cas : l’ » incendie « , qui
n’est pas mentionné dans la loi relative à la convocation des
prévenus. (note de l’auteur )
[4] On ne donne pas le maximum de l’amende encourue pour un seul
jour d’absence injustifiée par un ouvrier payé à la journée. Il
est dit simplement qu’elle est » proportionnelle au salaire de
l’ouvrier ». Le montant des amendes est précisé dans chaque
fabrique par le tableau des sanctions pécuniaires, comme nous le
verrons par la suite. (note de l’auteur )
[5] L’ouvrier qui estime irrégulière cette rupture du contrat
peut se pourvoir en justice, mais le délai qui lui est accordé pour
cela est très court : un mois (à compter, bien entendu, du jour du
licenciement). (note de l’auteur )
[6] De qui se compose le Bureau du Travail ? Du gouverneur, du
procureur, du chef de la gendarmerie, d’un inspecteur du travail et
de deux fabricants . Si l’on y ajoutait, le
directeur de la prison et l’officier commandant les cosaques, on
aurait là tous les fonctionnaires qui incarnent » la
sollicitude du gouvernement impérial de Russie pour les classes
laborieuses « . (note de l’auteur )
[7] Note à l’article 26 des Instructions. (note
de l’auteur )
[8] Il va de soi que le fait de recevoir une allocation provenant
du fonds des amendes ne prive pas l’ouvrier du droit d’exiger du
fabricant une indemnité si, par exemple il est estropié. (note
de l’auteur )
[9] C’est à-dire des déclarations imprimées où la demande
figure déjà et où l’on a laissé des espaces vides pour le nom de
la fabrique, le motif de la demande, le domicile, la signature, etc.
(note de l’auteur )
[10] L’existence de ces fraudes est attestée par M. Mikouline,
inspecteur du travail de la province de Vladimir, dans son livre sur
la nouvelle loi de 1886. (note de l’auteur )
[11] Ce genre de tarifications existe aussi dans certaines
fabriques de Saint-Pétersbourg : on écrit, par exemple, que telle
quantité de marchandises est payée à l’ouvrier de 20 à 50
kopecks. (note de l’auteur )
[12] Dans le formulaire de demande d’allocation qui, nous l’avons
dit, a été distribué dans les fabriques et usines par le Bureau du
Travail de Vladimir, et qui présente le mode d’application du »
règlement » le plus favorable aux ouvriers, nous lisons : »
L’administration de la fabrique certifie la signature et la teneur de
la demande, en ajoutant qu’à son avis le demandeur mérite une
allocation de… » Ainsi l’administration peut toujours écrire,
même sans apporter de justification, qu’ » à son avis » le
demandeur ne mérite pas d’allocation. Bénéficieront des
allocations non pas ceux qui en ont besoin, mais ceux qui, » de
l’avis des fabricants, méritent d’être secourus « . (note
de l’auteur )
[13] En semant la division, en encourageant la servilité et en
cultivant un mauvais esprit. (note de l’auteur )
[14] Cette loi fait partie du » règlement spécial relatif
aux rapports entre fabricants et ouvriers « . Ce »
règlement spécial » n’est applicable que dans » les
localités où l’industrie a pris un grand développement » et
que nous indiquerons par la suite. (note de l’auteur )