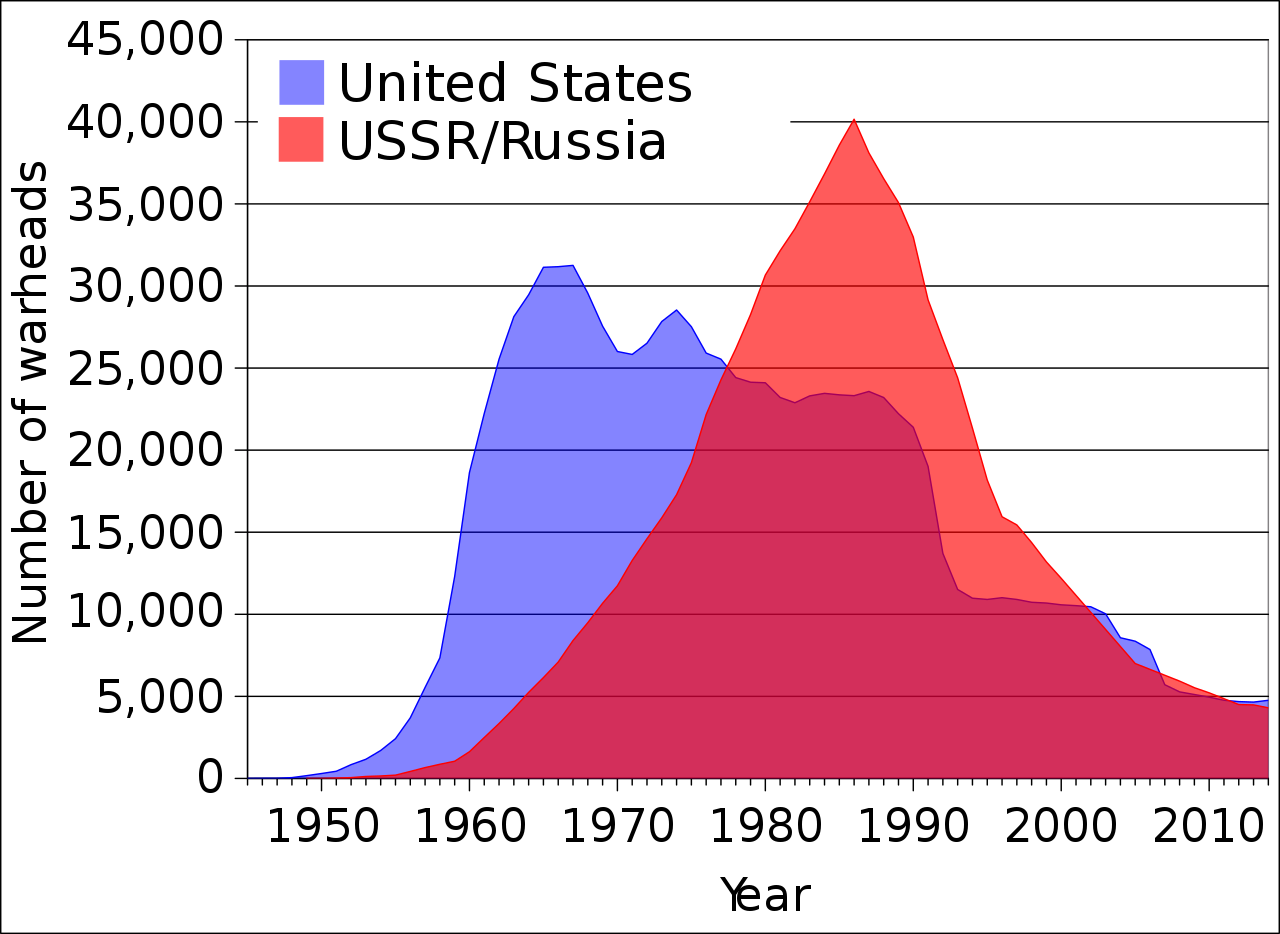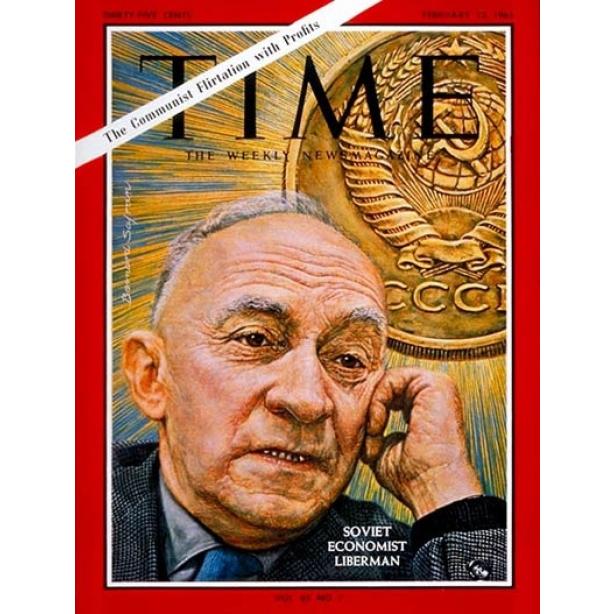Précis d’histoire du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchévik), 1938
1. L’origine et les causes de la guerre impérialiste.
Le 14 (27) juillet 1914, le gouvernement tsariste proclamait la mobilisation générale. le 19 juillet (1er août), l’Allemagne déclarait la guerre à la Russie.
La Russie entrait en campagne.
Bien avant le début de la guerre, Lénine, les bolchéviks avaient prévu qu’elle allait éclater inévitablement. Dans les congrès socialistes internationaux, Lénine avait formulé ses propositions visant à définir la ligne de conduite révolutionnaire des socialistes en cas de guerre.
Lénine indiquait que les guerres étaient l’accompagnement inévitable du capitalisme. Le pillage des territoires d’autrui, la conquête et la spoliation des colonies, la mainmise sur de nouveaux débouchés avaient plus d’une fois servi de motifs aux États capitalistes pour entreprendre des guerres de conquête. La guerre pour les pays capitalistes est un fait aussi naturel et aussi légitime que l’exploitation de la classe ouvrière.
Les guerres sont inévitables surtout depuis que le capitalisme, à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, s’est définitivement transformé en impérialisme, stade suprême et dernier stade de son développement. Sous l’impérialisme, les puissantes associations (les monopoles) capitalistes et les banques prennent un rôle décisif dans la vie des États capitalistes. Le capitalisme financier y règne en maître. Il exige de nouveaux marchés, la conquête de nouvelles colonies, de nouveaux débouchés pour l’exportation des capitaux, de nouvelles sources de matières premières.
Mais dès la fin du XIXe siècle, tout le territoire du globe se trouvait partagé entre les États capitalistes. Cependant, le capitalisme, à l’époque de l’impérialisme, se développe d’une façon extrêmement inégale et par bonds : tels pays qui autrefois occupaient la première place, développent leur industrie avec assez de lenteur ; d’autres, qui étaient autrefois arriérés, les rattrapent et les dépassent par bonds rapides.
Le rapport de forces économique et militaire des États impérialistes se modifie. Une tendance se manifeste en faveur d’un nouveau partage du monde. C’est la lutte pour ce nouveau partage du monde qui rend inévitable la guerre impérialiste. La guerre de 1914 fut une guerre pour repartager le monde et les zones d’influence. Elle avait été préparée longtemps à l’avance par tous les États impérialistes. Ses responsables, ce furent les impérialistes de tous les pays.
Cette guerre avait été particulièrement préparée par l’Allemagne et l’Autriche d’une part, et de l’autre, par la France et l’Angleterre, avec la Russie qui dépendait de ces deux derniers pays. En 1907 apparut la Triple Entente, ou l’Entente, alliance de l’Angleterre, de la France et de la Russie. L’autre alliance impérialiste était formée par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Mais au début de la guerre de 1914, l’Italie abandonna cette alliance pour rejoindre ensuite l’Entente. L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie étaient soutenues par la Bulgarie et la Turquie.
En se préparant à la guerre impérialiste, l’Allemagne voulait enlever leurs colonies à l’Angleterre et à la France, et l’Ukraine, la Pologne et les provinces baltiques à la Russie. L’Allemagne menaçait la domination de l’Angleterre dans le Proche-Orient en construisant le chemin de fer de Bagdad. L’Angleterre redoutait le développement des armements navals de l’Allemagne.
La Russie tsariste visait à démembrer la Turquie ; elle rêvait de conquérir les Dardanelles, détroit reliant la mer Noire à la Méditerranée, et de s’emparer de constantinople. Il entrait aussi dans les plans du gouvernement tsariste d’annexer une partie de l’Autriche-Hongrie, la Galicie.
L’Angleterre voulait la guerre pour battre son dangereux concurrent, l’Allemagne, dont les marchandises évinçaient de plus en plus les siennes propres du marché mondial. En outre, l’Angleterre se proposait de conquérir sur la Turquie la Mésopotamie et la Palestine et de prendre solidement pieds en Egypte.
Les capitalistes français voulaient conquérir sur l’Allemagne le bassin de la Sarre, l’Alsace et la Lorraine, riches en charbon et en fer ; l’Alsace et la Lorraine avaient été enlevées à la France par l’Allemagne à l’issue de la guerre de 1870-1871.
Ainsi, c’étaient les graves antagonismes divisant les deux groupes d’États capitalistes qui avaient abouti à la guerre impérialiste.
Cette guerre de rapine pour un nouveau partage du monde affectait les intérêts de tous les pays impérialistes ; c’est pourquoi le Japon, les États-Unis d’Amérique et nombre d’autres États s’y trouvèrent, par la suite, également entraînés.
La guerre devint mondiale.
La guerre impérialiste avait été fomentée par la bourgeoisie dans le plus grand secret, à l’insu des peuples. Lorsqu’elle éclata, chaque gouvernement impérialiste s’attacha à démontrer que ce n’était pas lui qui avait attaqué ses voisins, mais que c’était lui la victime de l’agression. La bourgeoisie trompait le peuple en dissimulant les véritables motifs de la guerre, son caractère impérialiste, expansionniste. Chaque gouvernement impérialiste déclarait faire la guerre pour la défense de la patrie.
Les opportunistes de la IIe Internationale aidèrent la bourgeoisie à tromper le peuple. Les social-démocrates de la IIe Internationale trahirent lâchement la cause du socialisme, la cause de la solidarité internationale du prolétariat. Loin de s’élever contre la guerre, ils aidèrent au contraire la bourgeoisie à dresser les uns contre les autres les ouvriers et les paysans des États belligérants, en invoquant la défense de la patrie.
Ce n’est point par hasard que la Russie était entrée dans la guerre impérialiste aux côtés de l’Entente : de la France et de l’Angleterre. Il ne faut pas oublier qu’avant 1914, les principales industries de Russie étaient détenues par le capital étranger, surtout par le capital français, anglais et belge, c’est-à-dire par le capital des pays de l’Entente. Les usines métallurgiques les plus importantes de Russie se trouvaient entre les mains de capitalistes français. La métallurgie dépendait, presque pour les trois quarts (72%), du capital étranger. Même tableau pour l’industrie houillère dans le bassin du Donetz.
Près de la moitié des puits de pétrole étaient aux mains du capital anglo-français. Une notable partie des profits de l’industrie russe allait aux banques étrangères, anglo-françaises principalement. Toutes ces circonstances, ajoutées aux emprunts qui avaient été contractés par le tsar en France et en Angleterre et qui se chiffraient par des milliards, rivaient le tsarisme à l’impérialisme anglo-français, transformaient la Russie en pays tributaire, en semi-colonie de ces pays.
La bourgeoisie russe comptait, en déclanchant la guerre, améliorer sa situation : conquérir de nouveaux débouchés, s’enrichir par les commandes militaires et les fournitures aux armées et mater du même coup le mouvement révolutionnaire en exploitant la situation crée par la guerre.
La Russie tsariste n’était pas préparée à la guerre. Son industrie retardait fortement sur celle des autres pays capitalistes. La plupart des fabriques et des usines étaient vieilles, leur outillage usé. L’agriculture, étant donné le régime de propriété semi-féodal et l’appauvrissement, la ruine des masses paysannes, ne pouvait servir de base économique solide pour une guerre de longue haleine.
Le tsar s’appuyait principalement sur les féodaux de la terre. Les grands propriétaires fonciers ultra-réactionnaires, alliés aux grands capitalistes, régnaient en maîtres dans le pays et à la Douma d’État. Ils appuyaient entièrement la politique intérieure et extérieure du gouvernement tsariste. La bourgeoisie impérialiste russe comptait sur l’autocratie tsariste comme un poing ganté de fer, capable d’un côté de lui garantir la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux territoires et, de l’autre, de mater le mouvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans.
Le parti de la bourgeoisie libérale, — les cadets – figurait l’opposition ; il soutenait cependant sans réserve la politique extérieure du gouvernement tsariste.
Les partis petits-bourgeois socialiste-révolutionnaire et menchévik, tout en se retranchant derrière le drapeau du socialisme, aidèrent dès le début de la guerre la bourgeoisie à tromper le peuple, à cacher le caractère impérialiste et spoliateur de la guerre. Ils prêchaient la nécessité de sauvegarder, de défendre la « patrie » bourgeoise contre les « barbares prussiens » ; ils appuyaient la politique d’ « union sacrée » et aidaient ainsi le gouvernement du tsar russe à faire la guerre, comme les social-démocrates allemands aidaient le gouvernement du kaiser à faire la guerre aux « barbares de Russie ».
Seul, le Parti bolchévik demeura fidèle au glorieux drapeau de l’internationalisme révolutionnaire ; seul, il resta fermement attaché aux positions marxistes de lutte résolue contre l’autocratie tsariste, contre les propriétaires fonciers et les capitalistes, contre la guerre impérialiste. Le Parti bolchévik, dès l’ouverture des hostilités, s’en tint à ce point de vue que la guerre avait été déclenchée, non pour défendre la patrie, mais pour s’emparer des territoires d’autrui, pour piller les autres peuples dans l’intérêt des propriétaires fonciers et des capitalistes, en sorte que les ouvriers devaient résolument faire la guerre à cette guerre.
La classe ouvrière soutenait le Parti bolchévik.
À la vérité, l’ivresse patriotique de la bourgeoisie, qui, au début de la guerre avait gagné les intellectuels et les éléments koulaks de la paysannerie, avaient également touché une certaine partie des ouvriers. Mais c’étaient surtout des membres de l’ « Union du peuple russe » — union de fripouilles – et une partie des ouvriers à tendances socialistes-révolutionnaires et menchéviques. Il est évident qu’ils ne traduisaient pas et ne pouvaient pas traduire l’état d’esprit de la classe ouvrière. Ce sont ces éléments là qui participaient aux manifestations chauvines de la bourgeoisie, organisées par le gouvernement tsariste dans les premiers jours de la guerre.
2. Les partis de la IIe Internationale se placent aux côtés de leurs gouvernements impérialistes respectifs. La IIe Internationale se désagrège en partis social-chauvins séparés.
Lénine avait plus d’une fois mis en garde contre l’opportunisme de la IIe internationale et la carence de ses chefs. Il répétait sans cesse que les chefs de la IIe internationale n’étaient contre la guerre qu’en paroles ; qu’au cas où la guerre éclaterait, ils pourraient bien abandonner leurs positions et se ranger aux côtés de la bourgeoisie impérialiste ; qu’ils pourraient devenir partisans de la guerre. Cette prévision de Lénine se confirma dès le début des hostilités.
En 1910, le congrès de la IIe internationale tenu à Copenhague avait décidé que les socialistes, dans les parlements, voteraient contre les crédits de guerre. Pendant la guerre des Balkans, en 1912, le congrès de la IIeinternationale, tenu à Bâle, avait proclamé que les ouvriers de tous les pays regardaient comme un crime de s’entre-tuer à seule fin d’augmenter les profits des capitalistes. Telle était la position prise en paroles, dans les résolutions.
Mais lorsque éclata le coup de tonnerre de la guerre impérialiste et qu’il fallut appliquer les décisions, les chefs de la IIe internationale s’avérèrent des félons, des traîtres au prolétariat, des serviteurs de la bourgeoisie ; ils devinrent partisans de la guerre.
Le 4 août 1914, la social-démocratie allemande vota au parlement les crédits de guerre, le soutien de la guerre impérialiste. L’immense majorité des socialistes de France, d’Angleterre, de Belgique et des autres pays en fit autant.
La IIe internationale avait cessé d’exister. En fait, elle s’était désagrégée en partis social-chauvins séparés, qui se faisaient mutuellement la guerre.
Traîtres au prolétariat, les chefs des partis socialistes passèrent sur les positions du social-chauvinisme et de la défense de la bourgeoisie impérialiste. Ils aidèrent les gouvernements impérialistes à duper la classe ouvrière, à l’intoxiquer du poison du nationalisme. Sous le drapeau de la défense de la patrie, ces social-traîtres excitèrent les ouvriers allemands contre les ouvriers français, les ouvriers français et anglais contre les ouvriers allemands. Il n’y eût qu’une minorité infime de la IIe internationale qui resta fidèle aux positions internationalistes et marcha contre le courant, certes sans assez d’assurance, sans beaucoup de détermination, mais néanmoins contre le courant.
Seul le Parti bolchévik avait, du premier coup et sans hésiter, levé le drapeau d’une lutte décidée contre la guerre impérialiste. Dans les thèses sur la guerre que Lénine rédigea à l’automne de 1914, il indiqua que l’effondrement de la IIe internationale n’était pas un effet du hasard.
La IIe internationale devait sa perte aux opportunistes, contre lesquels les meilleurs représentants du prolétariat révolutionnaire avaient depuis longtemps mis en garde.
Les partis de la IIe internationale étaient, dès avant la guerre, atteints d’opportunisme. Les opportunistes prêchaient ouvertement l’abandon de la lutte révolutionnaire, ils prêchaient la théorie de l’ « intégration pacifique du capitalisme dans le socialisme ». La IIe internationale se refusait à combattre l’opportunisme ; elle était pour faire la paix avec lui et elle le laissait se fortifier. En pratiquant une politique de conciliation à l’égard de l’opportunisme, la IIe internationale était devenue elle-même opportuniste.
Avec les profits qu’elle tirait de ses colonies, de l’exploitation des pays arriérés, la bourgeoisie impérialiste achetait systématiquement, grâce à des salaires plus élevés et autres aumônes, les couches supérieures des ouvriers qualifiés, l’aristocratie ouvrière, comme on les appelait.
C’est de cette catégorie d’ouvriers qu’étaient sortis maints dirigeants des syndicats et des coopératives, maint conseillers municipaux et parlementaires, maint employés de la presse et des organisations social-démocrates. Au moment de la guerre, ces gens, par crainte de perdre leur situation, deviennent des adversaires de la révolution, les défenseurs les plus enragés de leur bourgeoisie, de leurs gouvernements impérialistes.
Les opportunistes s’étaient transformés en social-chauvins. Ces derniers, y compris les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires russes, prêchaient la paix sociale entre ouvriers et bourgeois à l’intérieur du pays, et la guerre contre les autres peuples, hors de leur pays.
Non moins dangereux pour la cause du prolétariat étaient les social-chauvins masqués, dits centristes. Les centristes, — Kautsky, Trotski, Martov et autres, — justifiaient et défendaient les social-chauvins déclarés, c’est-à-dire qu’avec les social-chauvins ils trahissaient le prolétariat, en couvrant leur trahison de phrases gauchistes sur la lutte contre la guerre, phrases destinées à abuser la classe ouvrière.
De fait, les centristes appuyaient la guerre, puisque leur proposition de ne pas voter contre les crédits de guerre et de s’abstenir revenait à soutenir la guerre. Tout comme les social-chauvins, ils exigeaient l’abandon de la lutte de classe pendant la guerre, pour ne pas gêner leurs gouvernements impérialistes respectifs dans la conduite de la guerre. Sur toutes les questions importantes de la guerre et du socialisme, le centriste Trotski était contre Lénine, contre le parti bolchévik.
Dès l’ouverture des hostilités, Lénine avait commencé à rassembler les forces pour créer une nouvelle Internationale, la IIIe internationale. Déjà dans le manifeste lancé contre la guerre en novembre 1914, le Comité central du Parti bolchévik avait posé la tâche de créer une IIIe internationale à la place de la IIe internationale qui avait honteusement fait faillite.
En février 1915, à Londres, le camarade Litvinov, mandaté par Lénine, prit la parole à la conférence des socialistes des pays de l’Entente. Litvinov demanda la sortie des socialistes (Vandervelde, Sembat, Guesde) des gouvernements bourgeois de Belgique et de France, la rupture complète avec les impérialistes, le refus de collaborer avec eux. Il demanda à tous les socialistes de lutter résolument contre leurs gouvernements impérialistes et de réprouver le vote des crédits de guerre. Mais à cette conférence, la voix de Litvinov retentit solitaire.
Au début de septembre 1915, une première conférence des internationalistes se réunit à Zimmerwald. Lénine a qualifié cette conférence de « premier pas » dans la voie du développement du mouvement internationaliste contre la guerre. Lénine y constitua la gauche de Zimmerwald. Mais dans cette gauche zimmerwaldienne, seul le Parti bolchévik, avec Lénine en tête, occupait une position juste contre la guerre, une position allant jusqu’au bout de ses conséquences. La gauche de Zimmerwald publia en langue allemande la revue l’Avant-coureur, où étaient insérés les articles de Lénine.
En 1916, on réussit à convoquer dans le village de Kienthal, en Suisse, une deuxième conférence des internationalistes. Elle est connue sous le nom de deuxième conférence de Zimmerwald. À ce moment, des groupes d’internationalistes étaient apparus dans presque tous les pays ; la séparation des éléments internationalistes d’avec les social-chauvins s’était précisée. Mais l’essentiel, c’est que les masses elles-mêmes avaient à l’époque évolué à gauche sous l’influence de la guerre et des malheurs qu’elle engendrait. Le manifeste de Kienthal fut le résultat d’un accord entre les différents groupes qui s’étaient affrontés à la conférence. Il marqua un pas en avant par rapport au manifeste de Zimmerwald.
Mais la conférence de Kienthal, elle non plus, n’avait pas adopté les principes fondamentaux de la politique bolchévique : transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, défaite des gouvernements impérialistes respectifs dans la guerre, constitution d’une IIIe internationale. Toutefois, la conférence de Kienthal contribua à dégager les éléments internationalistes qui plus tard devaient former la IIIe internationale, l’Internationale communiste.
Lénine critiqua les erreurs des internationalistes inconséquents, social-démocrates de gauche, comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht ; mais il les aida en même temps à adopter une position juste.
3. La théorie et la tactique du Parti bolchévik dans les questions de la guerre, de la paix et de la révolution.
Les bolchéviks n’étaient pas de simples pacifistes, soupirant après la paix et se bornant à faire de la propagande en sa faveur, comme la majorité des social-démocrates de gauche. Les bolchéviks s’affirmaient pour une lutte révolutionnaire active en faveur de la paix, allant jusqu’à renverser le pouvoir de la belliqueuse bourgeoisie impérialiste. Ils rattachaient la cause de la paix à celle dé la victoire de la révolution prolétarienne, estimant que le plus sûr moyen de liquider la guerre et d’obtenir une paix équitable, une paix sans annexions ni contributions, était de renverser le pouvoir de la bourgeoisie impérialiste.
Contre le reniement menchévik et socialiste-révolutionnaire de la révolution, et contre le mot d’ordre de trahison appelant au respect de l’ « union sacrée » pendant la guerre, les bolchéviks formulèrent le mot d’ordre de « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ». Ce mot d’ordre signifiait que les travailleurs, y compris les ouvriers et les paysans armés et revêtus de la capote de soldat, devaient tourner leurs armes contre leur propre bourgeoisie et renverser son pouvoir, s’ils voulaient se débarrasser de la guerre et obtenir une paix équitable.
Contre la politique menchévique et socialiste-révolutionnaire de défense de la patrie bourgeoise, les bolchéviks préconisèrent la politique de « défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste ». Cela voulait dire qu’on devait voter contre les crédits de guerre, créer des organisations révolutionnaires illégales dans l’armée, encourager la fraternisation des soldats sur le front et organiser l’action révolutionnaire des ouvriers et des paysans contre la guerre, en transformant cette action en insurrection contre son gouvernement impérialiste.
Les bolchéviks estimaient que le moindre mal pour le peuple, dans la guerre impérialiste, serait la défaite militaire du gouvernement tsariste, puisqu’elle faciliterait la victoire du peuple sur le tsarisme et la lutte victorieuse de la classe ouvrière pour son affranchissement de l’esclavage capitaliste et des guerres impérialistes. Lénine estimait au surplus que ce n’étaient pas seulement les révolutionnaires russes, mais aussi les partis révolutionnaires de la classe ouvrière de tous les pays belligérants qui devaient pratiquer la politique de défaite de leur gouvernement impérialiste.
Les bolchéviks n’étaient pas contre toute guerre. Ils étaient seulement contre la guerre de conquête, contre la guerre Impérialiste. Les bolchéviks estimaient qu’il y a deux genres de guerres :
a) La guerre juste, non annexionniste, émancipatrice, ayant pour but soit de défendre le peuple contre une agression du dehors et contre les tentatives de l’asservir, soit d’affranchir le peuple de l’esclavage capitaliste, soit enfin de libérer les colonies et les pays dépendants du joug des impérialistes.
b) La guerre injuste, annexionniste, ayant pour but de conquérir et d’asservir les autres pays, les autres peuples.
Les bolchéviks soutenaient la guerre du premier genre. En ce qui concerne l’autre guerre, les bolchéviks estimaient qu’on devait diriger contre elle une lutte résolue, allant jusqu’à la révolution et au renversement de son gouvernement impérialiste. Les ouvrages théoriques composés par Lénine du temps de la guerre eurent une énorme importance pour la classe ouvrière du monde entier. C’est au printemps de 1916 qu’il écrivit son Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Lénine montra dans ce livre que l’impérialisme est le stade suprême du capitalisme, le stade où celui-ci, de capitalisme « progressif » qu’il était, s’est déjà transformé en capitalisme parasitaire, en capitalisme pourrissant ; que l’impérialisme est un capitalisme agonisant.
Cela ne voulait point dire, bien entendu, que le capitalisme disparaîtrait de lui-même, sans une révolution du prolétariat ; que de lui-même, il achèverait de pourrir sur pied. Lénine a toujours enseigné que sans une révolution accomplie par la classe ouvrière, il est impossible de renverser le capitalisme. C’est pourquoi, après avoir défini l’impérialisme comme un capitalisme agonisant, Lénine montrait en même temps dans son ouvrage que « l’impérialisme est la veille de la révolution sociale du prolétariat ».
Lénine montrait que l’oppression capitaliste, à l’époque de l’impérialisme, allait se renforçant ; que dans les conditions de l’impérialisme, l’indignation du prolétariat augmentait sans cesse contre les bases du capitalisme ; que les éléments d’une explosion révolutionnaire se multipliaient au sein des pays capitalistes. Lénine montrait qu’à l’époque de l’impérialisme la crise révolutionnaire s’aggrave dans les pays coloniaux et dépendants ; que l’indignation s’accroît contre l’impérialisme ; que les facteurs d’une guerre libératrice contre l’impérialisme s’accumulent. Lénine montrait que dans les conditions de l’impérialisme, l’inégalité du développement et les contradictions du capitalisme s’aggravent particulièrement ; que la lutte pour les marchés d’exportation des marchandises et des capitaux, la lutte pour les colonies, pour les sources de matières premières, rend inévitables les guerres impérialistes périodiques en vue d’un nouveau partage du monde.
Lénine montrait que justement par suite de ce développement inégal du capitalisme, des guerres impérialistes éclatent qui débilitent les forces de l’impérialisme et rendent possible la rupture du front de l’impérialisme là où il se révèle le plus faible.
Partant de ce point de vue, Lénine en arrivait à conclure que la rupture du front impérialiste par le prolétariat était parfaitement possible en un ou plusieurs points ; que la victoire du socialisme était possible d’abord dans un petit nombre de pays ou même dans un seul pays pris à part ; que la victoire simultanée du socialisme dans tous les pays, en raison du développement inégal du capitalisme, était impossible ; que le socialisme vaincrait d’abord dans un seul ou dans plusieurs pays tandis que les autres pays resteraient, pendant un certain temps, des pays bourgeois.
Voici la formule de cette conclusion géniale, telle que Lénine la donna dans deux articles du temps de la guerre impérialiste :
1° « L’inégalité du développement économique et politique est une loi absolue du capitalisme. I1 s’ensuit que la victoire du socialisme est possible au début dans un petit nombre de pays capitalistes ou même dans un seul pays capitaliste pris à part. Le prolétariat victorieux de ce pays, après avoir exproprié les capitalistes et organisé chez lui la production socialiste, se dresserait contre le reste du monde, capitaliste, en attirant à lui les classes opprimées des autres pays. .. » (Extrait de l’article « Du mot d’ordre des États-Unis d’Europe », août 1915. Lénine, Œuvres choisies, t. I, p. 755.)
2° « Le développement du capitalisme se fait d’une façon extrêmement inégale dans les différents pays. Au reste il ne saurait en être autrement sous le régime de la production marchande. D’où cette conclusion qui s’impose : le socialisme ne peut vaincre simultanément dans tous les pays. Il vaincra d’abord dans un seul ou dans plusieurs pays, tandis que les autres resteront pendant un certain temps des pays bourgeois ou pré-bourgeois. Cette situation donnera lieu non seulement à des frottements, mais à une tendance directe de la bourgeoisie des autres pays à écraser le prolétariat victorieux de l’État socialiste. Dans ces cas-là, la guerre de notre part serait légitime et juste. Ce serait une guerre pour le socialisme, pour l’affranchissement des autres peuples du joug de la bourgeoisie. » (Extrait de l’article : « Le programme militaire de la révolution prolétarienne », automne 1916. Lénine, Œuvres choisies, t. I, p. 888.)
Il y avait là une théorie nouvelle, une théorie achevée sur la révolution socialiste, sur la possibilité de la victoire du socialisme dans un pays pris à part, sur les conditions de sa victoire, sur les perspectives de sa victoire, — théorie dont les fondements avaient été définis par Lénine, dès 1905, dans sa brochure Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique.
Elle différait foncièrement de la conception répandue dans la période du capitalisme pré-impérialiste parmi les marxistes, au temps où ceux-ci estimaient que la victoire du socialisme était impossible dans un seul pays, que le socialisme triompherait simultanément dans tous les pays civilisés. C’est en partant des données relatives au capitalisme impérialiste, exposées dans son remarquable ouvrage L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, que Lénine renversait cette conception comme périmée ; il formulait une nouvelle conception théorique d’après laquelle la victoire simultanée du socialisme dans tous les pays était jugée impossible, tandis que la victoire du socialisme dans un seul pays capitaliste pris à part était reconnue possible.
Ce qui fait la valeur inappréciable de la théorie de Lénine sur la révolution socialiste, ce n’est pas seulement qu’elle a enrichi le marxisme d’une théorie nouvelle et qu’elle l’a fait progresser. Ce qui fait sa valeur, c’est encore qu’elle donne une perspective révolutionnaire aux prolétaires des différents pays ; qu’elle stimule leur initiative pour livrer assaut à leur bourgeoisie nationale ; elle leur apprend à utiliser les circonstances de guerre pour organiser cet assaut et affermit leur foi en la victoire de la révolution prolétarienne.
Telle était la conception théorique et tactique des bolchéviks dans les questions de guerre, de paix et de révolution. C’est en se basant sur cette conception que les bolchéviks faisaient leur travail pratique en Russie.
Malgré les féroces persécutions policières, les députés bolchéviks à la Douma, Badaev, Pétrovski, Mouranov, Samoïlov, Chagov, s’étaient mis, au début de la guerre, à faire le tour d’une série d’organisations pour y exposer l’attitude des bolchéviks devant la guerre et la révolution. En novembre 1914, la fraction bolchévique de la Douma d’État se réunit pour discuter de l’attitude à observer à l’égard de la guerre. Au troisième jour, l’ensemble des participants de la réunion furent arrêtés. Le tribunal condamna tous les députés à la perte des droits civiques et à la déportation en Sibérie orientale. Le gouvernement tsariste accusait de « haute trahison » les députés bolchéviks de la Douma d’État.
Le procès révéla l’activité qui avait été déployée par les députés de la Douma et qui faisait honneur à notre Parti. Les députés bolchéviks eurent une attitude courageuse devant le tribunal tsariste, dont ils se firent une tribune pour dénoncer la politique de conquête du tsarisme. Tout autre fut la conduite de Kaménev, impliqué dans la même affaire. Au premier danger, il renia par lâcheté la politique du Parti bolchévik. Kaménev proclama au procès son désaccord avec les bolchéviks dans la question de la guerre ; il demanda, pour preuve, à faire citer le menchévik Iordanski comme témoin.
Les bolchéviks firent un gros travail dirigé contre les comités des industries de guerre, contre les tentatives des menchéviks de soumettre les ouvriers à l’influence de la bourgeoisie impérialiste. La bourgeoisie avait un intérêt vital à présenter aux yeux de tout le monde la guerre impérialiste comme l’affaire du peuple entier. Pendant la guerre, elle avait pris une grande influence sur les affaires de l’État en créant sa propre organisation nationale, les unions des zemstvos et des villes. Il lui restait à soumettre les ouvriers à sa direction et à son influence.
La bourgeoisie imagina un bon moyen pour y parvenir : la création de « groupes ouvriers » près les comités des industries de guerre. Les menchéviks s’emparèrent de cette idée de la bourgeoisie.
Les bourgeois avaient intérêt à faire participer à ces comités des industries de guerre les représentants des ouvriers, afin qu’ils fissent de 1’agitation parmi les niasses ouvrières pour affirmer la nécessité d’intensifier la productivité du travail dans les fabriques d’obus, de canons, de fusils, de cartouches, et autres entreprises travaillant pour la défense.
« Tout pour la guerre, tout en vue de la guerre », tel était le mot d’ordre de la bourgeoisie. Mot d’ordre qui signifiait en réalité : « Enrichis-toi tant que tu pourras dans les fournitures de guerre et l’annexion des territoires d’autrui ! » Les menchéviks prirent une part active à cette entreprise pseudo-patriotique de la bourgeoisie. Se faisant les auxiliaires des capitalistes, ils engageaient vivement les ouvriers à participer à l’élection des « groupes ouvriers ». Les bolchéviks étaient contre cette entreprise. Ils préconisaient le boycottage des comités des industries de guerre et ils réalisèrent ce boycottage avec succès.
Une partie des ouvriers s’associa pourtant aux travaux de ces comités, sous la direction du menchévik notoire Gvozdev et de l’agent provocateur Abrossimov. Lorsque, en septembre 1915, les mandataires des ouvriers se réunirent pour procéder à l’élection définitive des « groupes ouvriers » des comités des industries de guerre, il se trouva que la plupart des mandataires étaient contre la participation à ces comités.
Dans leur majorité, les représentants des ouvriers adoptèrent une résolution condamnant nettement la participation aux comités des industries de guerre et déclarèrent que les ouvriers s’assignaient comme tâche de lutter pour la paix, pour le renversement du tsarisme.
Un important travail fut également accompli par les bolchéviks dans l’armée et dans la flotte. Ils dénonçaient aux masses de soldats et de matelots les responsables des atrocités de la guerre et des souffrances inouïes du peuple ; ils expliquaient que la révolution était pour le peuple le seul moyen de s’arracher à la boucherie impérialiste. Les bolchéviks créaient des cellules dans l’armée et dans la flotte, sur les fronts et dans les formations de l’arrière ; ils diffusaient des appels contre la guerre.
À Cronstadt, les bolchéviks constituèrent le « Groupe central de l’organisation militaire de Cronstadt », étroitement rattaché au Comité de Pétrograd du Parti. Une organisation militaire fut créée auprès du Comité de Pétrograd du Parti pour le travail parmi les troupes de la garnison. En août 1916, le chef de l’Okhrana de Pétrograd fit un rapport où on lit : « Dans le Groupe de Cronstadt, le travail est organisé très sérieusement, clandestinement ; les participants sont tous des gens silencieux et circonspects. Ce groupe a aussi des représentants à terre. »
Le Parti faisait de l’agitation au front pour la fraternisation entre les soldats des armées belligérantes ; il soulignait que l’ennemi était la bourgeoisie mondiale et qu’on ne pouvail terminer la guerre impérialiste qu’en la transformant en guerre civile, en tournant les armes contre sa propre bourgeoisie et son gouvernement. On voyait se multiplier les cas où telle ou telle formation militaire refusait de monter à l’attaque.
Des faits de ce genre se produisirent en 1915, et surtout en 1916. Les bolchéviks firent un travail particulièrement important dans les armées du front Nord, qui étaient cantonnées dans les Provinces baltiques. Au début de 1917, le général Rouzski, commandant en chef de l’armée du front nord, fit un rapport à ses chefs hiérarchiques sur l’intense activité révolutionnaire déployée sur ce front par les bolchéviks.
La guerre marquait un tournant considérable dans la vie des peuples, dans la vie de la classe ouvrière mondiale.
Elle avait mis en jeu les destinées des États, le sort des peuples et du mouvement socialiste. Aussi fut-elle en même temps une pierre de touche, une épreuve pour tous les partis et fous les courants qui se disaient socialistes. Ces partis et ces courants resteraient-ils fidèles à la cause du socialisme, à la cause de l’internationalisme, ou préféreraient-ils trahir la classe ouvrière, rouler leurs drapeaux et les jeter aux pieds de leur bourgeoisie nationale ? Voila comment la question se posait.
La guerre montra que les partis de la IIe Internationale n’avaient pu résister à l’épreuve, qu’ils avaient trahi la classe ouvrière et incliné leurs drapeaux devant leur bourgeoisie nationale, leur bourgeoisie impérialiste. Au reste, comment ces partis auraient-ils pu agir autrement, eux qui cultivaient dans leur sein l’opportunisme et étaient éduqués dans l’esprit des concessions aux opportunistes, aux nationalistes ? La guerre montra que seul le Parti bolchévik passait l’épreuve avec honneur et demeurait fidèle jusqu’au bout à la cause du socialisme, à la cause de l’internationalisme prolétarien.
Et cela se conçoit : seul un parti d’un type nouveau, seul un parti éduqué dans l’esprit d’une lutte intransigeante contre l’opportunisme, seul un parti affranchi de l’opportunisme et du nationalisme, seul un tel parti pouvait passer la grande épreuve et demeurer fidèle à la cause de la classe ouvrière, à la cause du socialisme et de l’internationalisme. Ce parti-là, c’était le Parti bolchévik.
4. Défaite de l’armée tsariste sur le front. Ruine économique. Crise du tsarisme.
La guerre durait depuis trois ans. Elle emportait des millions de vies humaines : tués, blessés, victimes des épidémies qu’elle avait engendrées. La bourgeoisie et les propriétaires fonciers s’enrichissaient tandis que les ouvriers et les paysans souffraient de plus en plus de la misère et des privations. La guerre délabrait l’économie nationale de la Russie. Environ 14 millions de travailleurs valides avaient été incorporés à l’armée, retirés de la production ; fabriques et usines s’arrêtaient. La surface des emblavures diminuait : on manquait de bras. La population et les soldats du front étaient affamés, sans chaussures et sans vêtements. La guerre engloutissait toutes les ressources du pays.
L’armée tsariste essuyait défaite sur défaite. L’artillerie allemande faisait pleuvoir une grêle d’obus sur les troupes tsaristes qui, elles, manquaient de canons, d’obus, voire même de fusils. Il y arrivait qu’il n’y eût qu’un fusil pour trois hommes.
En pleine guerre, on avait découvert la trahison du ministre de la guerre Soukhomlinov, qui avait des intelligences avec les espions allemands. Soukhomlinov, exécutant les ordres qu’il recevait des services d’espionnage allemands, sabotait le ravitaillement du front en munitions, laissait le front sans canons et sans fusils.
Plusieurs ministres et généraux du tsar contribuaient en sous-main aux succès de l’armée allemande ; de concert avec la tsarine, qui avait des attaches chez les allemands, ils leur livraient les secrets militaires. Rien d’étonnant que l’armée tsariste essuyât des défaites et fût obligée de reculer. Vers 1916, les Allemands s’étaient déjà emparés de la Pologne et d’une partie des Provinces baltiques.
Tous ces faits provoquaient la haine et la colère des ouvriers, des paysans, des soldats et des intellectuels contre le gouvernement tsariste ; ils renforçaient et aggravaient le mouvement révolutionnaire des masses du peuple contre la guerre, contre le tsarisme, tant à l’arrière que sur le front, tant au centre qu’à la périphérie.
Le mécontentement avait aussi gagné la bourgeoisie impérialiste russe. Ce qui l’irritait, c’était de voir qu’à la cour impériale régnaient en maître des aigrefins dans le genre de Raspoutine, qui visaient manifestement à faire signer une paix séparée avec les Allemands. Elle se persuadait de plus en plus que le gouvernement tsariste était incapable de mener la guerre à la victoire. Elle craignait que le tsarisme, pour sauver sa situation, n’acceptât une paix séparée avec les Allemands.
Aussi la bourgeoisie russe avait-elle décidé de faire une révolution de palais, afin de déposer le tsar Nicolas II et de mettre à sa place un tsar lié à la bourgeoisie : Michael Romanov. Ce faisant, elle entendait courir deux lièvres à la fois : premièrement, se faufiler au pouvoir et assurer la continuation de la guerre impérialiste ; en second lieu, prévenir par une petite révolution de palais l’avènement de la grande révolution populaire, dont elle voyait monter la vague.
Pour cette entreprise, la bourgeoisie russe avait l’appui entier des gouvernements anglais et français. Ceux-ci se rendaient compte que le tsar était incapable de continuer la guerre. Ils redoutaient qu’il ne finît par signer une paix séparée avec les Allemands. Si le gouvernement tsariste avait conclu une paix séparée, les gouvernements d’Angleterre et de France auraient perdu, par la défection de la Russie, un allié qui non seulement attirait des forces adverses sur les fronts occupés par lui, mais fournissaient à la France des dizaines de milliers d’excellents soldats russes. Aussi prêtaient-ils leur appui à la bourgeoisie russe dans ses tentatives d’accomplir une révolution de palais.
Le tsar se trouvait ainsi isolé.
En même temps que les revers se multipliaient sur le front, la ruine économique s’aggravait. C’est dans les journées de janvier-février 1917 que la crise des denrées alimentaires, des matières premières et du combustible atteignit son point culminant, sa plus grande acuité. Il y eut arrêt presque complet des transports de vivres sur Pétrograd et sur Moscou. Les entreprises fermaient l’une après l’autre, augmentant le chômage. La situation des ouvriers était devenue particulièrement intenable. Des masses populaires de plus en plus profondes arrivaient à la conviction qu’il n’y avait qu’une seule issue à cette situation intolérable : renverser l’autocratie tsariste.
Le tsarisme traversait manifestement une crise mortelle.
La bourgeoisie croyait pouvoir régler la crise par une révolution de palais.
Mais le peuple la régla à sa manière.
5. La révolution de Février. Chute du tsarisme. Formation des Soviets de députés ouvriers et soldats. Formation du gouvernement provisoire. Dualité des pouvoirs.
L’année 1917 débuta par la grève du 9 Janvier. Au cours de cette grève des manifestations se déroulèrent à Pétrograd, Moscou, Bakou, Nijni-Novgorod. A noter que le 9 janvier, à Moscou, près d’un tiers de tous les ouvriers prirent part à la grève. Une manifestation de deux mille personnes sur le boulevard Tverskoï fut dispersée par la police montée. Sur la chaussée de Vyborg, à Pétrograd, les soldats firent cause commune avec les manifestants. La police de Pétrograd écrivait dans son rapport : « L’idée de la grève générale rallie de jour en jour de nouveaux partisans ; elle devient populaire comme elle le fut en 1905. »
Les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires s’appliquaient à faire entrer le mouvement révolutionnaire qui s’amorçait, dans le cadre voulu par la bourgeoisie libérale. Au 14 février, lors de l’ouverture de la Douma d’État, les menchéviks proposèrent d’organiser un cortège des ouvriers dans la direction de la Douma. Mais les masses ouvrières suivirent les bolchéviks : au lieu d’aller à la Douma, elles s’en furent manifester. Le 18 février 1917 éclata à Pétrograd la grève de l’usine Poutilov. Le 22 février, les ouvriers de la plupart des grandes entreprises se joignirent au mouvement.
Le 23 février (8 mars), Journée internationale des femmes, à l’appel du Comité bolchévik de Pétrograd, les ouvrières descendirent dans la rue pour manifester contre la famine, la guerre le tsarisme. Cette manifestation fut soutenue par l’action gréviste générale des ouvriers de Pétrograd. La grève politique commença à se transformer en une manifestation politique générale contre le régime tsariste. Le 24 février (9 mars), la manifestation redouble de force. Cette fois, 200.000 ouvriers sont en grève.
Le 25 février (10 mars), le mouvement révolutionnaire s’étend à tous les ouvriers de Pétrograd. Les grèves politiques des différents quartiers se transforment en une grève politique générale de la ville entière. Partout, ce ne sont que manifestations et collisions avec la police. Sur les masses ouvrières flottent des drapeaux rouges portant ces mots d’ordre : « À bas le tsar ! », « À bas la guerre ! », « Du pain ! »
Dans la matinée du 26 février (11 mars), la grève politique et la manifestation commencent à se transformer en essais d’insurrection. Les ouvriers désarment la police et la gendarmerie, et ils s’arment eux-mêmes. Toutefois, la collision armée avec la police, place Znamenskaïa, se termine par la fusillade de la manifestation. Le général Khabalov, commandant de la région militaire de Pétrograd, signifie aux ouvriers d’avoir à reprendre le travail le 28 février (13 mars), sinon ils seront envoyés au front. Le 25 février (10 mars), le tsar mande au général Khabalov : « J’ordonne de faire cesser dès demain les désordres dans la capitale. »
Mais il n’était plus possible de « faire cesser » la révolution !
Dans la journée du 26 février (11 mars), la 4° compagnie du bataillon de réserve du régiment Pavlovski ouvre le feu, non sur les ouvriers, mais sur les détachements de police montée qui échangeaient des coups de feu avec les ouvriers. La lutte pour l’armée se déploya, énergique et opiniâtre, notamment du côté des ouvrières, qui faisaient directement appel aux soldats, fraternisaient avec eux, les exhortaient à aider le peuple à renverser l’autocratie tsariste exécrée. L’action pratique du Parti bolchévik était dirigée par le Bureau du Comité central de notre Parti, qui se trouvait alors à Pétrograd, avec le camarade Mololov en tête.
Le 26 février (11 mars), le Bureau du Comité central lança un manifeste qui engageait à poursuivre la lutte armée contre le tsarisme, à créer un Gouvernement révolutionnaire provisoire.
Le 27 février (12 mars), à Pétrograd, les troupes refusent de tirer sur les ouvriers et passent aux côtés du peuple insurgé. Dans la matinée, il n’y avait que 10.000 soldats insurgés ; le soir, ils étaient déjà plus de 60.000. Ouvriers et soldats soulevés procèdent à l’arrestation des ministres et des généraux tsaristes ; ils remettent en Liberté les révolutionnaires emprisonnés. Sitôt libres, les détenus politiques s’incorporent à la lutte révolutionnaire.
Dans les rues, la fusillade continuait avec les agents de police et les gendarmes, qui avaient posté des mitrailleuses dans les greniers des maisons. Mais le rapide passage de la troupe aux côtés des ouvriers décida du sort de l’autocratie tsariste. Lorsque la nouvelle de la révolution victorieuse à Pétrograd arriva dans les autres villes et sur le front, ouvriers et soldats se mirent en devoir de destituer partout les fonctionnaires tsaristes.
La révolution démocratique bourgeoise de Février triomphait.
Elle avait triomphé parce que sa promotrice avait été la classe ouvrière, qui s’était mise à la tête du mouvement des millions de paysans en capote de soldat « pour la paix, pour le pain, pour la liberté ». L’hégémonie du prolétariat avait déterminé le succès de la révolution :
« La révolution a été accomplie par le prolétariat ; c’est lui qui a fait preuve d’héroïsme, qui a versé son sang, qui a entraîné derrière lui les plus grandes masses des travailleurs et de la population pauvre… », écrivait Lénine dans les premiers jours de la révolution. (Lénine, t. XX, pp. 23-24, éd. russe.)
La première révolution de 1905 avait préparé la victoire rapide de la deuxième révolution de 1917 :
« Si le prolétariat russe n’avait pas, pendant trois ans, de 1905 à 1907, livré les plus grandes batailles de classe et déployé son énergie révolutionnaire, la deuxième révolution n’eût pas été aussi rapide, en ce sens que son étape initiale n’eût pas été achevée en quelques jours », indiqua Lénine. (Lénine, Œuvres choisies, t. I, pp. 898-899.)
Les Soviets apparurent dès les premiers jours de la révolution. La révolution victorieuse s’appuya sur les Soviets des députés ouvriers et soldats, créés par les ouvriers et les soldats insurgés. La révolution de 1905 avait montré que les Soviets étaient les organes de l’insurrection armée et en même temps l’embryon d’un pouvoir nouveau, révolutionnaire. L’idée des Soviets vivait dans la conscience des masses ouvrières, et elles la réalisèrent dès le lendemain du renversement du tsarisme, avec cette différence toutefois qu’en 1905 c’étaient des Soviets uniquement de députés ouvriers, tandis qu’on février 1917, sur l’initiative des bolchéviks, furent formés des Soviets de députés ouvriers et soldats.
Pendant que les bolchéviks assumaient la direction immédiate de la lutte des masses dans la rue, les partis de conciliation, menchéviks et socialistes-révolutionnaires, s’emparèrent des sièges de députés dans les Soviets, y établissant leur majorité.
Ce qui pour une part avait contribué à cette situation, c’est que la majorité des chefs du Parti bolchévik se trouvaient en prison ou en exil (Lénine, dans l’émigration, Staline et Sverdlov, déportés en Sibérie), alors que menchéviks et socialistes-révolutionnaires déambulaient en toute liberté dans les rues de Pétrograd C’est ainsi que les représentants des partis de conciliation, menchéviks et socialistes-révolutionnaires, se trouvèrent à la tête du Soviet de Pétrograd et de son Comité exécutif.
Il en fut de même à Moscou et dans plusieurs autres villes. C’est seulement à Ivanovo-Voznessensk, à Krasnoïarsk et dans quelques villes encore que la majorité au sein des Soviets appartint dès le début aux bolchéviks. Le peuple armé, les ouvriers et les soldats, en déléguant leurs représentants au Soviet, regardaient celui-ci comme l’organe du pouvoir populaire. Ils estimaient, ils étaient convaincus que le Soviet des députés ouvriers et soldats ferait aboutir toutes les revendications du peuple révolutionnaire, et qu’en premier lieu la paix serait conclue.
Mais la crédulité excessive des ouvriers et des soldats allait leur jouer un mauvais tour. Les socialistes-révolutionnaires et Les menchéviks ne songeaient même pas à mettre un terme à la guerre, à obtenir la paix. Ils entendaient utiliser la révolution pour continuer la guerre. Pour ce qui était de la révolution et des revendications révolutionnaires du peuple, les socialistes-révolutionnaires et les menchéviks considéraient que la révolution était terminée, qu’il s’agissait maintenant de la consolider et de s’engager dans la voie d’une coexistence « normale », constitutionnelle, avec la bourgeoisie. C’est pourquoi la direction socialiste-révolutionnaire et menchévique du Soviet de Pétrograd prit toutes les mesures qui dépendaient d’elle pour escamoter le problème de la cessation de la guerre, la question de la paix, et remettre le pouvoir à la bourgeoisie.
Le 27 février (12 mars) 1917, les députés libéraux de la Douma d’État, après s’être concertés dans la coulisse avec les leaders socialistes-révolutionnaires et menchéviks, constituèrent le Comité provisoire de la Douma d’État avec, en tête, le président de la IVe Douma Rodzianko, grand propriétaire foncier et monarchiste. Quelques jours après, le Comité provisoire et les leaders socialistes-révolutionnaires et menchéviks du Comité exécutif du Soviet des députés ouvriers et soldats s’entendirent entre eux, à l’insu des bolchéviks, pour former un nouveau gouvernement de la Russie, le Gouvernement provisoire bourgeois avec, à sa tête, le prince Lvov, dont le tsar Nicolas II, avant la révolution de Février, avait pensé faire son premier ministre.
Le Gouvernement provisoire comprenait le chef des cadets Milioukov, le chef des octobristes Goutchkov et d’autres représentants notoires de la classe des capitalistes ; le socialiste-révolutionnaire Kérenski y avait été Introduit comme représentant de la « démocratie ».
Voilà comment les leaders socialistes-révolutionnaires et menchéviks du Comité exécutif du Soviet livrèrent le pouvoir à la bourgeoisie ; le Soviet des députés ouvriers et soldats, mis au courant du fait, approuva à la majorité l’activité des leaders socialistes-révolutionnaires et menchéviks, malgré les protestations des bolchéviks. C’est ainsi que fut formé, en Russie, le nouveau pouvoir d’État, composé, comme dit Lénine, des représentants « de la bourgeoisie et des grands propriétaires fonciers embourgeoisés ».
Mais à côté du gouvernement bourgeois existait un autre pouvoir, le Soviet des députés ouvriers et soldats. Les députés soldats étaient principalement des paysans mobilisés. Le Soviet des députés ouvriers et soldats était l’organe de l’alliance des ouvriers et des paysans contre le pouvoir tsariste et, en même temps, l’organe de leur pouvoir, l’organe de la dictature de la classe ouvrière et de la paysannerie.
Il en résulta un original enchevêtrement de deux pouvoirs, de deux dictatures : la dictature de la bourgeoisie représentée par le Gouvernement provisoire et la dictature du prolétariat et de la paysannerie représentée par le Soviet des députés ouvriers et soldats.
Il y eut dualité des pouvoirs.
Comment expliquer que les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires se soient trouvés au début en majorité dans les Soviets ? Comment expliquer que les ouvriers et les paysans victorieux aient remis volontairement le pouvoir aux représentants de la bourgeoisie ?
Lénine l’expliquait par ce fait que des millions d’hommes non initiés à la politique s’étaient éveillés à la politique, s’y sentaient attirés. C’étaient pour la plupart de petits exploitants, des paysans, des ouvriers récemment venus de la campagne, des hommes qui tenaient le milieu entre la bourgeoisie et le prolétariat. La Russie était alors le pays petit-bourgeois par excellence entre les grands pays d’Europe.
Et dans ce pays, « une formidable vague petite-bourgeoise avait tout submergé, avait écrasé non seulement par son nombre, mais aussi par son idéologie, le prolétariat conscient, c’est-à-dire qu’elle avait contaminé de très larges milieux ouvriers, en leur communiquant ses conceptions petites-bourgeoises en politique ». (Lénine, Œuvres choisies, t. II, p. 21.)
C’est cette vague de l’élément petit-bourgeois qui avait fait remonter à la surface les partis petits-bourgeois : menchévik et socialiste-révolutionnaire. Lénine indiqua encore une autre raison, à savoir le changement intervenu dans la composition du prolétariat pendant la guerre, et le degré insuffisant de conscience et d’organisation du prolétariat au début de la révolution. Pendant la guerre, des changements notables s’étaient opérés dans la composition du prolétariat lui-même. Près de 40% des hommes de condition ouvrière avaient été incorporés à l’armée.
Un grand nombre de petits propriétaires, d’artisans, de boutiquiers, étrangers à la mentalité prolétarienne, s’étaient infiltrés dans les entreprises pour échapper à la mobilisation. Ce sont ces éléments petits-bourgeois du monde ouvrier qui formaient justement le terrain où s’alimentèrent les politiciens petits-bourgeois, menchéviks et socialistes-révolutionnaires.
Voilà pourquoi les grandes masses populaires non initiées à la politique, débordées par la vague de l’élément petit-bourgeois et grisées par les premiers succès de la révolution, se trouvèrent, dans les premiers mois de la révolution, sous l’emprise des partis conciliateurs ; voilà pourquoi elles consentirent à céder à la bourgeoisie le pouvoir d’État, croyant dans leur candeur que le pouvoir bourgeois ne gênerait pas l’activité des Soviets.
Une tâche s’imposait au Parti bolchévik : par un patient travail d’explication auprès des masses, dévoiler le caractère impérialiste du Gouvernement provisoire, dénoncer la trahison des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks, et montrer qu’il était impossible d’obtenir la paix à moins de remplacer le Gouvernement provisoire par le gouvernement des Soviets.
Et le Parti bolchévik s’attela à cette besogne avec la plus grande énergie.
Il reconstitue ses organes de presse légaux. Cinq jours seulement après la révolution de Février, le journal Pravda paraît à Pétrograd, et quelques jours plus tard, le Social-Démocrate à Moscou. Le Parti se met à la tête des masses qui perdent leur confiance dans la bourgeoisie libérale, leur confiance dans les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires.
Il explique patiemment aux soldats, aux paysans, la nécessité d’une action commune avec la classe ouvrière. Il leur explique que les paysans n’auront ni la paix, ni la terre, si la révolution ne continue pas à se développer, si le Gouvernement provisoire bourgeois n’est pas remplacé par le gouvernement des Soviets.
=>Retour au Précis d’histoire du
Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchévik)