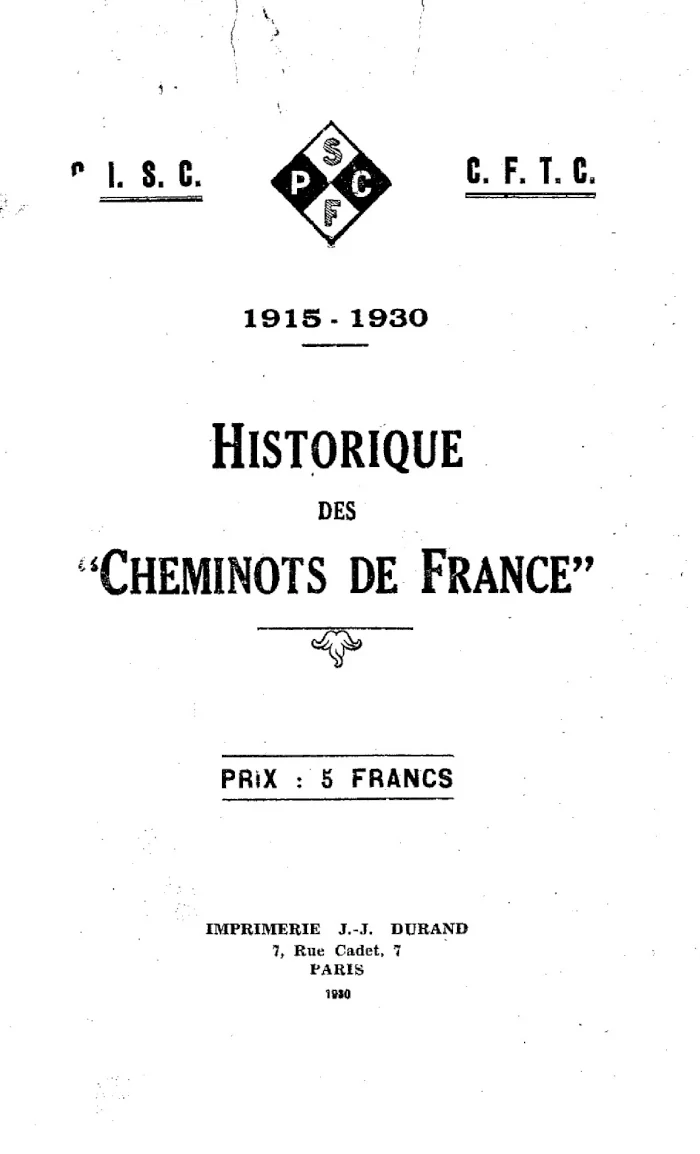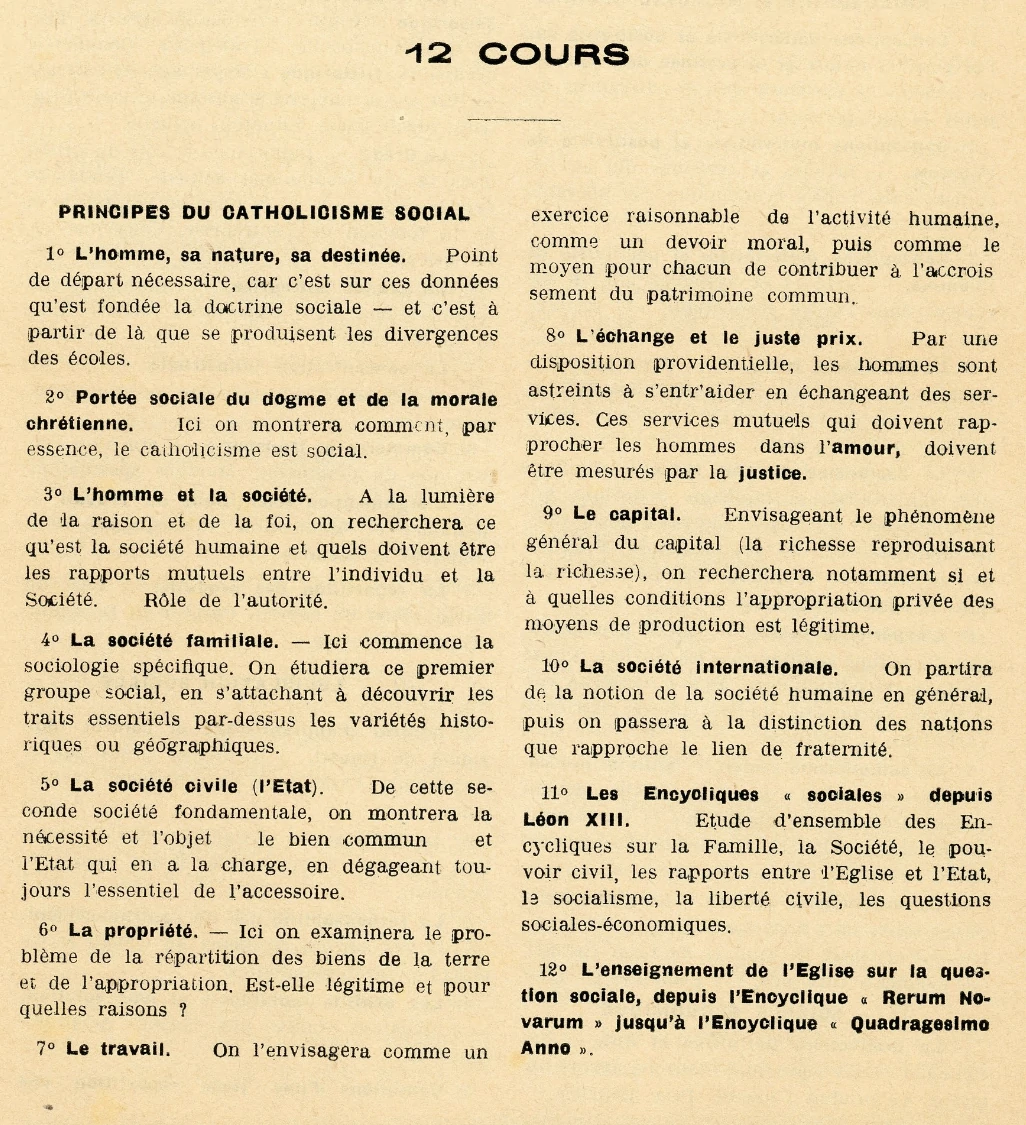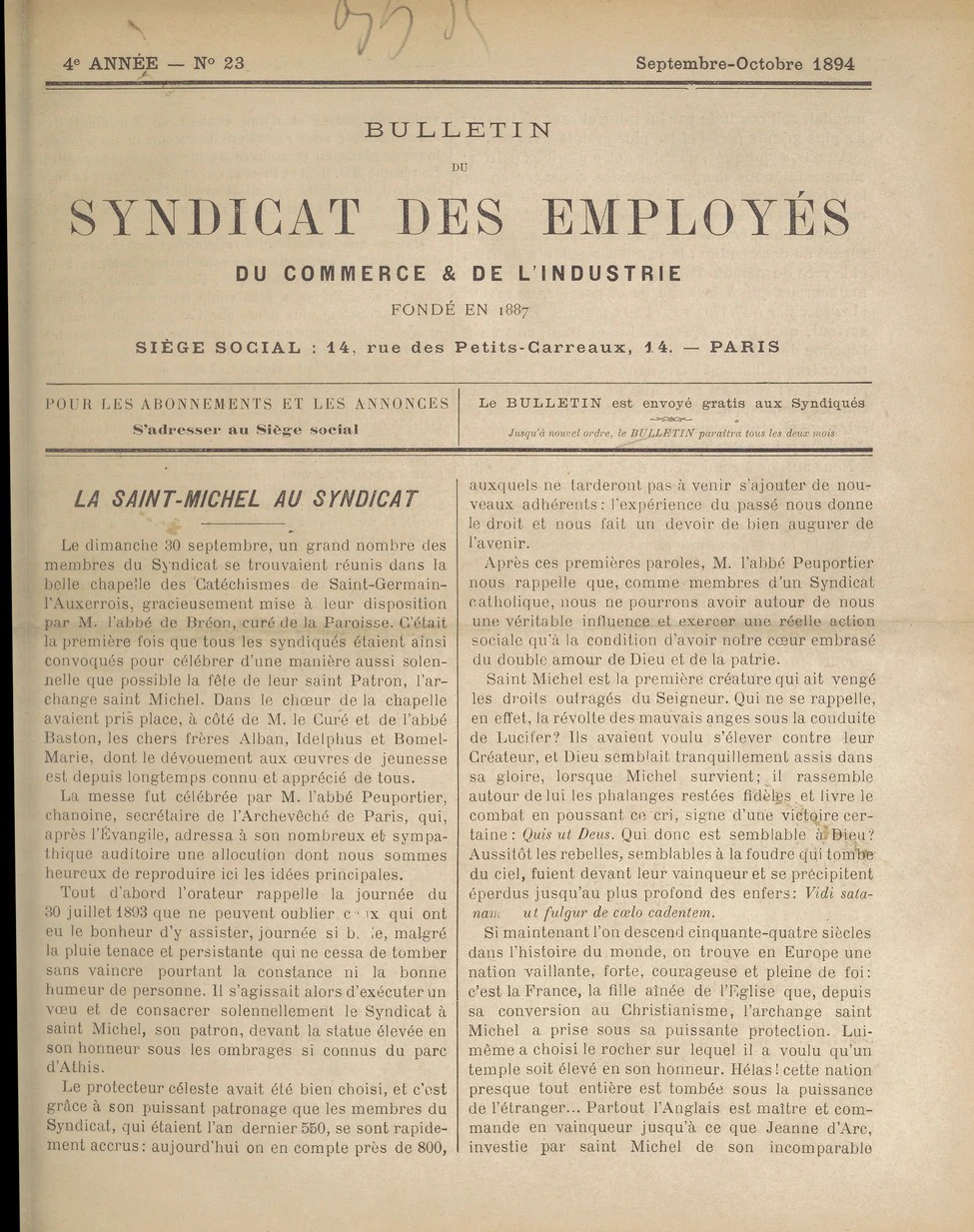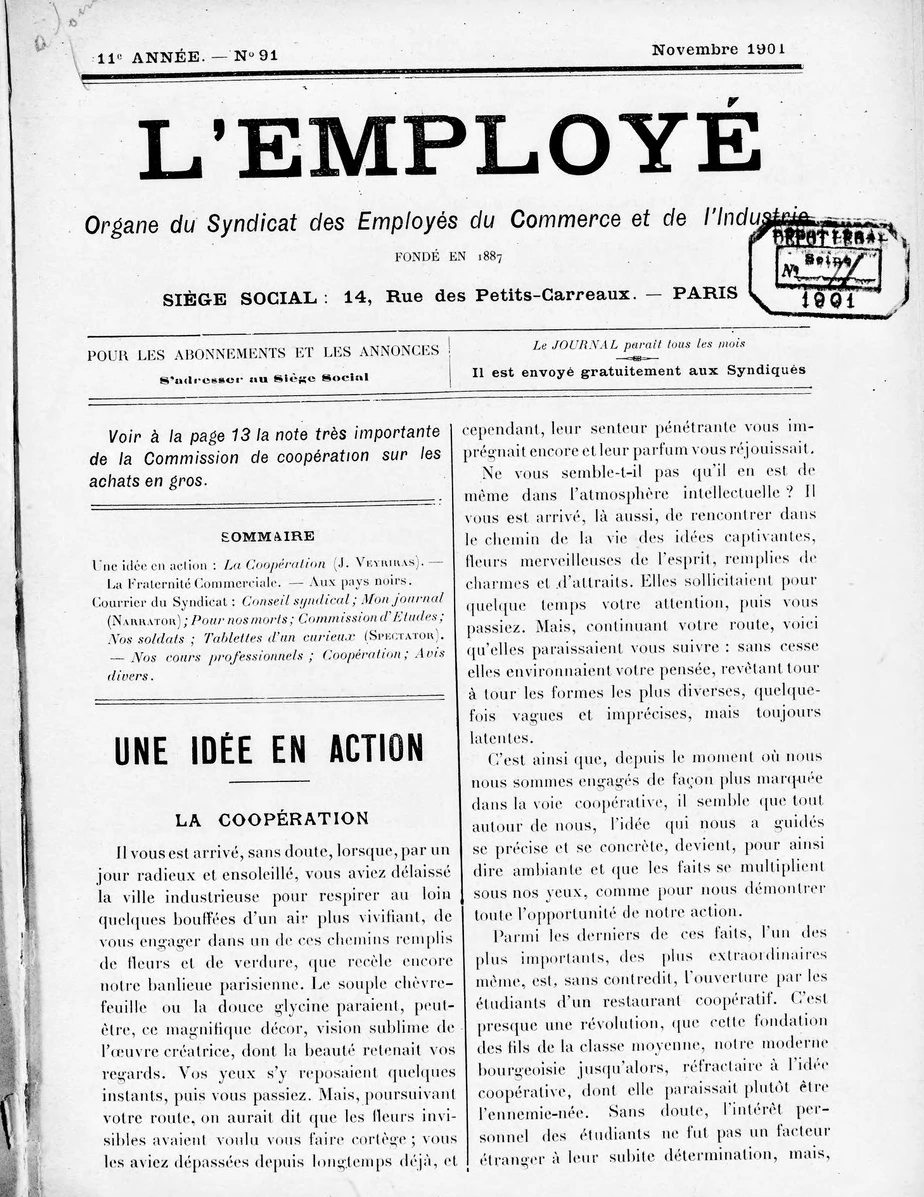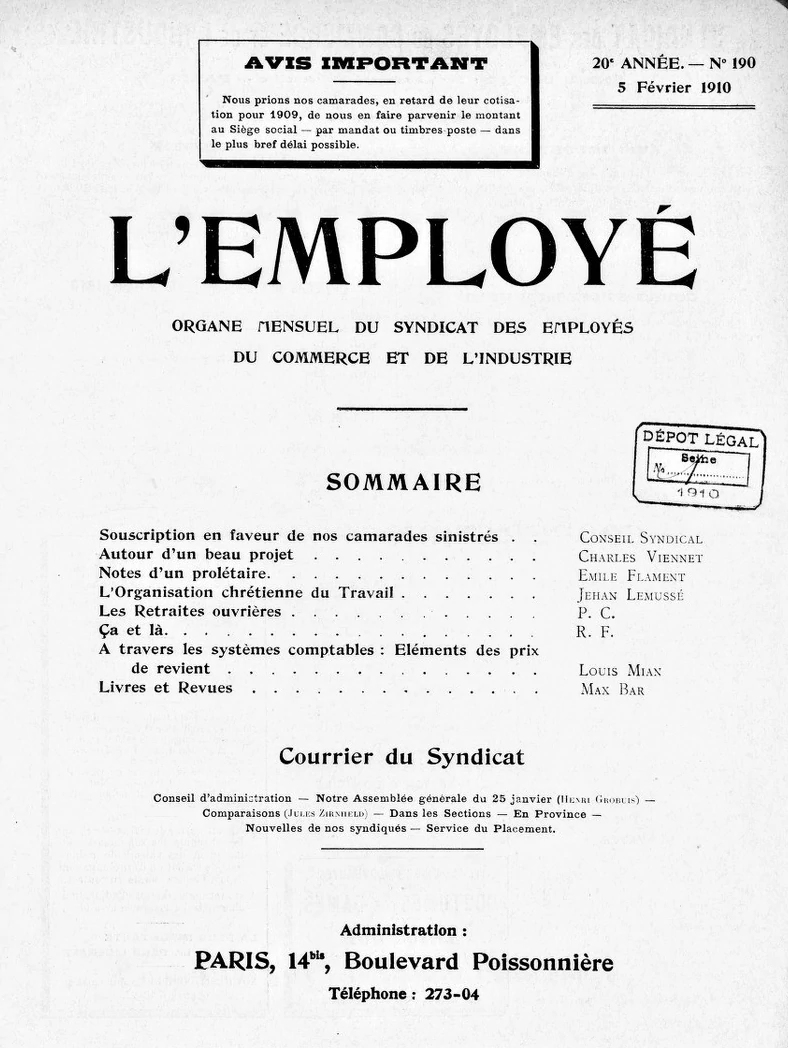La défaite face à l’Allemagne nazie amena, logiquement, la CFTC, à s’aligner sur la CGT. Cette dernière, en juillet 1940, avait éjecté les communistes et s’était empressé d’enlever de ses statuts la lutte des classes et l’abolition du salariat.
Des discussions CGT-CFTC se développèrent alors, aboutissant à une réaction commune à leur dissolution par l’État en août 1940.
Cette réaction, dénommée le « Manifeste des douze » en raison des douze auteurs (9 CGT et 3 CFTC) composant un « Comité d’études économiques et sociales », consiste en une synthèse du réformisme de la CGT et de l’esprit social-catholique.
Il est parlé de la nécessité d’un « syndicat libre dans la profession organisée », qui contribuerait à « réaliser une économie dirigée à des fins anticapitalistes ».
On est là dans une soumission à l’esprit corporatiste fasciste assumant la négation de la lutte des classes :
« La lutte des classes qui a été jusqu’ici un fait plus qu’un principe ne peut disparaître que :
— Par la transformation du régime du profit.
— Par l’égalité des parties en présence dans les transactions collectives.
— Par un esprit de collaboration entre ces parties, esprit auquel devra se substituer, en cas de défaut, l’arbitrage impartial de l’État (…).
Au régime capitaliste doit succéder un régime d’économie dirigée au service de la collectivité. La notion du profit doit se substituer à celle du profit individuel. Les entreprises devront désormais être gérées suivant les directives générales d’un plan de production, sous le contrôle de l’Etat avec le concours des syndicats de techniciens et d’ouvriers. »
Cela explique la paralysie complète tant de la CGT que de la CFTC face à la Charte du travail promulgué par le régime collaborateur de Pétain en octobre 1941.
Il faudra la Résistance pour que les militants, déboussolés, parviennent à une réorganisation, dont l’expression majeure est la formation du Mouvement ouvrier français le 1er mai 1942, une structure CGT-CFTC.
Si cela est marginal dans le contexte, cela va être d’une grande signification de par l’immense impact des communistes. Ceux-ci, qui avaient été interdits par l’État en 1940 et exclus de la CGT, sont réintégrés dans celle-ci suivant les accords du Perreux d’avril 1943.
La CFTC, liée à une CGT anticommuniste et se brisant sur l’Occupation, se retrouve alors désormais liée à une CGT totalement revigorée et où les communistes jouent un grand rôle.
Cela aboutit à un Comité inter-fédéral d’entente des deux syndicats en 1944, qui publie en juillet de la même année un « Appel aux travailleurs français », en août un appel à la grève générale insurrectionnelle.
La CFTC, à la marge de l’Histoire, se voyait propulsée aux premières loges par l’intermédiaire de son alliance avec la CGT liée aux communistes… alliance effectuée à l’époque où la CGT avait exclu les communistes.
La CFTC tenta même de pousser l’initiative le plus loin possible, avec un bricolage pour fabriquer une sorte de super-syndicat à deux têtes, mais cela fut repoussé par une CGT désormais dirigée par les communistes qui comprirent la menace de parasitage généralisé et proposèrent une fusion.
Cette fusion fut bien entendu refusée par la CFTC, par deux fois. Qui plus est, la vague de syndicalisation liée à la Résistance lui permettait d’avoir une formidable base, avec 750 000 adhérents (contre 5,5 millions pour la CGT).

La CFTC, de syndicat marginal, avait ainsi d’abord profité de la massification du Front populaire, puis ensuite de celle de la Résistance, sans jamais avoir été une force motrice. Elle avait simplement su être présente au bon moment, par deux fois, en s’alignant sur la CGT.
Il va de soi que, profitant d’une telle aubaine, elle fit le choix de quitter le second congrès de la Fédération syndicale mondiale de septembre 1945, afin de participer à la reconstitution de la Confédération internationale des syndicats chrétiens.
C’était une victoire parfaite pour l’Église, et ce d’autant plus que la CFTC était reconnue comme un syndicat relevant de la Résistance.
Aux élections de la Sécurité sociale de 1947, la CFTC récolta 26,36 % des voix (soit pratiquement 1,5 million de votants) ; surtout, une nouvelle génération de cadres se formait.
Parmi eux, on a Charles Savouillan des Métaux, Fernand Hennebicq de l’Électricité, Paul Vignaux de la SGEN, qui oeuvrèrent à monter le groupe « Reconstruction », qui va être au coeur de la minorité CFTC, avec notamment les fédérations où ils oeuvrent mais également le Bâtiment et la Chimie.
->Retour au dossier De la CFTC à la CFDT